 19. De chaque bouche, avec les
dents, comme broie la maque, un pécheur, il broyait, de sorte qu’ainsi il en
tourmentait trois.
19. De chaque bouche, avec les
dents, comme broie la maque, un pécheur, il broyait, de sorte qu’ainsi il en
tourmentait trois. la gueule de Lucifer. Son circuit est le plus étroit, mais il est dominé par une figure
colossale à l’image d’un triumvirat du Mal. En huit cents ans toutefois, la
figure de Judas s’est écartée du Mal métaphysique. D’autres l’ont
remplacé : Napoléon, Hitler, Staline, Ben Laden… À la façon dont la
modernité a choisi ses stéréotypes du Mal, on est en droit de s’interroger sur la
figure même d’un personnage à la limite de la vérité historique. Qui est Judas, jadis et maintenant?
la gueule de Lucifer. Son circuit est le plus étroit, mais il est dominé par une figure
colossale à l’image d’un triumvirat du Mal. En huit cents ans toutefois, la
figure de Judas s’est écartée du Mal métaphysique. D’autres l’ont
remplacé : Napoléon, Hitler, Staline, Ben Laden… À la façon dont la
modernité a choisi ses stéréotypes du Mal, on est en droit de s’interroger sur la
figure même d’un personnage à la limite de la vérité historique. Qui est Judas, jadis et maintenant? Vie
de Jésus suscita, bien évidemment, la controverse et fut condamnée par la
papauté réactionnaire de Pie IX. Qui est donc Judas pour Renan, si Jésus, lui,
est l’«individualité parfaite»? «Les
agents des prêtres sondèrent les disciples, espérant obtenir des renseignements
utiles de leur faiblesse ou de leur simplicité. Ils trouvèrent ce qu’ils
cherchaient dans Judas de Kerioth. Ce malheureux, par des motifs impossibles à expliquer,
trahit son maître, donna toutes les indications nécessaires et se chargea même
(quoiqu’un tel excès de noirceur soit à peine croyable) de conduire la brigade
qui devait opérer l’arrestation. Le souvenir d’horreur que la sottise ou la
méchanceté de cet homme laissa dans la tradition chrétienne a dû introduire ici
quelque exagération» (E. Renan. Vie
de Jésus, Paris, Calmann-Lévy, rééd. Livre de poche, Col. Classique, #
1548-1549, s.d., p. 379). Renan est parmi les premiers à redonner à Judas une
psychologie qui dépasse la simple instrumentalisation du Mal. Il écarte les
raisons données par les évangélistes de la cupidité de Judas qui, en trahissant
Jésus, se coupait d’une source de revenu à laquelle il avait accès. La jalousie
serait un motif plus sérieux : soit qu’il ait été jaloux d’autres apôtres
favoris de Jésus; soit qu’il ait lui-même été victime de la jalousie des autres
apôtres, ce que Renan croit reconnaître dans l’Évangile de Jean. «Sans nier que Judas de Kerioth ait contribué
à l’arrestation de son maître, nous croyons donc que les malédictions dont on
le charge ont quelque chose d’injuste. Il y eut peut-être dans son fait plus de
Vie
de Jésus suscita, bien évidemment, la controverse et fut condamnée par la
papauté réactionnaire de Pie IX. Qui est donc Judas pour Renan, si Jésus, lui,
est l’«individualité parfaite»? «Les
agents des prêtres sondèrent les disciples, espérant obtenir des renseignements
utiles de leur faiblesse ou de leur simplicité. Ils trouvèrent ce qu’ils
cherchaient dans Judas de Kerioth. Ce malheureux, par des motifs impossibles à expliquer,
trahit son maître, donna toutes les indications nécessaires et se chargea même
(quoiqu’un tel excès de noirceur soit à peine croyable) de conduire la brigade
qui devait opérer l’arrestation. Le souvenir d’horreur que la sottise ou la
méchanceté de cet homme laissa dans la tradition chrétienne a dû introduire ici
quelque exagération» (E. Renan. Vie
de Jésus, Paris, Calmann-Lévy, rééd. Livre de poche, Col. Classique, #
1548-1549, s.d., p. 379). Renan est parmi les premiers à redonner à Judas une
psychologie qui dépasse la simple instrumentalisation du Mal. Il écarte les
raisons données par les évangélistes de la cupidité de Judas qui, en trahissant
Jésus, se coupait d’une source de revenu à laquelle il avait accès. La jalousie
serait un motif plus sérieux : soit qu’il ait été jaloux d’autres apôtres
favoris de Jésus; soit qu’il ait lui-même été victime de la jalousie des autres
apôtres, ce que Renan croit reconnaître dans l’Évangile de Jean. «Sans nier que Judas de Kerioth ait contribué
à l’arrestation de son maître, nous croyons donc que les malédictions dont on
le charge ont quelque chose d’injuste. Il y eut peut-être dans son fait plus de
 mala-
mala-dresse que de perversité. La conscience morale de l’homme du peuple est vive et juste, mais instable et inconsé-quente. Elle ne sait pas résister à un entraî-nement momentané. Les sociétés secrètes du parti républicain [Renan pense ici aux zélotes, groupe auquel appartenait Judas] cachaient dans leur sein beaucoup de conviction et de sincérité, et cependant les dénonciateurs y étaient fort nombreux. Un léger dépit suffisait pour faire d’un sectaire un traître. Mais, si la folle envie de quelques pièces d’argent fit tourner la tête au pauvre Judas, il ne semble pas qu’il eût complètement perdu le sentiment moral, puisque, voyant les conséquences de sa faute, il se repentit, et, dit-on, se donna la mort» (E. Renan. Ibid. p. 380). Renan donnait le ton de ce que sera pour beaucoup la figure de Judas tout au long du XXe siècle dans la littérature et dans le cinéma. Le pauvre Judas finit à peu près comme son maître : humilié (plus moralement que physiquement) et pendu (par la cou de préférence à crucifié au bois).
 l’Italien Giovanni Papini (1881-1956)
dans une Histoire du Christ plus
subjective que critique. Ce que Papini appelle le mystère de Judas est un mystère né des questionne-
l’Italien Giovanni Papini (1881-1956)
dans une Histoire du Christ plus
subjective que critique. Ce que Papini appelle le mystère de Judas est un mystère né des questionne-ments portés sur ce personnage sur lequel on n’avait eu jusqu’alors aucun doute. Comme le rappelle Papini
: «Soixante générations de chrétiens y ont rêvé, mais l’homme d’Ishkarioth, bien qu’il ait fait sur la terre des nuées de disciples, reste obstinément indéchiffré. C’est l’unique mystère humain que l’on trouve dans les Évangiles. Nous comprenons sans peine l’esprit démoniaque des Hérodes, la rancœur envieuse des Pharisiens, la rage vindicative de Hanan et de Caïphe, la lâche mollesse de Pilate. Mais nous ne comprenons pas avec une égale évidence l’ignominie de Judas. Les Quatre historiens nous parlent trop peu de lui et des raisons qui le persuadèrent de vendre son Roi» (G. Papini. Histoire du Christ, Paris, Payot, 1934, p. 293). Les historiens catholiques vont emboîter le pas à ce mystère et ils vont généralement passer en revue les mêmes hypothèses déjà posées par Papini. Quelles sont-elles?
D’abord, les Trente Deniers, ils sont structurels mieux que toute autre hypothèse à la logique de l’histoire.
 Judas est avide d’argent, avare même. Le Diable que les
Évangiles disent s’être insinué en lui serait Mammon. Mais, comme Renan l’avait
remarqué, il y avait un non-sens à cette explication, si orthodoxe soit-elle.
Et Papini d'ajouter : «Ces
réflexions du sens commun autour d’un crime aussi extraordinaire ont conduit
bien des gens, depuis les premiers temps du christianisme, à chercher d’autres
motifs à l’infâme marché. Une secte d’hérétiques, les Caïnites, imagina que
Judas, sachant que Jésus devait, de par sa propre volonté et celle du
Père, aller à la mort par trahison – pour que rien ne manquât à la torture de la
grande expiation – consentit à accepter avec douleur l’éternelle infamie pour
que tout s’accomplit. Instrument nécessaire et volontaire de la Rédemption,
Judas fut, d’après eux, héros et martyr, digne d’être vénéré et non maudit»
(G. Papini. Ibid. pp. 294-295).
Judas est avide d’argent, avare même. Le Diable que les
Évangiles disent s’être insinué en lui serait Mammon. Mais, comme Renan l’avait
remarqué, il y avait un non-sens à cette explication, si orthodoxe soit-elle.
Et Papini d'ajouter : «Ces
réflexions du sens commun autour d’un crime aussi extraordinaire ont conduit
bien des gens, depuis les premiers temps du christianisme, à chercher d’autres
motifs à l’infâme marché. Une secte d’hérétiques, les Caïnites, imagina que
Judas, sachant que Jésus devait, de par sa propre volonté et celle du
Père, aller à la mort par trahison – pour que rien ne manquât à la torture de la
grande expiation – consentit à accepter avec douleur l’éternelle infamie pour
que tout s’accomplit. Instrument nécessaire et volontaire de la Rédemption,
Judas fut, d’après eux, héros et martyr, digne d’être vénéré et non maudit»
(G. Papini. Ibid. pp. 294-295). appelé à
reconquérir l’indépendance de la Palestine. D’autres voyaient en Judas une
âme ayant perdu la foi et, par dépit, aurait trahi son Maître. Papini rappelle
également la thèse de Thomas de Quincey (1785-1859) : que c’est par excès de foi que Judas
aurait précipité les choses afin de légitimé
la mission messianique du Christ. Pour d’autres, ce serait la vengeance le
principal motif de Judas, disciple frustré de l’amour de Jésus. Des avocats
exposant la thèse circonstancielle pensent que Judas trahit sans se douter que
l’affaire irait aussi loin, bref, qu’il aurait été dépassé par les événements qu’il
avait amorcés. Pour Papini, ces «ratiocinations» s’enroulent et en réfèrent à
l’attitude de Jésus elle-même. Après tout, ne savait-il pas qui devait le
trahir depuis le début? Et cet apôtre renégat, il le nourrit de son sein, à
l’égal de tous les autres, lui confiant même la trésorerie des disciples. Jésus
«sait que Judas doit le trahir et il le
fait participer à sa divinité en lui offrant le pain et le vin; il voit
Judas guider ceux qui vont l’arrêter et il lui donne, encore une fois, comme
auparavant, et toujours, le saint nom d’ami. “Il vaudrait mieux qu’il ne fût
jamais né !” Ces paroles, plus qu’une condamnation, peuvent être un
mouvement de pitié à la
appelé à
reconquérir l’indépendance de la Palestine. D’autres voyaient en Judas une
âme ayant perdu la foi et, par dépit, aurait trahi son Maître. Papini rappelle
également la thèse de Thomas de Quincey (1785-1859) : que c’est par excès de foi que Judas
aurait précipité les choses afin de légitimé
la mission messianique du Christ. Pour d’autres, ce serait la vengeance le
principal motif de Judas, disciple frustré de l’amour de Jésus. Des avocats
exposant la thèse circonstancielle pensent que Judas trahit sans se douter que
l’affaire irait aussi loin, bref, qu’il aurait été dépassé par les événements qu’il
avait amorcés. Pour Papini, ces «ratiocinations» s’enroulent et en réfèrent à
l’attitude de Jésus elle-même. Après tout, ne savait-il pas qui devait le
trahir depuis le début? Et cet apôtre renégat, il le nourrit de son sein, à
l’égal de tous les autres, lui confiant même la trésorerie des disciples. Jésus
«sait que Judas doit le trahir et il le
fait participer à sa divinité en lui offrant le pain et le vin; il voit
Judas guider ceux qui vont l’arrêter et il lui donne, encore une fois, comme
auparavant, et toujours, le saint nom d’ami. “Il vaudrait mieux qu’il ne fût
jamais né !” Ces paroles, plus qu’une condamnation, peuvent être un
mouvement de pitié à la  pensée d’un destin inéluctable. Si Judas hait Jésus,
nous ne voyons pas qu’à aucun moment Jésus ait de l’horreur pour Judas. Car
Jésus sait que l’infâme marché de Judas est nécessaire comme seront nécessaires
la faiblesse de Pilate, la rage de Caïphe, les crachats des soldats, les
poutres et les clous de la croix. Il sait que Judas doit faire ce qu’il fait,et
il ne le maudit pas plus qu’il ne maudit le peuple qui veut sa mort ou le
marteau qui le fixe à la croix. Une seule prière lui vient aux lèvres pour
abréger l’épouvantable agonie : “Fais vite ce que tu comptes faire”»
(G. Papini. Ibid. p. 298-299).
pensée d’un destin inéluctable. Si Judas hait Jésus,
nous ne voyons pas qu’à aucun moment Jésus ait de l’horreur pour Judas. Car
Jésus sait que l’infâme marché de Judas est nécessaire comme seront nécessaires
la faiblesse de Pilate, la rage de Caïphe, les crachats des soldats, les
poutres et les clous de la croix. Il sait que Judas doit faire ce qu’il fait,et
il ne le maudit pas plus qu’il ne maudit le peuple qui veut sa mort ou le
marteau qui le fixe à la croix. Une seule prière lui vient aux lèvres pour
abréger l’épouvantable agonie : “Fais vite ce que tu comptes faire”»
(G. Papini. Ibid. p. 298-299). l’homme de la bourse, le caissier, ne se présenta pas
seulement comme délateur, il ne s’offrit pas comme sicaire, mais comme
négociant, comme vendeur de sang. Les Juifs qui s’y connaissaient bien, eux les
bouchers ordinaires du Très-Haut, égorgeurs et découpeurs de victimes, furent
les premiers et les derniers clients de Judas. La vente de Jésus fut la
première affaire du marchand improvisé : une maigre affaire en vérité,
mais enfin une vraie transaction mercantile, un contrat valide, contrat verbal mais
honnêtement observé par les contractants.
l’homme de la bourse, le caissier, ne se présenta pas
seulement comme délateur, il ne s’offrit pas comme sicaire, mais comme
négociant, comme vendeur de sang. Les Juifs qui s’y connaissaient bien, eux les
bouchers ordinaires du Très-Haut, égorgeurs et découpeurs de victimes, furent
les premiers et les derniers clients de Judas. La vente de Jésus fut la
première affaire du marchand improvisé : une maigre affaire en vérité,
mais enfin une vraie transaction mercantile, un contrat valide, contrat verbal mais
honnêtement observé par les contractants.Si Jésus n’avait pas été vendu, quelque chose aurait manqué à la parfaite ignominie de l’expiation; s’il avait été payé cher, trois cents sicles au lieu de trente, avec de l’or et non de l’argent, l’ignominie aurait été diminuée, de peu, mais diminuée. Il était écrit, de toute éternité, qu’il serait acheté, acheté à vil prix, mais de toutes façons à prix d’argent» (G. Papini. Ibid. pp. 299-300).
 ne voit en Judas que l’image obscène peinte
par Giotto : «C’était une coutume
très établie que le disciple baisât la main de son maître : le Talmud en
fait obligation. La tradition constante de l’art a cependant montré un baiser
au visage; à l’Arena de Padoue, Giotto a immortalisé le geste affreux de cette
tête bestiale, au front bas, à la grosse bouche entrouverte, le ricanement
silencieux d’un mauvais prêtre; mais rien ne permet de donner cette précision.
Baiser horrible, qui révolte, ancêtre de tous ces baisers de trahison qui sont
monnaie courante dans les amours humaines, mais qui, peut-être, avait un sens
moins ignoble, comme si, à l’instant décisif, un suprême remords avait empêché
Judas de montrer du doigt le Christ en s’écriant : “C’est lui!”»
(Daniel-Rops. Jésus en son temps, Paris,
Fayard, rééd. Livre de poche, Col. Historique, 1945, p. 406). Usant de son esprit
romanesque dont il se sert mieux que son esprit critique, l’auteur fait de la
trahison de Judas un dépit amoureux : «Là
est peut-être l’explication la plus vraie de cette âme. Cette violence ne
trahirait-elle pas un sentiment moins ignoble? Ne serait-ce pas l’amour qui
aurait été le vrai mobile, un amour non pas rayonnant, désintéressé, comme
celui de
ne voit en Judas que l’image obscène peinte
par Giotto : «C’était une coutume
très établie que le disciple baisât la main de son maître : le Talmud en
fait obligation. La tradition constante de l’art a cependant montré un baiser
au visage; à l’Arena de Padoue, Giotto a immortalisé le geste affreux de cette
tête bestiale, au front bas, à la grosse bouche entrouverte, le ricanement
silencieux d’un mauvais prêtre; mais rien ne permet de donner cette précision.
Baiser horrible, qui révolte, ancêtre de tous ces baisers de trahison qui sont
monnaie courante dans les amours humaines, mais qui, peut-être, avait un sens
moins ignoble, comme si, à l’instant décisif, un suprême remords avait empêché
Judas de montrer du doigt le Christ en s’écriant : “C’est lui!”»
(Daniel-Rops. Jésus en son temps, Paris,
Fayard, rééd. Livre de poche, Col. Historique, 1945, p. 406). Usant de son esprit
romanesque dont il se sert mieux que son esprit critique, l’auteur fait de la
trahison de Judas un dépit amoureux : «Là
est peut-être l’explication la plus vraie de cette âme. Cette violence ne
trahirait-elle pas un sentiment moins ignoble? Ne serait-ce pas l’amour qui
aurait été le vrai mobile, un amour non pas rayonnant, désintéressé, comme
celui de  Pierre et des dix autres, mais une de ces passions exclusives qui
jettent aux pires extrémités ceux que la jalousie dévore, amour proche de la
haine et qui, d’un coup, peut se trans-former en elle, mais qui ne retrouve, à
l’heure où le pire est accompli, dans la douleur sans bornes et le désespoir?»
(Daniel-Rops. Ibid. p. 387).
Bref, l'amour de Judas pourrait être teintée d'homosexualité! Daniel-Rops ne dit pas la chose clairement, mais la description nous y invite. Cela contribuerait-il au fait que Dieu ne marquera pas Judas comme il a marqué Caïn, mais livrera le Traître aux remords éternels et au désespoir qui est l’équivalent de cette
profondeur de l’enfer où Dante le place. Ceci a l’avantage d’expliquer (ou
plutôt de justifier) cela.
Pierre et des dix autres, mais une de ces passions exclusives qui
jettent aux pires extrémités ceux que la jalousie dévore, amour proche de la
haine et qui, d’un coup, peut se trans-former en elle, mais qui ne retrouve, à
l’heure où le pire est accompli, dans la douleur sans bornes et le désespoir?»
(Daniel-Rops. Ibid. p. 387).
Bref, l'amour de Judas pourrait être teintée d'homosexualité! Daniel-Rops ne dit pas la chose clairement, mais la description nous y invite. Cela contribuerait-il au fait que Dieu ne marquera pas Judas comme il a marqué Caïn, mais livrera le Traître aux remords éternels et au désespoir qui est l’équivalent de cette
profondeur de l’enfer où Dante le place. Ceci a l’avantage d’expliquer (ou
plutôt de justifier) cela. désespérer de son pardon.
Judas avait vu Jésus pardonner à des usuriers et à des prostituées, il avait
entendu de sa bouche les paraboles de la miséricorde, y compris celle de
l’enfant prodigue, il l’avait entendu commander à Pierre de pardonner septante
fois sept fois; pourtant, après tout cela, il désespère de son pardon et se
pend, tandis que Pierre après son reniement ne désespérera pas mais éclatera en
sanglots. Ce désespoir montre aussi que Judas avait pour le juste trahi par lui
une très haute estime, qui lui faisait mesurer l’horreur abyssale du crime
accomplit; mais c’était pourtant une estime incomplète et donc injurieuse,
puisque devant la responsabilité de la trahison elle s’arrêtait à mi-chemin et
croyait injurieusement Jésus incapable de pardonner au traître. Bien plus que
par la trahison de Judas, Jésus fut offensé par son désespoir : là fut
l’outrage suprême envers Jésus et la suprême iniquité commise par Judas» (J.
Ricciotti. Vie de Jésus-Christ, Paris,
Payot, Col. Bibliothèque historique, 1954, p. 585). Ricciotti s’engage ensuite
dans une évaluation des Trente deniers qui lui apparaissent non pas une somme
dérisoire, mais bien une petite fortune en conversion actuelle. Évidemment,
tout cela repose sur des spéculations monétaires. Le chiffre de trente
(deniers) étant, comme je l'ai dit plus haut, plus marquant de la bassesse du geste que dire 128 francs-or!
désespérer de son pardon.
Judas avait vu Jésus pardonner à des usuriers et à des prostituées, il avait
entendu de sa bouche les paraboles de la miséricorde, y compris celle de
l’enfant prodigue, il l’avait entendu commander à Pierre de pardonner septante
fois sept fois; pourtant, après tout cela, il désespère de son pardon et se
pend, tandis que Pierre après son reniement ne désespérera pas mais éclatera en
sanglots. Ce désespoir montre aussi que Judas avait pour le juste trahi par lui
une très haute estime, qui lui faisait mesurer l’horreur abyssale du crime
accomplit; mais c’était pourtant une estime incomplète et donc injurieuse,
puisque devant la responsabilité de la trahison elle s’arrêtait à mi-chemin et
croyait injurieusement Jésus incapable de pardonner au traître. Bien plus que
par la trahison de Judas, Jésus fut offensé par son désespoir : là fut
l’outrage suprême envers Jésus et la suprême iniquité commise par Judas» (J.
Ricciotti. Vie de Jésus-Christ, Paris,
Payot, Col. Bibliothèque historique, 1954, p. 585). Ricciotti s’engage ensuite
dans une évaluation des Trente deniers qui lui apparaissent non pas une somme
dérisoire, mais bien une petite fortune en conversion actuelle. Évidemment,
tout cela repose sur des spéculations monétaires. Le chiffre de trente
(deniers) étant, comme je l'ai dit plus haut, plus marquant de la bassesse du geste que dire 128 francs-or! là, en attente que Jésus
ordonne le mouvement de foule vers les places fortes de Jérusalem. Mais voici
que Jésus se dérobe. Du dépit amoureux nous passons au dépit politique : «Nous savons que Jésus n’était pas un lâche,
il devait le prouver tout au long de cette semaine sinistre. Judas était
violemment désireux de la victoire charnelle, son jugement passionné se porta
sans doute à cette extrémité, de considérer ce retour à Béthanie comme une
fuite honteuse, ce dont il avait toutes les apparences. Jésus était si
courageux qu’il lui était indifférent de passer pour un lâche, et cette
indifférence est une extrémité de courage» (R.-L. Bruckberger. L’Histoire de Jésus Christ, Paris,
Grasset, rééd. Livre de poche, # 2884, 1965, pp. 358-359). Bruckberger n’osera
pas s’avancer aussi loin que ses prédécesseurs :
là, en attente que Jésus
ordonne le mouvement de foule vers les places fortes de Jérusalem. Mais voici
que Jésus se dérobe. Du dépit amoureux nous passons au dépit politique : «Nous savons que Jésus n’était pas un lâche,
il devait le prouver tout au long de cette semaine sinistre. Judas était
violemment désireux de la victoire charnelle, son jugement passionné se porta
sans doute à cette extrémité, de considérer ce retour à Béthanie comme une
fuite honteuse, ce dont il avait toutes les apparences. Jésus était si
courageux qu’il lui était indifférent de passer pour un lâche, et cette
indifférence est une extrémité de courage» (R.-L. Bruckberger. L’Histoire de Jésus Christ, Paris,
Grasset, rééd. Livre de poche, # 2884, 1965, pp. 358-359). Bruckberger n’osera
pas s’avancer aussi loin que ses prédécesseurs : On s’embrasse beaucoup en Orient, et il est probable que le
geste de Judas lui était coutumier. Mais c’est la seule fois que les Évangiles
prennent la peine de noter que Jésus ait reçu un baiser sur la face :
c’est devenu éternellement “le baiser de Judas”. Marie-Madeleine avait baisé
seulement les pieds de Jésus. En tout cas, ce baiser de Judas est le dernier
que Jésus ait reçu avant de mourir. Après ce baiser fatal, les hommes, ses
frères, ne lui donneront plus que des crachats, des gifles et des coups.
On s’embrasse beaucoup en Orient, et il est probable que le
geste de Judas lui était coutumier. Mais c’est la seule fois que les Évangiles
prennent la peine de noter que Jésus ait reçu un baiser sur la face :
c’est devenu éternellement “le baiser de Judas”. Marie-Madeleine avait baisé
seulement les pieds de Jésus. En tout cas, ce baiser de Judas est le dernier
que Jésus ait reçu avant de mourir. Après ce baiser fatal, les hommes, ses
frères, ne lui donneront plus que des crachats, des gifles et des coups. cette
opération nocturne qui complique tout? Pourquoi cette volte-face de la
population si enthou-siaste aupara-
cette
opération nocturne qui complique tout? Pourquoi cette volte-face de la
population si enthou-siaste aupara-vant à fêter l’entrée de Jésus à Jérusalem?» (G. Mordillat et J. Prieur. Ibid. p. 326). Et que dire aujourd’hui du fameux «baiser de Judas»? «“Or, le traître leur avait donné ce signe convenu : ‘Celui à qui je donnerai un baiser, c’est lui; arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde.’ Et aussitôt arrivé, il s’approcha de lui en disant : ‘Rabbi’, et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l’arrêtèrent” (Mc 14, 44-46). En quoi faut-il un signal de reconnaissance pour identifier Jésus dont les évangélistes vantent sans cesse la célébrité? On a pu conjecturer que les disciples, uniformément vêtus, se ressemblaient tous et qu’il fallut bien un geste pour distinguer Jésus au milieu d’eux. N’est-ce pas là aussi la marque usuelle du respect des disciples envers leur rabbi? Mais jamais chez Marc ni même chez les autres évangélistes, les disciples n’embrassent Jésus» (G. Mordillat et J. Prieur. Ibid. p. 327).
C’est en partant de cette scène, et là encore avec la célèbre fresque de Giotto, que nos deux auteurs ramènent le doppelgänger dans la constitution du parricide. «Dans ce baiser, Judas et Jésus font corps, comme si un archétype était en jeu, comme si, irréductiblement, Jésus faisait couple avec son traître. Comme si (hormis Jésus) Judas était, dans le christianisme, la seule et unique trace de l’ambivalence
 qui caractérise
toujours le sacré, une exception. “Dans le sacrifice chrétien, la
responsa-bilité du sacrifice n’est pas donnée dans la volonté du fidèle. Le
fidèle ne contribue au sacrifice de la croix que dans la mesure de ses
manquements, de ses péchés. De ce fait, écrit Georges Bataille dans son essai
sur l’érotisme, l’unité de la sphère sacrée est brisée. Au stade païen de la
religion, la transgression fondait le sacré dont les aspects impurs n’étaient
pas moins sacrés que les aspects contraires. L’ensemble de la sphère sacrée se
composait du pur et de l’impur. Le christianisme rejeta l’impureté. Il rejeta
la culpabilité, sans laquelle le sacré n’est pas concevable, puisque seule la
violation de l’interdit ouvre l’accès” (G. Mordillat et J. Prieur. Ibid. pp. 327-328). Qu’importe
finalement que Jésus ait choisi son destin ou non, le baiser de Judas ramène,
pour un instant, les doubles à une confrontation unique. C’est le méchant
William Wilson qui condamne le bon et le tue dans le conte de Poe. Ce
geste reprend le meurtre d’Abel et cette fois-ci Judas, comme je l’ai dit,
n’aura pas la consolation, ou ne l’entendra pas, qui est le pardon de l’agneau
sacrifié qui prend le poids du péché du sacrificateur sur ses épaules, et le
console d’avoir été l’instrument de Sa volonté. Véritable relation masochiste où Jésus se sert de Judas comme de son instrument sadique.
qui caractérise
toujours le sacré, une exception. “Dans le sacrifice chrétien, la
responsa-bilité du sacrifice n’est pas donnée dans la volonté du fidèle. Le
fidèle ne contribue au sacrifice de la croix que dans la mesure de ses
manquements, de ses péchés. De ce fait, écrit Georges Bataille dans son essai
sur l’érotisme, l’unité de la sphère sacrée est brisée. Au stade païen de la
religion, la transgression fondait le sacré dont les aspects impurs n’étaient
pas moins sacrés que les aspects contraires. L’ensemble de la sphère sacrée se
composait du pur et de l’impur. Le christianisme rejeta l’impureté. Il rejeta
la culpabilité, sans laquelle le sacré n’est pas concevable, puisque seule la
violation de l’interdit ouvre l’accès” (G. Mordillat et J. Prieur. Ibid. pp. 327-328). Qu’importe
finalement que Jésus ait choisi son destin ou non, le baiser de Judas ramène,
pour un instant, les doubles à une confrontation unique. C’est le méchant
William Wilson qui condamne le bon et le tue dans le conte de Poe. Ce
geste reprend le meurtre d’Abel et cette fois-ci Judas, comme je l’ai dit,
n’aura pas la consolation, ou ne l’entendra pas, qui est le pardon de l’agneau
sacrifié qui prend le poids du péché du sacrificateur sur ses épaules, et le
console d’avoir été l’instrument de Sa volonté. Véritable relation masochiste où Jésus se sert de Judas comme de son instrument sadique. Paris,
Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, pp. 720-721). Le théologien Léon-Dufour va
même plus loin encore : «“Mieux eût
valu pour cet homme-là de ne pas naître.” Ce qui selon Xavier Léon-Dufour, ne
doit en aucun cas être interprété comme la damnation de Judas, ni même comme
une malédiction, mais simplement comme l’expression d’une sympathie douloureuse
éprouvée par Jésus devant une terrible faute. Ne pas avoir vu le jour eût été
plus enviable. Jésus ne maudit pas Judas, il reconnaît qu’il est malheureux»
(C. Soullard. Judas, Paris, Éditions
Autrement, Col. Figures mythiques, 1999, p. 27). Quand on sait que lorsque Mussolini tenta de rejoindre l'armée allemande dans les Alpes, se disant trahi par le Parti National Fasciste et les Italiens, il traînait avec lui un exemplaire de la Vie de Jésus-Christ de Ricciotti, on peut se demander quelle méditation il en tira, ignorant qu'il allait finir lui aussi pendu, une fois mort cependant, par les pieds à une station service!
Paris,
Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, pp. 720-721). Le théologien Léon-Dufour va
même plus loin encore : «“Mieux eût
valu pour cet homme-là de ne pas naître.” Ce qui selon Xavier Léon-Dufour, ne
doit en aucun cas être interprété comme la damnation de Judas, ni même comme
une malédiction, mais simplement comme l’expression d’une sympathie douloureuse
éprouvée par Jésus devant une terrible faute. Ne pas avoir vu le jour eût été
plus enviable. Jésus ne maudit pas Judas, il reconnaît qu’il est malheureux»
(C. Soullard. Judas, Paris, Éditions
Autrement, Col. Figures mythiques, 1999, p. 27). Quand on sait que lorsque Mussolini tenta de rejoindre l'armée allemande dans les Alpes, se disant trahi par le Parti National Fasciste et les Italiens, il traînait avec lui un exemplaire de la Vie de Jésus-Christ de Ricciotti, on peut se demander quelle méditation il en tira, ignorant qu'il allait finir lui aussi pendu, une fois mort cependant, par les pieds à une station service! occidentale, ainsi l’idée exprimée par l’auteur russe
Volochine en 1929 : «Pour moi, Judas
est la nation juive, qui, en tant que plus ancien apôtre du Christ, a pris sur
lui tous les maux du monde» (Cité in P.-E. Dauzat. Judas, Paris, Perrin, Col. Tempus, # 240, 2008, p. 200). Bien sûr,
l’antisémitisme, qu’il soit de la civilisation chrétienne occidentale ou de la
chrétienne orientale, a toujours associé Judas à l’ensemble du peuple déicide. Dès la dernière décennie du XIXe
siècle, le nom de Judas se trouva fracturé d'une bilocation entre le
Judas-Dreyfus, et les Judas-antidreyfusards appelés à devenir les Collabos de
1940. En Allemagne, on retrouvait le Judas-Kautsky qui avait vendu, avec la
social-démocratie allemande, le Lénine christique qui montrait la nouvelle voie bolchevique
du communisme. Le Judas-Trotsky devint le prétexte aux monstrueux procès de
Moscou alors que le Judas-Blum faisait triompher, pour un court laps de temps,
le Front Populaire : «Après Jeanne
d’Arc, Judas. Blum, tu es notre avilissement. Je te hais», lançait
Jean-Charles Legrand en 1938. Étrange association. «Chez Cioran, qui se veut subversif, l’ambivalence est pour le moins
appuyée jusque dans la très controversée Transfiguration de la
Roumanie : “Si j’étais juif, je me
suiciderais sur-le-champ”, lance-t-il après avoir évoqué la malédiction qui
s’acharne sur les Juifs et dont Dieu seul est
occidentale, ainsi l’idée exprimée par l’auteur russe
Volochine en 1929 : «Pour moi, Judas
est la nation juive, qui, en tant que plus ancien apôtre du Christ, a pris sur
lui tous les maux du monde» (Cité in P.-E. Dauzat. Judas, Paris, Perrin, Col. Tempus, # 240, 2008, p. 200). Bien sûr,
l’antisémitisme, qu’il soit de la civilisation chrétienne occidentale ou de la
chrétienne orientale, a toujours associé Judas à l’ensemble du peuple déicide. Dès la dernière décennie du XIXe
siècle, le nom de Judas se trouva fracturé d'une bilocation entre le
Judas-Dreyfus, et les Judas-antidreyfusards appelés à devenir les Collabos de
1940. En Allemagne, on retrouvait le Judas-Kautsky qui avait vendu, avec la
social-démocratie allemande, le Lénine christique qui montrait la nouvelle voie bolchevique
du communisme. Le Judas-Trotsky devint le prétexte aux monstrueux procès de
Moscou alors que le Judas-Blum faisait triompher, pour un court laps de temps,
le Front Populaire : «Après Jeanne
d’Arc, Judas. Blum, tu es notre avilissement. Je te hais», lançait
Jean-Charles Legrand en 1938. Étrange association. «Chez Cioran, qui se veut subversif, l’ambivalence est pour le moins
appuyée jusque dans la très controversée Transfiguration de la
Roumanie : “Si j’étais juif, je me
suiciderais sur-le-champ”, lance-t-il après avoir évoqué la malédiction qui
s’acharne sur les Juifs et dont Dieu seul est  respon-
respon-sable. Et trente ans plus tard : “Tous les peuples sont maudits. Le peuple juif l’est plus que les autres. Sa malé-
diction est automatique, sans lacunes. Elle va de soi”…» (P.-E. Dauzat. Ibid. p. 261). La malédiction du Juif Judas se diffuse dans toute sa race. «…en 1946, c’est-à-dire alors qu’on n’ignorait plus rien de l’Holocauste, “l’historien chrétien” Daniel-Rops reprendra en écho cette légende avec ces mots abjects tirés de son Histoire sainte : “Les Juifs avaient crié : ‘Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants!' Dans sa justice, Dieu les a exaucés”. Et d’ajouter que les persécutions des Juifs ne feront jamais oublier leur manque de compassion pour le Crucifié» (P.-E. Dauzat. Ibid. p. 313). Le cardinal Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, devait pardonner aux Juifs comme aux Romains la mort de Jésus puisqu’ils agissaient dans une non-liberté, étant les instruments de Dieu. Évidemment ce «pardon» venait trop tard, l’antisémitisme étant depuis longtemps passé de l’anti-judaïsme à l’anthropologie raciale.
 effet de le tirer de la
position monstrueuse qu’on lui découvre en enfer. Le XXe siècle fut au siècle de trahisons
inouïes, de ces assassinats de masse, de ces guerres génocidaires, et la folie meurtrière qui s'empara du monde fit en sorte de décrocher Judas de sa mauvaise posture de pendu pour enfin trouver compassion auprès des hommes qui avaient tant de crimes à se faire pardonner. Mais Brutus? Mais Cassius? Que viennent-ils faire dans cette galère?
effet de le tirer de la
position monstrueuse qu’on lui découvre en enfer. Le XXe siècle fut au siècle de trahisons
inouïes, de ces assassinats de masse, de ces guerres génocidaires, et la folie meurtrière qui s'empara du monde fit en sorte de décrocher Judas de sa mauvaise posture de pendu pour enfin trouver compassion auprès des hommes qui avaient tant de crimes à se faire pardonner. Mais Brutus? Mais Cassius? Que viennent-ils faire dans cette galère? devait l’éloigner de
Freud, Métamorphose de l’âme et ses
symboles, se penche sur un roman de Anatole France racontant l’histoire de
l’abbé Œgger obsédé par la damnation de Judas et qui, au cours d’une intense
prière, est averti par un signe que Dieu a pardonné à Judas. Ce qui l’amène à
vouloir prêcher l’Évangile de l’infinie
miséricorde de Dieu. Jung enchaîne aussitôt avec l’analyse d’usage.
devait l’éloigner de
Freud, Métamorphose de l’âme et ses
symboles, se penche sur un roman de Anatole France racontant l’histoire de
l’abbé Œgger obsédé par la damnation de Judas et qui, au cours d’une intense
prière, est averti par un signe que Dieu a pardonné à Judas. Ce qui l’amène à
vouloir prêcher l’Évangile de l’infinie
miséricorde de Dieu. Jung enchaîne aussitôt avec l’analyse d’usage. entourage. Le touchant et le tragique de ce mythe
viennent de ce que ce n’est pas dans un combat loyal que tombe le héros, mais à
la suite d’une trahison. C’est là aussi un événement fréquent dans
l’histoire : ainsi César et Brutus par exemple. Le mythe d’un tel acte
remonte à la plus lointaine antiquité, mais il reste le sujet de récits
continuellement nouveaux. C’est ainsi que s’exprime le fait que la jalousie
empêche l’homme de dormir en paix. Voici la règle qu’il faut appliquer à la
tradition mythique d’une façon générale : ce ne sont pas les récits
d’événements anciens quelconques qui se perpétuent, mais uniquement ceux qui
traduisent une idée générale humaine et qui se rajeunit éternellement et
continuellement. La vie et les exploits des héros culturels et fondateurs de
religions par exemple sont les plus pures condensations» (C.-G. Jung. Métamorphoses de l’âme et ses symboles, Paris,
Georg, rééd. Livre de poche, Col. Références, # 0438, 1993, p. 84).
entourage. Le touchant et le tragique de ce mythe
viennent de ce que ce n’est pas dans un combat loyal que tombe le héros, mais à
la suite d’une trahison. C’est là aussi un événement fréquent dans
l’histoire : ainsi César et Brutus par exemple. Le mythe d’un tel acte
remonte à la plus lointaine antiquité, mais il reste le sujet de récits
continuellement nouveaux. C’est ainsi que s’exprime le fait que la jalousie
empêche l’homme de dormir en paix. Voici la règle qu’il faut appliquer à la
tradition mythique d’une façon générale : ce ne sont pas les récits
d’événements anciens quelconques qui se perpétuent, mais uniquement ceux qui
traduisent une idée générale humaine et qui se rajeunit éternellement et
continuellement. La vie et les exploits des héros culturels et fondateurs de
religions par exemple sont les plus pures condensations» (C.-G. Jung. Métamorphoses de l’âme et ses symboles, Paris,
Georg, rééd. Livre de poche, Col. Références, # 0438, 1993, p. 84). 84). Du moine Jacques Clément
qui assassina le roi de France Henri III à Lee Harvey Oswald, les assassins politiques sont tués pour la plupart du temps aussitôt leur crime commis. Les assassins qui furent liquidés après avoir porté le coup homicide sont nombreux au cours de l’histoire. Mais dans la mesure où César s’était
approprié la figure divine et donné les insignes de la royauté, le tribut du sang qui fut porté sur la tête de Brutus et de Cassius, fut reporté sine die, plusieurs années après le crime et dans le contexte des luttes civiles à Rome. Aussi, la question que nous sommes en droit de nous poser, en rapport avec le poème de Dante, comment se fait-il que ces deux récits partagent une même valeur psychologique pour l’Imaginaire historique du poète florentin?
84). Du moine Jacques Clément
qui assassina le roi de France Henri III à Lee Harvey Oswald, les assassins politiques sont tués pour la plupart du temps aussitôt leur crime commis. Les assassins qui furent liquidés après avoir porté le coup homicide sont nombreux au cours de l’histoire. Mais dans la mesure où César s’était
approprié la figure divine et donné les insignes de la royauté, le tribut du sang qui fut porté sur la tête de Brutus et de Cassius, fut reporté sine die, plusieurs années après le crime et dans le contexte des luttes civiles à Rome. Aussi, la question que nous sommes en droit de nous poser, en rapport avec le poème de Dante, comment se fait-il que ces deux récits partagent une même valeur psychologique pour l’Imaginaire historique du poète florentin? romaniste néo-zélandais, n’écrivait-il pas : «Il
est vraiment trop facile de qualifier les assassins d’adeptes fanatiques des
théories grecques sur la vertu supérieure du tyrannicide, aveugles à la vraie
nature des mots d’ordre politiques et aux besoins pressants de l’État romain.
Le caractère et les visées de Marcus Brutus, la figure représentative de la
conspiration, pourraient prêter de la vraisemblance à une telle théorie. Il
n’est cependant nullement évident que le tempérament de Brutus eût été vraiment
autre s’il n’avait jamais ouvert un traité philosophique du Portique ou de
l’Académie. D’ailleurs, l’initiateur du complot, le froid et militaire Cassius,
était épicurien de conviction, et nullement fanatique. Quant aux principes
stoïciens, ils pouvaient fonder des doctrines qui répugnaient tout à fait à des
Romains républicains, c’est-à-dire la monarchie ou la fraternité humaine.
L’enseignement du stoïcisme, en fait, n’était rien de plus qu’une confirmation
et qu’une défense théorique de certaines vertus traditionnelles de la classe
gouvernante dans un État aristocratique et républicain» (R. Syme. La révolution romaine, Paris, Gallimard,
Col. Tel, #32, 1967, p. 64). Cassius épicurien et Brutus stoïcien, disciples tous deux du
vieux Caton et de la virtus : «Aux yeux de ses contemporains Marcus Brutus,
ferme de caractère, droit et loyal, de manières austères et retenues, semblait
incarner
romaniste néo-zélandais, n’écrivait-il pas : «Il
est vraiment trop facile de qualifier les assassins d’adeptes fanatiques des
théories grecques sur la vertu supérieure du tyrannicide, aveugles à la vraie
nature des mots d’ordre politiques et aux besoins pressants de l’État romain.
Le caractère et les visées de Marcus Brutus, la figure représentative de la
conspiration, pourraient prêter de la vraisemblance à une telle théorie. Il
n’est cependant nullement évident que le tempérament de Brutus eût été vraiment
autre s’il n’avait jamais ouvert un traité philosophique du Portique ou de
l’Académie. D’ailleurs, l’initiateur du complot, le froid et militaire Cassius,
était épicurien de conviction, et nullement fanatique. Quant aux principes
stoïciens, ils pouvaient fonder des doctrines qui répugnaient tout à fait à des
Romains républicains, c’est-à-dire la monarchie ou la fraternité humaine.
L’enseignement du stoïcisme, en fait, n’était rien de plus qu’une confirmation
et qu’une défense théorique de certaines vertus traditionnelles de la classe
gouvernante dans un État aristocratique et républicain» (R. Syme. La révolution romaine, Paris, Gallimard,
Col. Tel, #32, 1967, p. 64). Cassius épicurien et Brutus stoïcien, disciples tous deux du
vieux Caton et de la virtus : «Aux yeux de ses contemporains Marcus Brutus,
ferme de caractère, droit et loyal, de manières austères et retenues, semblait
incarner  cet idéal de caractère, admiré de ceux qui ne se souciaient pas de
l’imiter. Ce n’était pas une personnalité simple, mais passionnée, excessive et
renfermée. Et l’on ne pouvait prévoir exactement quelle serait sa conduite
politique, Brutus aurait pu être aussi bien un Césarien – ni lui ni César
n’étaient des partisans prédestinés de Pompée. Servilia éleva son fils dans la
haine de Pompée, projeta une alliance avec César et décida que Brutus
épouserait la fille de César. Son plan fut anéanti par le tour que prirent les
événements pendant le fatal consulat de Metellus. Pompée mit la main sur
César : Julie, la fiancée prévue pour Brutus, scella l’alliance. Ensuite,
les chemins de Brutus et de César s’écartèrent largement…» (R. Syme. Ibid. p. 65).
cet idéal de caractère, admiré de ceux qui ne se souciaient pas de
l’imiter. Ce n’était pas une personnalité simple, mais passionnée, excessive et
renfermée. Et l’on ne pouvait prévoir exactement quelle serait sa conduite
politique, Brutus aurait pu être aussi bien un Césarien – ni lui ni César
n’étaient des partisans prédestinés de Pompée. Servilia éleva son fils dans la
haine de Pompée, projeta une alliance avec César et décida que Brutus
épouserait la fille de César. Son plan fut anéanti par le tour que prirent les
événements pendant le fatal consulat de Metellus. Pompée mit la main sur
César : Julie, la fiancée prévue pour Brutus, scella l’alliance. Ensuite,
les chemins de Brutus et de César s’écartèrent largement…» (R. Syme. Ibid. p. 65). s’abreuvaient aussi bien des
références ancestrales que de l’opportunisme : «Brutus et ses alliés pouvaient invoquer la philosophie ou un ancêtre
qui avait libéré Rome des Tarquins, le premier consul de la République et le
fondateur de la Libertas. Histoire
incertaine – et étrangère à la question. Les Libérateurs savaient ce qu’ils
voulaient. Si des hommes honorables saisissaient le poignard de l’assassin pour
tuer un aristocrate romain, un ami et un bienfaiteur, ils avaient de meilleures
raisons. Ils défendaient non seulement les traditions et les institutions de
l’État républicain, mais très précisément la dignité et les intérêts de leur
ordre. La liberté et les lois étaient des mots de fière résonance. À juger
froidement, ils peuvent se traduire souvent par privilèges et intérêts établis»
(R. Syme. Ibid. pp. 65-66). Or c’est
précisément ce à quoi s’était attaqué l’absolutisme césarien : «Tutelle tribunicienne des assemblées,
recommandation – commendatio –
obligatoire des candidats, adlectio des
Patres, commissions préfectorales, et
imperium infinitum sur les armées et
les provinces, telles sont les réalités sur lesquelles les empereurs édifièrent
leur monarchie. Mais c’est à bon droit qu’ils ont tous pris le nom de César,
car c’est à César qu’en remontent la découverte et l’emploi. Par lui, grâce à
s’abreuvaient aussi bien des
références ancestrales que de l’opportunisme : «Brutus et ses alliés pouvaient invoquer la philosophie ou un ancêtre
qui avait libéré Rome des Tarquins, le premier consul de la République et le
fondateur de la Libertas. Histoire
incertaine – et étrangère à la question. Les Libérateurs savaient ce qu’ils
voulaient. Si des hommes honorables saisissaient le poignard de l’assassin pour
tuer un aristocrate romain, un ami et un bienfaiteur, ils avaient de meilleures
raisons. Ils défendaient non seulement les traditions et les institutions de
l’État républicain, mais très précisément la dignité et les intérêts de leur
ordre. La liberté et les lois étaient des mots de fière résonance. À juger
froidement, ils peuvent se traduire souvent par privilèges et intérêts établis»
(R. Syme. Ibid. pp. 65-66). Or c’est
précisément ce à quoi s’était attaqué l’absolutisme césarien : «Tutelle tribunicienne des assemblées,
recommandation – commendatio –
obligatoire des candidats, adlectio des
Patres, commissions préfectorales, et
imperium infinitum sur les armées et
les provinces, telles sont les réalités sur lesquelles les empereurs édifièrent
leur monarchie. Mais c’est à bon droit qu’ils ont tous pris le nom de César,
car c’est à César qu’en remontent la découverte et l’emploi. Par lui, grâce à
 elles, les anciennes formes républicaines, comices, magistratures, Sénat, et
gouvernements, qui semblent subsister encore, ont été vidées de leur contenu,
plantées sur la scène de l’histoire comme un décor en trompe-l’œil où ne se
déploient plus qu’une pensée et qu’une volonté : les siennes. Indifférent à
la sourde rancune des ennemis qu’il a brisés et qui ne sauraient plus se
réfugier que dans la stérilité de regrets inavouables, dédaigneux de conseils
dont il n’a que faire, en pleine possession de ses forces et de ses idées, il
ne demande aux hommes que de le servir, aux institutions que de refléter et de
transmettre sa domination» (J. Carcopino. Jules César, Paris, P.U.F. Col. Hier, 1968 (1935), p. 491). César
avait fait son œuvre de déconstruction de l'esprit républicain à défaut d'en abolir, comme les fascistes le firent avec la démocratie, les institutions maintenant fossilisées, et l’assassinat des Ides de mars ne
changera rien sinon que de prolonger la guerre civile, rétablir
un second triumvirat qui sera encore plus désastreux que le premier, mais
d'où sortira le principat d’Octave Auguste,
héritier de la politique de César.
elles, les anciennes formes républicaines, comices, magistratures, Sénat, et
gouvernements, qui semblent subsister encore, ont été vidées de leur contenu,
plantées sur la scène de l’histoire comme un décor en trompe-l’œil où ne se
déploient plus qu’une pensée et qu’une volonté : les siennes. Indifférent à
la sourde rancune des ennemis qu’il a brisés et qui ne sauraient plus se
réfugier que dans la stérilité de regrets inavouables, dédaigneux de conseils
dont il n’a que faire, en pleine possession de ses forces et de ses idées, il
ne demande aux hommes que de le servir, aux institutions que de refléter et de
transmettre sa domination» (J. Carcopino. Jules César, Paris, P.U.F. Col. Hier, 1968 (1935), p. 491). César
avait fait son œuvre de déconstruction de l'esprit républicain à défaut d'en abolir, comme les fascistes le firent avec la démocratie, les institutions maintenant fossilisées, et l’assassinat des Ides de mars ne
changera rien sinon que de prolonger la guerre civile, rétablir
un second triumvirat qui sera encore plus désastreux que le premier, mais
d'où sortira le principat d’Octave Auguste,
héritier de la politique de César. l’oligarchie» et «la promotion donnée au mérite» (R. Syme.
Op. cit. p. 96). En retour, César,
dès l’an 47, «réunit à sa dignité de
grand pontife celle de l’augurat dont l’emblème figurera au revers de ses
monnaies ; et il se hausse à la monarchie par les degrés de sa
divinisation» (J. Carcopino. Op. cit. p. 555). C’est-à-dire qu’en tuant le
monarque, Brutus et Cassius commettaient de facto un «déicide», et le fait qu'ils n'en éprouvèrent ni la honte ni les remords et que le peuple romain s'assembla pour aller écouter leurs discours le lendemain de l'assassinat, montre que l'attachement religieux à César n'était pas encore accompli. Judas aussi, en sacrifiant le Dieu vivant, allait commettre un acte comparable puisque, de la bouche de Jésus à Pilate, ne se reconnaissait-il pas lui-même être le Roi des Juifs? Certes, le divus
Iulius n'accéda pas au statut de la divinité sur le même modèle que le Christ :
l’oligarchie» et «la promotion donnée au mérite» (R. Syme.
Op. cit. p. 96). En retour, César,
dès l’an 47, «réunit à sa dignité de
grand pontife celle de l’augurat dont l’emblème figurera au revers de ses
monnaies ; et il se hausse à la monarchie par les degrés de sa
divinisation» (J. Carcopino. Op. cit. p. 555). C’est-à-dire qu’en tuant le
monarque, Brutus et Cassius commettaient de facto un «déicide», et le fait qu'ils n'en éprouvèrent ni la honte ni les remords et que le peuple romain s'assembla pour aller écouter leurs discours le lendemain de l'assassinat, montre que l'attachement religieux à César n'était pas encore accompli. Judas aussi, en sacrifiant le Dieu vivant, allait commettre un acte comparable puisque, de la bouche de Jésus à Pilate, ne se reconnaissait-il pas lui-même être le Roi des Juifs? Certes, le divus
Iulius n'accéda pas au statut de la divinité sur le même modèle que le Christ : char processionnel ou tensa, pour les défilés rituels du Grand Cirque; une table d’offrandes,
ou ferculum, et un lit de parade ou pulvinar
dans les lectisternes; un fronton
au-dessus de sa demeure; le service d’un flamine et, finalement,
l’inauguration de deux statues cultuelles : la première dans le temple de
Quirinus, non pour parer l’édifice, mais pour accompagner fraternellement
le dieu dont César devient ainsi le copain – contubernalis – comme plaisante Cicéron en se félicitant
avec une ironie féroce de savoir César associé à Quirinus, et non à Salus, la
déesse de la santé; la seconde, plus tard, dans le temple de la Clémence,
de plain-pied avec celle de cette vertu divine, la main de l’une dans celle de
l’autre. Alors, ayant tout d’un dieu, César en assume la dénomination. En
Italie même, de simples particuliers, dans un élan de reconnaissance, l’avaient
spontanément inscrite sur la pierre, tel ce bourgeois de Nole, qui, nommé
duumvir de son municipe par la grâce de César, n’a rien trouvé de mieux pour le
remercier. Le Sénat la lui impose officiellement au début de 44 et César ne la refuse
pas. On a suspecté le témoignage de Dion à cet égard, parce Dion dénomme le
nouveau dieu, Zeus Ioulios,
char processionnel ou tensa, pour les défilés rituels du Grand Cirque; une table d’offrandes,
ou ferculum, et un lit de parade ou pulvinar
dans les lectisternes; un fronton
au-dessus de sa demeure; le service d’un flamine et, finalement,
l’inauguration de deux statues cultuelles : la première dans le temple de
Quirinus, non pour parer l’édifice, mais pour accompagner fraternellement
le dieu dont César devient ainsi le copain – contubernalis – comme plaisante Cicéron en se félicitant
avec une ironie féroce de savoir César associé à Quirinus, et non à Salus, la
déesse de la santé; la seconde, plus tard, dans le temple de la Clémence,
de plain-pied avec celle de cette vertu divine, la main de l’une dans celle de
l’autre. Alors, ayant tout d’un dieu, César en assume la dénomination. En
Italie même, de simples particuliers, dans un élan de reconnaissance, l’avaient
spontanément inscrite sur la pierre, tel ce bourgeois de Nole, qui, nommé
duumvir de son municipe par la grâce de César, n’a rien trouvé de mieux pour le
remercier. Le Sénat la lui impose officiellement au début de 44 et César ne la refuse
pas. On a suspecté le témoignage de Dion à cet égard, parce Dion dénomme le
nouveau dieu, Zeus Ioulios,  Jupiter Julius, ce qui, à la lettre, serait, en
effet, trop fort pour être vraisemblable. Mais Dion est un Grec, dont la langue
ne dispose pour deus et divu, que
d’un vocable (Theos), et pour qui, au
surplus, Zeus Ioulios est un euphémisme pour deus ou plutôt divus Iulius, tout
de même que pour les gens de Mitylène qui, vers la même époque, appelèrent leur
illustre compatriote Théophane, admis par eux aux honneurs divins, du nom de
Zeus Theophanes. Aussi bien les gens d’Aesernia n’ont-ils dû consacrer que du
vivant de César leur ex-voto Genio divi Daesaris, et puisque le culte de César mort n’a été institué qu’en 42, c’est le
culte de divus Iulius en chair et en
os que Cicéron, dans sa deuxième Philippique, peu après le 19 septembre 44, blâme Antoine d’avoir cyniquement négligé»
(J. Carcopino. Op. cit. pp. 556-557).
Jupiter Julius, ce qui, à la lettre, serait, en
effet, trop fort pour être vraisemblable. Mais Dion est un Grec, dont la langue
ne dispose pour deus et divu, que
d’un vocable (Theos), et pour qui, au
surplus, Zeus Ioulios est un euphémisme pour deus ou plutôt divus Iulius, tout
de même que pour les gens de Mitylène qui, vers la même époque, appelèrent leur
illustre compatriote Théophane, admis par eux aux honneurs divins, du nom de
Zeus Theophanes. Aussi bien les gens d’Aesernia n’ont-ils dû consacrer que du
vivant de César leur ex-voto Genio divi Daesaris, et puisque le culte de César mort n’a été institué qu’en 42, c’est le
culte de divus Iulius en chair et en
os que Cicéron, dans sa deuxième Philippique, peu après le 19 septembre 44, blâme Antoine d’avoir cyniquement négligé»
(J. Carcopino. Op. cit. pp. 556-557). consumait l’âme tourmentée du
gendre du martyr, Marcus Iunius Brutus,le fils de cette Servilia que César
avait aimée et du démocrate que Pompée avait froidement exécuté, l’homme
intraitable qui, préférant à son juste ressentiment la cause de la Liberté,
avait, en 49, rallié, surmontant son dégoût, l’armée du meurtrier de son
père. César avait sauvé, amnistié Brutus à Pharsale ; puis il lui avait
prodigué les témoignages de son affection : il lui avait donné le
gouvernement de la Cisalpine en 46, la préture urbaine le 1er
janvier 44. Mais les faveurs glissaient sur ce philosophe passionné pour
l’étude et rongé de scrupules; et le doctrinaire maudissait
intérieurement le despotisme qui le comblait. Seuls, la reconnaissance qu’il
devait à César et peut-être aussi un obscur désir d’être adopté par lui
l’avaient jusqu’à présent détourné d’entendre les exhortations des tentateurs.
Cicéron, qui avait discerné la violence des convictions de Brutus et aussi le
secret orgueil dont il était pétri, avait, dès 45, fait fond sur ce puritain
pour assumer à sa place la terrible responsabilité de renverser le tyran. Déjà,
il avait essayé d’émouvoir sa colère; et, avant que des mains anonymes
vinssent placarder sur le tribunal du préteur des appels non déguisés à son
courage et à sa vengeance – Tu dors, Brutus! -, Cicéron avait invoqué les
ancêtres, réels
consumait l’âme tourmentée du
gendre du martyr, Marcus Iunius Brutus,le fils de cette Servilia que César
avait aimée et du démocrate que Pompée avait froidement exécuté, l’homme
intraitable qui, préférant à son juste ressentiment la cause de la Liberté,
avait, en 49, rallié, surmontant son dégoût, l’armée du meurtrier de son
père. César avait sauvé, amnistié Brutus à Pharsale ; puis il lui avait
prodigué les témoignages de son affection : il lui avait donné le
gouvernement de la Cisalpine en 46, la préture urbaine le 1er
janvier 44. Mais les faveurs glissaient sur ce philosophe passionné pour
l’étude et rongé de scrupules; et le doctrinaire maudissait
intérieurement le despotisme qui le comblait. Seuls, la reconnaissance qu’il
devait à César et peut-être aussi un obscur désir d’être adopté par lui
l’avaient jusqu’à présent détourné d’entendre les exhortations des tentateurs.
Cicéron, qui avait discerné la violence des convictions de Brutus et aussi le
secret orgueil dont il était pétri, avait, dès 45, fait fond sur ce puritain
pour assumer à sa place la terrible responsabilité de renverser le tyran. Déjà,
il avait essayé d’émouvoir sa colère; et, avant que des mains anonymes
vinssent placarder sur le tribunal du préteur des appels non déguisés à son
courage et à sa vengeance – Tu dors, Brutus! -, Cicéron avait invoqué les
ancêtres, réels  ou supposés, des deux lignages de Marcus Brutus : l’ancien
Brutus qui avait exterminé les Tarquins, Servilius Ahala qui avait délivré le
peuple de l’usurpateur Sp. Maelius. Mais, avec sa conscience bourrelée de
scrupules, le nouveau Brutus ne fût sans doute jamais passé à l’acte sans le
choc psychologique dû à l’annonce de la suprême usurpation de César. À C.
Cassius, qui, en l’apprenant, avait tenu à se réconcilier avec lui et lui
demanda quelle serait son attitude, il répondit d’abord que le jour où le Sénat
aurait à délibérer sur la royauté de César il protesterait en n’assistant pas à
la séance. C. Cassius avait alors insisté : “Mais si nous sommes
convoqués, que feras-tu?” –“Alors, répliqua Brutus, mon devoir sera de défendre
la liberté et de mourir avant de la voir expirer”. Cassius lui objecta qu’il
valait mieux la sauver en tuant César; et, soudain, l’assentiment de Brutus
décida du complot» (J. Carcopino. Ibid.
pp. 562-563).
ou supposés, des deux lignages de Marcus Brutus : l’ancien
Brutus qui avait exterminé les Tarquins, Servilius Ahala qui avait délivré le
peuple de l’usurpateur Sp. Maelius. Mais, avec sa conscience bourrelée de
scrupules, le nouveau Brutus ne fût sans doute jamais passé à l’acte sans le
choc psychologique dû à l’annonce de la suprême usurpation de César. À C.
Cassius, qui, en l’apprenant, avait tenu à se réconcilier avec lui et lui
demanda quelle serait son attitude, il répondit d’abord que le jour où le Sénat
aurait à délibérer sur la royauté de César il protesterait en n’assistant pas à
la séance. C. Cassius avait alors insisté : “Mais si nous sommes
convoqués, que feras-tu?” –“Alors, répliqua Brutus, mon devoir sera de défendre
la liberté et de mourir avant de la voir expirer”. Cassius lui objecta qu’il
valait mieux la sauver en tuant César; et, soudain, l’assentiment de Brutus
décida du complot» (J. Carcopino. Ibid.
pp. 562-563). et
Decimus Iunius Brutus. Au seul nom de royauté et devant l’imminence de
l’expédition chez les Parthes qui leur fait horreur, ces hommes, que tout
divise, s’unissent dans la même volonté criminelle. Plus encore peut-être que
la tyrannie ouverte de César, ils détestaient sa guerre contre la Perse, où elle
s’infecterait des couleurs odieuses de l’étranger. Déjà impopulaire au temps de
Crassus, lorsque dix ans plus tôt le «“triumvir” avait rejoint son armée sous
les injures des passants et la malédiction d’un tribun, l’expédition parthique
les affolait maintenant qu’ils l’accusaient de les murer en ce dilemme :
ou subir un désastre plus affreux que celui de 53, ou, par le triomphe du “roi”
César, assister à l’orientalisation des terres romaines. Ils résolurent de la
prévenir par le meurtre, et choisirent pour lieu de leur assassinat celui où le
Sénat serait appelé à la
et
Decimus Iunius Brutus. Au seul nom de royauté et devant l’imminence de
l’expédition chez les Parthes qui leur fait horreur, ces hommes, que tout
divise, s’unissent dans la même volonté criminelle. Plus encore peut-être que
la tyrannie ouverte de César, ils détestaient sa guerre contre la Perse, où elle
s’infecterait des couleurs odieuses de l’étranger. Déjà impopulaire au temps de
Crassus, lorsque dix ans plus tôt le «“triumvir” avait rejoint son armée sous
les injures des passants et la malédiction d’un tribun, l’expédition parthique
les affolait maintenant qu’ils l’accusaient de les murer en ce dilemme :
ou subir un désastre plus affreux que celui de 53, ou, par le triomphe du “roi”
César, assister à l’orientalisation des terres romaines. Ils résolurent de la
prévenir par le meurtre, et choisirent pour lieu de leur assassinat celui où le
Sénat serait appelé à la  sanctionner de ses suffrages, pour moment celui qui
précéderait la consommation de cette honte. Avant l’ouverture de l’inexpiable
séance, César, et César seul, attiré au milieu des conjurés avec une hypocrisie
égale à celle qui avait amené son rival dans la barque des sicaires égyptiens,
s’écroula aux pieds de la statue du vaincu de Pharsale, dans la curie de
Pompée, transpercé de 35 coups de poignard, dont un seul, planté en pleine
poitrine, avait été mortel, le 15 mars 44, vers 11 heures du matin. À
l’inévitable, il avait opposé qu’une sereine intrépidité et c’est seulement à
la vue de Brutus s’acharnant au carnage qu’il a laissé échapper un gémissement
de stupeur et de douloureux reproche : “Toi aussi, mon enfant !…»
(J. Carcopino. Ibid. p. 364),
sanctionner de ses suffrages, pour moment celui qui
précéderait la consommation de cette honte. Avant l’ouverture de l’inexpiable
séance, César, et César seul, attiré au milieu des conjurés avec une hypocrisie
égale à celle qui avait amené son rival dans la barque des sicaires égyptiens,
s’écroula aux pieds de la statue du vaincu de Pharsale, dans la curie de
Pompée, transpercé de 35 coups de poignard, dont un seul, planté en pleine
poitrine, avait été mortel, le 15 mars 44, vers 11 heures du matin. À
l’inévitable, il avait opposé qu’une sereine intrépidité et c’est seulement à
la vue de Brutus s’acharnant au carnage qu’il a laissé échapper un gémissement
de stupeur et de douloureux reproche : “Toi aussi, mon enfant !…»
(J. Carcopino. Ibid. p. 364), d’années
après les événements. Sans être un témoin direct de la scène, Nicolas de Damas
a eu accès à des témoignages de gens qui assistèrent à la cohue qui suivit le
meurtre du dictateur. Le récit de Nicolas est assez simple : «À peine les sénateurs le virent-ils entrer,
qu’ils se levèrent tous en signe d’honneur. Déjà ceux qui allaient le frapper
se pressaient autour de lui. Avant tous Tillius Cimber, dont César avait exilé
le frère, s’avance vers lui. Arrivé près de César, qui tenait ses mains sous sa
toge, il le saisit par ses vêtements et avec une audace toujours croissante il
l’empêchait de se servir de ses bras et d’être maître de ses mouvements. César
s’irritant de plus en plus, les conjurés se hâtent de tirer leurs poignards et
se précipitent tous sur lui. Servilius Casca le premier le frappe en levant son
fer à l’épaule gauche, un peu au-dessus de la clavicule ; il avait voulu
le frapper au cou, mais dans son trouble sa main s’égara. César se lève pour se
défendre contre lui. Casca, dans son agitation, appelle son frère en langue
grecque. Docile à sa voix, celui-ci enfonce son fer dans le côté de César. Mais
plus rapide que lui, déjà Cassius l’avait frappé à travers la figure. Decimus
Brutus lui porte un coup qui lui traverse le flanc, tandis que Cassius
Longinus, dans sa précipitation à joindre ses coups à ceux des autres, manque
César, et va frapper la main de Marcus Brutus. Ainsi que lui, Minucius Basilus,
en voulant atteindre César,
d’années
après les événements. Sans être un témoin direct de la scène, Nicolas de Damas
a eu accès à des témoignages de gens qui assistèrent à la cohue qui suivit le
meurtre du dictateur. Le récit de Nicolas est assez simple : «À peine les sénateurs le virent-ils entrer,
qu’ils se levèrent tous en signe d’honneur. Déjà ceux qui allaient le frapper
se pressaient autour de lui. Avant tous Tillius Cimber, dont César avait exilé
le frère, s’avance vers lui. Arrivé près de César, qui tenait ses mains sous sa
toge, il le saisit par ses vêtements et avec une audace toujours croissante il
l’empêchait de se servir de ses bras et d’être maître de ses mouvements. César
s’irritant de plus en plus, les conjurés se hâtent de tirer leurs poignards et
se précipitent tous sur lui. Servilius Casca le premier le frappe en levant son
fer à l’épaule gauche, un peu au-dessus de la clavicule ; il avait voulu
le frapper au cou, mais dans son trouble sa main s’égara. César se lève pour se
défendre contre lui. Casca, dans son agitation, appelle son frère en langue
grecque. Docile à sa voix, celui-ci enfonce son fer dans le côté de César. Mais
plus rapide que lui, déjà Cassius l’avait frappé à travers la figure. Decimus
Brutus lui porte un coup qui lui traverse le flanc, tandis que Cassius
Longinus, dans sa précipitation à joindre ses coups à ceux des autres, manque
César, et va frapper la main de Marcus Brutus. Ainsi que lui, Minucius Basilus,
en voulant atteindre César, blesse Rubrius Rufus à la cuisse. On eût dit qu’ils
se disputaient leur victime. Enfin, César, accablé de coups, va tomber devant la
statue de Pompée, et il n’y est pas un seul conjuré qui, pour paraître avoir
participé au meurtre, n’enfonçât son fer dans ce corps inanimé jusqu’à ce que
César eût rendu l’âme par ses trente-cinq blessures» (Cité in R. Étienne. Les Ides de mars, Paris,
Gallimard/Julliard, Col. Archives, #51, 1973, pp. 41-42). «Quand les conjurés virent
leur victime écroulée au pied de la statue, ils se précipitèrent dehors, de
même que les autres sénateurs stupéfiés par le crime. Pendant le reste de la
journée, la peur, la consternation et l’horreur paralysèrent Rome. Marc Antoine
et Lepidus eux-mêmes, “les plus grands amis de César, s’esquivèrent et
cherchèrent refuge dans des maisons autres que les leurs”. Le cadavre resta un
certain temps, gisant sur le sol “jusqu’à ce que trois esclaves le missent sur
une litière pour le ramener chez lui”» (E. Horst. César, Paris, Fayard, rééd. Marabout, Col. Histoire, # MU438, 1981,
p. 367.
blesse Rubrius Rufus à la cuisse. On eût dit qu’ils
se disputaient leur victime. Enfin, César, accablé de coups, va tomber devant la
statue de Pompée, et il n’y est pas un seul conjuré qui, pour paraître avoir
participé au meurtre, n’enfonçât son fer dans ce corps inanimé jusqu’à ce que
César eût rendu l’âme par ses trente-cinq blessures» (Cité in R. Étienne. Les Ides de mars, Paris,
Gallimard/Julliard, Col. Archives, #51, 1973, pp. 41-42). «Quand les conjurés virent
leur victime écroulée au pied de la statue, ils se précipitèrent dehors, de
même que les autres sénateurs stupéfiés par le crime. Pendant le reste de la
journée, la peur, la consternation et l’horreur paralysèrent Rome. Marc Antoine
et Lepidus eux-mêmes, “les plus grands amis de César, s’esquivèrent et
cherchèrent refuge dans des maisons autres que les leurs”. Le cadavre resta un
certain temps, gisant sur le sol “jusqu’à ce que trois esclaves le missent sur
une litière pour le ramener chez lui”» (E. Horst. César, Paris, Fayard, rééd. Marabout, Col. Histoire, # MU438, 1981,
p. 367. claudienne, le talent littéraire de Suétone est celui d’un chroniqueur
doublé d’un moraliste plutôt que d’un historien critique. Il a un sens du
dramatique peu courant. C’est lui qui modifie la phrase et fait dire à César
«Toi aussi, mon fils», exclamation qui fit tant couler d’encre au cours des siècles pour
savoir quel était le degré de filiation entre les deux hommes. Suétone, comme
les récits évangéliques, insiste sur ce côté pitoyable, pathétique, qui
accompagne la conjuration et le meurtre hystérique du grand Jules. Le récit
d’un vulgarisateur de grand talent, Gérard Walter, ramasse les détails qui
donnent de ce crime une confirmation du destin qui s’acharne sur sa
victime :
claudienne, le talent littéraire de Suétone est celui d’un chroniqueur
doublé d’un moraliste plutôt que d’un historien critique. Il a un sens du
dramatique peu courant. C’est lui qui modifie la phrase et fait dire à César
«Toi aussi, mon fils», exclamation qui fit tant couler d’encre au cours des siècles pour
savoir quel était le degré de filiation entre les deux hommes. Suétone, comme
les récits évangéliques, insiste sur ce côté pitoyable, pathétique, qui
accompagne la conjuration et le meurtre hystérique du grand Jules. Le récit
d’un vulgarisateur de grand talent, Gérard Walter, ramasse les détails qui
donnent de ce crime une confirmation du destin qui s’acharne sur sa
victime : l’assaillent. D’un geste las, il transmet leurs suppliques à ses officiers.
Artémidor lui tend la sienne. Mais il insiste pour que César en prenne
immédiatement connaissance. Celui-ci paraît impressionné par les accents
émouvants de sa voix. Il garde le billet dans sa main. Il n’a pas le temps de
l’ouvrir : déjà un importun l’accapare et se met à lui débiter une longue
histoire. Peut-être lui demande-t-il quelque faveur, puisque finalement on le
voit se confondre en remerciements. Enfin débarrassé de lui, César se dirige
vers l’entrée, sans avoir pu lire le billet d’Artémidor.
l’assaillent. D’un geste las, il transmet leurs suppliques à ses officiers.
Artémidor lui tend la sienne. Mais il insiste pour que César en prenne
immédiatement connaissance. Celui-ci paraît impressionné par les accents
émouvants de sa voix. Il garde le billet dans sa main. Il n’a pas le temps de
l’ouvrir : déjà un importun l’accapare et se met à lui débiter une longue
histoire. Peut-être lui demande-t-il quelque faveur, puisque finalement on le
voit se confondre en remerciements. Enfin débarrassé de lui, César se dirige
vers l’entrée, sans avoir pu lire le billet d’Artémidor. des entrailles défectueuses. “Signe de mort”, annonce Spurinna.
César hausse les épaules : à Munda, au moment de commencer la bataille, on
lui avait prédit la même chose, et pourtant… -- “Et pourtant, réplique
Spurinna, il y a couru le plus grand danger”. César coupe la conversation.
Qu’on consulte de nouvelles victimes. Spurinna obéit. Même résultat. L’épreuve
se prolonge. Autour de César, on s’impatiente. On le presse : il est temps
d’en finir, les devins abusent de sa patience, depuis quand est-il devenu si
superstitieux…
des entrailles défectueuses. “Signe de mort”, annonce Spurinna.
César hausse les épaules : à Munda, au moment de commencer la bataille, on
lui avait prédit la même chose, et pourtant… -- “Et pourtant, réplique
Spurinna, il y a couru le plus grand danger”. César coupe la conversation.
Qu’on consulte de nouvelles victimes. Spurinna obéit. Même résultat. L’épreuve
se prolonge. Autour de César, on s’impatiente. On le presse : il est temps
d’en finir, les devins abusent de sa patience, depuis quand est-il devenu si
superstitieux… ne veut pas l’écouter. Ce n’est pas le moment. On verra cela une autre
fois. Tillius insiste. Les autres joignent leurs prières aux siennes. Ils lui
saisissent les mains, lui baisent le front, la poitrine. Leurs doigts frôlent
son corps, furtifs et agiles. Non, il ne porte pas de cuirasse aujourd’hui, et
il n’a nulle arme cachée sur lui. César en a assez. Excédé, il fait un
mouvement pour se lever. Tillius, comme s’il voulait tenter une ultime prière,
saisit un pan de sa toge. On voit paraître l’épaule nue : signal convenu.
Un cri de César : “Mais c’est de la violence!” Aussitôt, par derrière,
Casca le frappe. Coup manqué : la main du tribun a tremblé, et son
poignard s’égare au-dessus de la clavicule. César n’a pas perdu son sang-froid.
Il se retourne, reconnaît celui
ne veut pas l’écouter. Ce n’est pas le moment. On verra cela une autre
fois. Tillius insiste. Les autres joignent leurs prières aux siennes. Ils lui
saisissent les mains, lui baisent le front, la poitrine. Leurs doigts frôlent
son corps, furtifs et agiles. Non, il ne porte pas de cuirasse aujourd’hui, et
il n’a nulle arme cachée sur lui. César en a assez. Excédé, il fait un
mouvement pour se lever. Tillius, comme s’il voulait tenter une ultime prière,
saisit un pan de sa toge. On voit paraître l’épaule nue : signal convenu.
Un cri de César : “Mais c’est de la violence!” Aussitôt, par derrière,
Casca le frappe. Coup manqué : la main du tribun a tremblé, et son
poignard s’égare au-dessus de la clavicule. César n’a pas perdu son sang-froid.
Il se retourne, reconnaît celui  qui vient de lever la main sur lui. “Scélérat!
Que fais-tu?” lui crie-t-il. En même temps, le saisissant par le bras, il le
blesse avec le poinçon dont il se sert pour écrire et s’élance en avant. Mais
Cassius se dresse en face et lui porte un coup de poignard en pleine figure.
César, aveuglé par le sang qui inonde son visage, chancelle, ne sait où diriger
ses pas. De tous les côtés, les poignards se lèvent. Il est poussé “tel une
bête féroce assaillie par les chasseurs” aux pieds de la statue de Pompée. À
chaque coup, c’est un cri, un hurlement sauvage. En recevant celui de Brutus,
il se tait, se couvre la tête de sa toge, et s’effondre.
qui vient de lever la main sur lui. “Scélérat!
Que fais-tu?” lui crie-t-il. En même temps, le saisissant par le bras, il le
blesse avec le poinçon dont il se sert pour écrire et s’élance en avant. Mais
Cassius se dresse en face et lui porte un coup de poignard en pleine figure.
César, aveuglé par le sang qui inonde son visage, chancelle, ne sait où diriger
ses pas. De tous les côtés, les poignards se lèvent. Il est poussé “tel une
bête féroce assaillie par les chasseurs” aux pieds de la statue de Pompée. À
chaque coup, c’est un cri, un hurlement sauvage. En recevant celui de Brutus,
il se tait, se couvre la tête de sa toge, et s’effondre. salle se vide. De son
piédestal, le vaincu de Pharsale, figé dans le marbre froid de sa statue,
regarde la dépouille de son vainqueur percée de vingt-trois blessures. Des
heures passent. Personne ne vient troubler leur muet colloque. Vers la fin de
la journée arrivent trois esclaves de César. Ils emportent le corps de leur maître
posé sur une civière, un bras pendant dehors. La main serre un billet. Celui
d’Artémidor qu’il n’a pas eu le temps de lire…
salle se vide. De son
piédestal, le vaincu de Pharsale, figé dans le marbre froid de sa statue,
regarde la dépouille de son vainqueur percée de vingt-trois blessures. Des
heures passent. Personne ne vient troubler leur muet colloque. Vers la fin de
la journée arrivent trois esclaves de César. Ils emportent le corps de leur maître
posé sur une civière, un bras pendant dehors. La main serre un billet. Celui
d’Artémidor qu’il n’a pas eu le temps de lire… Il y a quarante ans, le même jour, le long des mêmes rues,
un gracieux adolescent, revêtu d’une toge immaculée, s’en allait, accompagné
d’une foule joyeuse de parents et d’amis, prier la divinité de rendre clair et
heureux le destin qui s’ouvrait devant lui. C’était le jour de la fête d’Anna
Perenna, fête du printemps naissant, quand les hommes au fond des bois chantent
la gloire de la nature ressuscitée» (G. Walter. César, Paris,
Albin Michel, rééd. Marabout, Col. Université, # 49, 1964, pp. 415-416).
Il y a quarante ans, le même jour, le long des mêmes rues,
un gracieux adolescent, revêtu d’une toge immaculée, s’en allait, accompagné
d’une foule joyeuse de parents et d’amis, prier la divinité de rendre clair et
heureux le destin qui s’ouvrait devant lui. C’était le jour de la fête d’Anna
Perenna, fête du printemps naissant, quand les hommes au fond des bois chantent
la gloire de la nature ressuscitée» (G. Walter. César, Paris,
Albin Michel, rééd. Marabout, Col. Université, # 49, 1964, pp. 415-416). descendirent au forum et haranguè-
descendirent au forum et haranguè-rent le peuple, qui écouta leurs discours sans manifester ni blâme, ni appro-bation de ce qui s’était fait, mais qui laissait voir par son profond silence que s’il plaignait César, il respectait Brutus. Le Sénat décréta que l’on rendrait à César les honneurs divins et qu’on ne toucherait pas à la moindre des mesures qu’il avait prises quand il était au pouvoir» (Cité in E. Horst. Op. cit. p. 368). Quant à ses meurtriers, Suétone nous dit que tous ne vécurent pas plus de trois ans après le meurtre et périrent de manière violente. «Ainsi moururent de leur propre main les meneurs, Cassius et Brutus, l’un au printemps, l’autre en novembre 42, après qu’ils eurent été vaincus par Marc Antoine lors de la double bataille de Philippes» (E. Horst. Ibid. p. 371). Toujours dans la même poursuite du récit évangélique, Brutus subira le sort de Judas.
Paradoxalement, les motifs de Brutus permettent de comprendre un pan de la trahison de Judas. D’abord l’indicatif passé ramené au présent; la rétroprojection historique de notre action sur un modèle de référence passé, ce qui ramène le doppelgänger au centre de la trahison. «Brutus, le prétendu ancêtre, n’a-t-il pas
 vengé en 510 le déshonneur de Lucrèce, violée
par le fils du roi Tarquin le Superbe, en décidant de supprimer la ro-
vengé en 510 le déshonneur de Lucrèce, violée
par le fils du roi Tarquin le Superbe, en décidant de supprimer la ro-yauté […] Ce Brutus n’a-t-il pas lié ses amis, Collatin, Lucretius et Valerius, par un serment : et quand Brutus les invite à aller de ce pas abattre la royauté ils le suivirent comme leur chef (Tite-Live. I, 69)» (R. Étienne. Op. cit. p. 165). Ainsi procédèrent les conjurés dont le programme était essentiellement négatif : tuer César l’aspirant monarque. C’est ce que remarque Cicéron. Les conjurés des Ides de mars n’ont pas de programme consensuel. Il s’agit seulement de tuer César. Il s’agit d’un tyrannicide à la mode grecque, inspiré du récit antique du premier Brutus,
 le libérateur de Rome de l’emprise des rois étrusques. Judas
pouvait aussi s’inspirer de Judas Maccabée, le chef de l’insurrection des Juifs
devant la domination grecque des Séleucide en Syrie et surtout la façon dont
les mœurs grecques bouleversaient les coutumes et les valeurs juives au IIe siècle
av. J.-C. Pour les Juifs, Judas Maccabée est resté un héros à la mesure du
premier Brutus pour les Romains. Les deux figures signifiant à peu près la même
chose : celles de libérateurs contre une emprise extérieure. Judas Maccabée mourut en -160, dans un
affrontement avec le Grec Demetrios. Ses frères fondèrent la dynastie des
Hasmonéens qui s’imposa comme régnante en Judée jusqu’en -63, jusqu'à ce que Pompée fit
passer la Palestine au niveau d’un protectorat romain, faisant transiter la
monarchie aux Iduméens et à la famille d’Hérode le Grand. Au-delà du fait que
Judas ait pu être zélote, les réminiscences historiques des révoltes de Judas
Maccabée restent un corollaire psychologique possible du
dépit ressenti par la «lâcheté» de Jésus à prendre le pouvoir qui semblait à
portée de main lors de l’entrée triomphale à Jérusalem, une semaine avant la
Passion.
le libérateur de Rome de l’emprise des rois étrusques. Judas
pouvait aussi s’inspirer de Judas Maccabée, le chef de l’insurrection des Juifs
devant la domination grecque des Séleucide en Syrie et surtout la façon dont
les mœurs grecques bouleversaient les coutumes et les valeurs juives au IIe siècle
av. J.-C. Pour les Juifs, Judas Maccabée est resté un héros à la mesure du
premier Brutus pour les Romains. Les deux figures signifiant à peu près la même
chose : celles de libérateurs contre une emprise extérieure. Judas Maccabée mourut en -160, dans un
affrontement avec le Grec Demetrios. Ses frères fondèrent la dynastie des
Hasmonéens qui s’imposa comme régnante en Judée jusqu’en -63, jusqu'à ce que Pompée fit
passer la Palestine au niveau d’un protectorat romain, faisant transiter la
monarchie aux Iduméens et à la famille d’Hérode le Grand. Au-delà du fait que
Judas ait pu être zélote, les réminiscences historiques des révoltes de Judas
Maccabée restent un corollaire psychologique possible du
dépit ressenti par la «lâcheté» de Jésus à prendre le pouvoir qui semblait à
portée de main lors de l’entrée triomphale à Jérusalem, une semaine avant la
Passion.Judas, ce double maléfique de Jésus, restera toujours une énigme. L’ami, le disciple, l’homme de confiance qui se retourne contre son maître à qui depuis on attribue le statut d’un dieu venu libérer l'humanité de ses péchés. Ne peut-on imaginer être plus abject que Judas? Damné pour l’éternité, entre Brutus et Cassius, il élève l'homicide au déicide. Par ce fait même il prend cette majesté métaphysique qui en fait le Traître sur lequel tous les autres sont inspirés, y compris Caïn, y compris Brutus, y compris Ptolémée XIII, y compris tous ces traîtres, réels ou imaginaires. Dans certains cas - dans les Cités antiques, dans les nations, les empires mêmes - la «pathologie» du traître manifeste une tendance psychotique, voire même dans les cas les plus suicidaires, une tendance schizophrénique.
En abordant le cercle de Ptolémée, nous avons longuement élaboré sur le fantasme - et la réalité - de la trahison dans l’histoire du Québec. Nous rappelions que, de part et d'autre du 49e parallèle, il y a une définition commune au mot traître, mais une interprétation différente lorsqu'il s'agit de l'appliquer à l'histoire : là réside, précisément, la spécificité formelle de l'identité nationale. Dans le cas américain, Judas reste Judas, c'est-à-dire un individu menaçant pour la nation (que ce soit Arnold, Burr, Manning ou Snowden), car membre d'une cinquième colonne pactisant avec l'ennemi, peu importe qu'il soit réel ou fantasmatique. Dans le cas québécois, Judas devient la Judée toute entière, c'est-à-dire le groupe national face à sa propre spécificité formelle de l'identité nationale.
Au cours du Régime français (1534-1760), le traître n’est encore qu’un individu dans la Cité, il a franchi la porte arrière de la
 forteresse et menace la vie des fondateurs : c'est le serrurier Duval qui est pendu pour avoir conspiré contre la vie de Cham-
forteresse et menace la vie des fondateurs : c'est le serrurier Duval qui est pendu pour avoir conspiré contre la vie de Cham-plain; Étienne Brûlé, puis Radisson et des Groseillers qui pactisent tantôt avec les Hollandais, tantôt avec les Anglais, bref, au marché des fourrures le plus payant est celui qui attire les coureurs des bois français. Puis, il y a Thomas Pichon, qui
 correspond avec les Anglais lors du siège du Fort Beauséjour (17 juin 1755) enfin Thomas Cugnet qui aurait révélé à Wolfe le sentier lui permettant d'escalader l'Anse-aux-Foulons et atteindre les hauteurs d'Abraham et forcer ainsi Montcalm à livrer combat; le couard Du Chambon de Vergor (qui avait déjà contribué à perdre le Fort Beauséjour), gardien du poste de surveillance, se laissant surprendre au lit par les soldats ennemis. Tous sont encore des Judas individuels. La Cession de la Nouvelle-France à l'Angleterre et le ralliement plus ou moins docile de la population au nouveau régime, si différent par ses coutumes, son droit, sa langue et sa religion surtout, vont insérer le schéma du traître dans la spécificité formelle c’est-à-dire dans une structure schizophrénique culturelle de la nation québécoise.
correspond avec les Anglais lors du siège du Fort Beauséjour (17 juin 1755) enfin Thomas Cugnet qui aurait révélé à Wolfe le sentier lui permettant d'escalader l'Anse-aux-Foulons et atteindre les hauteurs d'Abraham et forcer ainsi Montcalm à livrer combat; le couard Du Chambon de Vergor (qui avait déjà contribué à perdre le Fort Beauséjour), gardien du poste de surveillance, se laissant surprendre au lit par les soldats ennemis. Tous sont encore des Judas individuels. La Cession de la Nouvelle-France à l'Angleterre et le ralliement plus ou moins docile de la population au nouveau régime, si différent par ses coutumes, son droit, sa langue et sa religion surtout, vont insérer le schéma du traître dans la spécificité formelle c’est-à-dire dans une structure schizophrénique culturelle de la nation québécoise. Avec le régime anglais (1760-1867), si certains gouverneurs coloniaux peuvent se montrer intransigeants et autoritaires, la plupart restent conciliants
 autant que les habitants canadiens-français, qui sont demeurés au pays après la Conquête anglaise, peuvent se montrer parfois têtus et rebelles. La concession d'un gouvernement démocratique (mais non ministériel) en 1791 força cette population à jouer le jeu du gouvernement colonial par une participation au pouvoir législatif sans détenir toutefois le contrôle de l'appareil exécutif. C'est lors de l'élection du premier orateur de la Chambre d'Assemblée, Jean-Antoine Panet, que se manifesta la première faille dans l'unité des colons francophones. Les membres de la députation anglaise alléguèrent, pour lui refuser leur vote, «que le président devait connaître les deux langues, et surtout la langue anglaise. On lui répondit que ce candidat l'entendait suffisamment pour conduire les affaires publiques. Un autre député, Richardson, avança que les Canadiens devaient, par tous les motifs d'intérêt et de reconnaissance, adopter la langue de la métropole, et soutint sa proposition avec
autant que les habitants canadiens-français, qui sont demeurés au pays après la Conquête anglaise, peuvent se montrer parfois têtus et rebelles. La concession d'un gouvernement démocratique (mais non ministériel) en 1791 força cette population à jouer le jeu du gouvernement colonial par une participation au pouvoir législatif sans détenir toutefois le contrôle de l'appareil exécutif. C'est lors de l'élection du premier orateur de la Chambre d'Assemblée, Jean-Antoine Panet, que se manifesta la première faille dans l'unité des colons francophones. Les membres de la députation anglaise alléguèrent, pour lui refuser leur vote, «que le président devait connaître les deux langues, et surtout la langue anglaise. On lui répondit que ce candidat l'entendait suffisamment pour conduire les affaires publiques. Un autre député, Richardson, avança que les Canadiens devaient, par tous les motifs d'intérêt et de reconnaissance, adopter la langue de la métropole, et soutint sa proposition avec  tant d'apparence de conviction qu'il entraîna Pierre-Louis Panet [cousin de Jean-Antoine]. "Le pays n'est-il pas une possession britannique? demanda ce dernier. La langue anglaise n'est-elle pas celle du souverain et de la législature dont nous tenons notre constitution? Ne doit-on pas conclure de là que puisqu'on parle l'anglais à Londres, on doit le parler à Québec?"» Jean-Antoine Panet fut élu grâce à la majorité canadienne-française, mais lors de la session de 1794, occasion de la reconduction du même orateur à son poste, «cette fois encore pas un Anglais ne vota pour ce dernier tandis que quatre Canadiens se levèrent contre lui, outre deux revêtus de charges publiques, entre autres le solliciteur général, [Louis-Charles Foucher], qui ne vota plus que comme un homme vendu» (F.-X. Garneau. Histoire du Canada, t. 2, Paris, Félix Alcan, pp. 433 et 448). La déchirure endogène du groupe ethnique, commençait à vicier l'homogénéité collective des Canadiens Français.
tant d'apparence de conviction qu'il entraîna Pierre-Louis Panet [cousin de Jean-Antoine]. "Le pays n'est-il pas une possession britannique? demanda ce dernier. La langue anglaise n'est-elle pas celle du souverain et de la législature dont nous tenons notre constitution? Ne doit-on pas conclure de là que puisqu'on parle l'anglais à Londres, on doit le parler à Québec?"» Jean-Antoine Panet fut élu grâce à la majorité canadienne-française, mais lors de la session de 1794, occasion de la reconduction du même orateur à son poste, «cette fois encore pas un Anglais ne vota pour ce dernier tandis que quatre Canadiens se levèrent contre lui, outre deux revêtus de charges publiques, entre autres le solliciteur général, [Louis-Charles Foucher], qui ne vota plus que comme un homme vendu» (F.-X. Garneau. Histoire du Canada, t. 2, Paris, Félix Alcan, pp. 433 et 448). La déchirure endogène du groupe ethnique, commençait à vicier l'homogénéité collective des Canadiens Français. Avec les Rébellions vaincues de 1837-1838, la structure schizophrénique s’impose. C’est elle que nous nommons le syndrome du Chouayen, du nom de ces partisans du gouverneur anglais contre les Patriotes locaux. Depuis, le pouvoir est passé du Colonial Office de Londres au gouvernement fédéral du Canada à Ottawa. La structure schizophrénique est encore plus douloureuse puisque la spécificité formelle couvre aussi bien les partisans du Canada uni que ceux du Québec libre. Une apparente
 synthèse nationale couvre des déchirures latentes qu’un moindre incident suffit parfois à exacerber de manière hystérique. Quiconque connaît l'histoire récente du Québec ne pourra s'empêcher de se rappeler le mot de la fin, le soir de la défaite référendaire du 20 mai 1980, lorsque le Premier ministre René Lévesque, animateur de l'option du Oui à la souveraineté, remit «à la prochaine fois» cet autre rendez-vous manqué des Québécois avec l'Histoire. Y aurait-il là plus que la tradition hégélienne de l'affirmation de l'auto-détermination d'une collectivité par un État souverain? La sinistrose post-référendaire qui s'abattit sur l'ensemble de la collectivité québécoise aux lendemains du Non ressemble assez à ce que Papineau décrivait de l'humeur des Québécois dix après l'échec des Patriotes. Un Non à l'indépendance nationale n'est pas un Oui à l'assimilation multiculturelle ou fédéraliste. On peut bien parler de résignation et de résistance passive plus que de suicide collectif - quoique, en ce début du XXIe siècle, la tendance à l'assimilation soit plus forte qu'elle ne l'a jamais été auparavant -, mais c'était surtout un état moral qui nuisait sérieusement à toute tentative d'homogénéiser la solidarité des Québécois dans leur désir d'auto-détermination face au monde extérieur.
synthèse nationale couvre des déchirures latentes qu’un moindre incident suffit parfois à exacerber de manière hystérique. Quiconque connaît l'histoire récente du Québec ne pourra s'empêcher de se rappeler le mot de la fin, le soir de la défaite référendaire du 20 mai 1980, lorsque le Premier ministre René Lévesque, animateur de l'option du Oui à la souveraineté, remit «à la prochaine fois» cet autre rendez-vous manqué des Québécois avec l'Histoire. Y aurait-il là plus que la tradition hégélienne de l'affirmation de l'auto-détermination d'une collectivité par un État souverain? La sinistrose post-référendaire qui s'abattit sur l'ensemble de la collectivité québécoise aux lendemains du Non ressemble assez à ce que Papineau décrivait de l'humeur des Québécois dix après l'échec des Patriotes. Un Non à l'indépendance nationale n'est pas un Oui à l'assimilation multiculturelle ou fédéraliste. On peut bien parler de résignation et de résistance passive plus que de suicide collectif - quoique, en ce début du XXIe siècle, la tendance à l'assimilation soit plus forte qu'elle ne l'a jamais été auparavant -, mais c'était surtout un état moral qui nuisait sérieusement à toute tentative d'homogénéiser la solidarité des Québécois dans leur désir d'auto-détermination face au monde extérieur. de la Nouvelle-France : Duval, Brûlé ou Cugnet; que sont-ils face aux grands noms du Régime français remplis d'idéaux mystiques ou d'aspirations commerciales ou politiques, tels Cartier, Champlain, Maisonneuve et Frontenac? Avec le Régime anglais, la perspective change. Que valent les noms de Chénier - dont on se rappelle de la mort atroce et de l'excision anthropophagique du cœur par la soldatesque triomphante après la bataille dans l’église de Saint-Eustache -, du docteur Côté, d’Amury Girod, de Cardinal et du malheureux Duquet, dont la face resta
de la Nouvelle-France : Duval, Brûlé ou Cugnet; que sont-ils face aux grands noms du Régime français remplis d'idéaux mystiques ou d'aspirations commerciales ou politiques, tels Cartier, Champlain, Maisonneuve et Frontenac? Avec le Régime anglais, la perspective change. Que valent les noms de Chénier - dont on se rappelle de la mort atroce et de l'excision anthropophagique du cœur par la soldatesque triomphante après la bataille dans l’église de Saint-Eustache -, du docteur Côté, d’Amury Girod, de Cardinal et du malheureux Duquet, dont la face resta  coincée dans la trappe de l’échafaud en 1839 face au burlesque Félix Poutré, dont le poète Louis Fréchette tira un vaudeville de ses rocambolesques récits d’évasion de prison après simulation de la folie? Il est vrai que Fréchette ignorait ce que nous savons depuis : que Poutré était un agent double chargé d’espionner et de dénoncer les membres de l’aile militaire des Patriotes, les Frères Chasseurs. La vraie simulation n’est pas celle que l’on crût à l’époque et ce ne sont pas les policiers coloniaux qui ont été bernés, mais bien les rebelles québécois. Traître ou héros Félix Poutré? La chose n’est pas encore tranchée pour tout le monde. Le comble de cette schizophrénie consiste bien à conduire au suicide collectif, tout comme Judas ne trouvant plus d’autres solutions à son impuissance et à son désarroi que la corde pour se pendre. L’impuissance à choisir une identité, à
coincée dans la trappe de l’échafaud en 1839 face au burlesque Félix Poutré, dont le poète Louis Fréchette tira un vaudeville de ses rocambolesques récits d’évasion de prison après simulation de la folie? Il est vrai que Fréchette ignorait ce que nous savons depuis : que Poutré était un agent double chargé d’espionner et de dénoncer les membres de l’aile militaire des Patriotes, les Frères Chasseurs. La vraie simulation n’est pas celle que l’on crût à l’époque et ce ne sont pas les policiers coloniaux qui ont été bernés, mais bien les rebelles québécois. Traître ou héros Félix Poutré? La chose n’est pas encore tranchée pour tout le monde. Le comble de cette schizophrénie consiste bien à conduire au suicide collectif, tout comme Judas ne trouvant plus d’autres solutions à son impuissance et à son désarroi que la corde pour se pendre. L’impuissance à choisir une identité, à  s’y tenir contre les confrontations internes et surmonter les dissensions se transforment en une sorte d’attitude végétative qui ne peut que conduire à la régression après des efforts surhumains pour se tirer de cette impasse. La stratégie référendaire est l’acte suicidaire inavouable cachée sous la pudeur d’une démocratie mal comprise. Les indépendantistes québécois postulent plus qu’ils ne démontrent l’unité du peuple Québécois. Il apparaît donc logique, selon la formule hégélienne, que ce peuple se dote de son État. C’est oublier la profondeur de la réflexion de l’homme d’État italien Massimo d’Azeglio (1798-1866), après que son successeur et rival Cavour ait fait passer l’unité italienne sous la tutelle de la monarchie de Savoie : «Maintenant que l’Italie est faite, ne reste plus qu’à faire les Italiens». La chose va de même au Québec. Le gouvernement doit penser à faire le Québec, ensuite il lui faudra faire les Québécois, et alors, et seulement alors, la rationalité deviendra réalité. C’est à cette seule condition qu’il sera possible d’expulser la spécificité formelle de l’identité schizophrénique des Québécois qui les entraîne à voir une moitié comme traîtresse de l’autre.
s’y tenir contre les confrontations internes et surmonter les dissensions se transforment en une sorte d’attitude végétative qui ne peut que conduire à la régression après des efforts surhumains pour se tirer de cette impasse. La stratégie référendaire est l’acte suicidaire inavouable cachée sous la pudeur d’une démocratie mal comprise. Les indépendantistes québécois postulent plus qu’ils ne démontrent l’unité du peuple Québécois. Il apparaît donc logique, selon la formule hégélienne, que ce peuple se dote de son État. C’est oublier la profondeur de la réflexion de l’homme d’État italien Massimo d’Azeglio (1798-1866), après que son successeur et rival Cavour ait fait passer l’unité italienne sous la tutelle de la monarchie de Savoie : «Maintenant que l’Italie est faite, ne reste plus qu’à faire les Italiens». La chose va de même au Québec. Le gouvernement doit penser à faire le Québec, ensuite il lui faudra faire les Québécois, et alors, et seulement alors, la rationalité deviendra réalité. C’est à cette seule condition qu’il sera possible d’expulser la spécificité formelle de l’identité schizophrénique des Québécois qui les entraîne à voir une moitié comme traîtresse de l’autre.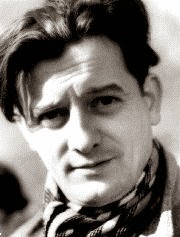 «Dans sa pièce, Judas, créée en 1955 au Théâtre de Paris, Marcel Pagnol avait déjà imaginé un Judas se dévouant pour servir l’Écriture :
“C’est à cause de la précision des prophéties, confirmées par les paroles mêmes
de Jésus, qui a plusieurs fois annoncé sa mort prochaine et nécessaire, que
Judas a cru à sa propre prédestination et qu’il a livré son maître; puis il l’a
suivi dans la mort. C’est ce personnage que j’ai mis en scène avec beaucoup de
soin et d’amitié, car s’il a cru obéir aux ordres de Dieu et de Jésus lui-même,
il fut sans doute le premier martyr» (Cité in C. Soullard. Op. cit. p. 33). Et Pagnol n’est pas le premier à
prier pour le salut de l’âme de Judas. «À
la fin du siècle dernier, dans un village du nord de la France, un petit enfant
apportait régulièrement ses économies au curé pour
«Dans sa pièce, Judas, créée en 1955 au Théâtre de Paris, Marcel Pagnol avait déjà imaginé un Judas se dévouant pour servir l’Écriture :
“C’est à cause de la précision des prophéties, confirmées par les paroles mêmes
de Jésus, qui a plusieurs fois annoncé sa mort prochaine et nécessaire, que
Judas a cru à sa propre prédestination et qu’il a livré son maître; puis il l’a
suivi dans la mort. C’est ce personnage que j’ai mis en scène avec beaucoup de
soin et d’amitié, car s’il a cru obéir aux ordres de Dieu et de Jésus lui-même,
il fut sans doute le premier martyr» (Cité in C. Soullard. Op. cit. p. 33). Et Pagnol n’est pas le premier à
prier pour le salut de l’âme de Judas. «À
la fin du siècle dernier, dans un village du nord de la France, un petit enfant
apportait régulièrement ses économies au curé pour  faire dire des messes pour
Judas. Mais il n’osait pas prononcer son nom. Il disait simplement : “Pour
une âme en peine…” Et des messes furent dites. Cet enfant qui priait pour le
salut de Judas s’appelait Georges Bernanos. La question qui tourmentait le
jeune Bernanos mérite d’être posée : Judas a-t-il été pardonné? Laissons à
sainte Gertrude, moniale et mystique allemande du XIIIe siècle, le soin de
répondre. Voici en effet les paroles de Dieu qu’elle entendit un jour dans ses
prières et qu’elle publia dans ses entretiens mystiques sous le titre Révélations :
“De Salomon ni de Judas, je ne te dirai
ce que j’ai fait, pour qu’on n’abuse pas de ma miséricorde”… Madame Gervaise
dans Jeanne d’Arc de Péguy ne dit pas
autre chose : “Jamais nous ne savons si une âme se damne”» (C.
Soullard. Op. cit. p. 39).
faire dire des messes pour
Judas. Mais il n’osait pas prononcer son nom. Il disait simplement : “Pour
une âme en peine…” Et des messes furent dites. Cet enfant qui priait pour le
salut de Judas s’appelait Georges Bernanos. La question qui tourmentait le
jeune Bernanos mérite d’être posée : Judas a-t-il été pardonné? Laissons à
sainte Gertrude, moniale et mystique allemande du XIIIe siècle, le soin de
répondre. Voici en effet les paroles de Dieu qu’elle entendit un jour dans ses
prières et qu’elle publia dans ses entretiens mystiques sous le titre Révélations :
“De Salomon ni de Judas, je ne te dirai
ce que j’ai fait, pour qu’on n’abuse pas de ma miséricorde”… Madame Gervaise
dans Jeanne d’Arc de Péguy ne dit pas
autre chose : “Jamais nous ne savons si une âme se damne”» (C.
Soullard. Op. cit. p. 39). Olivier Abel «qui expliquerait l’incompré-hensible trahison : ce scénario devient
une véritable tragédie où Judas est de toute façon incarcéré dans son rôle,
tant et si bien qu’il ne peut en sortir, qu’il ne peut que l’accomplir jusqu’au
bout» (O. Abel, in C. Soullard. Ibid.
p. 44). Sa trahison est une révélation, comme le reconnaissait sainte Gertrude. Comme l'usage des miracles, elle fait passer la
prédication en acte. Cette révélation est double. Aux yeux de la postérité,
elle fondera la Bonne nouvelle; aux
yeux de Judas, elle révèle le côté pitoyable de la faiblesse humaine. Il fallait que le sacrifice fut accompli. Il fallait donc que le
Mal intervienne par la main humaine : «Pourquoi
fallait-il le mal? Pourquoi ce mal est-il devenu l’instrument de la
volonté de Dieu? Inépuisables questions… La trahison de Judas n’est-elle
pas l’exemple même de la felix culpa, de
la faute bienheureuse qui permet la rédemption et le salut du monde, selon un
thème cher à saint Augustin? Elle est un moment crucial de l’histoire du
salut. Par un mal – la trahison de Judas – la grâce va abonder. Dieu fait de
Judas l’emblème du péché qui produit un bien, lui accordant ainsi une fonction
dans une théologie de la Rédemption. La trahison de Judas nous invite à sortir
d’une logique de la rétribution. Un homme devient traître et la Passion va
jusqu’à son terme. En
Olivier Abel «qui expliquerait l’incompré-hensible trahison : ce scénario devient
une véritable tragédie où Judas est de toute façon incarcéré dans son rôle,
tant et si bien qu’il ne peut en sortir, qu’il ne peut que l’accomplir jusqu’au
bout» (O. Abel, in C. Soullard. Ibid.
p. 44). Sa trahison est une révélation, comme le reconnaissait sainte Gertrude. Comme l'usage des miracles, elle fait passer la
prédication en acte. Cette révélation est double. Aux yeux de la postérité,
elle fondera la Bonne nouvelle; aux
yeux de Judas, elle révèle le côté pitoyable de la faiblesse humaine. Il fallait que le sacrifice fut accompli. Il fallait donc que le
Mal intervienne par la main humaine : «Pourquoi
fallait-il le mal? Pourquoi ce mal est-il devenu l’instrument de la
volonté de Dieu? Inépuisables questions… La trahison de Judas n’est-elle
pas l’exemple même de la felix culpa, de
la faute bienheureuse qui permet la rédemption et le salut du monde, selon un
thème cher à saint Augustin? Elle est un moment crucial de l’histoire du
salut. Par un mal – la trahison de Judas – la grâce va abonder. Dieu fait de
Judas l’emblème du péché qui produit un bien, lui accordant ainsi une fonction
dans une théologie de la Rédemption. La trahison de Judas nous invite à sortir
d’une logique de la rétribution. Un homme devient traître et la Passion va
jusqu’à son terme. En  trahissant, Judas révèle le Christ. Il devient son
complice et permet la lumière. Il est “l’ouvrier indispen-
trahissant, Judas révèle le Christ. Il devient son
complice et permet la lumière. Il est “l’ouvrier indispen-sable de la Rédemp-
tion” au même titre que Ponce Pilate, comme le note Roger Caillois. Jacques Hassoun aura, lui, cette formule concise et provocatrice : “Pas de Christ, pas de crucifixion, pas de résurrection sans Judas”… (C. Soullard. Op. cit. p. 38). Car Judas, comme Pilate, comme Caïphe et le sanhédrin, ne fut qu'un des instruments manipulés non pas tant par le Diable que par Dieu lui-même. Le deus ex machina utilise Judas à une fin qui ne peut qu'échapper aux acteurs du drame. Il n’y a pas de lecture alternative du Timshel pour Judas comme Yahweh en autorisait une à Caïn. De la démonisation de Judas jusqu’à ce que Borges crée l’identité Jésus/Judas selon le prescription sartrienne : l’enfer, c’est les autres, le XXe siècle a définitivement été tourmenté par cette figure logée dans notre conscience morale avec plus de certitude que son existence historique. Pourquoi ce besoin de rédimer la figure du Traître, la figure de l’abîme et de l’abject et ce, précisément en ce siècle?
 depuis plus d’un
demi-
depuis plus d’un
demi-siècle? Aucun siècle, sinon celui de la démo-cratie, a vu le circuit de Judas se remplir à une quantité effroyable, et avec une qualité toujours de plus en plus horrifiante, d'êtres immondes, abjects qui rendent dérisoire le crime même de Judas. Voilà ce que le catholique «intégriste» Daniel-Rops ne pouvait accepter. Voilà pourquoi il s'obstinait à affirmer que les persécutions des Juifs ne feront jamais oublier leur manque de compassion pour le Crucifié… Et de fait, comment ne pas être honteux de ce siècle, qui a tant manqué de compassion pour ses propres enfants? Comment ce siècle, qui a érigé des charniers de masse aux quatre coins du monde, pourrait-il juger du manque de compassion des citoyens d'une ville du passé pour un seul de ses enfants, tant Dieu fut-il? Comment des
 êtres dits civilisés, occidentalisés, disposant de
techniques raffinées pour gouverner, se laissèrent-ils entraîner par l’appétit de
souffrance qui ne serait que le revers de cet appétit de jouissance, dont le maréchal
Pétain dénonçait les Français et ciblait comme la cause de la défaite militaire
de 1940? En cela, Judas est non seulement une figure de notre temps, mais il est entré en chacun de nous, à la manière dont le Diable était dit être entré en lui. Sauver Judas, pardonner à Judas, le ramener au niveau du martyr, ce n’est
pas tant s’interroger s’il existe un salut pour Hitler ou pour Staline que pour
tous les hommes qui ont laissé faire et se sont même enthousiasmés pour ces
figures démoniaques. Bref, l’angoisse du salut de Judas est devenu l’angoisse
de notre salut pour tout ce que nous laissons faire au nom de la Raison d’État
et des fanatismes idéologiques, lorsque nous préférons l’argent, le pouvoir, l’avoir raison contre la moindre compassion envers l’un des nôtres, fut-il nous-mêmes⌛
êtres dits civilisés, occidentalisés, disposant de
techniques raffinées pour gouverner, se laissèrent-ils entraîner par l’appétit de
souffrance qui ne serait que le revers de cet appétit de jouissance, dont le maréchal
Pétain dénonçait les Français et ciblait comme la cause de la défaite militaire
de 1940? En cela, Judas est non seulement une figure de notre temps, mais il est entré en chacun de nous, à la manière dont le Diable était dit être entré en lui. Sauver Judas, pardonner à Judas, le ramener au niveau du martyr, ce n’est
pas tant s’interroger s’il existe un salut pour Hitler ou pour Staline que pour
tous les hommes qui ont laissé faire et se sont même enthousiasmés pour ces
figures démoniaques. Bref, l’angoisse du salut de Judas est devenu l’angoisse
de notre salut pour tout ce que nous laissons faire au nom de la Raison d’État
et des fanatismes idéologiques, lorsque nous préférons l’argent, le pouvoir, l’avoir raison contre la moindre compassion envers l’un des nôtres, fut-il nous-mêmes⌛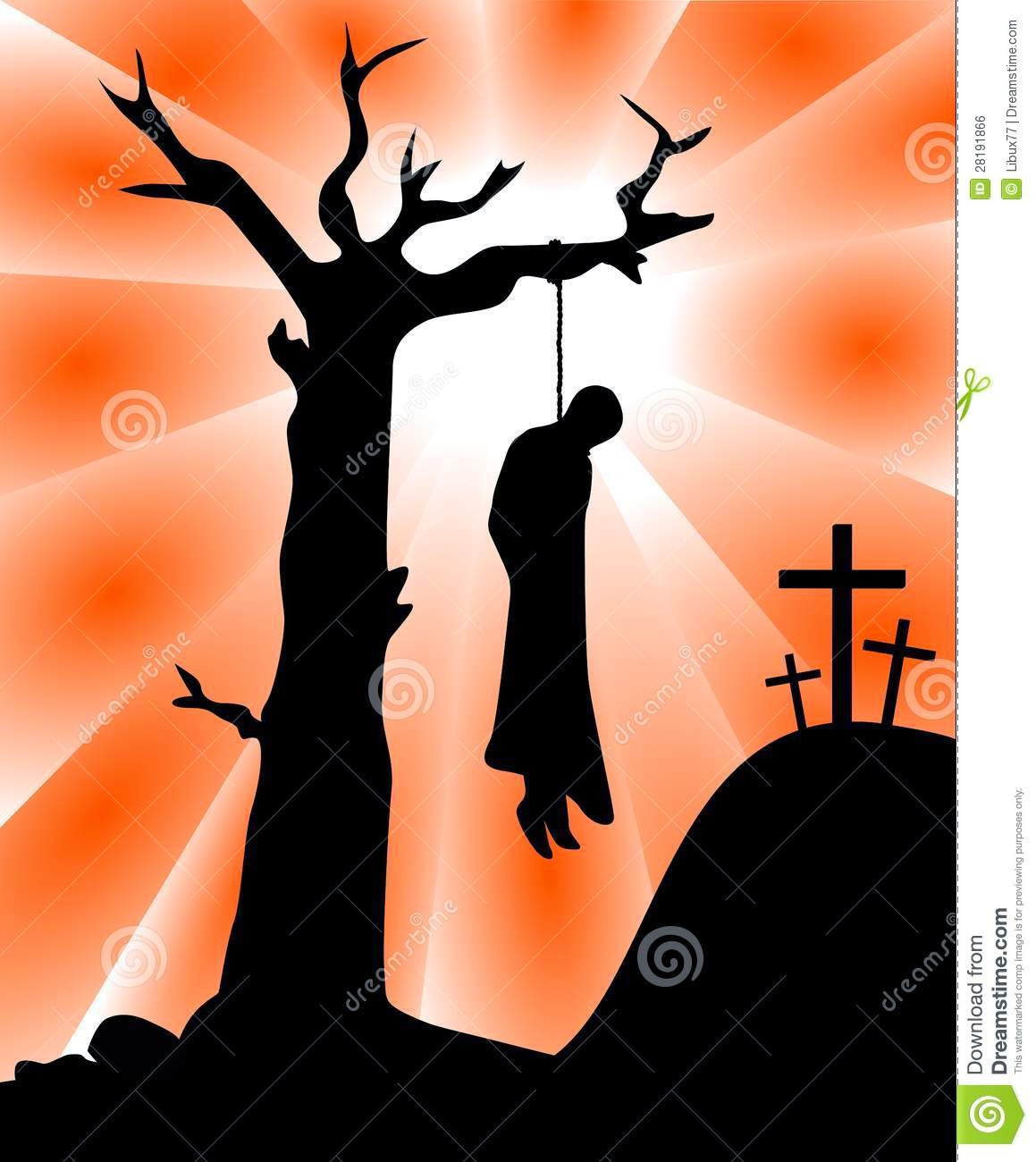

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire