 |
| Giovanni Bastianini buste de Piccarda Donati, 1855. |
DANS LA SPHÈRE DE LA LUNE :
LES VŒUX ROMPUS
Fin
avril 2023. Scandale dans la grande région urbaine de Québec. Les
élus de la Coalition Avenir Québec annoncent à leurs commettants
que la promesse électorale de créer un «troisième lien» entre
les deux rives du Saint-Laurent, entre la ville de
Québec et celle de Lévis – promesse phare d'un projet pharaonique
aux coûts exorbitants – était rompue. (Ce qui n'est rien comparé à l'augmentation faramineuse du salaire des députés qui monte  d'un coup à 25%, plus une prime pour le Premier ministre, ce qui, en temps d'inflation est ignoble et scandaleux. À croire que le budget prévu du troisième lien est passé directement dans la poche des députés?) À une population
banlieusarde qui voulait un tunnel autoroutier accompagné d'un
second tunnel pour le transport en commun (un bitube), le projet se limiterait à une voie de transport en commun. Le parti au pouvoir
(89 députés sur 124) avait fait élire 9 candidats dans 11
circonscriptions locales sur cette promesse hallucinante. Le sentiment d'avoir été
floué par les politiciens draina une colère populaire,
colère feutrée propre aux colères petites bourgeoises.
d'un coup à 25%, plus une prime pour le Premier ministre, ce qui, en temps d'inflation est ignoble et scandaleux. À croire que le budget prévu du troisième lien est passé directement dans la poche des députés?) À une population
banlieusarde qui voulait un tunnel autoroutier accompagné d'un
second tunnel pour le transport en commun (un bitube), le projet se limiterait à une voie de transport en commun. Le parti au pouvoir
(89 députés sur 124) avait fait élire 9 candidats dans 11
circonscriptions locales sur cette promesse hallucinante. Le sentiment d'avoir été
floué par les politiciens draina une colère populaire,
colère feutrée propre aux colères petites bourgeoises.
S'il
fallait projeter dans un cercle du Paradis tous les députés et les partis politiques qui ont
rompu leurs promesses électorales depuis que la démocratie existe, il y
aurait foule dans l'orbite lunaire! Faire des promesses à tout venant est déjà
en soi très petits- bourgeois comme attitude, et s'y laisser prendre, se
plaindre après avoir été les dupes illustrent assez bien
l'immatu-rité politique de nos démocra-ties mo-dernes. Promettre, avec ou
non l'intention de livrer la marchandise, est une dégradation de la
conception chrétienne du vœu. Un vœu est une
promesse faite à Dieu par laquelle le postulant à une vie
religieuse s'engageait à quelque œuvre qu'il croyait Lui être
agréable; une œuvre qui n'était pas un précepte,
c'est-à-dire une prescription, une obligation. Le vœu authentique se caractérise par sa volonté libre et sa gratuité. Les trois vœux cardinaux - la pauvreté, l'obéissance et la chasteté - étaient prononcés au moment de l'ordination des postulants, à quoi les Jésuites en rajoutèrent un quatrième, un vœu les liant à l'obéissance immédiate et sans intermédiaire au Souverain Pontife.
bourgeois comme attitude, et s'y laisser prendre, se
plaindre après avoir été les dupes illustrent assez bien
l'immatu-rité politique de nos démocra-ties mo-dernes. Promettre, avec ou
non l'intention de livrer la marchandise, est une dégradation de la
conception chrétienne du vœu. Un vœu est une
promesse faite à Dieu par laquelle le postulant à une vie
religieuse s'engageait à quelque œuvre qu'il croyait Lui être
agréable; une œuvre qui n'était pas un précepte,
c'est-à-dire une prescription, une obligation. Le vœu authentique se caractérise par sa volonté libre et sa gratuité. Les trois vœux cardinaux - la pauvreté, l'obéissance et la chasteté - étaient prononcés au moment de l'ordination des postulants, à quoi les Jésuites en rajoutèrent un quatrième, un vœu les liant à l'obéissance immédiate et sans intermédiaire au Souverain Pontife.
Dans le Chant V du Paradis, Dante écrit : «Le plus grand don que Dieu ait accordé, en vous créant, le don qu'il apprécie le plus, et qui est le plus conforme à sa bienfaisance, est la liberté de la volonté. Ce bienfait a été accordé seulement à toutes les créatures intelligentes» (Le Paradis, chant V. Dante Alighieri. La Divine Comédie, Verviers, Gérard & Cie, Col. Marabout Géant, # G1, s.d., p. 323). Le vœu répond au don divin de la liberté de la volonté. Dans la mesure où cette volonté se fait gratuite - qu'elle devient à son tour un don -, elle répond à la grâce divine. Le vœu prend cet aspect sacré qui engage l'intégrité et la responsabilité du croyant. En tant que promesse faite à Dieu, bien entendu, mais aussi promesse faite d'abord à soi-même. Une promesse qui est une ferme résolution, un engagement qu'on a pris de faire (ou ne pas faire) une action.
Les vœux sont donc des promesses, mais des promesses imbues d'une sacralité qui prend Dieu à témoin de la sincérité des intentions et l'accomplissement des résolutions. Depuis longtemps, on ne trouve plus pareilles intentions dans les promesses de nos politiciens.  Tout au plus y trouve-t-on la volonté de satisfaire une attente publique. Dans le monde médiéval - dans la chevalerie comme dans le clergé -, les vœux ne se prononçaient pas à la légère et encore moins sur des choses aussi triviales qu'une autoroute routière pour satisfaire des banlieusards! Ainsi, les vœux, contrairement aux promesses modernes, ne se rompaient pas sans avoir des effets lourds de conséquences sur les consciences humaines.
Tout au plus y trouve-t-on la volonté de satisfaire une attente publique. Dans le monde médiéval - dans la chevalerie comme dans le clergé -, les vœux ne se prononçaient pas à la légère et encore moins sur des choses aussi triviales qu'une autoroute routière pour satisfaire des banlieusards! Ainsi, les vœux, contrairement aux promesses modernes, ne se rompaient pas sans avoir des effets lourds de conséquences sur les consciences humaines.
Dante l'enseignera à ses lecteurs : «Que les mortels ne se fassent pas un jeu de leurs promesses. Soyez fidèles, mais jamais inconsidérés, comme Jephté dans sa première générosité : 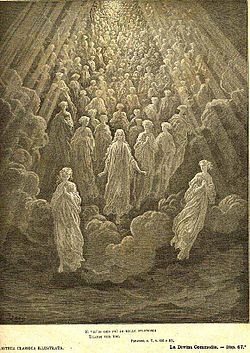 à qui cependant convenait-il plus de dire : J'ai mal fait, et en accomplissant ma promesse, je ferai plus mal? Il ne fut pas moins insensé, le grand chef des Grecs que ne fléchirent pas les larmes répandues sur le beau visage d'Iphigénie, et qui fit pleurer sur le sort de cette princesse les fous et les sages qui entendirent parler d'un vœu si barbare» (Chant V. ibid. p. 324). Arrêtons-nous sur ces deux cas; Jephté d'abord, Iphigénie ensuite. Des cas mythologiques qui permettent de mesurer la gravité d'un vœu et surtout si ces vœux sont prononcés à la légère, sans réflexion sur leurs réelles conséquences à long terme.
à qui cependant convenait-il plus de dire : J'ai mal fait, et en accomplissant ma promesse, je ferai plus mal? Il ne fut pas moins insensé, le grand chef des Grecs que ne fléchirent pas les larmes répandues sur le beau visage d'Iphigénie, et qui fit pleurer sur le sort de cette princesse les fous et les sages qui entendirent parler d'un vœu si barbare» (Chant V. ibid. p. 324). Arrêtons-nous sur ces deux cas; Jephté d'abord, Iphigénie ensuite. Des cas mythologiques qui permettent de mesurer la gravité d'un vœu et surtout si ces vœux sont prononcés à la légère, sans réflexion sur leurs réelles conséquences à long terme.
Jephté était l'un des juges d'Israël à une époque où les cultes de Baal et d'Astarté résistaient à la judaïsation des Hébreux. Comme toujours, parce  que Dieu aime son peuple élu (!), il décida de le punir en le livrant aux ambitions conqué-rantes des Philistins et des Ammoni-tes. Jephté était fils adultère de Galaad et d'une prostituée. Ses demi-frères, nés du mariage légitime de leur père, le chassèrent de la maison paternelle et Jephté partit vivre dans le pays de Tob. Mais la guerre déclarée aux Hébreux par les Ammonites le ramène pour conduire les armées d'Israël. Ce retour et ses victoires militaires contre les ennemis de la nation vont faire de lui l'un des grands juges de la tradition biblique.
que Dieu aime son peuple élu (!), il décida de le punir en le livrant aux ambitions conqué-rantes des Philistins et des Ammoni-tes. Jephté était fils adultère de Galaad et d'une prostituée. Ses demi-frères, nés du mariage légitime de leur père, le chassèrent de la maison paternelle et Jephté partit vivre dans le pays de Tob. Mais la guerre déclarée aux Hébreux par les Ammonites le ramène pour conduire les armées d'Israël. Ce retour et ses victoires militaires contre les ennemis de la nation vont faire de lui l'un des grands juges de la tradition biblique.
Qui étaient ces juges? C'étaient des «personnalités dirigeantes en Israël à l'époque des attributions de territoire et avant la création de la royauté vers 1200-1000 av. J.- C. Les juges remplirent la fonction de la juridiction au sein des diffé-rentes amphic-tyonies de clans ou groupes de tribus. De plus, ils jouaient le rôle de stratèges militaires dans les combats contre des ennemis extérieurs et veillaient à l'observation des cultes religieux» (Collectif. Dictionnaire illustré de la Bible, Paris, Bordas, 1990, p. 359). Ils se situaient quelque part entre l'établissement en Palestine des Hébreux encore nomades - après Moïse, Aaron et Josué -, et l'élection de Saül à la royauté. C'est donc en tant que stratège militaire que Jephté dut son rappel en Israël.
C. Les juges remplirent la fonction de la juridiction au sein des diffé-rentes amphic-tyonies de clans ou groupes de tribus. De plus, ils jouaient le rôle de stratèges militaires dans les combats contre des ennemis extérieurs et veillaient à l'observation des cultes religieux» (Collectif. Dictionnaire illustré de la Bible, Paris, Bordas, 1990, p. 359). Ils se situaient quelque part entre l'établissement en Palestine des Hébreux encore nomades - après Moïse, Aaron et Josué -, et l'élection de Saül à la royauté. C'est donc en tant que stratège militaire que Jephté dut son rappel en Israël.
Jephté apparaît bien comme l'un de ces Hébreux durant la phase intermédiaire entre la fin des cultes païens et le nouveau monothéisme. En témoigne ce vœu d'offrir en sacrifice à .jpg) Yahweh - un sacrifice humain - advenant la victoire. Décidé-ment, c'était aller contre la leçon donnée jadis à Abraham à qui l'ange avait retiré le couteau des mains au moment où il allait sacrifier son fils unique, Isaac. À la manière des disciples des Baal et Astarté, Jephté entendait sacrifier en holocauste d'action de grâces «celui qui, de [sa] maison, sortirait à [sa] rencontre». C'était se lier à une divinité qui avait pourtant proscrit les serments faits en son nom et qui le mit en charge d'exaucer ce terrible vœu :
Yahweh - un sacrifice humain - advenant la victoire. Décidé-ment, c'était aller contre la leçon donnée jadis à Abraham à qui l'ange avait retiré le couteau des mains au moment où il allait sacrifier son fils unique, Isaac. À la manière des disciples des Baal et Astarté, Jephté entendait sacrifier en holocauste d'action de grâces «celui qui, de [sa] maison, sortirait à [sa] rencontre». C'était se lier à une divinité qui avait pourtant proscrit les serments faits en son nom et qui le mit en charge d'exaucer ce terrible vœu :
«Victorieux, il le sera certes, infligeant une écrasante défaite, dans la région de
Rabba ("depuis Aroër et les abords de Minnit"), aux Ammonites qu'il poursuivra vers le sud jusqu'à Abel-Keramin. Mais quand il revient triomphant à Miçpa, c'est sa fille, son unique enfant, qui sort vers lui de sa maison en fête, "dansant au son des tambourins". Convaincu que nul ne se peut dédire d'une promesse faite à Dieu, aussi folle soit-elle, le malheureux père va tenir parole. Consentante, sa fille obtient pourtant un sursis de deux mois, employé par elle à pleurer dans les montagnes avoisinantes, en compagnie de ses amies, sur la vie d'épouse et de mère qu'elle avait espérée et qu'elle ne connaîtra jamais. À son retour, le sacrifice a lieu» (A.-M. Gerard. Dictionnaire de la Bible, Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, p. 603).
 garder sa virginité. L'énoncé littéral du texte est pourtant clair : «À la fin des deux mois elle revint chez son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Or elle n'avait pas connu d'homme et cela devint une coutume en Israël que d'année en année les fils d'Israël aillent célébrer la fille de Jephté le Galaadite, quatre jours par an» (Jg 11, 39-40). Le détail n'est pas sans importance, car il informe que non seulement Jephté eut à mettre à mort sa propre fille, mais qu'en plus, Jephté, fils bâtard de son père, devait renoncer à toute postérité, ce qui multipliait à l'infini le châtiment. Jephté figure depuis en tête d'une longue liste de juges dont la faculté de juger n'a jamais été au mieux de leurs compétences.
garder sa virginité. L'énoncé littéral du texte est pourtant clair : «À la fin des deux mois elle revint chez son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Or elle n'avait pas connu d'homme et cela devint une coutume en Israël que d'année en année les fils d'Israël aillent célébrer la fille de Jephté le Galaadite, quatre jours par an» (Jg 11, 39-40). Le détail n'est pas sans importance, car il informe que non seulement Jephté eut à mettre à mort sa propre fille, mais qu'en plus, Jephté, fils bâtard de son père, devait renoncer à toute postérité, ce qui multipliait à l'infini le châtiment. Jephté figure depuis en tête d'une longue liste de juges dont la faculté de juger n'a jamais été au mieux de leurs compétences. Antigone, le sort d'Iphigénie est sans doute l'un des plus émou-vants de la tragédie grecque. Il est bon toutefois de rappeler que le récit du sacrifice d'Iphigé-nie est tardif. Homère, semble-t-il, ne l'a pas connu. Il appartient à la Kypria, l'un des cycles qui se sont développés dans la continuité de l'Iliade. Ainsi, Iphigénie est la fille d'Agamemnon, roi de Mycènes, l'un des princes coalisés partis en guerre contre Troie afin de ramener Hélène, épouse de son frère Ménélas. Sa mère est Clytemnestre et, par le fait même, elle est la sœur d'Électre et d'Oreste, héros d'un autre cycle dégagé de l'intrigue homérique.
Antigone, le sort d'Iphigénie est sans doute l'un des plus émou-vants de la tragédie grecque. Il est bon toutefois de rappeler que le récit du sacrifice d'Iphigé-nie est tardif. Homère, semble-t-il, ne l'a pas connu. Il appartient à la Kypria, l'un des cycles qui se sont développés dans la continuité de l'Iliade. Ainsi, Iphigénie est la fille d'Agamemnon, roi de Mycènes, l'un des princes coalisés partis en guerre contre Troie afin de ramener Hélène, épouse de son frère Ménélas. Sa mère est Clytemnestre et, par le fait même, elle est la sœur d'Électre et d'Oreste, héros d'un autre cycle dégagé de l'intrigue homérique. archaïque, la guerre et la royauté étaient des insti-tutions inébranla-bles, struc-turantes des ordres comme de la société civile. Aussi, Ménélas a-t-il contraint tous les rois grecs à honorer le serment de ramener son épouse, Hélène, enlevée par Pâris, le fils du roi de Troie, Priam. Mais lorsque Agamemnon tente de lancer la flotte grecque réunie à Aulis vers les côtes de la Grèce du Levant, les vents se montrent défavorables. Calchas, le devin, révèle qu'une offense commise par Agamemnon contre la déesse Artémis en est la cause :
archaïque, la guerre et la royauté étaient des insti-tutions inébranla-bles, struc-turantes des ordres comme de la société civile. Aussi, Ménélas a-t-il contraint tous les rois grecs à honorer le serment de ramener son épouse, Hélène, enlevée par Pâris, le fils du roi de Troie, Priam. Mais lorsque Agamemnon tente de lancer la flotte grecque réunie à Aulis vers les côtes de la Grèce du Levant, les vents se montrent défavorables. Calchas, le devin, révèle qu'une offense commise par Agamemnon contre la déesse Artémis en est la cause :«Calchas prédit qu'elle [la flotte] serait dans l'impossibilité de partir à moins qu'Agamemnon ne sacrifie la plus belle de ses filles à Artémis. La raison pour laquelle Artémis aurait été offensée est controversée; certains disent qu'un jour, ayant tiré un cerf de très loin, Agamemnon se serait écrié orgueilleusement : "Artémis elle-même n'aurait pas pu faire mieux!" Ou bien qu'il avait tué sa chèvre sacrée; ou bien qu'il aurait promis de lui offrir la plus belle créature vivante née cette année-là dans son royaume et que ce fut Iphigénie; ou encore que son pèreAtrée avait conservé un agneau d'or qui lui appar-tenait. Toujours est-il qu'Aga-memnon refusa de faire ce qu'on lui demandait, en disant que Clytem-nestre ne laisserait jamais partir Iphigénie. Mais lorsque les Grecs eurent décidé : "Nous allons prêter serment d'allégeance à Palamède, s'il s'obstine à refuser", et lorsque Odysseus, stimulant la colère, se prépara à rentrer dans sa patrie, Ménélas vint en médiateur pour rétablir la paix entre eux. Il suggéra qu'Odysseus et Talthybios aillent chercher Iphigénie et l'amènent à Aulis sous le prétexte de la donner en mariage à Achille en récompense de ses exploits en Mysie. Agamemnon accepta cette ruse, et, bien qu'il ait aussitôt envoyé secrètement un message à Clytemnestre l'avertissant de ne pas croire ce qu'Odysseus lui dirait, Ménélas ayant intercepté le message, elle fut trompée et laissa partir Iphigénie pour Aulis» (R. Graves. Les mythes grecs, t. 2, Paris, Fayard, Col. Pluriel, # 8399, 1967, p. 287).
Lorsque Achille découvrit qu'on avait usé de son nom pour une mauvaise action, il décida de protéger Iphigénie. Mais la jeune fille consentit noblement à mourir pour
la gloire de la Grèce et offrit sa nuque à la hache du sacrifice sans une plainte. Certains disent qu'Arté-mis l'enleva en un clin d'œil à Chersonnèse, en Tauride, et lui substitua une biche sur l'autel; ou bien une ourse; ou bien une vieille femme. D'autres qu'il y eut un coup de tonnerre et que, sur l'ordre d'Artémis et sur la prière de Clytemnestre, Achille intervint, sauva Iphigénie et l'envoya sur Scythie; ou bien qu'il l'épousa et que c'est elle et non pas Deidamie qui lui donna Néoptolème. Quoi qu'il en soit d'Iphigénie, le fait est que le vent de nord-est cessa de souffler et la flotte se mit en route, enfin» (R. Graves. ibid. pp. 287-288).
On le voit, c'est bien avant l'affaire du cheval de Troie qu'Ulysse (Odysseus) s'était fait une réputation de rusé compagnon. Comme pour les docteurs juifs, toutefois, le sort d'Iphigénie créait 
De victime sacrifiée, Artémis fit d'Iphigénie une prêtresse chargée de sacrifier à son tour tous les étrangers qui aborderaient la Tauride. Plusieurs années après, Oreste, son frère _-_Oreste_et_Iphig%C3%A9nie_enlevant_la_statue_de_Diane_Taurique.jpg) qu'elle crût mort, et son ami Pylade abordè-rent la Tauride, obéissant à l'oracle de Delphes qui leur avait ordonné d'empor-ter la statue d'Artémis. Iphigénie les reconnut et les aida à s'échapper avec la statue. Poursuivis, ils furent aidés cette fois par la déesse Athéna et finalement purent retourner tous les trois en Grèce. Iphigénie aurait été vénérée dans le sanctuaire d'Artémis au sud-est d'Athènes, où elle y aurait fini ses jours en tant que prêtresse (kleidouchos). Euripide rapporte qu'à sa mort, les vêtements des femmes mortes en couches lui auraient été consacrés.
qu'elle crût mort, et son ami Pylade abordè-rent la Tauride, obéissant à l'oracle de Delphes qui leur avait ordonné d'empor-ter la statue d'Artémis. Iphigénie les reconnut et les aida à s'échapper avec la statue. Poursuivis, ils furent aidés cette fois par la déesse Athéna et finalement purent retourner tous les trois en Grèce. Iphigénie aurait été vénérée dans le sanctuaire d'Artémis au sud-est d'Athènes, où elle y aurait fini ses jours en tant que prêtresse (kleidouchos). Euripide rapporte qu'à sa mort, les vêtements des femmes mortes en couches lui auraient été consacrés.
Il est possible de retracer les origines étymologiques primitives d'Iphigénie (née de la force). Comme Edwin Rhode le suppose :
«Iphigénie était sans doute le surnom d'une déesse lunaire, mais le poète qui a raconté le rapt de la fille d'Agamemnon n'avait certainement pas la moindre idéede son identité avec une déesse – autre-ment, il ne l'aurait évidem-ment pas tenue pour la fille d'Aga-memnon – et, comme bien l'on peut croire, ce n'est pas pour avoir rencontré quelque part un culte rendu à la divine Iphigénie qu'il en est venu à rendre de nouveau immortelle, par quelque jus postliminii, son Iphigénie mortelle au moyen de l'enlèvement. Ce qui était l'important pour lui et pour ses contemporains, ce qui constituait le centre proprement dit de son récit – que ce récit ait été librement inventé ou qu'il fût composé de motifs déjà existants – c'est qu'il racontait l'élévation d'une jeune fille mortelle, née de parents mortels, à la vie immortelle, sans en faire l'objet d'une adoration que l'on n'aurait pu lui témoigner d'aucune manière, puisqu'elle était reléguée dans la lointaine Tauride» (E. Rhode. Psyché, Paris, Payot, Col Bibliothèque scientifique, 1952, pp. 73-74).
 où celle de Jephté se montrait résignée : «Le vieux serviteur, auquel il confie la
lettre, l'admoneste avec douceur : "Il est inévitable que tu
éprouves tour à tour joie et douleur, car tu es un homme et, que tu
le veuilles ou non, tel est l'arrêt des dieux". Ainsi
réapparaît d'emblée cette vérité première : les choses
d'ici-bas sont marquées d'un indice de néant, soit que la peine
habite au sein de la joie, soit qu'elle lui succède nécessairement»
(R. Schaerer. L'homme antique et la structure du monde
intérieur, Paris, Payot, Col.
Bibliothèque historique, 1958, p. 274). La poésie d'Euripide aurait
été incompréhensible aux oreilles des Grecs de l'époque
archaïque. Ainsi la résistance d'Agamemnon : «Une belle
entreprise! Répond le roi, qui a pour prix le meurtre d'un enfant.
Si la Grèce et toi vous l'approuvez, c'est que vous êtes malades
par la volonté des dieux» (R.
Schaerer. ibid. p. 274). Ménélas
peut bien se laisser convaincre, mais Agamemnon reste celui qui est
au centre de la colère d'Artémis. Du héros dont on célèbre le
courage, le voici complètement désemparé :
où celle de Jephté se montrait résignée : «Le vieux serviteur, auquel il confie la
lettre, l'admoneste avec douceur : "Il est inévitable que tu
éprouves tour à tour joie et douleur, car tu es un homme et, que tu
le veuilles ou non, tel est l'arrêt des dieux". Ainsi
réapparaît d'emblée cette vérité première : les choses
d'ici-bas sont marquées d'un indice de néant, soit que la peine
habite au sein de la joie, soit qu'elle lui succède nécessairement»
(R. Schaerer. L'homme antique et la structure du monde
intérieur, Paris, Payot, Col.
Bibliothèque historique, 1958, p. 274). La poésie d'Euripide aurait
été incompréhensible aux oreilles des Grecs de l'époque
archaïque. Ainsi la résistance d'Agamemnon : «Une belle
entreprise! Répond le roi, qui a pour prix le meurtre d'un enfant.
Si la Grèce et toi vous l'approuvez, c'est que vous êtes malades
par la volonté des dieux» (R.
Schaerer. ibid. p. 274). Ménélas
peut bien se laisser convaincre, mais Agamemnon reste celui qui est
au centre de la colère d'Artémis. Du héros dont on célèbre le
courage, le voici complètement désemparé :«Vains efforts, hélas, espoir déçu de l'éloigner de ce qu'elle va voir!Pour tromper ce que j'ai de plus cher,je m'ingénie en ruses et chaque fois j'échoue.Cependant, je vais consulter le devin Calchaspour savoir comment satisfaire au vœu de la déessequi fait tout mon malheur et pèse sur les Grecs.Le sage ne doit mettre en son logisqu'une femme bonne et docile, ou bien n'en point avoir» (Euripide. Tragédies, t. 2, Paris, Gallimard, rééd Livre de poche Col. Classiques, # 2755, 1962, p. 371).
«Hélas, le roi ne répond aux pleurs de sa femme et de sa fille que par ces mots : Je ne puis  autrement; l'armée se révolterait» (cité in R. Schaerer. ibid. p. 275). Ce à quoi Iphigénie répond : «À quoi bon m'obstiner à tenter l'impossible».
On croirait même entendre une chrétienne lorsqu'elle «réconcilie
la terre et le ciel, réhabilite les valeurs morales, réalise un
cosmos viable. "Mon sort est heureux, dit-elle, et je sauve la
Grèce"» (R. Schaerer.
ibid. p. 276). Seule une intervention surnaturelle peut venir à bout
de tant de dilemmes insolubles. En remplaçant Iphigénie par une
biche, Artémis résout l'impasse où elle avait enfermé les
humains.
autrement; l'armée se révolterait» (cité in R. Schaerer. ibid. p. 275). Ce à quoi Iphigénie répond : «À quoi bon m'obstiner à tenter l'impossible».
On croirait même entendre une chrétienne lorsqu'elle «réconcilie
la terre et le ciel, réhabilite les valeurs morales, réalise un
cosmos viable. "Mon sort est heureux, dit-elle, et je sauve la
Grèce"» (R. Schaerer.
ibid. p. 276). Seule une intervention surnaturelle peut venir à bout
de tant de dilemmes insolubles. En remplaçant Iphigénie par une
biche, Artémis résout l'impasse où elle avait enfermé les
humains.
On
voit comment la tragédie grecque développe en profondeur ce que le
texte hébraïque tient en surface : la désobéissance de Jephté et son  étourderie (le vœu et l'holocauste). Le malheureux
Agamemnon, jouet de la déesse et prisonnier de la coalition
militaire, est forcé à un vœu qui va contre sa volonté. Dans Le
livre des Juges, Yahweh refuse à
Jephté ce qu'il avait concédé à Abraham. Il devra immoler sa
fille. Dans la tragédie d'Euripide, la déesse soustraira la fille
d'Agamemnon pour en faire sa prêtresse dans la lointaine Tauride.
Entre le XIe siècle avant J.-C. (date de la rédaction du livre de
Jephté) et le Ve siècle av. J.-C. (la Grèce classique d'Euripide),
une évolution marquée de la civilisation conduisait de
l'impitoyable courroux où avait conduit le manque de jugement de
Jephté vers une alternative qui, s'il n'annonce pas le salut
chrétien, permet au moins de sauver la vie d'Iphigénie tout en maintenant
l'accomplissement du vœu de son père.
étourderie (le vœu et l'holocauste). Le malheureux
Agamemnon, jouet de la déesse et prisonnier de la coalition
militaire, est forcé à un vœu qui va contre sa volonté. Dans Le
livre des Juges, Yahweh refuse à
Jephté ce qu'il avait concédé à Abraham. Il devra immoler sa
fille. Dans la tragédie d'Euripide, la déesse soustraira la fille
d'Agamemnon pour en faire sa prêtresse dans la lointaine Tauride.
Entre le XIe siècle avant J.-C. (date de la rédaction du livre de
Jephté) et le Ve siècle av. J.-C. (la Grèce classique d'Euripide),
une évolution marquée de la civilisation conduisait de
l'impitoyable courroux où avait conduit le manque de jugement de
Jephté vers une alternative qui, s'il n'annonce pas le salut
chrétien, permet au moins de sauver la vie d'Iphigénie tout en maintenant
l'accomplissement du vœu de son père.
Avec le christianisme, rompre un vœu apparaît comme une sorte d'apostasie. Le geste revêt ainsi une gravité qui était déjà assez lourdes de conséquences dans le judaïsme. À l'origine, le christianisme se présentait sous deux formes assez distinctes. Une première, dite mystico-ontologique, prévoyait le Second Avènement du Christ, annoncé dans l'Apocalypse, pour prochain. Devant l'attente qui apparaissait ne pas devoir se réaliser prochainement se développa une seconde tradition, dite éthico-pédagogique. La première forme prédomina au cours des deux premiers siècles de l'ère chrétienne, puis la seconde s'imposa au fur et à mesure que les Chrétiens durent composer avec l'État impérial et les mœurs romaines. Ainsi, le christianisme occidental engageait l'Église dans un développement qui ne lui avait pas été prévu par la première génération de chrétiens. Cette distinction serait à l'origine des deux christianismes, celui d'Orient porté fortement vers le mysticisme, et celui d'Occident inspiré du rationalisme gréco-romain.
 C'est à Antioche, au Proche-Orient, au IIe siècle que se fixe ce choix, lorsque les repré-sentants de la tendance mystico-ontologique - les sectes gnostiques -, se heurtent à l'évêque-martyr Ignace sur l'attitude à tenir à l'égard des persécutions païennes. Pour ce dernier, «l'unique moyen de déjouer les ruses de Satan qui inspire ces bêtes fauves à face humaine [les persécuteurs], c'est l'obéissance à l'autorité constituée» (A. Bouché-Leclercq. L'intolérance religieuse et la politique, Paris, Flammarion, 1911), qu'importe son attitude envers la communauté des croyants. Cette politique fut reprise plus tard par un autre Ignace, Ignace de Loyola.
C'est à Antioche, au Proche-Orient, au IIe siècle que se fixe ce choix, lorsque les repré-sentants de la tendance mystico-ontologique - les sectes gnostiques -, se heurtent à l'évêque-martyr Ignace sur l'attitude à tenir à l'égard des persécutions païennes. Pour ce dernier, «l'unique moyen de déjouer les ruses de Satan qui inspire ces bêtes fauves à face humaine [les persécuteurs], c'est l'obéissance à l'autorité constituée» (A. Bouché-Leclercq. L'intolérance religieuse et la politique, Paris, Flammarion, 1911), qu'importe son attitude envers la communauté des croyants. Cette politique fut reprise plus tard par un autre Ignace, Ignace de Loyola.
Malgré les apparences, ce conflit des tendances n'en est pas un d'ordre géographique. Si l'Orient et l'Occident semblent choisir très tôt des voies opposées, c'est à l'intérieur de tout le christianisme que se dessine la rivalité antagonique des deux formes. Là où la brisure se produit, c'est d'abord entre les théologiens chargés de répondre aux poussées gnostiques et l'affirmation de la hiérarchie cléricale :
«Il est remarquable qu'une pareille similitude d'attitudes se rencontre à la même date en Afrique, en Asie, à Rome, à Alexandrie. C'est un même christianismeeschatologique qui s'exprime. Origène, Tertullien, Hippolyte ont une même indifférence à l'égard du destin de la cité terrestre. Ce qu'ils en espèrent, c'est le martyre, qui manifestera son incompatibilité avec la cité de Dieu. Avec lui, la cité terrestre leur paraît déjà condamnée. Il est inutile d'assurer sa perpétuité en engendrant des enfants, d'assurer sa défense en s'enrôlant dans l'armée. Tout cela relève d'un monde périmé. La cité chrétienne, déjà présente et qui va être bientôt manifestée, demande la chasteté des sages et l'amour universel. Il faut avant tout ne pas faire de concessions. Ce christianisme n'est pas tout le christianisme du temps. Et en particulier il n'est pas celui des évêques. On rencontre chez ceux-ci un souci plus grand du salut du plus grand nombre, la sollicitude du pasteur pour son peuple, la recherche du christianisme réaliste, le désir d'un accord avec les pouvoirs... Le conflit est le même : celui d'intellectuels épris d'une Église idéale, avec des pasteurs conscients des conditions de l'Église réelle» (J. Daniélou et H.-I. Marrou. Nouvelle histoire de l'Église, t. 1 des origines à Saint Grégoire le Grand, Paris, Seuil, 1963, pp. 172-173).
Contre la tendance eschatologique forte au premier siècle de notre ère, les évêques se chargent de guider le peuple de Dieu entre les incertitudes de la cité terrestre et de l'ouvrir à la conscience historique : «A different and much more complex move occurs in Didache 11-13, and it represents that community's eventual preference for residency over itinerancy and for local bishops and deacons over wandering apostles, prophets, and  teachers...» (J. D. Crossan. The historical Jesus, San Francisco, Harper/Collins, 1992). Si les deux courants étaient également persécutés par les autorités romaines, la réconciliation avec l'empereur païen ne ferait que polariser la division à l'intérieur de la communauté chrétienne. C'est autour de la question des lapsi, ces chrétiens qui sous la menace avaient renié leur foi et des traditor, ces évêques «collaborateurs» qui avaient livré les Livres Saints à leurs persécuteurs - la traditio - qu'allaient s'affronter les deux traditions, et cela non sans violence. Doit-on réhabiliter au sein de la communauté africaine les traîtres des mauvais jours? Comme nombre de ces lapsi sont des citoyens aisés et influents, bien établis dans les postes publics de l'Empire, les papes Zéphyrin (martyr en 217) et Calixte (martyr en 222) préfèrent rester en bons termes avec eux. Et le temps de la «révolution constantinienne» est encore loin, l'État peut toujours revenir à une politique anti-chrétienne comme ce fut le cas sous Septime Sévère, aussi, était-ce là politique de prudence.
teachers...» (J. D. Crossan. The historical Jesus, San Francisco, Harper/Collins, 1992). Si les deux courants étaient également persécutés par les autorités romaines, la réconciliation avec l'empereur païen ne ferait que polariser la division à l'intérieur de la communauté chrétienne. C'est autour de la question des lapsi, ces chrétiens qui sous la menace avaient renié leur foi et des traditor, ces évêques «collaborateurs» qui avaient livré les Livres Saints à leurs persécuteurs - la traditio - qu'allaient s'affronter les deux traditions, et cela non sans violence. Doit-on réhabiliter au sein de la communauté africaine les traîtres des mauvais jours? Comme nombre de ces lapsi sont des citoyens aisés et influents, bien établis dans les postes publics de l'Empire, les papes Zéphyrin (martyr en 217) et Calixte (martyr en 222) préfèrent rester en bons termes avec eux. Et le temps de la «révolution constantinienne» est encore loin, l'État peut toujours revenir à une politique anti-chrétienne comme ce fut le cas sous Septime Sévère, aussi, était-ce là politique de prudence.
 Face à eux, saint Hippolyte, lui-même évêque, repré-sentait la tendance opposée, refusant tout com-promis et toute confiance en ceux qui avaient déjà trahis une fois. On voit que le débat est davantage d'ordre politique que religieux. D'ordre politique intérieure surtout, vue que «l'Église de Rome est divisée à ce moment entre deux tendances. Elle est agitée par un courant apocalyptique. Ce courant se rattache à des caractères anciens de l'Église... Et ces tendances traditionnelles sont activées par la propagande montaniste. Par ailleurs il y a un autre courant également traditionnel, que l'on trouve principalement dans la hiérarchie. Il s'inspire d'une attitude de modération, cherche surtout
Face à eux, saint Hippolyte, lui-même évêque, repré-sentait la tendance opposée, refusant tout com-promis et toute confiance en ceux qui avaient déjà trahis une fois. On voit que le débat est davantage d'ordre politique que religieux. D'ordre politique intérieure surtout, vue que «l'Église de Rome est divisée à ce moment entre deux tendances. Elle est agitée par un courant apocalyptique. Ce courant se rattache à des caractères anciens de l'Église... Et ces tendances traditionnelles sont activées par la propagande montaniste. Par ailleurs il y a un autre courant également traditionnel, que l'on trouve principalement dans la hiérarchie. Il s'inspire d'une attitude de modération, cherche surtout  à maintenir les contacts entre les différents groupes de la communauté, est porté à une certaine indulgence, se soucie de bons rapports avec le pouvoir impérial. [...] Zéphyrin et Calixte ne sont pas des intellectuels, mais des hommes d'action. Sous leur pontificat l'Église a fait d'énormes progrès. Elle a gagné les sympathies du pouvoir impérial. Elle s'est considérablement étendue numériquement. Ce développement impliquait une adaptation de la discipline à ces circonstances nouvelles. C'est tout cela que refuse Hippolyte. Il rêve d'une Église qui soit une poignée de saints en conflit avec le monde, pauvres, sans biens. Mais les pasteurs, qui ont changé des âmes ne peuvent accepter cette vision. À un peuple chrétien qui grandit, il faut des institutions» (J. Daniélou et H.-I. Marrou. ibid. pp. 181-182). L'Église s'éloignait de son orientation eschatologique pour s'engager dans «le sens de l'histoire». L'apaisement était donc de mise afin de permettre l'institutionnalisation indispensable.
à maintenir les contacts entre les différents groupes de la communauté, est porté à une certaine indulgence, se soucie de bons rapports avec le pouvoir impérial. [...] Zéphyrin et Calixte ne sont pas des intellectuels, mais des hommes d'action. Sous leur pontificat l'Église a fait d'énormes progrès. Elle a gagné les sympathies du pouvoir impérial. Elle s'est considérablement étendue numériquement. Ce développement impliquait une adaptation de la discipline à ces circonstances nouvelles. C'est tout cela que refuse Hippolyte. Il rêve d'une Église qui soit une poignée de saints en conflit avec le monde, pauvres, sans biens. Mais les pasteurs, qui ont changé des âmes ne peuvent accepter cette vision. À un peuple chrétien qui grandit, il faut des institutions» (J. Daniélou et H.-I. Marrou. ibid. pp. 181-182). L'Église s'éloignait de son orientation eschatologique pour s'engager dans «le sens de l'histoire». L'apaisement était donc de mise afin de permettre l'institutionnalisation indispensable.
C'est finalement saint Cyprien évêque de Carthage qui ramène le débat au niveau de la sphère religieuse en liant subtilement l'angoisse de la souffrance du martyre à la tentation sexuelle : «Cyprien parlait des chrétiens de Carthage et de Rome comme d'un groupe  confronté au saeculum in acie constituti, "enligne de bataille", au cours de la six millième année de guerre du diable contre l'espèce humaine. Quelque chose comme une "mollesse efféminée affectant la vigueur du propos chrétien" pouvait constituer un désastre pour l'Église. Cette préoccupation majeure détermina la vision du corps que Cyprien légua à Ambroise, Jérôme et Augustin, et dont l'efficacité fut décisive. La "chair" du chrétien était un rempart contre le saeculum. Celle-ci pouvait être "consacrée au Christ", comme dans le cas d'une fille ou d'un garçon demeurés vierges. Il importait infiniment de protéger l'intégrité du corps, mais sans l'isoler dans un état de pureté mystérieuse, où eût été suspendue la faiblesse de la mortelle argile, comme parmi les paisibles ouailles de Méthode d'Olympe. La "chair" marquait, pour Cyprien, un point de perpétuel danger, un avant-poste du moi tendu pour recevoir du monde une pluie de coups. Si le corps était fragile en soi et de soi, et, on ne l'ignorait pas, tristement exposé à la tentation sexuelle, pourtant le plus grand danger n'était pas qu'il fût miné par ce "feu" caché et couvant intérieurement, mais qu'il fût gouverné, de l'extérieur, par la sinistre force d'attraction du monde. Homme de pouvoir, Cyprien ne savait que trop bien, pour l'avoir observé en lui comme chez ses turbulents collègues, ce que signifiait pour un chrétien d'être assiégé non seulement par la sensualité, mais aussi par les appétits "mondains" plus pesants et plus dévastateurs de la colère, de la jalousie et de l'orgueil ecclésiastique» (P. Brown. Le renoncement à la chair, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1995, pp. 245-246).
confronté au saeculum in acie constituti, "enligne de bataille", au cours de la six millième année de guerre du diable contre l'espèce humaine. Quelque chose comme une "mollesse efféminée affectant la vigueur du propos chrétien" pouvait constituer un désastre pour l'Église. Cette préoccupation majeure détermina la vision du corps que Cyprien légua à Ambroise, Jérôme et Augustin, et dont l'efficacité fut décisive. La "chair" du chrétien était un rempart contre le saeculum. Celle-ci pouvait être "consacrée au Christ", comme dans le cas d'une fille ou d'un garçon demeurés vierges. Il importait infiniment de protéger l'intégrité du corps, mais sans l'isoler dans un état de pureté mystérieuse, où eût été suspendue la faiblesse de la mortelle argile, comme parmi les paisibles ouailles de Méthode d'Olympe. La "chair" marquait, pour Cyprien, un point de perpétuel danger, un avant-poste du moi tendu pour recevoir du monde une pluie de coups. Si le corps était fragile en soi et de soi, et, on ne l'ignorait pas, tristement exposé à la tentation sexuelle, pourtant le plus grand danger n'était pas qu'il fût miné par ce "feu" caché et couvant intérieurement, mais qu'il fût gouverné, de l'extérieur, par la sinistre force d'attraction du monde. Homme de pouvoir, Cyprien ne savait que trop bien, pour l'avoir observé en lui comme chez ses turbulents collègues, ce que signifiait pour un chrétien d'être assiégé non seulement par la sensualité, mais aussi par les appétits "mondains" plus pesants et plus dévastateurs de la colère, de la jalousie et de l'orgueil ecclésiastique» (P. Brown. Le renoncement à la chair, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1995, pp. 245-246).
Sur la conduite politique à tenir envers une marge de chrétiens qui ont failli sous la pression de l'angoisse de la mort et la peur de la torture, Cyprien répond par la  prescription morale dégagée de la conduite du fidèle en matière sexuelle. Sous le Politikè gouvernait l'Érotikè et, en cela, le courant éthico-pédagogique reprend pleinement l'héritage de la tradition hellénique. Le pardon aux lapsi fut rendu possible par une chronique qui, comme le souligne André Latreille à propos des temps troublés de la Révolution française, recueillit avec diligence «les défaillances des faibles et la terne existence des indifférents, [qui] ont moins laissé de traces que les annales des martyrs», rappelant, ce qui n'est pas peu utile pour la structure idéologique d'une institution officielle, le cours ordinaire de la vie chrétienne : «Et il est bon sans doute qu'il en soit ainsi pour que l'histoire ne devienne point école de démoralisation» (A. Latreille. L'Église catholique et la Révolution française, t. 1 : 1775-1799, s.v. Les Éditions du Cerf, Col. Foi vivante, # 131, 1970, p. 189.
prescription morale dégagée de la conduite du fidèle en matière sexuelle. Sous le Politikè gouvernait l'Érotikè et, en cela, le courant éthico-pédagogique reprend pleinement l'héritage de la tradition hellénique. Le pardon aux lapsi fut rendu possible par une chronique qui, comme le souligne André Latreille à propos des temps troublés de la Révolution française, recueillit avec diligence «les défaillances des faibles et la terne existence des indifférents, [qui] ont moins laissé de traces que les annales des martyrs», rappelant, ce qui n'est pas peu utile pour la structure idéologique d'une institution officielle, le cours ordinaire de la vie chrétienne : «Et il est bon sans doute qu'il en soit ainsi pour que l'histoire ne devienne point école de démoralisation» (A. Latreille. L'Église catholique et la Révolution française, t. 1 : 1775-1799, s.v. Les Éditions du Cerf, Col. Foi vivante, # 131, 1970, p. 189.
Ce rapprochement entre l'engagement de la foi et la morale sexuelle n'est pas qu'une simple métaphore. Ils sont tous les deux dans le prolongement l'un de l'autre. Celui ou 
Le
rappel des vœux extravagants de Jephté et d'Agamemnon n'était
qu'une mise en place pour l'entrée au Paradis. Dans le chant XXIII
du Purgatoire – le cercle des gourmands -, le poète avait
rencontré Forese Donati à qui il avait demandé où se trouvait sa
sœur  Piccarda. Donati lui avait répondu qu'elle se trouvait au
Paradis. Aux yeux des deux hommes, Piccarda était un modèle de
vertu et de beauté. Aussi, à peine franchies les portes du Paradis,
Dante va-t-il se trouver face à Piccarda Donati et Constance
d'Hauteville, la mère de l'Empereur Frédéric II, qui aurait
été enlevée d'un couvent pour épouser l'empereur Henri
VI Hohenstaufen. La rencontre a lieu dans le Ciel de la Lune, sphère
la plus basse du Paradis, qui abrite les âmes inconstantes et peu
fermes dans leur vocation. Piccarda aussi avait dû renoncer à ses vœux afin d'acquiescer aux souhaits de Corso Donati, son frère, le chef du clan,
grand seigneur de Florence, et se marier.
Piccarda. Donati lui avait répondu qu'elle se trouvait au
Paradis. Aux yeux des deux hommes, Piccarda était un modèle de
vertu et de beauté. Aussi, à peine franchies les portes du Paradis,
Dante va-t-il se trouver face à Piccarda Donati et Constance
d'Hauteville, la mère de l'Empereur Frédéric II, qui aurait
été enlevée d'un couvent pour épouser l'empereur Henri
VI Hohenstaufen. La rencontre a lieu dans le Ciel de la Lune, sphère
la plus basse du Paradis, qui abrite les âmes inconstantes et peu
fermes dans leur vocation. Piccarda aussi avait dû renoncer à ses vœux afin d'acquiescer aux souhaits de Corso Donati, son frère, le chef du clan,
grand seigneur de Florence, et se marier.
Car on ne désobéissait pas au seigneur Donati, dirigeant de la faction guelfe de Florence - partisan du pape contre le pouvoir dominant de l'Empereur, représenté par les Gibelins -, et pour le moment podestat de Bologne. Étant la sœur de Corso et de Forese, il est fort probable que Piccarda et Dante (qui appartenait à la faction des Guelfes) se connaissaient. Comme il arrivait à ces femmes qui t entaient de s'écarter des voies du politique, Piccarda avait fui sa maison pour se faire religieuse et éviter ainsi d'épouser celui que la famille avait désigné pour son époux. Se réfugiant au couvent de Santa Maria di Monticelli, de l'Ordre de sainte Claire - les Clarisses, pendant féminin des franciscains -, proche de Florence, ses vœux durèrent le temps d'une année, jusqu'à ce que les sbires de Corso l'enlèvent de force du monastère et la traînent devant Rossellino della Tosa afin de célébrer leurs noces. Le but de ce mariage forcé était de renforcer les liens entre les deux familles. Certaines sources - possiblement pieuses - affirment que Piccarda serait morte d'une maladie soudaine ayant les aspects de la lèpre avant même la consommation du mariage! N'insistons pas sur la véracité de ce ouï-dire.
entaient de s'écarter des voies du politique, Piccarda avait fui sa maison pour se faire religieuse et éviter ainsi d'épouser celui que la famille avait désigné pour son époux. Se réfugiant au couvent de Santa Maria di Monticelli, de l'Ordre de sainte Claire - les Clarisses, pendant féminin des franciscains -, proche de Florence, ses vœux durèrent le temps d'une année, jusqu'à ce que les sbires de Corso l'enlèvent de force du monastère et la traînent devant Rossellino della Tosa afin de célébrer leurs noces. Le but de ce mariage forcé était de renforcer les liens entre les deux familles. Certaines sources - possiblement pieuses - affirment que Piccarda serait morte d'une maladie soudaine ayant les aspects de la lèpre avant même la consommation du mariage! N'insistons pas sur la véracité de ce ouï-dire.
Le récit de Piccarda affectait sans doute Dante qui l'avait connue, mieux que celui de Constance d'Hauteville, dernière héritière des rois normands de Sicile, épouse de l'empereur Henri VI de Souabe et mère de Frédéric II (1154-1198), future empereur Hohenstaufen. Toute une tradition sombre enveloppe Constance dès sa naissance. On dit que sa mère, Béatrice, qui accoucha d'une enfant orpheline de père, qu'elle «précipiterait son pays au comble de la ruine» :
«Sans doute était-ce pour prévenir ces malheurs que Constance avait ensuite été destinée à devenir nonne, comme jadis Ilia, mère et première ancêtre de Rome, avait été vouée à l'état de vestale. Il est vrai que le long séjour de la fille du roi dans différents couvents de Palerme a pu confirmer cette rumeur. On prétendait aussi
que Constance ne s'était décidée au mariage qu'à contre-cœur, et cela contribua à préciser l'image que Dante se faisait d'elle : parce qu'elle avait quitté la "douce cellule" sous la contrainte et non de son plein gré, Dante avait donné à l'impératrice une place au Paradis. Tout le monde croyait que Constance avait pris le voile, et plus tard, par haine de son fils, les Guelfes répandirent intentionnellement cette légende (ne dira-t-on pas ensuite que l'Antéchrist serait enfanté par une nonne?). La première et unique grossesse de l'impératrice, alors quadragénaire, donna cependant lieu à un autre cycle de légendes. On la vieillit sensiblement pour rapprocher plus encore le miracle de cette maternité tardive des modèles bibliques, et la tradition ne la montra plus que sous les traits d'une vieille femme ridée. La rumeur courut que l'enfant qu'elle disait avoir mis au monde était un enfant supposé et l'on prétendit qu'il s'agissait en réalité du fils d'un boucher. On dit que Constance, qui était avisée, aurait su prévenir ces racontars : elle aurait fait dresser une tente en plein marché et, après sa délivrance, aurait fièrement montré à tout le peuple ses seins gonflés de lait» (E. Kantorowicz. L'empereur Frédéric II, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1987, pp. 18-19).
Dans cette atmosphère orientale qui baignait la cour de Sicile à la fin du XIIe siècle, que la fille posthume du roi Roger II fût engagée à épouser le futur Henri VI, fils de Frédéric Barberousse, prêtait à la légende. Il prêtait surtout aux disputes politiques, car en plein  milieu de la crise opposants Guelfes et Gibelins, l'union de la dynastie guelfe des Hauteville à celle, gibeline des Hohenstaufen, la situation était explosive. La trêve de Venise, souscrite en mai-août 1177 par l'ex-empereur Frédéric, négociée à l'insu de la papauté, «qui ne pouvait voir que d'un mauvais œil ce rapprochement diplomatique entre son ennemi et son allié», d'autant plus que Guillaume II demeurait toujours roi de Sicile, du moins jusqu'en 1189. Pendant ce temps, il était toujours possible d'apprécier de manière contradictoire la trêve : «L'archevêque de Palerme, d'origine anglaise, y voit une garantie contre l'anarchie qui ne manquerait pas de se développer en cas de vide du pouvoir. À l'inverse, l'émir Matteo d'Ajello souligne le péril qui menace le royaume de Sicile s'il devient une dépendance de l'Empire germanique» (J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris, Fayard, 2009, p. 179). Aussi, est-ce à la mort du roi Guillaume que les accords de la trêve entrent en action :
milieu de la crise opposants Guelfes et Gibelins, l'union de la dynastie guelfe des Hauteville à celle, gibeline des Hohenstaufen, la situation était explosive. La trêve de Venise, souscrite en mai-août 1177 par l'ex-empereur Frédéric, négociée à l'insu de la papauté, «qui ne pouvait voir que d'un mauvais œil ce rapprochement diplomatique entre son ennemi et son allié», d'autant plus que Guillaume II demeurait toujours roi de Sicile, du moins jusqu'en 1189. Pendant ce temps, il était toujours possible d'apprécier de manière contradictoire la trêve : «L'archevêque de Palerme, d'origine anglaise, y voit une garantie contre l'anarchie qui ne manquerait pas de se développer en cas de vide du pouvoir. À l'inverse, l'émir Matteo d'Ajello souligne le péril qui menace le royaume de Sicile s'il devient une dépendance de l'Empire germanique» (J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris, Fayard, 2009, p. 179). Aussi, est-ce à la mort du roi Guillaume que les accords de la trêve entrent en action :
«Le choix de son successeur revient donc à ses conseillers. Très peu sont favorables à une régence de Constance, car son mari, le futur Henri VI, n'entend pas être le prince consort. De plus, la noblesse franco-sicilienne ne veut pas d'un Allemand. Consciente qu'il lui faut défendre ses privilèges et sans doute déjà porteuse d'une
identité sicilienne, une partie de la noblesse normande est favorable à Roger, comte d'Andria, tandis qu'une autre faction, qui peut se prévaloir du soutien du chancelier Matteo d'Ajello, choisit Tancrède de Lecce. Les deux hommes sont de hauts fonctionnaires d'égale valeur, le premier a été un des négociateurs de la trêve de Venise, le second s'est illustré comme commandant de la flotte sicilienne. Mais Tancrède a pour lui d'appartenir à la lignée des Hauteville puisqu'il est le fils illégitime de Roger, duc des Pouilles, frère de Guillaume Ier, et, à ce titre, cousin germain de Guillaume II. Tancrède bénéficie enfin du soutien de Clément III (1187-1191), un pape énergique qui organise la troisième croisade pour sauver la Terre sainte menacée par les armées de Saladin (1138-1193)» (J.-Y. Frétigné. ibid. p. 179).
On devine comment Constance pouvait se sentir, écrasée entre ces deux puissants seigneurs, avant que son époux, une fois devenu empereur, se charge de mettre main basse sur la Sicile :
«Les quatre années du règne de Tancrède (janvier 1190-février 1194) sont marquées par de nombreux troubles fomentés par les musulmans et par les grands féodaux, dont le roi parvient avec peine à venir à bout. Mais il ne peut résister àHenri VI (1165-1197, empereur depuis 1191) qui entreprend en 1193 une vaste campagne contre le roi normand. Salerne est détruite et quasiment toute la Sicile passe sous le contrôle des troupes impériales. Tandis qu'il a déjà perdu son fils aîné, Tancrède meurt de maladie le 20 février 1194, laissant comme héritier un tout jeune enfant, Guillaume III, sous la régence de sa mère, la reine Sibylle. Réfugiés un temps dans la place forte naturelle de Caltabellota, ils ne peuvent qu'accepter de se rendre. Dans une grande solennité, Henri VI est couronné roi de Sicile, le jour de Noël 1194, dans la cathédrale de Palerme, soixante-quatre ans après que l'eut été Roger II. Sa femme, l'impératrice Constance, n'assiste pas à la cérémonie car elle est alors à Iesi où elle donne naissance à un fils, le futur Frédéric II, le lendemain du sacre de son époux» (J.-Y. Frétigné. ibid. pp. 179-180).
 La
suite de ce triomphe fut abominable. Le dimanche de Pâques 1195,
l'empereur Henri fait défiler devant les yeux de Constance et de la
population sicilienne, le long cortège sinistre de 160 chevaux de bât qui
traversent la ville de Palerme chargés de tout le trésor des
Normands pour se rendre en Allemagne. Font partis du cortège, le
petit roi Guillaume III, châtré et aveuglé, et sa mère la reine
Sibylle. C'était la fin de la Sicile normande.
La
suite de ce triomphe fut abominable. Le dimanche de Pâques 1195,
l'empereur Henri fait défiler devant les yeux de Constance et de la
population sicilienne, le long cortège sinistre de 160 chevaux de bât qui
traversent la ville de Palerme chargés de tout le trésor des
Normands pour se rendre en Allemagne. Font partis du cortège, le
petit roi Guillaume III, châtré et aveuglé, et sa mère la reine
Sibylle. C'était la fin de la Sicile normande.
Cette humiliation visait en particulier l'impératrice dont la famille n'appréciait pas les Allemands. Malgré son mariage à l'empereur du Saint-Empire romain-germanique, Constance demeurait toujours une guelfe. À la mort d'Henri, trois ans plus tard, elle réaffirma son pouvoir sur la Sicile au nom de son fils, le futur Frédéric II :
«À la mort du fils de Frédéric Barberousse en septembre 1197, le jeune Frédéric n'a que trois ans. Il vit à Forli, confié aux soins de la femme de Conrad von Urslingen, duc de Spolète et fidèle d'Henri VI. Il est alors roi d'Allemagne mais son oncle et tuteur, Philippe de Souabe (1176-1208), cherche à s'emparer du titre impérial. Le futur maître de l'Occident est donc dans une position
d'extrême faiblesse. Sa mère, la reine Constance, et l'Église sont alors ses seuls soutiens, soutien sincère pour la première, plus intéressé mais bien réel pour la seconde. Devenue en septembre 1197, à la mort de son époux, reine de Sicile, du duché des Pouilles et de la principauté de Capoue, Constance s'efforce de chasser les Allemands dont la présence est devenue odieuse aux yeux des habitants du royaume et, fidèle à la tradition de ses ancêtres normands, elle décide de nouer une alliance avec la papauté. Elle fait venir son fils à ses côtés, à Palerme, et le proclame roi de Sicile, duc des Pouilles et prince de Capoue, sous le nom de Frédéric Ier. Cette opération se fait en accord avec la papauté. Par la volonté testamentaire de la reine, il est même prévu que le pape assure la régence du royaume et devienne le tuteur du jeune roi en attendant qu'il atteigne sa majorité. Enfin, Constance s'est engagée verbalement à ce que le Saint-Siège conclue une sorte de concordat avec le royaume de Frédéric Ier. Mais la reine décède en novembre 1198, avant de le signer. Aussi n'est-il pas intégré à la juridiction du royaume. Favorable à l'Église, il reprenait les clauses souscrites entre Tancrède et Célestin III (pape de 1191 à 1198) alors que le dernier des rois normands en position de grande faiblesse avait renoncé à la légation apostolique des lieux» (P.-Y. Frétigné. ibid. pp. 188-189).
Autant
dire que la décision de Constance préparait de jolies luttes entre
son fils, devenu  empereur romain-germanique et roi de Sicile
avec la papauté! Dans toute cette habileté diplomatique dont
déploie Constance, d'abord en tant que mère de l'héritier de la
couronne impériale et reine de Sicile, son patrimoine personnel, que reste-t-il des vœux
rompus? Il semble qu'ils se soient envolés avec la pratique du
gouvernement. En fait, la critique les ont fort mis à mal. Daniel-Rops, historien catholique militant et par
le fait même capable d'apprécier la ferveur guelfe de la reine
Constance de Sicile, y va plutôt durement lorsqu'il
la présente, «au demeurant sorte de nonne rancie, de dix
ans plus âgée que son époux, lequel ne devait jamais l'aimer»
(Daniel-Rops. L'Église de la cathédrale et de la croisade,
Paris, Arthème Fayard, Col. Les Grandes Études historiques,
1952, p. 249). Ici aussi, nous sommes très loin du Dante.
empereur romain-germanique et roi de Sicile
avec la papauté! Dans toute cette habileté diplomatique dont
déploie Constance, d'abord en tant que mère de l'héritier de la
couronne impériale et reine de Sicile, son patrimoine personnel, que reste-t-il des vœux
rompus? Il semble qu'ils se soient envolés avec la pratique du
gouvernement. En fait, la critique les ont fort mis à mal. Daniel-Rops, historien catholique militant et par
le fait même capable d'apprécier la ferveur guelfe de la reine
Constance de Sicile, y va plutôt durement lorsqu'il
la présente, «au demeurant sorte de nonne rancie, de dix
ans plus âgée que son époux, lequel ne devait jamais l'aimer»
(Daniel-Rops. L'Église de la cathédrale et de la croisade,
Paris, Arthème Fayard, Col. Les Grandes Études historiques,
1952, p. 249). Ici aussi, nous sommes très loin du Dante.
 Dans
un cas comme dans l'autre, Piccarda et Clémence apparaissaient, aux yeux du
poète, comme de saintes femmes dont la volonté spirituelle avait été
brimée par les intérêts profanes et politiques. Malgré le fait
qu'il les ait placées dans l'orbite du Paradis le plus loin de Dieu,
Piccarda offre l'exemple de celle qui n'a pas rompu ses vœux par volonté personnelle mais par la force armée des
intérêts dynastiques et politiques. Béatrice, la guide du Dante, explique même que lorsque la force
ou des actions énergiques affectent le corps physique, cela mine la
volonté de la personne. La volonté
absolue de
Piccarda, c'est-à-dire sa volonté de respecter son vœu,
était si intense qu'elle relevait de la volonté
la plus profonde. Sa
mort avant même que son mariage ne fût consommé en serait la
confirmation. Piccarda
restait une volonté pure, non une volonté
contaminée qui
serait celle qui céderait à ses pulsions ou ses penchants
corrupteurs ou encore – comme Constance, mais ça, Dante l'ignorait
-, par des intérêts mondains. Son vœu provenait du cœur et non
seulement de sa tête, et ce vœu consistait à choisir Dieu avant
tout.
Dans
un cas comme dans l'autre, Piccarda et Clémence apparaissaient, aux yeux du
poète, comme de saintes femmes dont la volonté spirituelle avait été
brimée par les intérêts profanes et politiques. Malgré le fait
qu'il les ait placées dans l'orbite du Paradis le plus loin de Dieu,
Piccarda offre l'exemple de celle qui n'a pas rompu ses vœux par volonté personnelle mais par la force armée des
intérêts dynastiques et politiques. Béatrice, la guide du Dante, explique même que lorsque la force
ou des actions énergiques affectent le corps physique, cela mine la
volonté de la personne. La volonté
absolue de
Piccarda, c'est-à-dire sa volonté de respecter son vœu,
était si intense qu'elle relevait de la volonté
la plus profonde. Sa
mort avant même que son mariage ne fût consommé en serait la
confirmation. Piccarda
restait une volonté pure, non une volonté
contaminée qui
serait celle qui céderait à ses pulsions ou ses penchants
corrupteurs ou encore – comme Constance, mais ça, Dante l'ignorait
-, par des intérêts mondains. Son vœu provenait du cœur et non
seulement de sa tête, et ce vœu consistait à choisir Dieu avant
tout.
Malgré
la diffusion du christianisme dans l'ensemble des civilisations
occidentale et grecque-orthodoxe, des crises internes, comme la
Réformation du XVIe-XVIIe siècles, soumirent bien des vocations à
des épreuves comparables à celles vécues par les premiers chrétiens sous l'Empire romain. Si les États
ralliés à la Réformation protestante  imposè-rent souvent à
apostasier la papauté et l'Église romaine, elle n'en-gageait pas
les croyants à apostasier la foi chrétienne. Le cas de l'Église
anglicane, qui reproduit tous les symboles et la hiérarchie
catholiques – le roi d'Angleterre substitué au pape -, montre combien le dogme restait ce qu'il était du temps où le pape avait consacré Henri VIII, défenseur de la foi! Une formule qui résumerait assez bien ce que fût la Réformation, serait de dire qu'elle fut un mouvement de nationalisation de la religion. La véritable épreuve devait venir deux siècles
plus tard, avec la Révolution française. Dans sa
radicalisation, elle alla jusqu'à nier la foi chrétienne, son Église, ses dogmes et ses
pompes, au nom d'un régime républicain et laïque et, avec l'Être suprême,
panthéiste, cosmique, naturel mais impersonnel, opposé à toute divinité anthropomorphique.
imposè-rent souvent à
apostasier la papauté et l'Église romaine, elle n'en-gageait pas
les croyants à apostasier la foi chrétienne. Le cas de l'Église
anglicane, qui reproduit tous les symboles et la hiérarchie
catholiques – le roi d'Angleterre substitué au pape -, montre combien le dogme restait ce qu'il était du temps où le pape avait consacré Henri VIII, défenseur de la foi! Une formule qui résumerait assez bien ce que fût la Réformation, serait de dire qu'elle fut un mouvement de nationalisation de la religion. La véritable épreuve devait venir deux siècles
plus tard, avec la Révolution française. Dans sa
radicalisation, elle alla jusqu'à nier la foi chrétienne, son Église, ses dogmes et ses
pompes, au nom d'un régime républicain et laïque et, avec l'Être suprême,
panthéiste, cosmique, naturel mais impersonnel, opposé à toute divinité anthropomorphique.
On
peut facilement retrouver les traditions éthico-pédagogique et
mystico-ontologique des origines dans ce que vécut le clergé
catholique français au moment où le nouveau régime républicain
décida de dépasser le dernier pas du gallicanisme du temps de la monarchie
d'Ancien Régime. La tradition éthico-pédagogique
trouva à s'incarner dans le clergé  constitu-tionnel. Votée le 12 juillet 1790
par l'Assem-blée cons-tituante, la Consti-tution civile du clergé
visait à appliquer au clergé catholique les principes partout
généralisés au niveau administratif, judiciaires et financiers du nouveau régime.
Uniformiser, décentraliser et égaliser les conditions conduisaient
à assimiler les diocèses aux départements; à l'élection des
membres du clergé (curés et évêques) par les citoyens actifs,
même
non-catholiques; la consultation électorale pour l'investiture
des évêques et des curés par les fidèles. Enfin, une rémunération stricte
des membres du clergé ciblant les inégalités antérieures de
traitement. Comme le roi, le pape perdait ses prérogatives. La
Constitution civile du clergé séparait l'ecclésiologie
française de celle de Rome et du reste de la catholicité. Non sans
surprise, le pape Pie VI refusa cet scission fondamentale du dogme et
de l'organisation de l'Église.
constitu-tionnel. Votée le 12 juillet 1790
par l'Assem-blée cons-tituante, la Consti-tution civile du clergé
visait à appliquer au clergé catholique les principes partout
généralisés au niveau administratif, judiciaires et financiers du nouveau régime.
Uniformiser, décentraliser et égaliser les conditions conduisaient
à assimiler les diocèses aux départements; à l'élection des
membres du clergé (curés et évêques) par les citoyens actifs,
même
non-catholiques; la consultation électorale pour l'investiture
des évêques et des curés par les fidèles. Enfin, une rémunération stricte
des membres du clergé ciblant les inégalités antérieures de
traitement. Comme le roi, le pape perdait ses prérogatives. La
Constitution civile du clergé séparait l'ecclésiologie
française de celle de Rome et du reste de la catholicité. Non sans
surprise, le pape Pie VI refusa cet scission fondamentale du dogme et
de l'organisation de l'Église.
Bien
des prélats, tel le célèbre abbé Grégoire, se montrèrent
favorables à la Constitution comme conséquente des autres
transformations sociales et politiques, et tout à fait .jpg) cohérente avec le dogme chrétien. En tant que fonctionnaires,
les membres du clergé se virent astreints à jurer le serment à
«la nation, à la loi, au roi» au moment de leur élection. Cette
Constitution civile adaptait aux conditions du Siècle des Lumières
l'ancienne tradition éthico-pédagogique. Il apparaissait possible aux députés de l'Assemblée de lier les intérêts révolutionnaires avec la foi chrétienne. Lui répondit un fort courant mystico-ontologique qui trouvait sa niche parmi le
clergé réfractaire, c'est-à-dire tous les membres du clergé qui
refusaient de prêter serment et conservaient leur fidélité à Rome.
cohérente avec le dogme chrétien. En tant que fonctionnaires,
les membres du clergé se virent astreints à jurer le serment à
«la nation, à la loi, au roi» au moment de leur élection. Cette
Constitution civile adaptait aux conditions du Siècle des Lumières
l'ancienne tradition éthico-pédagogique. Il apparaissait possible aux députés de l'Assemblée de lier les intérêts révolutionnaires avec la foi chrétienne. Lui répondit un fort courant mystico-ontologique qui trouvait sa niche parmi le
clergé réfractaire, c'est-à-dire tous les membres du clergé qui
refusaient de prêter serment et conservaient leur fidélité à Rome.
«Dès novembre 1790, se dessine un schisme, révélé statistiquement au moment du serment (janvier-février 1791). Le haut clergé sera massivement "réfractaire", "insermenté" (à l'exception de 7 évêques, dont Talleyrand et Gobel qui en investissant les autres sauveront la Constitution civile). Mais 52% des curés et des vicaires (soit plus de 28 000) prêtent le serment (parfois avec restriction) devenant "constitutionnels", "jureurs", ou "assermentés"» (S. Bianchi, in A. Soboul (éd.) Dictionnaire de la Révolution française, Paris, P.U.F., 1989, pp. 281-282).
Le
schisme devait ouvrir à la déchristianisation de la France républicaine. Le clergé assermenté, fonctionnarisé, devait rapprocher constamment la sphère
religieuse,  spirituelle de la sphère publique, politique, administrative et
mondaine, ce qui aboutira à l'abdication (l'apostasie), le mariage ou
l'arrêt du sacerdoce. Parallèlement, les membres du clergé réfractaire se virent pourchassés par les autorités et la police,
condamnés à l'exil puis, sous la Terreur, à devenir des agents de
la contre-révolution dans des régions comme la Vendée, la Bretagne
ou Lyon. La France retrouvait le climat des persécutions de l'Empire
romain et la faille ouverte au sein du catholicisme français devait
durer jusque sous la Restauration. Un siècle plus tard, avec la loi
de la séparation des Églises et de l'État, la République
poursuivra l'ambition de la Révolution de lier la sphère religieuse
à l'État.
spirituelle de la sphère publique, politique, administrative et
mondaine, ce qui aboutira à l'abdication (l'apostasie), le mariage ou
l'arrêt du sacerdoce. Parallèlement, les membres du clergé réfractaire se virent pourchassés par les autorités et la police,
condamnés à l'exil puis, sous la Terreur, à devenir des agents de
la contre-révolution dans des régions comme la Vendée, la Bretagne
ou Lyon. La France retrouvait le climat des persécutions de l'Empire
romain et la faille ouverte au sein du catholicisme français devait
durer jusque sous la Restauration. Un siècle plus tard, avec la loi
de la séparation des Églises et de l'État, la République
poursuivra l'ambition de la Révolution de lier la sphère religieuse
à l'État.
Les deux clergés se firent une lutte féroce tout le temps que dura la Révolution et le Premier Empire. Les gouvernements successifs tentèrent bien de recoudre la robe du Christ, mais dans l'esprit vindicatif né des persécutions, le retour du clergé romain avec les Bourbons en 1814-1815 ramena la querelle du temps de Zéphyrin, Calixte et d'Hippolyte : Devait-on pardonner aux modernes lapsis, ceux qui avaient prêter le serment constitutionnel, ou devait-on les maintenir au ban de l'Église catholique où ils s'y étaient placés eux-mêmes en jurant à la Constitution civile?
Le
Concordat de 1801-1802 avait pour but de réconcilier l'Église de
France mais aussi, par nécessité, de faire reconnaître le fait accompli au pape. Pie VII
avait délégué Mgr Spina  pour le représenter dans les
négociations avec les agents de Bona-parte, dont l'ineffable
Talleyrand qui trahissait tous les régimes qui l'avaient
supporté. «Le 15
août 1801, il signe le traité et trois brefs destinés à faciliter
son exécution : le premier, le plus important, le bref Tam
multa qui va
provoquer un petit schisme, exhorte les évêques légitimes à
démissionner; le second rappelle les évêques constitutionnels à
l'unité de l'Église; le troisième autorise l'absolution des
prêtres mariés et la validation de leur mariage sous la condition
d'un sincère repentir; plus de trois mille prêtres et près de
trois cents religieux seront ainsi réhabilités; Talleyrand n'a pas
eu tort de vouloir faire insérer dans le concordat "la clause
de Madame Grand", car le bref ne s'applique pas aux prêtres
revêtus du caractère épiscopal»
(A. Dansette. Histoire
religieuse de la France contemporaine, Paris,
Flammarion, Col. L'Histoire, 1965, p. 139). (On appelle clause de Madame Grand l'article inséré dans le Concordat par Talleyrand qui visait à le débarrasser définitivement des séquelles de son épiscopat et lui permettre d'épouser sa maîtresse Catherine Grand.)
pour le représenter dans les
négociations avec les agents de Bona-parte, dont l'ineffable
Talleyrand qui trahissait tous les régimes qui l'avaient
supporté. «Le 15
août 1801, il signe le traité et trois brefs destinés à faciliter
son exécution : le premier, le plus important, le bref Tam
multa qui va
provoquer un petit schisme, exhorte les évêques légitimes à
démissionner; le second rappelle les évêques constitutionnels à
l'unité de l'Église; le troisième autorise l'absolution des
prêtres mariés et la validation de leur mariage sous la condition
d'un sincère repentir; plus de trois mille prêtres et près de
trois cents religieux seront ainsi réhabilités; Talleyrand n'a pas
eu tort de vouloir faire insérer dans le concordat "la clause
de Madame Grand", car le bref ne s'applique pas aux prêtres
revêtus du caractère épiscopal»
(A. Dansette. Histoire
religieuse de la France contemporaine, Paris,
Flammarion, Col. L'Histoire, 1965, p. 139). (On appelle clause de Madame Grand l'article inséré dans le Concordat par Talleyrand qui visait à le débarrasser définitivement des séquelles de son épiscopat et lui permettre d'épouser sa maîtresse Catherine Grand.)
Un tel concordat ne pouvait que déplaire à tous les partis qui avaient vécu les pires heures de la tourmente révolutionnaire. D'un seul geste, le pape destituait tous les évêques gallicans tandis qu'il devait bientôt conférer l'institution canonique à d'anciens schismatiques, à des prêtres qui s'étaient séparés du catholicisme romain. Comme le dit Dansette : «L'hérésie est récompensée, l'orthodoxie punie!» (A. Dansette. ibid. p. 141). Il faut avoir bien à l'esprit que...
«le Concordat avait rétabli l'unité, du moins en principe, car en fait, elle demeura factice. On eut beau ne plus parler du passé, celui-ci subsistait. Les évêques d'ancien
régime continuèrent à considérer comme des intrus les anciens prêtres jureurs, élevés à l'épiscopat, et les fidèles – excités par les réfractaires – leur témoignèrent une certaine méfiance. De leur côté, les évêques constitutionnels ne purent oublier qu'autrefois ils avaient prêté le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé. Ces anciens schismatiques, rentrés dans la légalité, ne voulurent pas admettre qu'ils s'étaient trompés. Ils continuèrent à prétendre que leur situation avait toujours été orthodoxe et légitime, affirmant qu'en prêtant le serment "ils avaient sauvé l'Église catholique". N'ayant commis aucune faute, ils ne devaient se plier à aucune rétractation» (H. Verbist. Les Grandes controverses de l'Église contemporaine, Lausanne, Rencontre, 1969, pp. 117-118).
Bref,
la tentative de réconciliation imposée par le Concordat était loin
d'avoir résolu les problèmes de fond du catholicisme français. La
question des lapsi constitutionnels
 demeurait. La crise devait s'aggraver par l'esprit revanchard des
revenants de l'émigration dont le roi Louis XVIII. Ce dernier
méditait d'effacer le Concordat signé entre l'usurpateur
et Pie VII. Son but était de
renouveler le personnel épiscopal et revenir au Concordat de 1516.
Heureusement, Pie VII, même s'il accepta le retour des Jésuites et
autres compromis avec les intransigeants (zelanti),
était «trop informé pour croire avec eux qu'il soit
possible de revenir au statu quo
ante comme si rien ne s'était passé depuis un quart de
siècle. Il se propose de reconstituer les Églises des divers pays
européens en négociant des traités sur le type du concordat
français. Quant à ce dernier, il ne veut pas le supprimer, mais
seulement l'améliorer en augmentant le nombre trop réduit de ses
diocèses et en l'allégeant des articles organiques qui en ont
faussé l'esprit» (A. Dansette.
op. cit. pp. 193-194).
demeurait. La crise devait s'aggraver par l'esprit revanchard des
revenants de l'émigration dont le roi Louis XVIII. Ce dernier
méditait d'effacer le Concordat signé entre l'usurpateur
et Pie VII. Son but était de
renouveler le personnel épiscopal et revenir au Concordat de 1516.
Heureusement, Pie VII, même s'il accepta le retour des Jésuites et
autres compromis avec les intransigeants (zelanti),
était «trop informé pour croire avec eux qu'il soit
possible de revenir au statu quo
ante comme si rien ne s'était passé depuis un quart de
siècle. Il se propose de reconstituer les Églises des divers pays
européens en négociant des traités sur le type du concordat
français. Quant à ce dernier, il ne veut pas le supprimer, mais
seulement l'améliorer en augmentant le nombre trop réduit de ses
diocèses et en l'allégeant des articles organiques qui en ont
faussé l'esprit» (A. Dansette.
op. cit. pp. 193-194).
C'était
habile de la part du pape. «Il n'est pas sérieusement
question d'obtenir du Pape qu'il  relève de leurs fonctions les
évêques en exercice; le sacrifice de l'épiscopat ne se peut
accomplir tous les quinze ans et il serait particulièrement
difficile à Pie VII de démissionner des prêtres nommés en vertu
d'un traité dont il est signataire. C'est au contraire lui qui
obtient une concession sur ces questions de personnes : les évêques
de la Petite Église que le gouvernement royal voudrait réintégrer,
se retireront; quant aux prélats constitutionnels qu'il voudrait
tous chasser, ceux-là seuls qui ont retombés dans leurs erreurs
seront astreints à une amende honorable (la plupart des uns et des
autres se soumettront, et les récalcitrants s'en iront»
(A. Dansette. ibid. p. 194). Bref, Pie VII reprenait la position
occupée jadis par Zéphyrin, Calixte et Cyprien alors que Louis XVIII se rangeait du
côté d'Origène, de Tertullien et d'Hippolyte.
relève de leurs fonctions les
évêques en exercice; le sacrifice de l'épiscopat ne se peut
accomplir tous les quinze ans et il serait particulièrement
difficile à Pie VII de démissionner des prêtres nommés en vertu
d'un traité dont il est signataire. C'est au contraire lui qui
obtient une concession sur ces questions de personnes : les évêques
de la Petite Église que le gouvernement royal voudrait réintégrer,
se retireront; quant aux prélats constitutionnels qu'il voudrait
tous chasser, ceux-là seuls qui ont retombés dans leurs erreurs
seront astreints à une amende honorable (la plupart des uns et des
autres se soumettront, et les récalcitrants s'en iront»
(A. Dansette. ibid. p. 194). Bref, Pie VII reprenait la position
occupée jadis par Zéphyrin, Calixte et Cyprien alors que Louis XVIII se rangeait du
côté d'Origène, de Tertullien et d'Hippolyte.
Si
l'on reprend l'observation du Dante sur la liberté de
volonté et l'opposition entre la volonté
pure et .jpg) la volonté
contaminée, arrêtons-nous à quelques cas représentatifs. Si Talleyrand, évêque
athée dont les ruptures de vœux ne se comptent plus tant
l'opportunisme et la cupidité le menaient, il en est tout
autrement de l'évêque jureur de Paris, Mgr Gobel. Jean-Baptiste Joseph Gobel (1727-1794) n'avait pas
un esprit retors comme son collègue d'Autun. Comme tant de prélats
jureurs, Gobel avait voulu sauver la chèvre et le choux, ses
interventions concernant d'avantage des mesures morales que
d'authentiques manquement au dogme. Malgré toutes ses
compromissions, Gobel ne put empêcher la Convention de fermer les
églises. L'étape finale se produit lorsque...
la volonté
contaminée, arrêtons-nous à quelques cas représentatifs. Si Talleyrand, évêque
athée dont les ruptures de vœux ne se comptent plus tant
l'opportunisme et la cupidité le menaient, il en est tout
autrement de l'évêque jureur de Paris, Mgr Gobel. Jean-Baptiste Joseph Gobel (1727-1794) n'avait pas
un esprit retors comme son collègue d'Autun. Comme tant de prélats
jureurs, Gobel avait voulu sauver la chèvre et le choux, ses
interventions concernant d'avantage des mesures morales que
d'authentiques manquement au dogme. Malgré toutes ses
compromissions, Gobel ne put empêcher la Convention de fermer les
églises. L'étape finale se produit lorsque...
«Hébert, Chaumette et quelques acolytes se présentent chez l'archevêque de Paris Gobel et le somment d'abjurer le catholicisme. Pauvre Gobel! C'est un bel homme d'allure majestueuse, de noble visage et de moins noble caractère : sa foi, qui n'est pas douteuse, cède toujours à la peur; jamais les scrupules de ce malheureux dont la capitulation semble la raison d'être, ne résistent à sa lâcheté. Évêque in partibus, il a prêté serment malgré le trouble de sa conscience; archevêque de Paris, il a obéi à toutes les injonctions du pouvoir jusqu'à introniser un prêtre marié. On le somme de dépouiller la robe? Jamais! il se tiendra, répond-il, "collé" à sa religion. Mais les délégués alternant les prières avec les menaces, lui demandent seulement d'abdiquer ses fonctions épiscopales. Ce n'est donc que cela!"En ce cas, répond Gobel, j'adhère volon-tiers. Le peuple me renvoie. C'est le sort du domesti-que aux ordres du maître". Le lendemain, escorté de ses vicaires épiscopaux, suivi de jeunes gens accoutrés de surplis et de chasubles, l'archevêque se rend aux Tuileries et parle à l'Assemblée : "...Aujourd'hui que la liberté marche à grands pas, que tous les sentiments se trouvent réunis; aujourd'hui qu'il ne doit y avoir d'autre culte national que celui de la liberté et de l'égalité, je renonce à mes fonctions de ministre du culte catholique". Les vicaires font la même déclaration : "Nous déposons sur votre bureau nos lettres de prêtrise. Puisse cet exemple consolider le règne de la liberté et de l'égalité. Vive la République". (Ces cris sont répétés unanimement par les membres de l'Assemblée et les spectateurs au milieu des plus vifs applaudissements). Avec ses lettres de prêtrise, Gobel remet sa croix pectorale et son anneau. "Citoyens, répond le président, qui venez de sacrifier sur l'autel de la patrie les hochets gothiques de la superstition, vous êtes dignes de la République. Citoyens qui venez d'abjurer l'erreur, vous ne voudrez prêcher désormais que la pratique des vertus sociales et morales : c'est le culte de l'Être suprême trouvé agréable; vous êtes dignes de lui" (Vifs applaudissements). On présente le bonnet rouge à Gobel; il se le met sur la tête. (Les applaudissements recommencent et se prolongent). Un grand nombre de membres : "L'accolade à l'évêque de Paris". Le président : "Depuis l'abjuration qui vient d'être faite, l'évêque de Paris est un être de raison; mais je vais embrasser Gobel". (On l'applaudit)» (A. Dansette. ibid. p. 97).
C'était
du grand théâtre, indubitablement. À l'instar du baiser
Lamourette (lui, le premier évêque constitutionnel et député), lorsque la
Convention s'était donnée en représentation  fraternelle avant de se déchirer à belles dents. L'abjuration
pathétique de Gobel fait contraste à l'opiniâtreté de l'abbé Grégoire qui sut résister aussi bien aux menaces de ses adversaires
qu'à la hantise de la mort sur l'échafaud, et dont ce fut l'honneur de ne jamais s'abaisser à
un tel spectacle déshonorant, et pour l'Église et pour la
Convention : «L'abjuration de Gobel précipite la
déchristianisation. La Commune ferme toutes les églises de Paris au
culte constitutionnel (24 novembre 1793). À la Convention, les
scènes grotesques se succèdent; les chapes, les dalmatiques, les
chandeliers, les goupillons, ramassés dans les églises s'entassent
aux pieds des représentants, et le président de l'Assemblée de
s'exclamer devant les voyous porteurs de trophées et affublés
d'ornements religieux : "Votre philosophie vient de faire un
sacrifice digne d'elle. En un instant, vous venez de faire rentrer
dans le néant dix-huit siècles d'erreurs"»
(A. Dansette. ibid. p. 98). La morale de l'histoire, du moins celle
de Dansette, est de rappeler que «la lâcheté n'a pas
toujours reçu la récompense espérée; alors que Grégoire qui a la
chance d'être
fraternelle avant de se déchirer à belles dents. L'abjuration
pathétique de Gobel fait contraste à l'opiniâtreté de l'abbé Grégoire qui sut résister aussi bien aux menaces de ses adversaires
qu'à la hantise de la mort sur l'échafaud, et dont ce fut l'honneur de ne jamais s'abaisser à
un tel spectacle déshonorant, et pour l'Église et pour la
Convention : «L'abjuration de Gobel précipite la
déchristianisation. La Commune ferme toutes les églises de Paris au
culte constitutionnel (24 novembre 1793). À la Convention, les
scènes grotesques se succèdent; les chapes, les dalmatiques, les
chandeliers, les goupillons, ramassés dans les églises s'entassent
aux pieds des représentants, et le président de l'Assemblée de
s'exclamer devant les voyous porteurs de trophées et affublés
d'ornements religieux : "Votre philosophie vient de faire un
sacrifice digne d'elle. En un instant, vous venez de faire rentrer
dans le néant dix-huit siècles d'erreurs"»
(A. Dansette. ibid. p. 98). La morale de l'histoire, du moins celle
de Dansette, est de rappeler que «la lâcheté n'a pas
toujours reçu la récompense espérée; alors que Grégoire qui a la
chance d'être  absent lors du procès de Louis XVI, sortira de la
Révo-lution respecté par ses adver-saires eux-mêmes, Gobel, impliqué
dans le procès de Chaumette et compris, lui, ancien prélat de
l'Église gallicane, ex-archevêque de l'Église constitutionnelle,
dans la même accusation d'impiété et d'athéisme, finit sous le
couperet de la guillotine après avoir abjuré l'erreur schismatique
dans sa prison» (A. Dansette.
ibid. pp. 99-100).
absent lors du procès de Louis XVI, sortira de la
Révo-lution respecté par ses adver-saires eux-mêmes, Gobel, impliqué
dans le procès de Chaumette et compris, lui, ancien prélat de
l'Église gallicane, ex-archevêque de l'Église constitutionnelle,
dans la même accusation d'impiété et d'athéisme, finit sous le
couperet de la guillotine après avoir abjuré l'erreur schismatique
dans sa prison» (A. Dansette.
ibid. pp. 99-100).
Les
historiens catholiques ont été guère magnanimes envers Gobel. Daniel-Rops, qui peut parfois savoir se montrer ignoble,
n'hésita pas à rapporter les bobards les plus scandaleux concernant
le vieil évêque : «Il faut ajouter que l'équitable
guillotine ne discerna  pas toujours entre ceux qui avaient résisté
et ceux qui avaient cédé. Nombre d'apostats gravirent le fatal
escalier. Le plus célèbre fut Gobel lui-même. Arrêté le 15 mars
1794, traduit devant le Tribunal révolutionnaire, il fut accusé...
d'avoir poussé le peuple vers l'athéisme, et en outre de s'être
livré à des orgies. En fait, Robespierre le soupçonnait d'avoir
partie liée avec Chaumette et les Hébertistes. Il fut exécuté le
13 avril. Il avait pu écrire à son vicaire, l'abbé Lothringer,
demeuré prêtre, qui avait accompagné la Reine à l'échafaud, une
lettre très noble où il offrait sa vie en expiation de "ses
crimes et scandales" et lui demandait de lui donner l'absolution
sur le passage de la charrette. On sait qu'à l'échafaud même, il
se montra digne de l'Église qui lui avait pardonné»
(Daniel-Rops. L'Église des Révolutions, t. 1 : En face de
nouveaux destins, Paris, Arthème
Fayard, 1960, p. 68, n. 52).
pas toujours entre ceux qui avaient résisté
et ceux qui avaient cédé. Nombre d'apostats gravirent le fatal
escalier. Le plus célèbre fut Gobel lui-même. Arrêté le 15 mars
1794, traduit devant le Tribunal révolutionnaire, il fut accusé...
d'avoir poussé le peuple vers l'athéisme, et en outre de s'être
livré à des orgies. En fait, Robespierre le soupçonnait d'avoir
partie liée avec Chaumette et les Hébertistes. Il fut exécuté le
13 avril. Il avait pu écrire à son vicaire, l'abbé Lothringer,
demeuré prêtre, qui avait accompagné la Reine à l'échafaud, une
lettre très noble où il offrait sa vie en expiation de "ses
crimes et scandales" et lui demandait de lui donner l'absolution
sur le passage de la charrette. On sait qu'à l'échafaud même, il
se montra digne de l'Église qui lui avait pardonné»
(Daniel-Rops. L'Église des Révolutions, t. 1 : En face de
nouveaux destins, Paris, Arthème
Fayard, 1960, p. 68, n. 52).
Amalgamé
avec d'autres prisonniers accusés d'avoir fomenté le complot
des prisons, il fut, en effet, monté dans
la même charrette que Chaumette et Lucile Desmoulins (25 germinal an
II – 13 avril 1794). «Même aux dires de ses pires
détracteurs, l'ancien évêque eut une conduite très  digne, se
repentit de ses fautes et envoya une con-fession écrite à un de ses
vicaires. Après sa mort, on s'aperçut qu'il était complè-tement
ruiné. La République qui, selon la loi, était son héritière,
pour ne pas être obligée de payer ses créanciers, dut déclarer la
faillite», rappelle Serge
Bianchi (in op. cit. p. 508). Moins moraliste que Dansette, il
conclut : «Jean-Baptiste Joseph Gobel incarna jusque dans
la mort les contradictions du sacerdoce et de l'engagement des
prêtres dans la Révolution sans que l'on puisse, pourtant, le
qualifier d'"évêque rouge"»
(S. Bianchi. ibid. p. 508). Il avait risqué le pari de la
tradition éthico-pédagogique en jouant la carte de l'assermentation.
Il avait gagné son pari, du moins tant que la radicalisation de la Révolution
ne le conduisît pas, forcé, jusqu'à rompre ses vœux. Une fois le pas
franchi par son abjuration même, dont il essayait d'en diminuer la
portée symbolique, plus rien ne retenait le christianisme français,
sinon que la ferveur des simples croyants qui continuaient clandestinement, à pratiquer le culte interdit. Après avoir abusé de sa liberté de volonté
en la contaminant de la
compromission avec les intérêts du monde, au seuil de la mort, dans
son cachot de la Conciergerie, il renouait avec sa volonté
pure.
digne, se
repentit de ses fautes et envoya une con-fession écrite à un de ses
vicaires. Après sa mort, on s'aperçut qu'il était complè-tement
ruiné. La République qui, selon la loi, était son héritière,
pour ne pas être obligée de payer ses créanciers, dut déclarer la
faillite», rappelle Serge
Bianchi (in op. cit. p. 508). Moins moraliste que Dansette, il
conclut : «Jean-Baptiste Joseph Gobel incarna jusque dans
la mort les contradictions du sacerdoce et de l'engagement des
prêtres dans la Révolution sans que l'on puisse, pourtant, le
qualifier d'"évêque rouge"»
(S. Bianchi. ibid. p. 508). Il avait risqué le pari de la
tradition éthico-pédagogique en jouant la carte de l'assermentation.
Il avait gagné son pari, du moins tant que la radicalisation de la Révolution
ne le conduisît pas, forcé, jusqu'à rompre ses vœux. Une fois le pas
franchi par son abjuration même, dont il essayait d'en diminuer la
portée symbolique, plus rien ne retenait le christianisme français,
sinon que la ferveur des simples croyants qui continuaient clandestinement, à pratiquer le culte interdit. Après avoir abusé de sa liberté de volonté
en la contaminant de la
compromission avec les intérêts du monde, au seuil de la mort, dans
son cachot de la Conciergerie, il renouait avec sa volonté
pure.
Mais
face au modèle du prêtre constitutionnel fourvoyé par sa volonté
contaminée, il y en avait d'autres qui témoignaient d'une volonté pure. Je pense ici aux Carmélites de Compiègne exécutées à
Paris le 17 juillet 1794, dix jours avant la chute de
Robespierre. Ici, en effet, nous sommes pleinement dans la volonté pure; dans,
l'exercice  d'une authentique liberté de volonté. Cette
journée-là, seize religieuses carmélites du couvent de Compiègne
furent guillotinées :
«Arrêtées pour être demeurées groupées après la suppression
de leur monastère, traduite devant le Tribunal révolutionnaire,
l'une d'elles à ce qu'on rapporta, eut la présence d'esprit de
demander à Fouquier-Tinville [l'accusateur public, le D.P.C.P.
de l'époque] ce qu'il entendait par le terme de "fanatiques"
dont il les gratifiait, et sur sa réponse : "Votre fanatisme,
c'est votre sot attachement à vos stupides pratiques religieuses",
elle s'écria : "Oh, mes sœurs, vous avez entendu : nous sommes
condamnées pour notre religion... Quel bonheur de mourir pour notre
Dieu!" Exactement, l'accusateur venait par là de faire des
martyres. Au pied de l'échafaud, elles renouvelèrent leurs vœux et
entonnèrent le Veni Creator qui ne s'éteignit qu'avec la
dernière...» (Daniel-Rops. op. cit. 1960, p. 77). Guillotinées
sur la Place du Trône, elles furent enterrées au cimetière de
Picpus avec les autres victimes du jour. Pie X devait les béatifier
en 1906. Plus tard, le drame de Georges Bernanos mis en opéra par
Francis Poulenc, Les Dialogues des Carmélites, devait
actualiser le martyre de 1794.
d'une authentique liberté de volonté. Cette
journée-là, seize religieuses carmélites du couvent de Compiègne
furent guillotinées :
«Arrêtées pour être demeurées groupées après la suppression
de leur monastère, traduite devant le Tribunal révolutionnaire,
l'une d'elles à ce qu'on rapporta, eut la présence d'esprit de
demander à Fouquier-Tinville [l'accusateur public, le D.P.C.P.
de l'époque] ce qu'il entendait par le terme de "fanatiques"
dont il les gratifiait, et sur sa réponse : "Votre fanatisme,
c'est votre sot attachement à vos stupides pratiques religieuses",
elle s'écria : "Oh, mes sœurs, vous avez entendu : nous sommes
condamnées pour notre religion... Quel bonheur de mourir pour notre
Dieu!" Exactement, l'accusateur venait par là de faire des
martyres. Au pied de l'échafaud, elles renouvelèrent leurs vœux et
entonnèrent le Veni Creator qui ne s'éteignit qu'avec la
dernière...» (Daniel-Rops. op. cit. 1960, p. 77). Guillotinées
sur la Place du Trône, elles furent enterrées au cimetière de
Picpus avec les autres victimes du jour. Pie X devait les béatifier
en 1906. Plus tard, le drame de Georges Bernanos mis en opéra par
Francis Poulenc, Les Dialogues des Carmélites, devait
actualiser le martyre de 1794.
 Les
révo-lutionnai-res étaient entrés au Carmel de Compiè-gne au début
de la Révolu-tion, pensant offrir aux cloîtrées la liberté et les
rendre au monde. Ces fanatiques outrées préférèrent
toutefois rester dans leur communauté. Mais au bout de deux ans, la
garde armée finit par les disperser, les religieuses rendues à la
vie civile continuant d'entretenir leurs rites en secret. Dénoncées,
elles sont conduites à Paris :
Les
révo-lutionnai-res étaient entrés au Carmel de Compiè-gne au début
de la Révolu-tion, pensant offrir aux cloîtrées la liberté et les
rendre au monde. Ces fanatiques outrées préférèrent
toutefois rester dans leur communauté. Mais au bout de deux ans, la
garde armée finit par les disperser, les religieuses rendues à la
vie civile continuant d'entretenir leurs rites en secret. Dénoncées,
elles sont conduites à Paris :
«Avant de se séparer, la prieure a proposé à ses filles de s'offrir en victimes pour que l'Église et la France retrouvent la paix. Un "oui" général fut la réponse. Le 13
juillet, entassées dans des charret-tes, sans nourriture pendant trois jours, les mains liées derrière le dos, les treize [sic!] Carmélites de Compiègne sont conduites à la Conciergerie, à Paris. Une religieuse âgée, Marie-Anne Piecourt, qui a quatre-vingts ans, est jetée à terre. On la relève ensanglantée. "Merci de ne pas m'avoir tuée, dit-elle, vous m'auriez fait manquer le martyre". Elles sont, toutes les treize, de conditions sociales, d'âges, de caractères, bien différentes. Il y en a qui ont peur du supplice et de la mort, telles Anne-Marie Thouret, et Rose Chrétien de Neuville, entrée au Carmel après son veuvage. Marie-Anne Brideau est joyeuse, Marie-Françoise de Croissy exprime en un poème son désir de mourir pour le Christ. Il y a les deux jeunes servantes, Catherine et Thérèse qui ont supplié la prieure, l'admirable madame Lidoine, de leur permettre de mourir avec elle! En prison, la prieure a composé un chant : "L'élan joyeux de l'âme qui monte vers son Dieu", non pas sur l'air douceâtre d'un cantique, mais aux accents de la
Marseillaise! car c'est un chant de victoire qu'elles veulent entonner. Le 13 juillet, jour de leur arrivée à la Conciergerie, on leur annonce qu'elles comparaîtront le lendemain devant le tribunal révolutionnaire. Le 14, en effet, elles entendront le verdict : "La mort pour toutes". Elles l'accueillent d'un visage rayonnant. Sur leur passage un homme ne peut s'empêcher de pleurer. "Mais ne touchons-nous pas au terme de nos maux? dit l'une d'elles. Priez plutôt le bon Dieu et la Sainte Vierge pour qu'ils daignent nous assister dans ces derniers instants. Ce soir nous serons au ciel, et nous prierons pour vous". Rentrées dans leur cachot, les Carmélites récitent pour elles-mêmes les prières des agonisants. Des grincements de roues : ce sont les charrettes de la mort. Les religieuses, debout, les mains liées derrière le dos, chantent le Salve Regina et le Te Deum. Au détour de la rue Saint-Antoine, un homme portant la carmagnole leur donne une ultime absolution : un prêtre se cache sous ce déguisement. Voilà la place du Trône. Les Carmélites descendent, elles entourent leur prieure. Chacune, à son tour, renouvelle ses vœux de religion. Elles
entonnent le Veni Creator. La plus jeune, age-nouillée demande à sa prieure la permis-sion de mourir, puis monte les marches. Une à une, elles vont la suivre et c'est le bruit du couperet et le choc de la tête qui roule. "Madame Lidoine" offrira la dernière son cou au bourreau» (Marteau de Langle de Cary et G. Taburet-Missoffe. Dictionnaire des Saints, Paris, L.G.F., col. Livre de poche chrétien, # A28/A29, 1963, pp. 70-71).
Les
Carmélites de Compiègne ne furent certes pas les seules religieuses
à périr sous le rasoir national. Daniel-Rops rappelle,
pieusement, «les Sacramentines de Bollène qui, avant  de mourir,
remerciaient leurs juges et leurs bourreaux et dont l'une baisa
l'échafaud avant d'y monter. [Et] les Ursulines de
Valen-ciennes, qui chantèrent le Te Deum et prièrent pour
leurs bourreaux, ou les Filles de la Charité d'Arras, qui arrivèrent
à la guillotine ceintes du Rosaire...» (Daniel-Rops. op. cit.
1960, p. 77). Sans oublier les membres des congrégations masculines.
Les persécutions religieuses des révolutionnaires français, comme
au temps des persécutions sous l'Empire romain, avaient renouveler
le sens de ce que signifiait prononcer des vœux.
de mourir,
remerciaient leurs juges et leurs bourreaux et dont l'une baisa
l'échafaud avant d'y monter. [Et] les Ursulines de
Valen-ciennes, qui chantèrent le Te Deum et prièrent pour
leurs bourreaux, ou les Filles de la Charité d'Arras, qui arrivèrent
à la guillotine ceintes du Rosaire...» (Daniel-Rops. op. cit.
1960, p. 77). Sans oublier les membres des congrégations masculines.
Les persécutions religieuses des révolutionnaires français, comme
au temps des persécutions sous l'Empire romain, avaient renouveler
le sens de ce que signifiait prononcer des vœux.
 Les
Dialogues des Carmélites (1949) est une œuvre tardive dans
l'ensemble des écrits de Georges Bernanos. En fait, c'est la dernière
aventure littéraire du romancier déjà atteint d'un cancer
du foie. En 1937, une autrice allemande, Gertrud von Le Fort,
septuagénaire d'origine huguenote, fille d'un officier prussien,
luthérienne convertie au catholicisme et diplômée en théologie,
avait publié une nouvelle, La Dernière à l'échafaud (Die
Letzte am Schafott), inspirée de La Relation du martyre des
seize Carmélites de Compiègne, rédigée par la seule rescapée,
sœur Marie de l'Incarnation (Françoise-Geneviève Philippe,
1761-1836). La romancière s'était projetée dans la nouvelle en
donnant son propre patronyme – Blanche de La Force – à
l'héroïne, Blanche de l'Agonie du Christ. Un ami de Bernanos, le
R.P. Bruckberger, féru de cinéma, proposa à Bernanos
d'en tirer un scénario.
Les
Dialogues des Carmélites (1949) est une œuvre tardive dans
l'ensemble des écrits de Georges Bernanos. En fait, c'est la dernière
aventure littéraire du romancier déjà atteint d'un cancer
du foie. En 1937, une autrice allemande, Gertrud von Le Fort,
septuagénaire d'origine huguenote, fille d'un officier prussien,
luthérienne convertie au catholicisme et diplômée en théologie,
avait publié une nouvelle, La Dernière à l'échafaud (Die
Letzte am Schafott), inspirée de La Relation du martyre des
seize Carmélites de Compiègne, rédigée par la seule rescapée,
sœur Marie de l'Incarnation (Françoise-Geneviève Philippe,
1761-1836). La romancière s'était projetée dans la nouvelle en
donnant son propre patronyme – Blanche de La Force – à
l'héroïne, Blanche de l'Agonie du Christ. Un ami de Bernanos, le
R.P. Bruckberger, féru de cinéma, proposa à Bernanos
d'en tirer un scénario.
Le dominicain Bruckberger
avait d'abord pensé à Albert Camus, mais
ce dernier, ne se considéra «pas capable de
pouvoir assurer un tel travail. %20bis.jpg) Prétextant ne pas avoir la foi, il
se désiste et suggère Bernanos pour le remplacer. Le père
Bruckberger ne fut pas déçu d'avoir suivi son conseil. "[Bernanos]
était entré à l'intérieur du personnage de Blanche de La Force.
[...] Il en ressentait toute l'angoisse et la peur de la mort
inéluctable qui approchait à grands pas pour elle comme pour lui»
(P. Dufay. Bernanos, Paris, Perrin, 2013, p. 227). Albert
Béguin et Marcelle Tassencourt l'adaptèrent pour le théâtre avec
un bref prologue et cinq tableaux. Le canevas s'éloignait des
personnages historiques sans pour autant rien négliger de l'esprit
de leur expérience ultime :
Prétextant ne pas avoir la foi, il
se désiste et suggère Bernanos pour le remplacer. Le père
Bruckberger ne fut pas déçu d'avoir suivi son conseil. "[Bernanos]
était entré à l'intérieur du personnage de Blanche de La Force.
[...] Il en ressentait toute l'angoisse et la peur de la mort
inéluctable qui approchait à grands pas pour elle comme pour lui»
(P. Dufay. Bernanos, Paris, Perrin, 2013, p. 227). Albert
Béguin et Marcelle Tassencourt l'adaptèrent pour le théâtre avec
un bref prologue et cinq tableaux. Le canevas s'éloignait des
personnages historiques sans pour autant rien négliger de l'esprit
de leur expérience ultime :
«Sujette à la peur et à l'angoisse, Blanche de La Force décide d'entrer au Carmel pour recouvrer l'honneur et choisit comme nom de Carmélite celui de Sœur Blanche
de l'Agonie du Christ. La Prieure, Mme de Croissy, offre sa mort pour elle. Survient la Révo-lution : le Chevalier de La Force se rend au Carmel et tente en vain de convaincre Blanche de partir avec lui afin d'être plus en sûreté. À l'instigation de Mère Marie de l'Incarnation, les Carmélites acceptent de prononcer le vœu du martyre : aussitôt après, Blanche s'enfuit du couvent et se cache à Paris. Expulsées de leur couvent, les Carmélites sont ensuite arrêtées et condamnées à mort. Réfugiée à l'hôtel de La Force, Blanche, réduite à l'état de servante, trouvera la force nécessaire pour rejoindre ses compagnes au pied de l'échafaud, tandis que Mère Marie acceptera, au contraire, pour aider Blanche – comme sœur Constance – à surmonter sa peur, de renoncer au martyre» (M. Estève. Bernanos, Paris, Gallimard, Col. La Bibliothèque idéale, 1965, p. 185).
Bernanos
s'engagea dans la rédaction des Dialogues avec la fièvre de
l'œuvre  testamentaire. «Épuisé, l'écrivain s'investit dans
ses personnages au point de faire dire à sœur Constance, jeune
novice, évoquant la prieure du Carmel, mère Henriette de Jésus,
agonisante : "À cinquante-neuf ans, n'est-il pas grand temps de
mourir?» (M. Estève. ibid. p. 228). À sa façon, la rédaction
des Dialogues lui permettait,
à lui aussi, de renouveler son vœu de catholique intégral. Après
avoir défendu la tradition éthico-pédagogique à la suite de
l'épreuve de l'occupation, ayant prêché le pardon et
la réconciliation avec les Collaborateurs et les Allemands qui
avaient persécuté les siens, il renouait avec la tradition
mystico-ontologique en s'associant à l'agonie de ces religieuses. Après tout, ces religieuses ne venaient-elles pas de
Compiègne, le lieu de naissance de la sainte favorite de l'auteur,
Jeanne d'Arc? Tout cela ne faisait qu'un dans l'esprit de Bernanos.
testamentaire. «Épuisé, l'écrivain s'investit dans
ses personnages au point de faire dire à sœur Constance, jeune
novice, évoquant la prieure du Carmel, mère Henriette de Jésus,
agonisante : "À cinquante-neuf ans, n'est-il pas grand temps de
mourir?» (M. Estève. ibid. p. 228). À sa façon, la rédaction
des Dialogues lui permettait,
à lui aussi, de renouveler son vœu de catholique intégral. Après
avoir défendu la tradition éthico-pédagogique à la suite de
l'épreuve de l'occupation, ayant prêché le pardon et
la réconciliation avec les Collaborateurs et les Allemands qui
avaient persécuté les siens, il renouait avec la tradition
mystico-ontologique en s'associant à l'agonie de ces religieuses. Après tout, ces religieuses ne venaient-elles pas de
Compiègne, le lieu de naissance de la sainte favorite de l'auteur,
Jeanne d'Arc? Tout cela ne faisait qu'un dans l'esprit de Bernanos.
La
charrette conduisant les Carmélites de Compiègne suivait de quelques
jours à peine celle qui avait mené Gobel à l'échafaud. Les religieuses
réfractaires rejoignaient ainsi l'évêque  apostat dans un même
destin tragique. L'évêque avait abjuré mais les reli-gieuses étaient
restées fidèles à leurs vœux au prix de la clandestinité. Puis l'évêque s'était rétracté, mais les
religieuses avaient renouvelé leurs vœux. Les terribles conditions dans
lesquelles les catholiques français vécurent la Révolution nous
font apparaître nos actuelles promesses de politiciens et
d'idéologues sans consistances puisqu'il n'y a plus aucun enjeu vital autour d'engagements, généralement opportunistes. Aussi, le
sacrifice de l'un et des autres nous apparaît aujourd'hui quelque
chose de franchement incompréhensible.
apostat dans un même
destin tragique. L'évêque avait abjuré mais les reli-gieuses étaient
restées fidèles à leurs vœux au prix de la clandestinité. Puis l'évêque s'était rétracté, mais les
religieuses avaient renouvelé leurs vœux. Les terribles conditions dans
lesquelles les catholiques français vécurent la Révolution nous
font apparaître nos actuelles promesses de politiciens et
d'idéologues sans consistances puisqu'il n'y a plus aucun enjeu vital autour d'engagements, généralement opportunistes. Aussi, le
sacrifice de l'un et des autres nous apparaît aujourd'hui quelque
chose de franchement incompréhensible.
Aussi incompréhensible d'ailleurs, mais dans un autre sens, que l'intrigue du film de Steven  Spielberg, Saving private Ryan (Il faut sauver le soldat Ryan) (1998). Ce film, qui a décroché l'honneur de plusieurs Oscars et fut un succès au box-office, a même été inscrit en 2014 au National Film Registry pour être conservé à la Bibliothèque du Congrès comme étant «culturellement, historiquement et esthétiquement important». Il faut dire que Spielberg, dans la veine des œuvres de Sam Peckinpah et de Brian de Palma, est un virtuose de l'esthétique du sang. Il en donne la preuve dès l'ouverture du film avec une terrible scène de violence guerrière située lors du débarquement à Omaha Beach, en Normandie, le 6 juin 1944 : «Cette fois, la séquence de bataille qui démarre le film est d'une violence et d'un acharnement
Spielberg, Saving private Ryan (Il faut sauver le soldat Ryan) (1998). Ce film, qui a décroché l'honneur de plusieurs Oscars et fut un succès au box-office, a même été inscrit en 2014 au National Film Registry pour être conservé à la Bibliothèque du Congrès comme étant «culturellement, historiquement et esthétiquement important». Il faut dire que Spielberg, dans la veine des œuvres de Sam Peckinpah et de Brian de Palma, est un virtuose de l'esthétique du sang. Il en donne la preuve dès l'ouverture du film avec une terrible scène de violence guerrière située lors du débarquement à Omaha Beach, en Normandie, le 6 juin 1944 : «Cette fois, la séquence de bataille qui démarre le film est d'une violence et d'un acharnement  absolus. Les barges améri-caines n'ont pas sitôt accosté sur les plages de Norman-die que les flots de jeunes soldats qu'elles y déversent sont irrémédiablement fauchés par des tirs incessants de mitrailleuses, les balles traversant leurs casques inutiles avec des "cling" insupportables. Des hommes sont réduits en bouillie. Des morceaux de corps giclent dans les airs et jonchent le sol. La mer se colore d'un rouge qui donne la nausée. La caméra elle-même titube et la pellicule vire au pourpre. Le "nouveau" Spielberg ne fait pas de prisonnier» (S. J. Schneider. 1001 films à voir et revoir, Montréal, HMH, 2004, p. 886).
absolus. Les barges améri-caines n'ont pas sitôt accosté sur les plages de Norman-die que les flots de jeunes soldats qu'elles y déversent sont irrémédiablement fauchés par des tirs incessants de mitrailleuses, les balles traversant leurs casques inutiles avec des "cling" insupportables. Des hommes sont réduits en bouillie. Des morceaux de corps giclent dans les airs et jonchent le sol. La mer se colore d'un rouge qui donne la nausée. La caméra elle-même titube et la pellicule vire au pourpre. Le "nouveau" Spielberg ne fait pas de prisonnier» (S. J. Schneider. 1001 films à voir et revoir, Montréal, HMH, 2004, p. 886).
Mais le nouveau Spielberg n'éclipse pas l'ancien pour autant, et très vite il retombe sur ses  deux béquilles, la sentimentalité romanesque et le mani-chéisme, travers dans lesquels un Peckinpah s'avisait de ne jamais sombrer! Au-delà de l'intérêt historique du débarquement de Normandie, c'est la corde sensible patriotique américaine qu'entend faire vibrer le réalisateur, et là n'est pas la moindre importance :
deux béquilles, la sentimentalité romanesque et le mani-chéisme, travers dans lesquels un Peckinpah s'avisait de ne jamais sombrer! Au-delà de l'intérêt historique du débarquement de Normandie, c'est la corde sensible patriotique américaine qu'entend faire vibrer le réalisateur, et là n'est pas la moindre importance :
«L'intrigue de Il faut sauver le soldat Ryan se structure autour de la mission d'un commando spécial de huit soldats d'élite envoyés en Normandie, en juin 1944, derrière les lignes allemandes, pour retrouver un soldat inconnu et le renvoyer chez
lui. Le soldat Ryan n'a pas demandé à être relevé de ses fonctions. Il est prêt à risquer sa vie au front, estime de son devoir d'y rester. Mais l'ordre vient du général Marshall lui-même : l'institution s'est aperçue que la mère de Ryan venait de perdre sur le front, la même semaine, ses trois autres fils. Elle non plus n'a rien demandé, mais pour l'armée américaine, cela devient une question de principe : si l'on est en guerre contre le nazisme au service des valeurs humanistes, on ne prend pas à une mère tous ses fils pour la défense de la patrie. Il faut qu'il reste de la vie, une part de cette vie doit rester privée, intouchable : l'État démocratique ne peut ni l'exiger, ni l'accepter en sacrifice pour le bien de tous, sous peine de devenir un monstre» (F. Leichter-Flack. Le laboratoire des cas de conscience, Paris, Flammarion, Col. Champs essais, 2023, p. 100).
Rassurons-nous d'abord : la Seconde Guerre mondiale ne compte pas parmi ses causes l'humanisme, et l'alliance avec la Russie soviétique montre que la démocratie, non plus, n'était pas un facteur déterminant. Le sentiment de frustration née de l'attaque surprise japonaise sur Pearl Harbor a été beaucoup plus décisive dans le choix de l'État américain de s'engager dans la guerre que des thèmes idéalistes. Aussi, tenant compte de ce fait, la suite du film est carrément improbable, ou du moins surréaliste.
Le scénario, écrit par Robert Rodat pour Steven Spielberg, en effet et c'est le moindre que l'on puisse dire, repose sur un ensemble de postulats peu probables. Ce n'est pas qu'il n'y  ait pas eu de fratries décimées. De fait,
l’histoire vraie derrière le scénario du Soldat Ryan, c’est celle des
frères Niland. Sur les quatre, deux survécurent au conflit, mais on pensa pendant un temps qu'un seul, Frederick Niland, avait survécu. Il fut alors retiré du front de Normandie, mais non à la suite de la rescousse d'un commando mais par une initiative administrative. De fait, l'autre frère survivant, détenu en Birmanie par les Japonais, ne devait être retourné aux siens qu'à la fin de la guerre.
ait pas eu de fratries décimées. De fait,
l’histoire vraie derrière le scénario du Soldat Ryan, c’est celle des
frères Niland. Sur les quatre, deux survécurent au conflit, mais on pensa pendant un temps qu'un seul, Frederick Niland, avait survécu. Il fut alors retiré du front de Normandie, mais non à la suite de la rescousse d'un commando mais par une initiative administrative. De fait, l'autre frère survivant, détenu en Birmanie par les Japonais, ne devait être retourné aux siens qu'à la fin de la guerre.
Informé de la mort des trois frères Ryan la même semaine par les télégrammes envoyés à la mère des disparus, le général George C. Marshall - le même que le célèbre Plan Marshall d'aide américaine à la reconstruction de l'Europe -, alors chef d'état-major de l'Armée américaine, décide de monter une expédition de sauvetage qui est confiée au  capitaine Miller. À la tête d'une escouade de sept hommes, il doit retrouver le dernier Ryan encore en vie, combattant quelque part dans le bocage de Cottentin, en plein milieu des combats pour la conquête de la Normandie. L'ordre est de le ramener sain et sauf en Amérique. Évidemment, le petit corps expéditionnaire se retrouve au milieu des échanges de tirs entre Allemands et Alliés. Plusieurs des soldats sont tués et le reste des hommes de Miller plongent dans une mélancolie amère et désillusionnée. Pour la première fois, ils se demandent si la vie du seul soldat Ryan vaut la peine de risquer la vie de huit officiers d'élite?
capitaine Miller. À la tête d'une escouade de sept hommes, il doit retrouver le dernier Ryan encore en vie, combattant quelque part dans le bocage de Cottentin, en plein milieu des combats pour la conquête de la Normandie. L'ordre est de le ramener sain et sauf en Amérique. Évidemment, le petit corps expéditionnaire se retrouve au milieu des échanges de tirs entre Allemands et Alliés. Plusieurs des soldats sont tués et le reste des hommes de Miller plongent dans une mélancolie amère et désillusionnée. Pour la première fois, ils se demandent si la vie du seul soldat Ryan vaut la peine de risquer la vie de huit officiers d'élite?
«La priorité absolue accordée au sauvetage de Ryan ne va pas de soi à l'épreuve du terrain; elle est constamment questionnée tout au long du film. Les adjoints du général Marshall se risquaient déjà à douter du bien-fondé d'une telle mission : on ne sait même pas si Ryan est encore vivant, faut-il vraiment risquer la vie de plusieurs hommes d'élite pour un gain si aléatoire? Ce sont surtout les hommes du commando missionné qui s'interrogent sur cette étrange allocation des ressources militaires, qui ordonne à huit hommes de risquer leur vie - et, bientôt, de la perdre - pour sauver celle d'un anonyme» (F. Leichter-Flack. ibid. pp. 100-101).
Véritable cas de casuistique comme Frédérique Leichter-Flack pose le dilemme, on voit mal la rationalité militaire derrière la mission ordonnée par Marshall : «À l'objection présente depuis le début dans l'esprit des soldats du commando - la vie de Ryan ne vaut pas plus que celle  de ses camara-des, il n'a rien fait pour mériter d'être ainsi privilégié - s'ajoute celle qui surgit quand Ryan lui-même, enfin localisé, refuse d'abandonner son poste : pourquoi l'obliger à se sauver malgré lui? Il suffit en réalité au chef du commando d'exprimer ces deux objections à haute voix pour sentir combien elles sont inadéquates. Préserver la vie, l'émotion humaine, le sens d'un combat "pour la vie", cela n'a, en réalité, plus grand-chose à voir avec la personne de Ryan. L'enjeu le dépasse largement. Tout cela n'a, assurément, rien à voir avec son mérite propre» (F. Leichter-Flack. ibid. p. 101). Alors, avec quoi tout cela rime-t-il?
de ses camara-des, il n'a rien fait pour mériter d'être ainsi privilégié - s'ajoute celle qui surgit quand Ryan lui-même, enfin localisé, refuse d'abandonner son poste : pourquoi l'obliger à se sauver malgré lui? Il suffit en réalité au chef du commando d'exprimer ces deux objections à haute voix pour sentir combien elles sont inadéquates. Préserver la vie, l'émotion humaine, le sens d'un combat "pour la vie", cela n'a, en réalité, plus grand-chose à voir avec la personne de Ryan. L'enjeu le dépasse largement. Tout cela n'a, assurément, rien à voir avec son mérite propre» (F. Leichter-Flack. ibid. p. 101). Alors, avec quoi tout cela rime-t-il?
L'opiniâtreté du private Ryan finit par débaucher les officiers de la mission qui se joignent à lui pour l'aider à défendre le pont contre un coup de force ennemi. Comme dans les meilleurs westerns du genre, la cavalerie arrive à temps pour sauver Ryan, bien que les officiers d'élite soient morts au combat, y compris Miller, le chef de la mission. La mort  de Miller est d'ailleurs filmée comme l'une de ces scènes de Greuze, au XVIIIe siècle, où le père mourant justifie la mission au dernier Ryan : «James... mérite-ça. Mérite-le» : «Le conscrit de Spielberg aussi devra comprendre, et admettre, qu'il doit être sauvé, non pour lui-même, mais pour ce qu'il représente» (F. Leichter-Flack. ibid. p. 102). Les années passent. Revenu au cimetière de Colleville-sur-Mer, James Ryan demande alors à sa femme s'il a été digne d'un tel sacrifice, s'il a été «un homme bien». Elle lui répond - et que pouvait-elle répondre d'autres devant ce vieillard avec qui elle avait passé toute sa vie? - qu'il l'est. Ryan salue ensuite la tombe de Miller. La dernière séquence - reprenant la première - montre le drapeau américain flottant fièrement dans le ciel.
de Miller est d'ailleurs filmée comme l'une de ces scènes de Greuze, au XVIIIe siècle, où le père mourant justifie la mission au dernier Ryan : «James... mérite-ça. Mérite-le» : «Le conscrit de Spielberg aussi devra comprendre, et admettre, qu'il doit être sauvé, non pour lui-même, mais pour ce qu'il représente» (F. Leichter-Flack. ibid. p. 102). Les années passent. Revenu au cimetière de Colleville-sur-Mer, James Ryan demande alors à sa femme s'il a été digne d'un tel sacrifice, s'il a été «un homme bien». Elle lui répond - et que pouvait-elle répondre d'autres devant ce vieillard avec qui elle avait passé toute sa vie? - qu'il l'est. Ryan salue ensuite la tombe de Miller. La dernière séquence - reprenant la première - montre le drapeau américain flottant fièrement dans le ciel.
Ces clichés, monnaies courantes dans l'histoire du cinéma américain, expliquent le succès phénoménal du film de Spielberg qui ne mérite pas, lui, les hommages reçus. Wikipédia a  recensé tous les anachronismes, toutes les erreurs militaires et histo-riques du film - faut-il que tout le budget de reconsti-tution historique ait été dévoré par celui des effets spéciaux sanglants du carnage du début du film? Bref, tout le contraire d'un film de guerre de Peckinpah, Cross of Iron (1977), remarquable par l'authenticité du matériel de guerre utilisé et les toutes aussi violentes scènes de combats. Ce n'est donc pas pour son respect de la vérité historique que le Congrès s'est engagé à protéger le film! Nonobstant, bien qu'on puisse apprécier la réalisation vigoureuse et le jeu des acteurs, l'essentiel n'est pas là.
recensé tous les anachronismes, toutes les erreurs militaires et histo-riques du film - faut-il que tout le budget de reconsti-tution historique ait été dévoré par celui des effets spéciaux sanglants du carnage du début du film? Bref, tout le contraire d'un film de guerre de Peckinpah, Cross of Iron (1977), remarquable par l'authenticité du matériel de guerre utilisé et les toutes aussi violentes scènes de combats. Ce n'est donc pas pour son respect de la vérité historique que le Congrès s'est engagé à protéger le film! Nonobstant, bien qu'on puisse apprécier la réalisation vigoureuse et le jeu des acteurs, l'essentiel n'est pas là.
Ce film raconte la nécessité de rester fidèle à son vœu. Le Père de la nation, ici le général Marshall, fait le vœu national de sauver le fils survivant de la Mère. Comme le dit Leichter-Flack, il n'est pas nécessaire que tous les fils meurent à la guerre. Ce vœu n'est pas  contraire au patrio-tisme qui impose une logique militaire ration-nelle et impec-cable. Il s'inscrit d'ailleurs dans le patriotis-me de la fratrie Ryan, éduquée par la Mère. Les fils sont morts au combat, faisant honneur à l'Amérique. L'Amérique se doit de sauver le dernier fils Ryan, car il est l'espérance que le patriotisme ne s'éteindra jamais. Il est la graine de semence capable d'assurer la pérennité du patriotisme américain. Depuis la première guerre du Golfe au début des années 1990, celui-ci montrait des signes de lassitude. C'est alors que Spielberg tourna le film. Mais malgré le succès du film, il faudra les attaques du 11 septembre 2001 pour le réveiller.
contraire au patrio-tisme qui impose une logique militaire ration-nelle et impec-cable. Il s'inscrit d'ailleurs dans le patriotis-me de la fratrie Ryan, éduquée par la Mère. Les fils sont morts au combat, faisant honneur à l'Amérique. L'Amérique se doit de sauver le dernier fils Ryan, car il est l'espérance que le patriotisme ne s'éteindra jamais. Il est la graine de semence capable d'assurer la pérennité du patriotisme américain. Depuis la première guerre du Golfe au début des années 1990, celui-ci montrait des signes de lassitude. C'est alors que Spielberg tourna le film. Mais malgré le succès du film, il faudra les attaques du 11 septembre 2001 pour le réveiller.
Pour peu, nous serions dans l'une de ces légendes celtiques [le film, en partie tournée en Irlande, présente un américain au nom de consonance irlandaise], arthuriennes ou médiévales où le roi-suzerain se doit à ses chevaliers et vassaux, tous engagés par un  serment, l'adoubement (la Table Ronde autour du roi Arthur). La rhéto-rique de l'huma-nisme et de la démocratie ne fait que masquer ces préoccupations mystiques qui appartiennent à un autre âge. Les dragons ne sont plus des dragons mais des tanks, des bombardiers, des obus... L'emprise du Mal s'appelle Hitler et il règne sur le monde comme le Ty-rex des Parcs Jurassiques. La notion de mérite n'est-elle pas, elle-même, d'origine médiévale? Dieu est miséricordieux pour ses enfants, l'État américain ne peut faire moins. Par le cinéma, Spielberg fait renaître la forme mystico-ontologique qui défie la réalité historique.
serment, l'adoubement (la Table Ronde autour du roi Arthur). La rhéto-rique de l'huma-nisme et de la démocratie ne fait que masquer ces préoccupations mystiques qui appartiennent à un autre âge. Les dragons ne sont plus des dragons mais des tanks, des bombardiers, des obus... L'emprise du Mal s'appelle Hitler et il règne sur le monde comme le Ty-rex des Parcs Jurassiques. La notion de mérite n'est-elle pas, elle-même, d'origine médiévale? Dieu est miséricordieux pour ses enfants, l'État américain ne peut faire moins. Par le cinéma, Spielberg fait renaître la forme mystico-ontologique qui défie la réalité historique.
Et la honte de tourmenter, a posteriori, James Francis Ryan lui demande des comptes sur son mérite; s'il est à la hauteur de Miller (substitut du Père) et de l'attente de sa mère (substitut de l'Amérique). Bref, en lui sauvant la vie, Miller et ses hommes la lui ont retirée :
«Et il n'est pas si facile à Ryan d'admettre que sa vie ne lui appartient plus, qu'il n'est plus libre d'en disposer selon ses engagements, qu'il est désormais tenu de la
préserver. La honte, aussi, l'assaille. Car pour l'obliger à accepter de quitter le front, on lui a expliqué, durement, que d'autres soldats sont morts pour lui, qu'il ne peut plus refuser de partir : leur mort perdrait tout son sens. Le voilà pris au piège : la vie dont on lui offre le privilège, et dont huit morts ont été le prix, il faudra qu'il en fasse bon usage, qu'il prouve rétrospectivement qu'il la méritait» (F. Leichter-Flack. ibid. p. 102).
Et c'est par ce revers honteux que le vœu du Général Marshall se transforme en dette insolvable pour Ryan. La méritocratie, qui n'a jamais été une qualité de Ryan autrement qu'en tant que combattant patriote, devient une médiocratie dans le système des relations sociales qui vivent davantage de symboles que de réalités :
«"Earn this" lui souffle, en mourant, le dernier homme du commando venu le sauver. Avec cette responsabilité qui pèse sur les épaules de Ryan..., la question du mérite, pourtant écartée, se réinvite dans le jeu. Méritez cette vie! Faites quelque chose de votre vie, prouvez que l'on a bien fait de vous sauver, confortez-nous dans notre parti de vous préférer, vous, vivant, à n'importe quel autre : avec la dette vient la reconnaissance de dette, que toute une vie ultérieure tentera de rembourser sans jamais y parvenir vraiment, car comment calculer le solde? L'exemplarité - celle on se satisfera comme preuve que l'on a fait le bon choix - revient par la petite porte, elle qui n'avait jamais été sollicitée dans la délibération sur la valeur d'une vie, mais dont on comprend, après coup, que l'on ne peut pas tout à fait s'en passer. Car là encore, il y a un risque d'image - celui de voir l'injustice polluer le marché éthique» (F. Leichter-Flack. ibid. pp. 102-103).
Le mérite dissimule alors non plus le patriotisme - il passe en second, comme implicite -, mais le bon vieil utilitarisme capitaliste. À défaut de l'avoir sauvé de la mort sur le champ  de bataille, Ryan doit désormais se montrer bon pro-ducteur et excellent consom-mateur s'il veut mériter des honneurs du sacrifice de ses pals : «Tu ne mérites pas d'être sauvé au détriment des autres, mais puisque tu l'es, mérite-le! Le message adressé à Ryan par les camarades qui meurent pour lui repose sur ce paradoxe» (F. Leichter-Flack. ibid. p. 103). On comprend ici les raisons inconscientes qui motivaient Ryan à ne pas quitter son poste en Normandie. Là il était toujours maître de son destin. Il accomplissait son vœu personenel, de la même façon que ses frères. Là, il n'était pas moins patriote qu'eux ou Miller. Maintenant, il était l'obligé de l'État américain et des considérations morales et sociales de sa famille, de ses amis et de son milieu, considérations qui l'enchaîneront et le poursuivront jusqu'à la cérémonie du Souvenir qui inaugure et clôt le film. Chacun savait le prix qu'il avait coûté sur le champ de bataille, et il devait se montrer à la hauteur de cette dette contractée par le vœu d'un général émotionné. Méfions-nous donc lorsque l'État fait des vœux en notre nom. Ou bien, il ne tiendra pas ses promesses, ou bien il vous en fera porter le fardeau.
de bataille, Ryan doit désormais se montrer bon pro-ducteur et excellent consom-mateur s'il veut mériter des honneurs du sacrifice de ses pals : «Tu ne mérites pas d'être sauvé au détriment des autres, mais puisque tu l'es, mérite-le! Le message adressé à Ryan par les camarades qui meurent pour lui repose sur ce paradoxe» (F. Leichter-Flack. ibid. p. 103). On comprend ici les raisons inconscientes qui motivaient Ryan à ne pas quitter son poste en Normandie. Là il était toujours maître de son destin. Il accomplissait son vœu personenel, de la même façon que ses frères. Là, il n'était pas moins patriote qu'eux ou Miller. Maintenant, il était l'obligé de l'État américain et des considérations morales et sociales de sa famille, de ses amis et de son milieu, considérations qui l'enchaîneront et le poursuivront jusqu'à la cérémonie du Souvenir qui inaugure et clôt le film. Chacun savait le prix qu'il avait coûté sur le champ de bataille, et il devait se montrer à la hauteur de cette dette contractée par le vœu d'un général émotionné. Méfions-nous donc lorsque l'État fait des vœux en notre nom. Ou bien, il ne tiendra pas ses promesses, ou bien il vous en fera porter le fardeau.
Le mauvais tour que Spielberg fait jouer au vœu de l'un en le transformant en dette de  l'autre (l'Ordre du mérite) est une perversion de l'idéal chevaleresque médiéval mais aussi de la forme mystico-ontologique. Peut-être devrions-nous plutôt le reprocher à cette culture de donjon/dragon qui passionne la jeunesse occidentale? Les vœux rompus appellent à la miséricorde du Dieu sauveur. En acceptant de rompre son vœu de combattant pour complaire - pour sauver? - au vœu du général Marshall et ne pas le rompre de force, le private Ryan n'ira pas plus loin au Paradis que la sphère lunaire où se retrouvent Piccarda, Clémence de Hauteville, Gobel et les Carmélites de Compiègne. Ce qui est déjà beau, reconnaissons-le. Pour rester dans cet héritage mal avoué qui baigne le film de Spielberg, il ne reste que ce poème gaélique de Lady Gregory (traduction de Marion Peter) récité lors de la veillée du réveillon du film posthume de John Huston, The Dead (1987) : «Vœux rompus» :
l'autre (l'Ordre du mérite) est une perversion de l'idéal chevaleresque médiéval mais aussi de la forme mystico-ontologique. Peut-être devrions-nous plutôt le reprocher à cette culture de donjon/dragon qui passionne la jeunesse occidentale? Les vœux rompus appellent à la miséricorde du Dieu sauveur. En acceptant de rompre son vœu de combattant pour complaire - pour sauver? - au vœu du général Marshall et ne pas le rompre de force, le private Ryan n'ira pas plus loin au Paradis que la sphère lunaire où se retrouvent Piccarda, Clémence de Hauteville, Gobel et les Carmélites de Compiègne. Ce qui est déjà beau, reconnaissons-le. Pour rester dans cet héritage mal avoué qui baigne le film de Spielberg, il ne reste que ce poème gaélique de Lady Gregory (traduction de Marion Peter) récité lors de la veillée du réveillon du film posthume de John Huston, The Dead (1987) : «Vœux rompus» :
«Tard hier soir,Le chien parlait de toi.La bécasse parlait de toi au cœur du marais.Car tu es l’oiseau solitaire à travers bois.Et puisses tu demeurer sans compagnon...Jusqu’à ce que tu m’aies trouvé.Tu m’as promis,Et tu m’as menti.Tu as dit que tu m’apparaîtrais, quand s’assemblerait le troupeau de moutons. J’ai sifflé, j’ai crié trois cent fois vers toi.Et je n’ai rien trouvé... Qu’un agneau bêlant.Tu m’as promis une chose qui était difficile à trouver.Une nef d’or sous un mât d’argent.Douze villes, avec chacune un marché.Et un beau palais blanc sur le rivage de la mer.Tu m’as promis une chose qui n’était pas possible.Que tu me donnerais des gants faits de la peau d’un poisson.Que tu me donnerais des souliers de peau d’oiseaux.Et un habit de la plus coûteuse soie d’Irlande.Ma mère m’a dit de ne pas te parler.Aujourd’hui, ni demain, ni dimanche.Elle a mal choisi son moment pour me le dire.C’était fermer sa porte, après le cambriolage.Tu m’as pris l’Est.Tu m’as pris l’Ouest.Tu m’as pris ce qui était devant moi, et ce qui était derrière moi.Tu m’as pris la lune.Tu m’as pris le soleil.Et j’ai grand'peur, que tu ne m’aies pris DIEU!»⏳

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire