 |
| L'Empereur Justinien et sa cour. Saint-Vital de Ravenne |
DANS LA SPHÈRE DE MERCURE :
JUSTINIEN
La sphère céleste de
Mercure apparaît occupée par un seul individu,  l'empereur Justinien. Les chants V à VII du Paradis nous le montre
se présentant à ses visiteurs, Dante et Béatrice. Le poète se sert de Justinien afin d'exposer sa pensée
politique, pensée déjà formulée et développée dans
son traité De Monarchia (1310-1313),
ouvrage qui, contrairement à La Divine Comédie, était
entièrement rédigé en latin, comme tous les traités de
l'époque médiévale. Il avait été rédigé au milieu des tourmentes politiques qui déchiraient sa ville, Florence, tout comme les autres communes de la péninsule italienne. Par cet ouvrage, Dante témoignait de son implication volontaire dans
l'avenir de sa Florence natale, implication qui devenait finir par lui coûter l'exil hors de sa cité bien-aimée.
l'empereur Justinien. Les chants V à VII du Paradis nous le montre
se présentant à ses visiteurs, Dante et Béatrice. Le poète se sert de Justinien afin d'exposer sa pensée
politique, pensée déjà formulée et développée dans
son traité De Monarchia (1310-1313),
ouvrage qui, contrairement à La Divine Comédie, était
entièrement rédigé en latin, comme tous les traités de
l'époque médiévale. Il avait été rédigé au milieu des tourmentes politiques qui déchiraient sa ville, Florence, tout comme les autres communes de la péninsule italienne. Par cet ouvrage, Dante témoignait de son implication volontaire dans
l'avenir de sa Florence natale, implication qui devenait finir par lui coûter l'exil hors de sa cité bien-aimée.
En 1313 décédait le
souverain du Saint-Empire romain germanique, Henri VII de Luxembourg, après seulement un an de règne. Sur ce court laps de temps, les rivalités entre Gibelins, partisans de la suprématie du pouvoir impérial, et Guelfes - parti  auquel appartenait Dante -, dévoués plutôt du Pape, s'étaient ranimées. Cela signifiait la reprise de conflits civils au sein de Florence. L'argument principal des Guelfes reposait sur la soumission du glaive temporel au glaive spirituel qui tiendrait, seul, son pouvoir des mains de Dieu. Aux yeux du Dante, toutefois, à l'instar de Jean de Paris,
le droit divin des rois était incontestable. Inspiré de l'aristotélisme diffusé par les écrits de
Thomas d'Aquin, s'il concédait au Pape la suprématie spirituelle et politique sur l'Église, il ne lui reconnaissait pas pareille suprématie sur les affaires publiques. Si l'autorité
impériale découle de Dieu, celle-ci doit se soumettre spirituellement à la primauté du Siège romain, mais conserver toute son auctoritas sur les affaires séculières. En ce sens, même si Dante militait du côté des Guelfes - et même plutôt des Guelfes blancs, modérés, opposés aux Guelfes noirs, fanatisés par la politique de Boniface VIII -, sa pensée politique était éminemment gibeline, comme le montre De Monarchia.
auquel appartenait Dante -, dévoués plutôt du Pape, s'étaient ranimées. Cela signifiait la reprise de conflits civils au sein de Florence. L'argument principal des Guelfes reposait sur la soumission du glaive temporel au glaive spirituel qui tiendrait, seul, son pouvoir des mains de Dieu. Aux yeux du Dante, toutefois, à l'instar de Jean de Paris,
le droit divin des rois était incontestable. Inspiré de l'aristotélisme diffusé par les écrits de
Thomas d'Aquin, s'il concédait au Pape la suprématie spirituelle et politique sur l'Église, il ne lui reconnaissait pas pareille suprématie sur les affaires publiques. Si l'autorité
impériale découle de Dieu, celle-ci doit se soumettre spirituellement à la primauté du Siège romain, mais conserver toute son auctoritas sur les affaires séculières. En ce sens, même si Dante militait du côté des Guelfes - et même plutôt des Guelfes blancs, modérés, opposés aux Guelfes noirs, fanatisés par la politique de Boniface VIII -, sa pensée politique était éminemment gibeline, comme le montre De Monarchia.
 | ||
| Guelfes, à gauche et Gibelins, à droite. Les couleurs des fanions sont inversées |
L'importance de l'œuvre
politique du Dante s'inscrit dans les conséquences de la
célèbre Querelle des Investitures qui s'était étirée de 1075 à
1122, et avait opposé le pontife 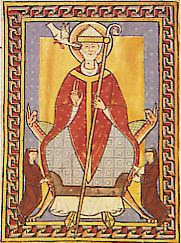 Grégoire VII à
l'empereur du Saint-Empire, Henri IV de la dynastie salienne. À l'époque, l'Empereur
s'était arrogé le droit de nommer les évêques, décision qui
allait à l'encontre de l'autorité pontificale. Grégoire VII - moine opiniâtre issu de la tendance monastique de Cluny, véritable
organisation multinationale bénédictine répandue sur tout le territoire
européen -, Hildebrand (c'était son nom), entendait
réformer l'Église, la purgeant des mœurs corrompues scandaleuses
qui depuis deux siècles en discréditaient la réputation; en particulier les péchés de simonie (trafic des objets sacerdotaux) et de nicolaïsme (l'entretien de femmes par des clercs).
Grégoire VII à
l'empereur du Saint-Empire, Henri IV de la dynastie salienne. À l'époque, l'Empereur
s'était arrogé le droit de nommer les évêques, décision qui
allait à l'encontre de l'autorité pontificale. Grégoire VII - moine opiniâtre issu de la tendance monastique de Cluny, véritable
organisation multinationale bénédictine répandue sur tout le territoire
européen -, Hildebrand (c'était son nom), entendait
réformer l'Église, la purgeant des mœurs corrompues scandaleuses
qui depuis deux siècles en discréditaient la réputation; en particulier les péchés de simonie (trafic des objets sacerdotaux) et de nicolaïsme (l'entretien de femmes par des clercs).
Henri IV menait une partie de
bras de fer avec le pape lorsque celui-ci décida d'excommunier
 l'empereur, ce qui signifiait que chez tous ses vassaux étaient levées
leurs obligations assermentées tenues à leur suzerain. Ainsi vit-on les
princes se révolter en octobre 1076 et menacer de déposer Henri si
l'excommunication n'était pas levée avant le 2 février 1077. Ce
jour-là, l'empereur et le pape étaient priés de se rendre à
Augsbourg, à la diète générale d'Empire présidée par le pape et
où l'on aurait entendu les deux partis. Mais Henri voulut rencontrer
Grégoire avant qu'il n'arrivât à Augsbourg, aussi se rendit-il chez
la comtesse Mathilde de Toscane, à Canossa, où résidait le pape en
villégiature.
l'empereur, ce qui signifiait que chez tous ses vassaux étaient levées
leurs obligations assermentées tenues à leur suzerain. Ainsi vit-on les
princes se révolter en octobre 1076 et menacer de déposer Henri si
l'excommunication n'était pas levée avant le 2 février 1077. Ce
jour-là, l'empereur et le pape étaient priés de se rendre à
Augsbourg, à la diète générale d'Empire présidée par le pape et
où l'on aurait entendu les deux partis. Mais Henri voulut rencontrer
Grégoire avant qu'il n'arrivât à Augsbourg, aussi se rendit-il chez
la comtesse Mathilde de Toscane, à Canossa, où résidait le pape en
villégiature.
Au plus fort de l'hiver,
Grégoire traversa les Alpes au col du Mont-Cenis, chemin des plus
difficiles que plus aucun prince ne pratiquait depuis des siècles.
Accompagné d'une troupe mal équipée et inexpérimentée, victimes
des aléas du trajet, Henri parvint malgré tout au pied de Canossa, le 25 janvier 1077, où les portes de la ville avaient été
fermées  sur ordre du pape. Là se place le fameux mythis-toire
où l'empe-reur, son épouse et ses enfants, en chemise de bure,
auraient attendu, les pieds nus dans la neige, que Grégoire daignât bien
les faire entrer au château de la reine Mathilde. Ce n'est que le 28 janvier que le
pape aurait cédé et fait entrer la famille, officialisant la
soumission de l'empereur par la levée de l'excommunication. Ce
n'était qu'une trêve. Après avoir triomphé des seigneurs féodaux
soulevés, l'empereur rompit de nouveau avec Grégoire VII et, afin
de prévenir que ne se répétât le chantage de l'excommunication, fit
entrer ses troupes à Rome et déposer le pape. En complément de l'outrage, Henri procéda à l'élection d'un
antipape, Clément III (Guibert de Ravenne) (1080). Toutefois,
l'autorité de ce fantoche ne fut respectée qu'à l'intérieur du Saint-Empire (Allemagne et Italie), Grégoire VII demeurant le pape légitime pour le reste de l'Europe.
sur ordre du pape. Là se place le fameux mythis-toire
où l'empe-reur, son épouse et ses enfants, en chemise de bure,
auraient attendu, les pieds nus dans la neige, que Grégoire daignât bien
les faire entrer au château de la reine Mathilde. Ce n'est que le 28 janvier que le
pape aurait cédé et fait entrer la famille, officialisant la
soumission de l'empereur par la levée de l'excommunication. Ce
n'était qu'une trêve. Après avoir triomphé des seigneurs féodaux
soulevés, l'empereur rompit de nouveau avec Grégoire VII et, afin
de prévenir que ne se répétât le chantage de l'excommunication, fit
entrer ses troupes à Rome et déposer le pape. En complément de l'outrage, Henri procéda à l'élection d'un
antipape, Clément III (Guibert de Ravenne) (1080). Toutefois,
l'autorité de ce fantoche ne fut respectée qu'à l'intérieur du Saint-Empire (Allemagne et Italie), Grégoire VII demeurant le pape légitime pour le reste de l'Europe.
À
travers cet épisode épique, la querelle opposant le
glaive temporel au glaive spirituel s'enrichit de débats théoriques, les plus importants sans doute au niveau politique de tout le Moyen Âge. Aux prétentions d'Henri IV,
Grégoire VII avait opposé un décret, les Dictatus
 papæ (1075),
un document de 27 propositions interdisant les investitures cléricales par des
laïcs sous peine d'excommunication. Même si le document ne fut
jamais promulgué de manière officielle, il affirmait que tout pouvoir appartenait à l'ordre
sacerdotal, et que l'ordre laïque devait se limiter à exécuter ses
commandements. Étant héritier du Christ, le Pape, selon le décret
de Grégoire VII, était le seul à posséder un pouvoir universel,
supérieur à celui de tous souverains qu'il pouvait déposer d'autorité en tant
que seul maître de l'Église chrétienne. Contre les prétentions de
l'Empereur, le Pape, s'estimant héritier de l'Empire romain, se
désignait même comme l'empereur
suprême. En
conséquence, tous les princes laïques lui devaient soumission et
obéissance. Du coup, l'Empereur perdait l'aura de sacralité qu'il
revendiquait pour être traité à l'égal du Souverain
Pontife. Même si, dans les faits, les décrets ne furent pas
appliqués d'une manière opératoire, le Dictatus
papæ était
un document de science et de Droit canonique définissant la puissance papale
comme une monarchie centralisée. Il supplantait même les décrets
des conciles, ce qui faisait du Pape un véritable despote absolu. On a
qualifié cette situation qui ressemblait, par certains aspects, au
Basileus byzantin, de césaropapisme.
papæ (1075),
un document de 27 propositions interdisant les investitures cléricales par des
laïcs sous peine d'excommunication. Même si le document ne fut
jamais promulgué de manière officielle, il affirmait que tout pouvoir appartenait à l'ordre
sacerdotal, et que l'ordre laïque devait se limiter à exécuter ses
commandements. Étant héritier du Christ, le Pape, selon le décret
de Grégoire VII, était le seul à posséder un pouvoir universel,
supérieur à celui de tous souverains qu'il pouvait déposer d'autorité en tant
que seul maître de l'Église chrétienne. Contre les prétentions de
l'Empereur, le Pape, s'estimant héritier de l'Empire romain, se
désignait même comme l'empereur
suprême. En
conséquence, tous les princes laïques lui devaient soumission et
obéissance. Du coup, l'Empereur perdait l'aura de sacralité qu'il
revendiquait pour être traité à l'égal du Souverain
Pontife. Même si, dans les faits, les décrets ne furent pas
appliqués d'une manière opératoire, le Dictatus
papæ était
un document de science et de Droit canonique définissant la puissance papale
comme une monarchie centralisée. Il supplantait même les décrets
des conciles, ce qui faisait du Pape un véritable despote absolu. On a
qualifié cette situation qui ressemblait, par certains aspects, au
Basileus byzantin, de césaropapisme.
De
Monarchia apparait comme une
réponse au Dictatus papæ. La
confusion des deux glaives établie par Grégoire VII était rejetée. Les affaires séculières
se devaient d'être  menées indépendamment de la
vie spirituelle. Plutôt que la confusion, la nette séparation des deux glaives était la meilleure garantie contre la corruption de la spiritualité chrétienne, les deux glaives poursuivant des objectifs
différents. Le glaive temporel avait, selon Dante, l'objectif d'apporter un
bonheur raisonnable dans le cadre politique de la cité, alors que le
glaive spirituel cherchait davantage à atteindre la béatitude de la
contemplation divine et la vie éternelle. Il fallait maintenir à l'esprit la nette séparation augustinienne entre la Cité terrestre et la Cité de Dieu. La clarté des
propositions de Dante équivalait à celle du Dictatus papæ,
et peut-être est-ce pour cela
que les deux documents ne trouvèrent aucune application stricto sensu. incompatibles qu'ils étaient avec ces royaumes
si indépendants, si jaloux de leurs prérogatives? Le débat était condamné à rester à un niveau purement théorique, ce
que reconnaît Étienne Gilson :
menées indépendamment de la
vie spirituelle. Plutôt que la confusion, la nette séparation des deux glaives était la meilleure garantie contre la corruption de la spiritualité chrétienne, les deux glaives poursuivant des objectifs
différents. Le glaive temporel avait, selon Dante, l'objectif d'apporter un
bonheur raisonnable dans le cadre politique de la cité, alors que le
glaive spirituel cherchait davantage à atteindre la béatitude de la
contemplation divine et la vie éternelle. Il fallait maintenir à l'esprit la nette séparation augustinienne entre la Cité terrestre et la Cité de Dieu. La clarté des
propositions de Dante équivalait à celle du Dictatus papæ,
et peut-être est-ce pour cela
que les deux documents ne trouvèrent aucune application stricto sensu. incompatibles qu'ils étaient avec ces royaumes
si indépendants, si jaloux de leurs prérogatives? Le débat était condamné à rester à un niveau purement théorique, ce
que reconnaît Étienne Gilson :
«Son remarquable traité sur La Monarchie, auquel peu d'œuvres de philosophie politique peuvent se comparer au moyen âge, tant pour la netteté de la thèse soutenue que pour la vigueur des démonstrations, est une expérience mentale aussi décisive qu'on peut le souhaiter à cet égard. Entièrement d'accord avec Bathélemy
(Tolomeï) de Lucques sur la nécessité d'un chef unique dont l'autorité vienne de Dieu, Dante aboutit pourtant à des conclusions tout opposées, parce qu'il distingue deux fins dernières de l'homme, c'est-à-dire deux fins dont chacune soit dernière dans son ordre propre. Cette dualité de fins s'explique par la dualité inhérente à la nature humaine : "De même qu'entre tous les êtres, l'homme seul participe de l'incorruptibilité, de même seul entre tous les êtres, il est ordonné à deux fins dernières, dont l'une est sa fin en tant qu'il est corruptible, l'autre, au contraire, en tant qu'il est incorruptible". En tant que corruptible, l'homme tend, comme vers sa fin dernière, au bonheur accessible par la vie active dans le cadre politique de la cité; en tant qu'incorruptible, c'est-à-dire immortel, il tend, comme vers sa fin dernière, à la béatitude contemplative de la vie éternelle. Pour atteindre ces deux fins essentiellement distinctes, l'homme dispose de deux moyens essentiellement distincts : "À ces deux béatitudes, comme à des conclusions diverses, il faut aller par des moyens divers. Nous allons à la première par les enseignements de la philosophie si nous la suivons en réglant nos actes selon les vertus morales et intellectuelles; quant à la seconde, nous y allons par les enseignements spirituels qui transcendent la raison humaine, si nous les suivons en réglant nos actes selon les vertus théologiques, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité". Ainsi, d'une part, le bonheur en cette vie, tel qu'on peut l'obtenir au moyen de la raison naturelle, qui s'est totalement découverte à nous dans l'œuvre des philosophes (quae per philosophos toa nobis apparuit); d'autre part, le bonheur de la vie future, tel qu'on peut l'obtenir en suivant les enseignements de Jésus-Christ. Pour le conduire à ces deux fins distinctes par ces deux moyens distincts, l'homme a enfin besoin de deux maîtres distincts, savoir : "le
Souverain Pontife, pour conduire le genre humain à la vie éternelle à l'aide de la révélation, et l'Empereur, pour diriger le genre humain vers la félicité temporelle selon les enseignements de la philosophie". De même donc que ces deux fins et ces deux moyens sont ultimes chacun en son ordre, ces deux pouvoirs sont ultimes et suprêmes chacun dans le sien. Au-dessus de l'un et de l'autre, il n'y a que Dieu, qui seul choisit l'Empereur, seul le confirme, et peut seul le juger. Il est vrai que le Pape est le père spirituel de tous les fidèles, y compris l'Empereur. Celui-ci doit donc au Pape le respect qu'un fils doit à son père, mais c'est bien de Dieu, non du Pape, que l'Empereur tient directement son autorité. La Monarchie de Dante annonçait donc un univers régi au temporel par un Empereur unique, et au spirituel par un Pape unique, c'est-à-dire l'accord, sous l'autorité suprême de Dieu, de deux universalismes juxtaposés» (É. Gilson. La philosophie au Moyen Âge, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1944, pp. 578-579).
 Entre le
philosophe placé derrière le Prince de
Platon et le despotisme éclairé
promu par les philosophes du Siècle des Lumières, La
Monarchia de Dante s'avère un
pont dans l'histoire des idées politiques. Gilson
soulève toutefois que, «comme toutes celles qui se sont
opposées sur ce problème, la thèse de Dante pouvait se retourner.
Car il établissait deux points distincts : que le monde doit être
politiquement soumis à un seul empereur, et que cet empereur est
politiquement indépendant du pape. On pouvait conserver le premier
point et renverser les termes du second. Pourquoi ne pas avoir un
empereur unique et le soumettre au pape? C'est la thèse que
suggérait implicitement Engelbert, élu abbé d'Admont en 1297, dans
son De ortu et fine Romani
imperii. Pour lui, comme pour Dante, "tous les
royaumes et tous les rois doivent être soumis à un seul empire et à
un seul empereur chrétien";
seulement, la base de cet empire universel est "l'unité
du corps de l'Église et de toute la république chrétienne".
Les deux
Entre le
philosophe placé derrière le Prince de
Platon et le despotisme éclairé
promu par les philosophes du Siècle des Lumières, La
Monarchia de Dante s'avère un
pont dans l'histoire des idées politiques. Gilson
soulève toutefois que, «comme toutes celles qui se sont
opposées sur ce problème, la thèse de Dante pouvait se retourner.
Car il établissait deux points distincts : que le monde doit être
politiquement soumis à un seul empereur, et que cet empereur est
politiquement indépendant du pape. On pouvait conserver le premier
point et renverser les termes du second. Pourquoi ne pas avoir un
empereur unique et le soumettre au pape? C'est la thèse que
suggérait implicitement Engelbert, élu abbé d'Admont en 1297, dans
son De ortu et fine Romani
imperii. Pour lui, comme pour Dante, "tous les
royaumes et tous les rois doivent être soumis à un seul empire et à
un seul empereur chrétien";
seulement, la base de cet empire universel est "l'unité
du corps de l'Église et de toute la république chrétienne".
Les deux  felicitates de
l'homme ne peuvent donc plus rester simplement juxtaposées, elles
retrouvent leur subordination hiérarchique, et cela dans l'intérêt
de l'Empire, ou plutôt comme condition de sa possibilité même... «É.Gilson. ibid. p. 579). Ce sont les conditions socio-politiques
du XIIIe siècle qui rendaient l'approche de Dante irrecevable par
les différentes autorités du temps. Philippe le Bel mettra fin au
débat lors de l'épisode de la gifle d'Anagni (septembre 1303) en
plaçant le pape Boniface VIII en état d'arrestation, puis sa
destitution, enfin, par le déménagement de la papauté à Avignon, créant ainsi les prémisses du grand schisme d'Occident (1378-1417),
dépouillant le Pape de ses prérogatives et faisant de la
papauté, pour le reste du siècle, une vassale du roi de France.
felicitates de
l'homme ne peuvent donc plus rester simplement juxtaposées, elles
retrouvent leur subordination hiérarchique, et cela dans l'intérêt
de l'Empire, ou plutôt comme condition de sa possibilité même... «É.Gilson. ibid. p. 579). Ce sont les conditions socio-politiques
du XIIIe siècle qui rendaient l'approche de Dante irrecevable par
les différentes autorités du temps. Philippe le Bel mettra fin au
débat lors de l'épisode de la gifle d'Anagni (septembre 1303) en
plaçant le pape Boniface VIII en état d'arrestation, puis sa
destitution, enfin, par le déménagement de la papauté à Avignon, créant ainsi les prémisses du grand schisme d'Occident (1378-1417),
dépouillant le Pape de ses prérogatives et faisant de la
papauté, pour le reste du siècle, une vassale du roi de France.
Dante avait déjà rappelé sa philosophie politique au chant XVI du Purgatoire :
«Rome jadis, qui le bon monde fit,
eut deux soleils, de quoi s'enluminaientles deux grands voies, de la terre et du ciel.Mais l'un a éteint l'autre, et à la crosseore est jointe l'épée; à fine force,mauvais ménage font les deux ensemblescar accouplées, l'une l'autre ne craint...» (Cité in J. Quillet. Les clefs du pouvoir au moyen âge, Paris, Flammarion, Col. Questions d'histoire, # 30, 1972, p. 136).
Dans
cette optique, en effet, la ferveur guelfe de Dante apparaît plutôt falote. Ne s'agit-il  pas d'un reproche adressé à la crosse maintenant doublée de l'épée qui n'est pas l'un de ses attributs? Le reproche est clair et s'adresse à une hiérarchisation qui a été substituée à une juxtaposition. Aussi, Dante fait-il surgir de la sphère céleste de Mercure l'empereur Justinien qui parlera en son nom.
pas d'un reproche adressé à la crosse maintenant doublée de l'épée qui n'est pas l'un de ses attributs? Le reproche est clair et s'adresse à une hiérarchisation qui a été substituée à une juxtaposition. Aussi, Dante fait-il surgir de la sphère céleste de Mercure l'empereur Justinien qui parlera en son nom.
Lorsque
Constantin autorisa au sein de l'Empire romain la libre pratique de la religion chrétienne et
la remise par les païens des biens saisis aux chrétiens, ce  n'était là qu'une première étape dans la juxtaposition des
deux glaives. Constantin voulut bien se convertir, mais sur son lit
de mort (337), il se fit arien, une hérésie qui rejetait la
consubstantialité du Père et du Fils. L'impair fut résolu par
Théodose lorsque celui-ci authentifia le dogme établit au concile
de Nicée des trois personnes en Dieu, déclarant définitivement
hérétique les sectaires d'Arien. À partir de l'édit de
Thessalonique du 28 février 380, le christianisme romain devenait la
religion officielle de l'État. Entre temps, Constantin avait déménagé la
capitale impériale à Constantinople, anciennement Byzance (324), et
c'est Théodose dont on peut dire qu'il fut le dernier empereur de ce
qu'avait été le grand Empire romain unifié. Désormais, de deux
empires romains, l'Occident et l'Orient, allaient naître deux
Églises chrétiennes, l'Église romaine et l'Église orthodoxe
(grecque). Cette dernière reconnut la sainteté de l'Empereur, ce
que jamais ne consentit son équivalent romain.
n'était là qu'une première étape dans la juxtaposition des
deux glaives. Constantin voulut bien se convertir, mais sur son lit
de mort (337), il se fit arien, une hérésie qui rejetait la
consubstantialité du Père et du Fils. L'impair fut résolu par
Théodose lorsque celui-ci authentifia le dogme établit au concile
de Nicée des trois personnes en Dieu, déclarant définitivement
hérétique les sectaires d'Arien. À partir de l'édit de
Thessalonique du 28 février 380, le christianisme romain devenait la
religion officielle de l'État. Entre temps, Constantin avait déménagé la
capitale impériale à Constantinople, anciennement Byzance (324), et
c'est Théodose dont on peut dire qu'il fut le dernier empereur de ce
qu'avait été le grand Empire romain unifié. Désormais, de deux
empires romains, l'Occident et l'Orient, allaient naître deux
Églises chrétiennes, l'Église romaine et l'Église orthodoxe
(grecque). Cette dernière reconnut la sainteté de l'Empereur, ce
que jamais ne consentit son équivalent romain.
 Mais
l'œuvre n'était pas achevée. C'est à Justinien (482-565),
empereur à partir de 527, que Dante attribue le parachèvement du
passage de l'Empire romain antique à l'Empire romain moderne –
médiéval – avec Charlemagne, Othon Ier et ses héritiers du
Saint-Empire romain germanique. C'est de cette tradition, qui
semblait s'achever avec Henri VII de Luxembourg, que Dante se
réclamait.
Mais
l'œuvre n'était pas achevée. C'est à Justinien (482-565),
empereur à partir de 527, que Dante attribue le parachèvement du
passage de l'Empire romain antique à l'Empire romain moderne –
médiéval – avec Charlemagne, Othon Ier et ses héritiers du
Saint-Empire romain germanique. C'est de cette tradition, qui
semblait s'achever avec Henri VII de Luxembourg, que Dante se
réclamait.
Le
règne de Justinien marque le siècle des institutions et de la
civilisation byzantine. Toutefois, les premières années du règne sont troublées par une sédition qui manque de renverser le jeune empereur. L'affaire commence à
l'Hippodrome de  Constantinople, lieu où les amateurs de courses de chevaux se dou-blaient de factions politiques : les Verts et les Bleus. Chacune cherchait depuis
toujours le soutien de l'empereur. Les Bleus avaient dominé sous
Anastase; Justinien, lui, donnait son soutien aux Verts :
Constantinople, lieu où les amateurs de courses de chevaux se dou-blaient de factions politiques : les Verts et les Bleus. Chacune cherchait depuis
toujours le soutien de l'empereur. Les Bleus avaient dominé sous
Anastase; Justinien, lui, donnait son soutien aux Verts :
«Le 10 janvier 532, un premier incident oppose les Bleus et les Verts à propos de la nomination d'un fonctionnaire; sept personnes sont
condamnées à mort, mais, pendant l'exécution publique, deux en réchappent, un Bleu et un Vert, et trouvent refuge dans un monastère. Les deux factions s'unissent pour réclamer leur grâce durant trois jours de courses organisées pour calmer la foule (11-13 janvier). Se produit alors ce qu'il faut à tout prix éviter : les deux factions font cause commune et sortent de l'Hippodrome, menaçantes, lançant à l'unisson le cri ordinaire réservé à la faction victorieuse de la course : "Nika", "sois vainqueur". La foule incendie plusieurs bâtiments publics voisins : la cathédrale, Sainte-Sophie, part en fumée. Le mercredi 14, lors de nouvelles courses, la foule exige la destitution des principaux fonctionnaires, le préfet de la Ville Eudaimôn, le préfet du prétoire Jean de Cappadoce et le questeur du Palais sacré Tribonien; Justinien leur donne satisfaction sans les calmer. C'est un signe de faiblesse qu'il va regretter.
La véritable opposition politique se dévoile alors, tentant de promouvoir des membres de la famille d'Anastase, qui sont confinés dans le Palais. Les trois jours suivants voient les incendies se multiplier. Le dimanche 18, Justinien apparaît dans sa loge à l'Hippodrome, puis se retire; le bruit commence à courir qu'il s'est enfui. La foule acclame Empereur l'un des parents d'Anastase, Hypatios, elle le revêt de la pourpre et l'installe dans la loge impériale de l'Hippodrome. Tandis que ses généraux, notamment Bélisaire et l'eunuque Narsès, tentent de jauger la fidélité de leurs troupes et que la foule assiège le Palais, Justinien semble sur le point de fuir. Procope de Césarée prête alors une intervention décisive à Théodora, l'Impératrice, qui aurait repris les paroles du tyran Denys de Sicile (IVe siècle av. J.-C.) : "Pour moi, cette parole ancienne me plaît qui dit que la royauté est un beau linceul".
Quoi qu'il en soit de l'influence de l'Impératrice, Justinien décide de résister : tandis que des provocateurs infiltrés jettent le trouble en criant des "Longue vie à Justinien", les soldats de Bélisaire pénètrent dans l'Hippodrome et commencent à
massacrer indistinctement partisans et adversaires de l'Empereur; les hommes de Narsès interceptent ceux qui tentent de sortir et leur font subir le même sort; Hypatios et son frère Pompée sont exécutés, les sénateurs qui les avaient soutenus subissent exil et confiscation. Mais la situation est définitivement rétablie : les courses ne reprendront que cinq ans plus tard, le temps de reconstruire, et l'on n'entend plus parler des factions durant plus de quinze ans. Justinien n'aura plus à craindre pour son trône. En revanche, il devra reconstruire une capitale recouverte de cendre et où persiste l'odeur de brûlé; les travaux de la nouvelle Sainte-Sophie auraient commencé dès le 23 février. Au moins, Justinien sait alors sur quels généraux il peut compter» (M. Kaplan. Pourquoi Byzance?, Paris, Gallimard, Col. Folio Histoire, # 252, 2016, pp. 101 à 103).
Une fois la sédition réprimée, la civilisation chrétienne-orthodoxe connut ses plus beaux moments sous la tutelle greco-byzantine.
Sainte-Sophie devient la plus belle cathédrale  chrétienne du monde;
Bélisaire, qui avait démontré sa loyauté, va se faire le gardien
des frontières de l'Empire, refoulant les invasions goths en
Occident et perses en Orient. L'art de la mosaïque va donner ses
plus beaux monuments, à Ravenne comme à Constantinople. Enfin, la
promulgation en 529 du Code Justinien (complété en 534), va
témoigner de l'œuvre principale de l'empereur, la réforme et
l'aboutissement du droit romain interrompu depuis Hadrien (117-138).
Tour à tour, Justinien promulgue en novembre 533 les Institutes,
un manuel en quatre livres pour les étudiants en Droit, puis, en
décembre, les Digestes, recueil de jurisprudence réparti en
50 livres, constitués d'extraits des principaux jurisconsultes de la
Rome républicaine et du Principat. Et comme si ce n'était pas
assez, Justinien continue de légiférer plus qu'aucun de ses
prédécesseurs sous formes de Novelles et d'édits. La grande
nouveauté? L'utilisation du grec, sauf pour les lois destinées à
des provinces latinophones. Désormais, l'Empire romain d'Orient sera
un empire grec.
chrétienne du monde;
Bélisaire, qui avait démontré sa loyauté, va se faire le gardien
des frontières de l'Empire, refoulant les invasions goths en
Occident et perses en Orient. L'art de la mosaïque va donner ses
plus beaux monuments, à Ravenne comme à Constantinople. Enfin, la
promulgation en 529 du Code Justinien (complété en 534), va
témoigner de l'œuvre principale de l'empereur, la réforme et
l'aboutissement du droit romain interrompu depuis Hadrien (117-138).
Tour à tour, Justinien promulgue en novembre 533 les Institutes,
un manuel en quatre livres pour les étudiants en Droit, puis, en
décembre, les Digestes, recueil de jurisprudence réparti en
50 livres, constitués d'extraits des principaux jurisconsultes de la
Rome républicaine et du Principat. Et comme si ce n'était pas
assez, Justinien continue de légiférer plus qu'aucun de ses
prédécesseurs sous formes de Novelles et d'édits. La grande
nouveauté? L'utilisation du grec, sauf pour les lois destinées à
des provinces latinophones. Désormais, l'Empire romain d'Orient sera
un empire grec.
Les
efforts de Justinien visent à asseoir un État romain dans les
formes de la culture orientale, jugées plus raffinées que celles d'Occident, marquées par plus de deux siècles d'invasions
germaniques. C'était avant que le monde arabe se mette en marche,
guidé par l'enseignement du Prophète, Mahomet. Rien ne semblait
devoir l'empêcher de réaliser les vieux rêves d'Alexandre le Grand
et de Jules César, d'unifier le monde. Aussi, le nom de Justinien
reste-t-il rattaché à la grandeur retrouvée de l'État romain.
Mais c'est un mal  de nature différente qui devait venir d'Orient et ternir les
dernières années du règne. En 541-542, une formi-dable peste
emporta plus de 300 000 citoyens de la capitale, Constantinople. Comme
toujours, la famine et la déroute financière suivent. L'Empire
s'est étendu territorialement, mais les caisses, pleines en 518 au
moment de l'arrivée de Justinien au pouvoir, sont maintenant vides en 565.
Lorsque l'empereur meurt, dans la nuit du 14 au 15 novembre 563, à
l'âge vénérable de 83 ans, il n'a pas de fils pour lui succéder,
mais le passage du pouvoir à son neveu Justin, membre du
gouvernement avec le grade de curopalate – chef de la garde
palatine -, lui succède sans difficulté, poursuivant la
politique de son oncle.
de nature différente qui devait venir d'Orient et ternir les
dernières années du règne. En 541-542, une formi-dable peste
emporta plus de 300 000 citoyens de la capitale, Constantinople. Comme
toujours, la famine et la déroute financière suivent. L'Empire
s'est étendu territorialement, mais les caisses, pleines en 518 au
moment de l'arrivée de Justinien au pouvoir, sont maintenant vides en 565.
Lorsque l'empereur meurt, dans la nuit du 14 au 15 novembre 563, à
l'âge vénérable de 83 ans, il n'a pas de fils pour lui succéder,
mais le passage du pouvoir à son neveu Justin, membre du
gouvernement avec le grade de curopalate – chef de la garde
palatine -, lui succède sans difficulté, poursuivant la
politique de son oncle.
L'opinion des
historiens est partagée au sujet du règne de Justinien. Déjà, à la
fin du XVIIIe .jpg) siècle, le Britannique Edward Gibbon écrivait de
Justinien : «Il
fut moins sage ou moins heureux dans le gouverne-ment de l'empire :
son règne fut remar-quable par des calamités; le peuple fut opprimé
et mécon-tent; Théodora abusa de son pouvoir; une suite de mauvais
ministres fit tort au discernement de Justinien, qui ne fut ni aimé
durant sa vie ni regretté après sa mort. Réellement épris de la
gloire, il eut cependant la misérable ambition des titres, des
honneurs et des éloges de ses contemporains; et en s'efforçant de
fixer l'admiration des Romains, il perdit leur affection et leur
estime» (E. Gibbon. Histoire du déclin et de la chute de
l'Empire romain, t. 2 : Byzance (de 455 à 1500), Paris, Robert
Laffont, Col. Bouquins, 1983, p. 192).
siècle, le Britannique Edward Gibbon écrivait de
Justinien : «Il
fut moins sage ou moins heureux dans le gouverne-ment de l'empire :
son règne fut remar-quable par des calamités; le peuple fut opprimé
et mécon-tent; Théodora abusa de son pouvoir; une suite de mauvais
ministres fit tort au discernement de Justinien, qui ne fut ni aimé
durant sa vie ni regretté après sa mort. Réellement épris de la
gloire, il eut cependant la misérable ambition des titres, des
honneurs et des éloges de ses contemporains; et en s'efforçant de
fixer l'admiration des Romains, il perdit leur affection et leur
estime» (E. Gibbon. Histoire du déclin et de la chute de
l'Empire romain, t. 2 : Byzance (de 455 à 1500), Paris, Robert
Laffont, Col. Bouquins, 1983, p. 192).
Gibbon reprenait la raison pour laquelle Dante situe Justinien dans l'orbite de Mercure : Ceux qui firent le bien par souci de réputation et d'honneur, ce qui est le cas naturel des Princes. D'autre part, Gibbon contribua à noircir la réputation de Théodora qui, de fille de dompteur d'ours, était haïe de la foule byzantine comme une véritable prostituée! D'autre part, il insista sur les signes à l'origine des superstitions qui nourrirent le préjugé de l'avenir sombre de Byzance. Outre la peste, Gibbon rappelle le passage d'une comète, puis un tremblement de terre désastreux qui frappa l'Empire. Plus près de nous – mais encore assez loin -, un historien soviétique, M. V. Levtchenko décrit avec un peu plus de profondeur les maux réels qui devaient déchirer la robe de Byzance :
«Parallèlement au mécontentement et à l'irritation des masses croissait la décomposition des classes dirigeantes. La prolifération d'une aristocratie féodalisante, s'arrogeant les prérogatives de l'État et, en la personne de certains de ses représentants, entrant en lutte ouverte contre le pouvoir central, conditionnait l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les classes dirigeantes de conserver intacte leur suprématie.
Justinien a laissé à ses successeurs un héritage redoutable. Rien de surprenant que son successeur direct, Justin II, ait perdu la raison, n'ayant pu supporter le fardeau
de la tâche qui lui était échue. Le "brillant" règne de Justinien prépara une for-midable explosion de la lutte des classes, la crise terrible que l'Empire eut à subir dans la première moitié du VIIe siècle. Certains historiens (Bury, Stein) expliquent d'une manière plutôt simpliste les raisons de cette crise, qui faillit être fatal à l'Empire romain d'Orient. D'après Bury, il faut y voir la faiblesse de Byzance, en liaison avec la politique de toute-puissance de Justinien. Stein est du même avis. L'un et l'autre taisent le rôle et la signification de la lutte de classes acharnée et des révoltes de la plèbe de l'Empire d'Orient au début du VIIe siècle, qui se présentent, en réalité, comme le développement et le prolongement directs des révoltes d'esclaves qui avaient eu raison de l'Empire romain d'Occident» (M. V. Levtchenko. Byzance des origines à 1453, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1949, pp. 98-99).
 Malgré
l'aspect caricatural de l'explication soviétique, elle n'est pas
loin d'être rejointe par celle de John Julius Norwich, qui affirme en
conclusion : «Une époque se terminait. Justinien était le
dernier véritable empereur romain à occuper le trône de Byzance.
L'essentiel n'était pas que, à en croire Procope, il écorchât le
grec toute sa vie : son esprit sortait d'un moule romain, il pensait
en termes d'Empire romain antique. Jamais il ne comprit que cet
empire-là était devenu un anachronisme. L'époque où un seul homme
pouvait revendiquer une autorité universelle incontestée était
révolue, et jamais elle ne reviendrait». J. J. Norwich.
Histoire de Byzance, Paris, Perrin, Col. Tempus, # 14, 2002,
p. 104).
Malgré
l'aspect caricatural de l'explication soviétique, elle n'est pas
loin d'être rejointe par celle de John Julius Norwich, qui affirme en
conclusion : «Une époque se terminait. Justinien était le
dernier véritable empereur romain à occuper le trône de Byzance.
L'essentiel n'était pas que, à en croire Procope, il écorchât le
grec toute sa vie : son esprit sortait d'un moule romain, il pensait
en termes d'Empire romain antique. Jamais il ne comprit que cet
empire-là était devenu un anachronisme. L'époque où un seul homme
pouvait revendiquer une autorité universelle incontestée était
révolue, et jamais elle ne reviendrait». J. J. Norwich.
Histoire de Byzance, Paris, Perrin, Col. Tempus, # 14, 2002,
p. 104).
Louis
Bréhier a noté comment, après avoir militairement vaincu les
Goths en Italie et .jpg) les Perses en Orient, «Justinien crut le
moment venu d'accomplir son grand dessein : reconquérir l'Occident,
restaurer l'Empire romain dans son intégralité» (L. Bréhier.
Vie et mort de Byzance, Paris, Albin Michel, Col. L'évolution
de l'humanité, # 13, 1969, p. 34). C'était le début d'une volonté obstinée, mais souvent velléitaire de restaurer l'ancien Empire des césars. Justinien
anticipait ainsi les volontés répétées de Charlemagne, d'Othon et de la
dynastie des Staufen, mais aussi des papes. Mû par une
volonté de prestige qui n'était rien de moins que restaurer
l'autorité absolue des césars, Justinien se voulait un prince absolu, un tyran dans la définition grecque antique du mot :
les Perses en Orient, «Justinien crut le
moment venu d'accomplir son grand dessein : reconquérir l'Occident,
restaurer l'Empire romain dans son intégralité» (L. Bréhier.
Vie et mort de Byzance, Paris, Albin Michel, Col. L'évolution
de l'humanité, # 13, 1969, p. 34). C'était le début d'une volonté obstinée, mais souvent velléitaire de restaurer l'ancien Empire des césars. Justinien
anticipait ainsi les volontés répétées de Charlemagne, d'Othon et de la
dynastie des Staufen, mais aussi des papes. Mû par une
volonté de prestige qui n'était rien de moins que restaurer
l'autorité absolue des césars, Justinien se voulait un prince absolu, un tyran dans la définition grecque antique du mot :
«Et pourtant, avec tout le monde sauf sa femme, Justinien était un autocrate pur et dur. Son énergie stupéfia tous ceux qui le connurent, et sa capacité de travail était apparemment sans limites. Personne mieux que lui ne comprit l'importance de se montrer à son peuple, de le fasciner par une magnificence qui reflétât la gloire de bâtir. Justinien transforma Constantinople et, bien que nombre de ses monuments aient disparu depuis longtemps, les grandes églises de Sainte-Sophie et Sainte-Irène, et le petit miracle que constitue Saint-Serge-et-Bacchus, coupent encore le souffle» (J. J. Norwich. op. cit. p. 104).
Il apparaît donc impossible de commenter le bilan du règne de Justinien en ciblant les défauts de la culasse. Le moteur qui mobilisa les efforts des Byzantins résidait dans le dynamisme de l'empereur et la poursuite de ses rêves auliques visant à inscrire sa réputation dans la foulée de celle des grands bâtisseurs de Rome :
«Le règne de Justinien offre des côtés brillants. La reconquête des provinces d'Occident fut une grande entreprise, dont les résultats immédiats réalisaient le
vieux rêve d'une renovatio imperii. La codification juridique faite sur l'ordre de l'empereur mit un point final à l'évolution du droit romain et légua à la postérité un monument qui a fait beaucoup pour sa gloire posthume. Beaucoup de réformes entreprises méritent l'admiration. Le relevé des dépenses publiques laisse apparaître la richesse de l'empire, encore très considérable. Dans l'ancienne capitale impériale, Sainte-Sophie témoigne encore de nos jours de la splendeur des innombrables constructions dues à l'initiative de l'empereur – même si l'on ne peut le considérer comme l'inspirateur d'une renaissance artistique -, et nombreuses sont les réalisations de l'art byzantin qui nous sont parvenues de "l'âge de Justinien", pour reprendre un titre d'André Grabar. S'il est sans doute excessif de qualifier cette époque d'"âge d'or de la littérature byzantine",
comme le fait Ernest Stein, et, ici encore, de voir en Justinien une sorte de patron de la culture, on peut y relever les noms d'auteurs dignes de ce nom, ceux d'historiens – Procope de Césarée, Agathias de Myrina, Évagre le Scolastique -, de poètes – Romanos le Mélode, le plus grand hymnographe chrétien de langue grecque -, d'hagiographes – Cyrille de Scythopolis, dont les biographies de moines palestiniens sont une source historique du plus grand intérêt -, de théologiens – le plus remarquable étant Sévère d'Antioche, dont l'œuvre ne nous est parvenue qu'en syriaque. Tout cela certes n'est pas à mettre au crédit de Justinien, mais témoigne de la vitalité d'une société que l'on ne peut taxer d'immobilisme ni de décadence» (P. Maraval. L'empereur Justinien, Paris, CNRS éditions, Col. Biblis # 28, 2012, pp. 179-180).
Quoi
qu'il en fût de la splendeur de Byzance, à la mort de Justinien, bien des problèmes structurels restaient en suspens tant au niveau de la société que de l'État,  mais surtout des
liens avec l'Église. Bien qu'il ait voulu
maintenir l'unité de l'Église en essayant de contenir les hérésies,
en particulier le monophysisme, il a fini par se laisser lui-même entraîné à l'hérésie : «La faillite de la politique religieuse
de Justinien était complète, et à force de raffiner sur les
dogmes, il finit par tomber lui-même dans l'hérésie de ceux qu'il
voulait ramener à la vraie foi. Il se laissa gagner par la doctrine
égyptienne d'après laquelle le corps de Jésus sur la croix était
resté incorruptible (aphtartodocétisme), exila le patriarche
Eutychios qui refusait de l'approuver (22 janvier 565), et se
préparait à publier un édit imposant sa croyance à tout l'Empire
lorsqu'il mourut» (L. Bréhier. op. cit. pp. 41-42). Cette
conversion à une forme radicale de monophysisme rapprochait le
destin de Justinien de celui de Constantin. Si Justinien voulut
restaurer et unifier l'Empire, il devait, par contre, être celui qui amorça le
schisme de l'Église chrétienne universelle :
mais surtout des
liens avec l'Église. Bien qu'il ait voulu
maintenir l'unité de l'Église en essayant de contenir les hérésies,
en particulier le monophysisme, il a fini par se laisser lui-même entraîné à l'hérésie : «La faillite de la politique religieuse
de Justinien était complète, et à force de raffiner sur les
dogmes, il finit par tomber lui-même dans l'hérésie de ceux qu'il
voulait ramener à la vraie foi. Il se laissa gagner par la doctrine
égyptienne d'après laquelle le corps de Jésus sur la croix était
resté incorruptible (aphtartodocétisme), exila le patriarche
Eutychios qui refusait de l'approuver (22 janvier 565), et se
préparait à publier un édit imposant sa croyance à tout l'Empire
lorsqu'il mourut» (L. Bréhier. op. cit. pp. 41-42). Cette
conversion à une forme radicale de monophysisme rapprochait le
destin de Justinien de celui de Constantin. Si Justinien voulut
restaurer et unifier l'Empire, il devait, par contre, être celui qui amorça le
schisme de l'Église chrétienne universelle :
«Ses autres entreprises ne furent pas toutes aussi réussies. Dans son désir d'unité religieuse, il n'était parvenu qu'à approfondir le fossé entre l'Orient et l'Occident. Ses efforts immenses pour réformer l'administration et la purger de toute corruption avaient été sabotés à maintes reprises par ses propres extravagances. Même ses conquêtes furent décevantes. Mais il y eut aussi des succès. Constantinople était déjà le principal centre de commerce entre l'Europe et l'Asie. L'Occident étant à présent tristement appauvri, c'était vers le Cathay et les Indes que les Byzantins se tournaient pour assurer leur prospérité commerciale et se fournir en soieries, épices et pierres précieuses (J. J. Norwich. op. cit. pp. 104-105).
_from_The_Divine_Comedy_by_Dante_Al_-_(MeisterDrucke-424274).jpg) Évidemment,
lorsque Dante fait intervenir Justinien au Paradis, il le fait dans
une perspective éminemment politique et dans l'intérêt de Florence
déchirée entre Guelfes et Gibelins. D'abord, le poète tient à bien identifier qui
parle : «Après que Constantin eut tourné l'Aigle contre le
cours du ciel, qui l'accompagna derrière l'antique héros qui enleva
Lavinie», situe historiquement où se place la voix. Parce qu'il
avait transporté le siège de l'Empire à Byzance, en Orient,
Constantin avait inversé le parcours de l'Aigle qui était venu de
Troie vers Rome (avec Énée) en le ramenant de Rome vers le lieu d'où
il était parti. «César je fus, et je suis Justinien qui, par le
vouloir du premier Amour, dont je jouis, ôtai des lois le trop et
l'inutile». De l'œuvre justinienne, c'est d'abord et avant tout
l'immense travail accompli par l'empereur en matière de Droit qui
l'impose à la pensée du poète.
Évidemment,
lorsque Dante fait intervenir Justinien au Paradis, il le fait dans
une perspective éminemment politique et dans l'intérêt de Florence
déchirée entre Guelfes et Gibelins. D'abord, le poète tient à bien identifier qui
parle : «Après que Constantin eut tourné l'Aigle contre le
cours du ciel, qui l'accompagna derrière l'antique héros qui enleva
Lavinie», situe historiquement où se place la voix. Parce qu'il
avait transporté le siège de l'Empire à Byzance, en Orient,
Constantin avait inversé le parcours de l'Aigle qui était venu de
Troie vers Rome (avec Énée) en le ramenant de Rome vers le lieu d'où
il était parti. «César je fus, et je suis Justinien qui, par le
vouloir du premier Amour, dont je jouis, ôtai des lois le trop et
l'inutile». De l'œuvre justinienne, c'est d'abord et avant tout
l'immense travail accompli par l'empereur en matière de Droit qui
l'impose à la pensée du poète.
Au Paradis, que dit l'empereur à Béatrice
et à Dante? Justinien
poursuit en rappelant qu'il avait su échapper à l'attraction
hérétique représenté par le courant monophysite soutenu par l'impératrice Théodora. Dante évoque le pape
Agapit (535-536) qui avait dû se rendre à Constantinople déchirée alors par les  intrigues de Théodora, soutien d'Anthime, élu patriarche et de tendance monophysite. Agapit, sous la pression du clergé fidèle au concile de Chalcédoine qui authentifiait les deux natures du Christ, somma Anthime d'une profession de foi qu'il refusa de rédiger. Agapit le rejeta et l'hérétique alla se réfugier dans les jupes de Théodora. Cette mesure contraria fort Justinien qui y voyait une intrusion dans ses prérogatives. Il alla même jusqu'à menacer Agapit de bannissement. On retient depuis ce «mot historique» qu'Agapit aurait adressé à Justinien : «C'est impatiemment que j'étais venu contempler Justinien, l'empereur Très Chrétien... Et voilà que je trouve à sa place un Dioclétien, dont les menaces, cependant ne me font pas peur». Comme les paroles de Théodora avaient suffit à fouetter l'ardeur de Justinien lors de la sédition Nika, celles d'Agapit le ramenèrent à l'orthodoxie. Il accepta que le pape dépose et suspende Anthime et nomme son successeur (ce qui irrita profondément l'impératrice), d'où les vers de Dante : «Je le crus; et ce
qu'il disait, maintenant je le vois clairement, comme tu vois que
toute contradiction implique le faux et le vrai. Dès qu'avec
l'Église je m'approchai de Dieu, par grâce il lui plut de
m'inspirer le haut travail».
intrigues de Théodora, soutien d'Anthime, élu patriarche et de tendance monophysite. Agapit, sous la pression du clergé fidèle au concile de Chalcédoine qui authentifiait les deux natures du Christ, somma Anthime d'une profession de foi qu'il refusa de rédiger. Agapit le rejeta et l'hérétique alla se réfugier dans les jupes de Théodora. Cette mesure contraria fort Justinien qui y voyait une intrusion dans ses prérogatives. Il alla même jusqu'à menacer Agapit de bannissement. On retient depuis ce «mot historique» qu'Agapit aurait adressé à Justinien : «C'est impatiemment que j'étais venu contempler Justinien, l'empereur Très Chrétien... Et voilà que je trouve à sa place un Dioclétien, dont les menaces, cependant ne me font pas peur». Comme les paroles de Théodora avaient suffit à fouetter l'ardeur de Justinien lors de la sédition Nika, celles d'Agapit le ramenèrent à l'orthodoxie. Il accepta que le pape dépose et suspende Anthime et nomme son successeur (ce qui irrita profondément l'impératrice), d'où les vers de Dante : «Je le crus; et ce
qu'il disait, maintenant je le vois clairement, comme tu vois que
toute contradiction implique le faux et le vrai. Dès qu'avec
l'Église je m'approchai de Dieu, par grâce il lui plut de
m'inspirer le haut travail».
On aurait pas de misère à reconnaître l'essentiel exprimé dans La Monarchia dans le texte premier du Code que Justinien fit publier en 529 et consacré aux affaires religieuses.
«Le préambule d'une loi relative aux élections des évêques et des clercs, adressée le 7 avril 535 à l'évêque de Constantinople, permet d'en comprendre la raison : "Dieu, dans sa clémence, a accordé d'en haut deux grands dons : le sacerdoce et la dignité impériale. Le premier sert les choses divines tandis que le second dirige et administre les affaires humaines; toutefois, les deux procèdent de la même origine et rehaussent la vie de l'humanité. Par conséquent les empereurs ne sauraient avoir de responsabilité plus grande que la dignité des prêtres, car c'est pour leur bien-être que les prêtres invoquent Dieu constamment. si donc le sacerdoce est à tous égards irréprochable et préserve son accès à Dieu, et si les empereurs administrent équitablement et judicieusement l'État confié à leur soin, l'harmonie générale en résultera, et ce sera un bienfait pour la race humaine. C'est pourquoi nous avons le plus grand soin des dogmes du vrai Dieu et de la dignité des prêtres" (Novelle VI). Le programme de l'empereur ne pouvait être plus explicite» (Y.-M. Hilaire (éd.) Histoire de la papauté, Paris, Seuil, Col. Point Histoire # H333, 2003, p. 102).
L'Empereur est oint de Dieu avec le prêtre, en collaboration et non en subordination.
Revenons à la rencontre entre l'empereur et le poète. Justinien spécifie l'aide que lui apporta
Bélisaire en lui évitant de combattre lui-même les ennemis aux frontières, le laissant entièrement à son œuvre  civilisatrice. Comme pour asseoir son assertion politique, Justinien entre-prend de rappeler le glorieux passer de Rome depuis la
fuite d'Énée de Troie et l'établis-sement dans la péninsule
italique. Il énumère tous les combats par lesquels Rome acquit sa
gloire et sa renommée; la défaite de ses ennemis et ses conquêtes
territoriale; l'extension des frontières de la péninsule jusqu'au pourtour de la Méditerranée,
de la Gaule et de la Germanie, et ce jusqu'à ce que Charlemagne
assure la protection de la Sainte Église! Toute l'histoire de l'Empire romain ne prouve-t-il pas qu'il est l'œuvre de la volonté divine et que tous ces empereurs, qui l'ont précédé ou qui lui ont succédé, travaillent à la même œuvre commune, condamnant d'une seule voix «ceux qui se l'approprient ou à lui s'opposent». Il déplore, finalement, que les Gibelins, porteurs de l'aigle impérial - signe de l'Empire universel - le brandissent comme signe de leurs intérêts propres :
civilisatrice. Comme pour asseoir son assertion politique, Justinien entre-prend de rappeler le glorieux passer de Rome depuis la
fuite d'Énée de Troie et l'établis-sement dans la péninsule
italique. Il énumère tous les combats par lesquels Rome acquit sa
gloire et sa renommée; la défaite de ses ennemis et ses conquêtes
territoriale; l'extension des frontières de la péninsule jusqu'au pourtour de la Méditerranée,
de la Gaule et de la Germanie, et ce jusqu'à ce que Charlemagne
assure la protection de la Sainte Église! Toute l'histoire de l'Empire romain ne prouve-t-il pas qu'il est l'œuvre de la volonté divine et que tous ces empereurs, qui l'ont précédé ou qui lui ont succédé, travaillent à la même œuvre commune, condamnant d'une seule voix «ceux qui se l'approprient ou à lui s'opposent». Il déplore, finalement, que les Gibelins, porteurs de l'aigle impérial - signe de l'Empire universel - le brandissent comme signe de leurs intérêts propres :
«Maintenant tu peux juger de ceux que j'ai d'abord accusés, et de leurs fautes, qui sont la cause de tous vos maux. Au signe public l'un oppose les lis jaunes, l'autre
l'approprie à son parti, de sorte qu'il est difficile de voir lequel faillit le plus. Qu'exercent les Gibelins, qu'ils exercent leurs manœuvres sous un autre signe; mal suit celui-là toujours qui le sépare de la justice : et que ne l'abatte point le nouveau Charles avec ses Guelfes, mais qu'il craigne les serres qui à un plus fort lion ont arraché le poil. Plusieurs fois déjà les fils ont pleuré pour le péché de leur père; et qu'il ne croie pas qu'en faveur de ses lys Dieu transportera la puissance» (La Divine Comédie, traduction de Lamennais).
Ce lys jaune, brandit par les partisans guelfes en hommage aux fleurs de lys d'or des blasons de la
monarchie française et angevine de Naples, désigne Charles II d'Anjou
roi des Pouilles, frère du roi de France, dont l'intervention en Italie répugnait à Dante.
Ce
qui vient après est moins clair. Justinien révèle que cette
petite étoile – Mercure était tenue au Moyen Âge pour une
étoile – s'orne des esprits bons qui ont été actifs pour
acquérir  honneur et renommée. Mais l'honneur et la renommée ne
saurait justifier véritable amour qui est la gloire qui mérite le
ciel. L'œuvre de Justinien n'étant pas désintéressé, cultivant
sa vanité de son autorité, elle coûte une partie de la joie du
mérite. C'est alors qu'apparaît, en contrapposto, la figure de l'authentique mérite
et de la joie pleine et entière; celui qu'il appelle Roméo et qui est Romieu de Villeneuve (±1170-1250)
dont l'œuvre grande et belle fut mal récompensée. Mais n'ont pas
ri les Provençaux qui agirent contre lui; car mal chemine celui qui
regarde comme un tort fait à soi, le bien fait à autrui. : Quatre
filles eut Raimond Béranger, et toutes reines : et cela pour lui
fit Roméo, personnage humble et étranger. Puis de louches paroles
le portèrent à demander compte à ce juste, qui lui rendit sept et
cinq pour dix. De là il partit pauvre et vieux; et si le monde
savait quel cœur il eut, mendiant sa vie morceau à morceau, il le
loue beaucoup, mais plus il le louerait» (Traduction de
Lamennais).
honneur et renommée. Mais l'honneur et la renommée ne
saurait justifier véritable amour qui est la gloire qui mérite le
ciel. L'œuvre de Justinien n'étant pas désintéressé, cultivant
sa vanité de son autorité, elle coûte une partie de la joie du
mérite. C'est alors qu'apparaît, en contrapposto, la figure de l'authentique mérite
et de la joie pleine et entière; celui qu'il appelle Roméo et qui est Romieu de Villeneuve (±1170-1250)
dont l'œuvre grande et belle fut mal récompensée. Mais n'ont pas
ri les Provençaux qui agirent contre lui; car mal chemine celui qui
regarde comme un tort fait à soi, le bien fait à autrui. : Quatre
filles eut Raimond Béranger, et toutes reines : et cela pour lui
fit Roméo, personnage humble et étranger. Puis de louches paroles
le portèrent à demander compte à ce juste, qui lui rendit sept et
cinq pour dix. De là il partit pauvre et vieux; et si le monde
savait quel cœur il eut, mendiant sa vie morceau à morceau, il le
loue beaucoup, mais plus il le louerait» (Traduction de
Lamennais).
Nous en savons aujourd'hui un peu mieux sur cette anecdote morale dont l'humilité fait contraste avec la vanité de Justinien :
«Romieu de Villeneuve : né vers 1170, fut ministre, connétable et grand sénéchal de Raymond Bérenger IV comte de Provence. Le comte mort (1245), Romieu continua
d'administrer la Provence. Tuteur de Béatrice, quatrième fille de Raymond, il la maria à Charles d'Anjou; puis il mourut en 1250. Tout cela est historique. Mais Dante suit une tradition légendaire, née en partie du nom de Romieu... Ce personnage serait un humble pèlerin qui, revenant de Galice, se serait arrêté en Provence. Bien reçu par Raymond, il gagne vite sa confiance, rétablit l'ordre dans les affaires du seigneur, et marie ses quatre filles à quatre rois. Mais la jalousie des courtisans amène Raymond à exiger des comptes de son ministre. Celui-ci montre qu'il est aussi pauvre qu'à son arrivée, alors que le patrimoine seigneurial a crû merveilleusement. Puis il s'en va sans rien entendre, comme un malheureux réduit à la mendicité» (A. Pézard, note, in D. Alighieri. Œuvre complète, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque de la Pléiade, # 182, 1965, p. 1411, n. 128).
 (Les
quatre filles en question étaient Marguerite, mariée en 1234 à
Louis IX (saint Louis), roi de France; Léonore, mariée en 1236 à
Henri III d'Angleterre; Sanche, mariée en 1243 à Richard de
Cornouailles frère d'Henri, et roi de Germanie en 1257, enfin
Béatrice, héritière de Provence, mariée à Charles Ier d'Anjou,
frère de saint Louis, et plus tard roi de Sicile. C'était à
l'époque où les princes d'Aquitaine et de Provence mariaient leurs
filles avec des seigneurs et rois du nord de l'Europe). Maintenant,
revenons à Justinien.
(Les
quatre filles en question étaient Marguerite, mariée en 1234 à
Louis IX (saint Louis), roi de France; Léonore, mariée en 1236 à
Henri III d'Angleterre; Sanche, mariée en 1243 à Richard de
Cornouailles frère d'Henri, et roi de Germanie en 1257, enfin
Béatrice, héritière de Provence, mariée à Charles Ier d'Anjou,
frère de saint Louis, et plus tard roi de Sicile. C'était à
l'époque où les princes d'Aquitaine et de Provence mariaient leurs
filles avec des seigneurs et rois du nord de l'Europe). Maintenant,
revenons à Justinien.
L'Empereur byzantin se révélait être l'idéal dans l'optique monarchiste de Dante. Comme le définissait l'article du Code Justinien cité plus haut, il ne suffisait pas de reconnaître qu'il était l'égal du Pape devant Dieu; il tenait à ce que les deux hommes agissent de concert pour le bien de la Chrétienté (et de l'Italie plus précisément dans l'esprit du poète). Sous Justinien, comme le remarque son biographie Georges Tate :
«Aucune révolution politique n'intervient. Le christianisme et l'Église sont introduits dans l'État avec des aménagements effectués au coup par coup, sans bouleversement radical. L'empereur conserve les attributions religieuses qu'il détenait au temps des cultes païens. Les idées relatives à l'origine divine de son pouvoir et au caractère sacré de sa personne continuent d'avoir cours mais elles sont progressivement christianisées. Une véritable théologie du pouvoir est élaborée : l'empereur est le représentant de Dieu sur la terre, l'image et l'agent du Christ. Sans être à proprement parler un saint, il participe de la sainteté. De tous les évêques contemporains de Constantin, Eusèbe de Césarée est un de ceux qui célèbrent avec le plus d'euphorie l'édit de Milan. Il considère Constantin comme le "vicaire de Dieu", "l'interprète du Verbe", qui a reçu en son âme les effluves de la grâce divine et participe déjà du royaume céleste. Depuis qu'il est chrétien, l'empereur a vocation à gouverner une cité terrestre dont tous les chrétiens feraient partie tandis que Dieu est le souverain de la cité céleste. Constantin a une haute
conscience de sa mission : étendre les dimensions de la cité terrestre, faire régner la justice et faire triompher la vraie foi sont ses premiers devoirs. Cette théologie, toutefois, ne débouche pas sur un fondamentalisme : elle donne du sens aux actes des empereurs mais elle ne comporte pas d'impératif d'action. Pour Eusèbe de Césarée, l'empereur est un "ami de Dieu", "un être divin" et l'Empire est une création de Dieu, le seul empire voulu par Dieu. Désormais, l'ancienne conception universaliste de l'empire s'intègre pleinement dans la cosmologie chrétienne et la sacralisation de la fonction et de la personne impériale est achevée. Pour la masse de ses sujets, c'est cette image redoutable d'un empereur sacré qui s'impose. Comme le proclame Jean Chrysostome : "Le corps de l'empereur est celui d'un homme mais son pouvoir impérial le rend semblable à Dieu", tandis qu'Agapet explique qu'il est "le maître de la terre et de la mer et de tous les cieux" (G. Tate. Justinien, Paris, Fayard, 2004, p. 137).
Empereur pleinement chrétien, Justinien prenait ces symboles et ses fonctions très au sérieux. À l'époque, l'évêque de Rome n'était pas encore le Pape tel que Dante le connût. Les deux pouvoirs - de l'autorité aulique et de la souveraineté de l'Église romaine -, se sont définis l'un par rapport à l'autre, avec le temps, essayant respectivement de tirer leurs forces, l'une à travers les crises du régime impérial, et l'autre des hérésies :
«Les penseurs chrétiens ont été confrontés au problème des rapports entre l'empereur et les évêques. Pour définir la position de l'Église par rapport à ce problème, les chrétiens disposent des références évangéliques et des textes de saint Paul. Mais la doctrine qui s'en dégage manque de clarté. D'un côté, le Christ aurait
répondu aux pharisiens : "Rendez à César ce qui est à César", ce qui posait l'existence d'une double sphère et d'un double pouvoir. D'un autre côté, selon saint Pierre : "Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes", ce qui marque que l'une des deux sphères, un des deux pouvoirs est supérieur à l'autre. Mais la question demeurait posée de la nature de cette hiérarchie entre les deux pouvoirs ainsi que celle des domaines où elle s'exerçait, car, d'un autre côté, saint Paul avait proclamé, dans l'épître aux Corinthiens : "Que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment mais aussi par motif de conscience". La voie était ouverte à des interprétations très variées qui pouvaient aller de la soumission totale aux autorités politiques, si excessives que pussent être leurs décisions, à la résistance à certaines de ces décisions et même à la défense d'un domaine réservé de l'Église» (G. Tate. ibid. p. 138).
Était planté là l'arbre de discordes qui devait
empoisonner la politique européenne tout au long du Moyen Âge. Sous
les persécutions des empereurs païens, la doctrine intimait aux
chrétiens de souffrir puisque, étant l'instrument de la volonté
divine, il y avait une raison cachée à la persécution et aux martyres
connue de Dieu seul. D'autre part, une  tradition s'était mise en
place dès que Constan-tin eût autorisé la pratique du culte
chrétien. Comment limiter ce pouvoir absolu, sacré, des empereurs
dans le champ de compétences clérical? Comment préserver l'Église
contre les empiètements du pouvoir séculier, dans le champ du dogme
par exemple, et, d'autre part, de remarquer qu'en tant que chrétien,
l'empereur était soumis aux mêmes obligations morales et
spirituelles que les autres fidèles?
tradition s'était mise en
place dès que Constan-tin eût autorisé la pratique du culte
chrétien. Comment limiter ce pouvoir absolu, sacré, des empereurs
dans le champ de compétences clérical? Comment préserver l'Église
contre les empiètements du pouvoir séculier, dans le champ du dogme
par exemple, et, d'autre part, de remarquer qu'en tant que chrétien,
l'empereur était soumis aux mêmes obligations morales et
spirituelles que les autres fidèles?
«Sur le premier point, les évêques ne purent faire prévaloir leur point de vue. L'empereur ne renonça jamais à exercer sur l'Église l'autorité qu'il détenait depuis plusieurs siècles sur les cultes païens. En vertu de ce droit, il convoque les conciles, s'autorise à influencer leurs décisions, nomme et dépose les patriarches et intervient de mille manières dans la vie de l'Église. Les principaux responsables de ce contrôle impérial sont d'ailleurs les évêques eux-mêmes : dans les innombrables conflits de doctrine et de personne qui déchirent l'Église, dans les affaires générales aussi bien que régionales et locales, ils sollicitent sans retenue l'arbitrage de l'empereur et de ses agents. L'empereur a d'ailleurs été qualifié d'"évêque du dehors" par Eusèbe de Césarée, ce qui est peu explicite mais indique qu'il participe de la nature épiscopale
et qu'il doit être tenu pour l'évêque, l'évangélisateur de ceux qui ne sont pas chrétiens mais sont destinés ou s'apprêtent à le devenir et se trouvent encore en dehors de l'Église. Un autre de ses titres fait de lui l'"égal des apôtres", c'est-à-dire le treizième apôtre, titre également ambigu car, en toute rigueur, le treizième apôtre est saint Paul. À partir du règne de Marcien, les empereurs sont couronnés par le patriarche après leur proclamation. Cet épisode nouveau dans le cérémonial de l'avènement impérial n'indique pas que l'Église, en la personne du Patriarche, sa plus haute autorité, a un rôle à jouer dans la désignation de l'empereur : le couronnement n'est pas un acte institutionnel; il apporte au nouvel empereur une consécration complémentaire mais celle-ci n'est pas obligatoire : Dieu fait connaître sa volonté directement par le Sénat, le peuple ou les armées» (G. Tate. ibid. p. 139).
Constatons que les germes du césaro-papisme se sont développés d'abord dans le jardin de la sphère politique avant d'être transplantés dans celui de l'Église :
«Ainsi se met en place, dès le règne de Constantin, ce qu'il est convenu d'appeler un régime de "césaro-papisme", c'est-à-dire un régime, comme G. Dagron l'a montré..., dans lequel les pouvoirs politiques et religieux, bien que séparés, ne sont
pas dissociables car le détenteur du pouvoir politique, qui se prétend désigné par Dieu, participe de la nature épiscopale et exerce son autorité sur l'Église. L'Empereur n'abolit pas pour autant le pouvoir propre de l'Église et n'est pas fondé à déterminer le dogme mais il doit veiller à son respect en prêtant son bras séculier à l'Église. Dans la pratique, les empereurs n'ont pas renoncé à aller au-delà et à peser sur les décisions conciliaires quand il leur paraissait que cela s'imposât» (G. Tate. ibid. pp. 139-140).
De leur côté, les évêques ont travaillé à dégager la sphère religieuse d'une emprise toujours menaçante de la sphère politique; à réaffirmer la suprématie du glaive spirituel sur le temporel, ce qui n'était pas du goût des différents empereurs, encore peu chrétiens ou penchant vers l'une ou l'autre des hérésies qui leurs étaient favorables :
«Sur le second point, en revanche, la conception des évêques l'emporte : comme pécheur et comme chrétien, l'empereur doit se soumettre à la loi de l'Église et obéir aux évêques. La pénitence publique que saint Ambroise, évêque de Milan, impose à Théodose Ier, en expiation des massacres qu'il a ordonnés à Thessalonique, est
l'expression claire de cette doctrine. Comme chrétien, l'empereur n'est pas en dehors de l'Église mais dans l'Église. Il est soumis à ses lois et à la juridiction des évêques. Contraire-ment à ce qui a été parfois soutenu, saint Ambroise, en imposant cette humiliation à l'empereur ne tentait pas d'imposer aux empereurs la domination des évêques. Il entendait montrer que, dans son domaine, l'Église était souveraine et que son autorité s'étendait à la personne de l'empereur mais sans remettre en cause son indépendance dans son domaine propre. Il convient toutefois de noter que cet événement ne se produisit avec cet éclat qu'une fois et que le caractère solennel de la pénitence imposée à Théodose marquait tout de même une velléité de suprématie du pouvoir ecclésial car ce n'étaient pas ses actes privés mais ses actions en tant qu'empereur qui étaient sanctionnées» (G. Tate. ibid. p. 140).
Ambroise et son disciple Augustin - le premier évêque de Milan, le second d'Hippone (Carthage) en Afrique du Nord -, reconnaissaient au rôle de l'empereur celui de gardien de l'orthodoxie chrétienne contre les différents hérésiarques qui surgissaient d'un peu partout dans la Chrétienté. Ils confinaient donc la suprématie impériale en matière religieuse à la seule fonction du fameux bras séculier - un service de police et de répressions - commandé par l'autorité politique mis au service de la hiérarchie cléricale :
«Ce sont les évêques de Rome, dès le pontificat de Damase, qui mettent en pratique
les principes énoncés par Ambroise et Augustin. Ils affirment la primauté du Siège Apostolique comme source de la vraie foi et de la tradition, fondée sur le droit divin et non pas sur la puissance humaine. Le rôle de l'empereur est de défendre cette orthodoxie, en décourageant par son intervention toute tentative des novateurs, assurant ainsi la paix de l'Église. Telle est la volonté même de Dieu, de qui il tient son pouvoir. En retour, le prince peut compter sur la protection divine, la mesure de la fidélité à son devoir étant la mesure de sa propre sécurité et de la prospérité de l'Empire» (P. A. McShane. La Romanitas et le pape Léon le Grand, Paris/Tournai, Desclée et Montréal, Bellarmin, 1979, p. 186).
D'un côté, l'Église exigeait de l'empereur une
autorité institutionnelle liée aux pouvoirs judiciaire, policier et
militaire, mais de l'autre, elle exerçait sur lui une contrainte de  conscience
morale qui finissait par en faire sa marionnette : «le rôle de l'empereur est de défendre»
l'orthodoxie, mais c'est aux «évêques, et surtout celui de
Rome, de préciser l'orthodoxie, de juger et de condamner les
hérésies; à l'empereur d'assurer l'exécution du jugement en
mettant sa force au service de l'orthodoxie et de l'ordre dans
l'Église» (P. A. McShane. ibid. p. 187). En Occident, l'émiettement des pouvoirs politiques, depuis que les invasions
germaniques et arabes avaient démantelé l'autorité aulique de
l'empereur, rendait proprement impensable l'unité européenne. C'est
dans ces circonstances que l'autorité des évêques, et en
particulier celui de Rome, se substitua progressivement à l'autorité impériale, au point de ramener sous la tiare les anciennes fonctions administratives (diocésaines) et diplomatiques (chancellerie) qui étaient celles jadis dévolues à l'empereur. C'est ainsi qu'émergea ce
qu'on appelât la Romanitas. Cette situation était propice à susciter, mais de la part du pape cette fois, un césaro-papisme qui allait tenter bien des
conscience
morale qui finissait par en faire sa marionnette : «le rôle de l'empereur est de défendre»
l'orthodoxie, mais c'est aux «évêques, et surtout celui de
Rome, de préciser l'orthodoxie, de juger et de condamner les
hérésies; à l'empereur d'assurer l'exécution du jugement en
mettant sa force au service de l'orthodoxie et de l'ordre dans
l'Église» (P. A. McShane. ibid. p. 187). En Occident, l'émiettement des pouvoirs politiques, depuis que les invasions
germaniques et arabes avaient démantelé l'autorité aulique de
l'empereur, rendait proprement impensable l'unité européenne. C'est
dans ces circonstances que l'autorité des évêques, et en
particulier celui de Rome, se substitua progressivement à l'autorité impériale, au point de ramener sous la tiare les anciennes fonctions administratives (diocésaines) et diplomatiques (chancellerie) qui étaient celles jadis dévolues à l'empereur. C'est ainsi qu'émergea ce
qu'on appelât la Romanitas. Cette situation était propice à susciter, mais de la part du pape cette fois, un césaro-papisme qui allait tenter bien des  successeurs de Pierre. Mais l'action belliqueuse des différentes royautés issues des partages territoriaux du temps des «Grandes Invasions» devait condamner le césaro-papisme en Occident, alors qu'il s'institutionnalisait dans la personne de l'empereur byzantin dans l'Église d'Orient. En Orient, rappelle Tate,
«les empereurs conservent leur prééminence dans tous les
domaines. Même dans les cas où ils sont excommuniés pour des actes
publics ou privés, la légitimité de leur pouvoir en tant
qu'empereurs demeure intacte» (G. Tate. op. cit. p. 140), ce qui
n'était désormais plus le cas en Occident. Tous les princes
terrestres se voyaient menacés d'excommunication dès lors que le Pape
les condamnait moralement (et politiquement), comme le montra la
Querelle des Investitures déclenchée entre le pape Grégoire VII et
l'empereur romain-germanique Henri IV.
successeurs de Pierre. Mais l'action belliqueuse des différentes royautés issues des partages territoriaux du temps des «Grandes Invasions» devait condamner le césaro-papisme en Occident, alors qu'il s'institutionnalisait dans la personne de l'empereur byzantin dans l'Église d'Orient. En Orient, rappelle Tate,
«les empereurs conservent leur prééminence dans tous les
domaines. Même dans les cas où ils sont excommuniés pour des actes
publics ou privés, la légitimité de leur pouvoir en tant
qu'empereurs demeure intacte» (G. Tate. op. cit. p. 140), ce qui
n'était désormais plus le cas en Occident. Tous les princes
terrestres se voyaient menacés d'excommunication dès lors que le Pape
les condamnait moralement (et politiquement), comme le montra la
Querelle des Investitures déclenchée entre le pape Grégoire VII et
l'empereur romain-germanique Henri IV.
 Dans l'Empire byzantin, quatre patriarches
gouvernaient l'Église, avec une prédominance certaine pour le
patriarcat de la capitale. Mais le patriarche de Constantinople, si
puissant fut-il, n'eût jamais un pouvoir comparable à celui du pape
dans la Romanitas occidentale. Il resta toujours sous la
tutelle de l'Empereur. Ou de l'Impératrice, comme devait tristement
le montrer le sort de Jean Chrysostome, archevêque de
Constantinople, qui ayant la malheur de prêcher contre les mœurs
dissolues de l'impératrice Eudoxie, fut arrêté et exilé à deux
reprises. En Occident, le principe d'unification qui échappait à
l'imperium oriental fut repris par la papauté. C'est par saint Léon le Grand, en juillet 445, que furent prononcés les premiers
principes du pouvoir pontifical :
Dans l'Empire byzantin, quatre patriarches
gouvernaient l'Église, avec une prédominance certaine pour le
patriarcat de la capitale. Mais le patriarche de Constantinople, si
puissant fut-il, n'eût jamais un pouvoir comparable à celui du pape
dans la Romanitas occidentale. Il resta toujours sous la
tutelle de l'Empereur. Ou de l'Impératrice, comme devait tristement
le montrer le sort de Jean Chrysostome, archevêque de
Constantinople, qui ayant la malheur de prêcher contre les mœurs
dissolues de l'impératrice Eudoxie, fut arrêté et exilé à deux
reprises. En Occident, le principe d'unification qui échappait à
l'imperium oriental fut repris par la papauté. C'est par saint Léon le Grand, en juillet 445, que furent prononcés les premiers
principes du pouvoir pontifical :
«Tout de suite on remarque un certain parallèle avec le rôle assumé par l'empereur romain. Celui-ci, nous l'avons vu, était le père et le bienfaiteur de son peuple. Sa mission impériale était, en faisant respecter les traditions et les institutions de Rome, d'assurer la paix, l'ordre et l'unité dans l'Empire. Léon, lui aussi..., se voyait dans l'obligation, avec le devoir de se préoccuper de l'Église entière et, par ses encouragements et ses corrections, d'en assurer le bien-être avec une sollicitude constante et désintéressée. Toujours soucieux que les traditions et les coutumes des Pères soient maintenues et observées, il voulait par ce moyen faire régner la paix et l'unité dans l'Église. À la différence de la fonction impériale, cependant, celle de Léon dans ce nouveau principat fut d'ordre purement spirituel...» (P. A. McShane. op. cit. p. 190).
Au regard de Léon, toutefois, la cité terrestre (celle
dominée par l'empereur) se trouvait inscrite dans un rapport éternel avec la cité de Dieu (dont le représentant sur terre restait le pape) : sa «"sollicitude à la fois
paternelle et fraternelle", avec laquelle il devait soutenir
tout ce qui était conforme à ses souhaits et, par des censures,
corriger tout ce qui paraissait  être détourné» ((P. A.
McShane. ibid. p. 192). L'infério-rité de rang de l'Empire était comprise
dans la définition des devoirs du pape : «Léon voit dans
l'Empire romain un instrument de la Providence divine. L'Empire est
appelé au service de l'Évangile, l'Empire non seulement en tant
qu'unité géographique, mais aussi en tant que structure politique
et sociale. Ainsi, cette vocation chrétienne s'applique aussi à la
tête de l'Empire, c'est-à-dire à l'Empereur» (P. A. McShane.
ibid. p. 214). Si, au plan théorique, rappelons-le, le partage des deux
sphères était clair, dans la
pratique il en était tout autrement. Surtout lorsque les États occidentaux ressuscitèrent sous
l'imperium de Charlemagne. Sous les empereurs Staufen, il ne
l'était plus.
être détourné» ((P. A.
McShane. ibid. p. 192). L'infério-rité de rang de l'Empire était comprise
dans la définition des devoirs du pape : «Léon voit dans
l'Empire romain un instrument de la Providence divine. L'Empire est
appelé au service de l'Évangile, l'Empire non seulement en tant
qu'unité géographique, mais aussi en tant que structure politique
et sociale. Ainsi, cette vocation chrétienne s'applique aussi à la
tête de l'Empire, c'est-à-dire à l'Empereur» (P. A. McShane.
ibid. p. 214). Si, au plan théorique, rappelons-le, le partage des deux
sphères était clair, dans la
pratique il en était tout autrement. Surtout lorsque les États occidentaux ressuscitèrent sous
l'imperium de Charlemagne. Sous les empereurs Staufen, il ne
l'était plus.
Devant les conditions qui agitaient l'ouest européen, les défis qui confrontaient la papauté étaient forts
différents des avantages dont bénéficiait Byzance. La
réponse forgée par Léon le Grand, réponse purement symbolique et idéologique, consistait à envelopper Rome non plus dans la continuité
orientale où la tenaient les empereurs de Constantinople, mais dans
une refondation de Rome :
«Le fondateur de cette Rome renouvelée est Saint Pierre, député à cette ville par le Seigneur lui-même. Pour sa part, l'Église d'Orient n'a jamais nié le fait que Pierre ait
demeuré à Rome, qu'il y soit mort martyr et que son corps y reposât. Cet honneur était incontes-tablement réservé à la ville de Rome, et les autres Églises n'ont jamais disputé à cette ville le prestige qui lui en revenait. Mais jusqu'au IVe siècle, les évêques de Rome n'avaient point eu besoin de souligner ce fait. Ils avaient, en effet, un autre titre qui leur assurait la première place. C'est que leur siège était en même temps la résidence de l'empereur et surtout la capitale de l'Empire romain, raison qui était alors acceptée par tous, car l'Église s'était conformée pour son organisation à la division politique de l'Empire» (P. A. McShane. ibid. p. 230).
Que le siège impérial fût déplacé vers l'Orient ne
changeait en rien la situation primordiale de la transmission de la
tradition pétrinienne. Comme l'explique McShane, «les papes .jpg) opposèrent au principe d'adap-tation aux divisions politiques de
l'Empire le principe de l'origine aposto-lique et pétri-nienne d'un
siège. Rome avait la primauté non parce qu'elle avait été la
capitale de l'Empire mais parce que son siège avait été fondé par
Pierre, prince des Apôtres. En Orient, par contre, le caractère
apostolique d'un siège se présentait de toute autre façon. Il y
avait là plusieurs sièges importants qui avaient été fondés par
un Apôtre. C'est la raison pour laquelle le principe de l'origine
apostolique ne put jamais s'enraciner profondément dans
l'organisation ecclésiastique de l'Orient et que le principe
d'accommodement aux divisions politiques demeura toujours
prépondérant. C'était d'ailleurs un principe non seulement de
convenance, mais en fait d'ordre religieux : l'Empire romain
n'était-il pas voulu et soutenu par la Providence divine?» (P.
A. McShane. ibid. pp. 230-231). Et l'auteur de conclure : «Le
premier malentendu entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident
eut donc pour cause le heurt de deux principes différents
d'organisation de l'Église : le principe d'adaptation aux divisions
de
opposèrent au principe d'adap-tation aux divisions politiques de
l'Empire le principe de l'origine aposto-lique et pétri-nienne d'un
siège. Rome avait la primauté non parce qu'elle avait été la
capitale de l'Empire mais parce que son siège avait été fondé par
Pierre, prince des Apôtres. En Orient, par contre, le caractère
apostolique d'un siège se présentait de toute autre façon. Il y
avait là plusieurs sièges importants qui avaient été fondés par
un Apôtre. C'est la raison pour laquelle le principe de l'origine
apostolique ne put jamais s'enraciner profondément dans
l'organisation ecclésiastique de l'Orient et que le principe
d'accommodement aux divisions politiques demeura toujours
prépondérant. C'était d'ailleurs un principe non seulement de
convenance, mais en fait d'ordre religieux : l'Empire romain
n'était-il pas voulu et soutenu par la Providence divine?» (P.
A. McShane. ibid. pp. 230-231). Et l'auteur de conclure : «Le
premier malentendu entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident
eut donc pour cause le heurt de deux principes différents
d'organisation de l'Église : le principe d'adaptation aux divisions
de .jpg) l'Empire et le principe de l'origine apostolique et pétrinienne
des sièges épiscopaux. Pour les Occidentaux, qui s'appelaient
Romaioi, Rome demeurait la base de l'Empire, l'ancienne
capitale était toujours "cité impériale". Mais en
voulant assimiler la nouvelle capitale à l'ancienne, ils brisaient,
aux yeux des Occidentaux, l'unité de l'Église, ils confondaient, du
moins selon Léon, les "choses séculières" et les
"choses divines"» (P. A. McShane. ibid. p. 231). De là
les raisons pour lesquelles la hiérarchie ecclésiastique
s'appropria les édifices, les meubles, les costumes, les couleurs et les symboles
que le régime impérial avait laissé à Rome alors qu'il émigrait
vers l'Orient. La tiare, la crosse, le blanc du pape et le rouge des
cardinaux, les rites sacerdotaux, l'Église était l'héritière de
l'Empire romain, mieux même que l'Empereur byzantin. Sans doute, mais
à aucun moment Dante n'accepta la confusion des deux glaives
comme la pratiquait des pontifes attirés par le césaro-papisme tels
Grégoire VII, Innocent III ou Boniface VIII. Voilà pourquoi, à ses yeux, Justinien demeurait le modèle
impérial, modèle perverti aussi bien par les ambitions privés des
Gibelins que par l'arrogance des Guelfes⏳
l'Empire et le principe de l'origine apostolique et pétrinienne
des sièges épiscopaux. Pour les Occidentaux, qui s'appelaient
Romaioi, Rome demeurait la base de l'Empire, l'ancienne
capitale était toujours "cité impériale". Mais en
voulant assimiler la nouvelle capitale à l'ancienne, ils brisaient,
aux yeux des Occidentaux, l'unité de l'Église, ils confondaient, du
moins selon Léon, les "choses séculières" et les
"choses divines"» (P. A. McShane. ibid. p. 231). De là
les raisons pour lesquelles la hiérarchie ecclésiastique
s'appropria les édifices, les meubles, les costumes, les couleurs et les symboles
que le régime impérial avait laissé à Rome alors qu'il émigrait
vers l'Orient. La tiare, la crosse, le blanc du pape et le rouge des
cardinaux, les rites sacerdotaux, l'Église était l'héritière de
l'Empire romain, mieux même que l'Empereur byzantin. Sans doute, mais
à aucun moment Dante n'accepta la confusion des deux glaives
comme la pratiquait des pontifes attirés par le césaro-papisme tels
Grégoire VII, Innocent III ou Boniface VIII. Voilà pourquoi, à ses yeux, Justinien demeurait le modèle
impérial, modèle perverti aussi bien par les ambitions privés des
Gibelins que par l'arrogance des Guelfes⏳



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire