 |
| Victor Hugo, Miseria, 1862 |
LA PUTAIN, LE CROISÉ ET LE POÈTE
Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées
Lorsque j'étais enfant, mes parents m'enseignaient que si j'étais bon envers les autres, eh bien, les autres seraient bons envers moi. Je me suis rendu compte assez vite que ce n'était pas si simple que ça. Alors, pendant des années, j'ai été un enfant méchant. Jusqu'à ce que je réalise que je n'étais pas foncièrement méchant, ou plutôt, que pour être efficacement méchant, il aurait fallu que je sois particulièrement bête. Or, cette compétence là, je ne l'avais pas. Aussi, n'étais-je, comme tout un chacun, partagé entre la bonté et la méchanceté. Devenir bon, ça s'apprend tout au long d'une vie et il y a vraiment peu de maître en la matière de qui suivre les enseignements.
Parlant d'enseignement, c'était aussi l'époque où l'on m'apprenait l'histoire sainte et où, il faut le dire, les modèles de bonté se faisaient plutôt rares. Même la vedette, Yahweh, était un modèle de méchanceté particulièrement réussi. On y apprenait que les Hébreux - ou les Israélites, au choix - ont marché quarante ans dans le désert avant d'aborder la Terre promise où étaient censé couler le lait et le miel. Ils n'y trouvèrent qu'un fleuve assez banal, le Jourdain, contre lequel se dressait une dernière forteresse pour leur barrer le chemin : Jéricho :
«Josué, fils de Nûn, envoya secrètement de Shittim deux espions avec cette consigne : "Allez, examinez le pays de Jéricho." Ils y allèrent et se rendirent à la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y couchèrent. On le fit savoir au roi de Jéricho en ces termes : "Voici que des hommes, de chez les Israélites, sont venus ici cette nuit en vue de reconnaître le pays". Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab : "Fais sortir les hommes venus de chez toi, - qui sont descendus dans ta maison, - car c'est pour reconnaître tout le pays qu'ils sont venus". Mais la femme prit les deux hommes et les cacha. "C'est vrai, répondit-elle, ces hommes sont venus chez moi,
mais je ne savais pas d'où ils étaient. Lorsque à la nuit tombante on allait fermer la porte de la ville, ils sont sortis et je ne sais pas où ils sont allés. Mettez-vous vite à leur poursuite, car vous pouvez encore les atteindre".
Or elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait entassées. Les gens du roi les poursuivirent dans la direction du Jourdain vers les gués, et l'on ferma la porte dès que furent sortis ceux qui étaient à leur poursuite» (Jos. 2. 1-7).
Ce récit appelle à demander les raisons pour lesquelles Rahab accepte, au risque de sa vie et de celle des siens, de protéger les émissaires de Josué. La suite le dit :
«Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés que Rahab monta vers eux sur la terrasse. Elle leur dit : "Je sais que Yahvé vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur et que tous les habitants de cette région ont été pris de panique à votre approche : car nous avons appris comment Yahvé avait mis à sec devant vous
les eaux de la mer des Roseaux à votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois amorites de l'autre côté du Jourdain, à Sihôn et à Og que vous avez voués à l'anathème. En l'apprenant, le cœur nous a manqué et l'on ne trouve plus chez personne le courage de vous tenir tête, parce que Yahvé, votre Dieu, est Dieu aussi bien là-haut dans les cieux que sur la terre ici-bas. Jurez-moi donc maintenant par Yahvé, puisque je vous ai traités avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la maison de mon père et m'en donnerez un signe certain; que vous laisserez la vie sauve à mon père et à ma mère, à mes frères et à mes sœurs, à tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous préserverez de la mort". Alors les hommes lui répondirent : "Autrement, ce serait à nous-mêmes de mourir à votre place, à moins que vous ne divulguiez notre convention! Quant Yahvé nous aura livré le pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté". Rahab les fit descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était contre le mur d'enceinte et elle-même logeait dans le rempart.
C'est vers la montagne, leur dit-elle, qu'il vous faut aller pour échapper à ceux qui vous poursuivent. Cachez-vous là-haut pendant trois jours jusqu'au retour de cette
patrouille, et puis, allez votre chemin". Les hommes répliquèrent : "nous autres, nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter, à ces conditions : Voici, à notre arrivée dans le pays, tu useras de ce signe : tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents; mais le sang de quiconque restera avec toi dans la maison retombera sur nos têtes si l'on porte la main sur lui. S'il t'arrive de révéler notre présent entretien, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prêter". Elle répondit : "Qu'il en soit ainsi!" Elle les fit partir, et ils s'éloignèrent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre» (Jos. 2. 8-21).
Les
émissaires suivent les conseils de Rahab et «dirent à
Josué : "Yahvé a livré tout ce pays entre nos mains et déjà
tous ses habitants tremblent devant nous". Les
Israélites se mettent donc  en marche, l'Arche d'alliance en tête, et
traver-sent le Jourdain. Yahvé leur demande de choisir douze
individus, un par tribu, qui prendront chacun une pierre afin de
dresser un mémorial
au milieu du fleuve. Suit une série de rites d'appropriation du
territoire, de circoncision, de célébration de la Pâque.
Enfin, un ange, chef de l'armée de Yahvé, se
dresse devant Josué et prononce la sainteté de la terre où Josué
pose les pieds. Après ces palabres seulement, vient le récit, bref et concis, de la
prise de Jéricho :
en marche, l'Arche d'alliance en tête, et
traver-sent le Jourdain. Yahvé leur demande de choisir douze
individus, un par tribu, qui prendront chacun une pierre afin de
dresser un mémorial
au milieu du fleuve. Suit une série de rites d'appropriation du
territoire, de circoncision, de célébration de la Pâque.
Enfin, un ange, chef de l'armée de Yahvé, se
dresse devant Josué et prononce la sainteté de la terre où Josué
pose les pieds. Après ces palabres seulement, vient le récit, bref et concis, de la
prise de Jéricho :
«Jéricho s'était soigneusement barricadée contre les Israélites : personne n'en sortait, personne n'y entrait. Yahvé dit alors à Josué : "Vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi. Vous tous les com-battants, vaillants guerriers, vous con-
tournerez la ville pour en faire une fois le tour, et pendant six jours tu feras de même. (Mais sept prêtres porteront sept trompes en avant de l'arche.) Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville (et les prêtres sonneront de la trompe). Lorsque la corne de bélier retentira (quand vous entendrez le son de la trompe), tout le peuple poussera un formidable cri de guerre et le mur de la ville s'effondrera sur place : alors le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi" » (Jos. 6. 1-6).
Josué suit les ordres de son Dieu à la lettre. Le récit tiré du Livre de Josué ne cesse de répéter d'ailleurs combien les prêtres et les porteurs de l'Arche ont respecté la parole divine :
«La ville sera dévouée par anathème à Yahvé avec tout ce qui s'y trouve; seule, Rahab la prostituée aura la vie sauve ainsi que tous ceux qui sont avec elle dans sa
maison, parce qu'elle a caché les émissaires que nous avions envoyés. Mais vous, prenez bien garde à l'ana-thème : n'allez pas, poussés par la convoi-tise, dérober quelque chose de ce qui est anathème, car ce serait exposer à l'anathème tout le camp d'Israël et lui porter malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de bronze et de fer étant consacrés à Yahvé, ils entreront dans son trésor.
Le peuple cria et l'on fit retentir les trompes. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un cri de guerre formidable et le rempart s'écroula sur lui-même. Aussitôt le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils appliquèrent l'anathème à tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes, les passant au fil de l'épée» (Jos. 6 17-21).
Josué avait ordonné de ne pas s'emparer des biens de Jéricho car la ville était vouée à la destruction complète. L'anathème, explique les exégètes, signifiait le renoncement à tout butin, ce qui distinguait une guerre sainte de tout autre type de guerres. Tout manquement des vainqueurs devenait un sacrilège et le châtiment leur retombait sur la tête. On y tue donc toute vie, y compris celle des bêtes. On ne pourrait imaginer meilleur génocide si le mot avait pu signifier quelque chose dans l'esprit des hommes de l'Antiquité.
Il est à noter toutefois que le premier extrait (Jos. 6. 1-6) et le second (Jos. 6. 17-21) marquent des temps différents. Le premier se situe avant la prise de Jéricho. Il contient une prescription («...vous contournerez la ville...»). Le second s'énonce nettement après la chute de la cité («Le peuple cria...»). On y parle de Rahab et des deux espions envoyés par Josué :
«Josué dit aux deux hommes qui avaient reconnu le pays : "Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme avec tous ceux qui lui appartiennent,
ainsi que vous lui avez juré". Ces jeunes gens, les espions, s'y rendirent et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils en firent sortir aussi tous ceux de son clan et les mirent en lieu sûr hors du camp d'Israël.
On brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et tous les objets de bronze et de fer, qu'on livra au trésor de la maison de Yahvé. Mais Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient, Josué les épargna. Elle est demeurée au milieu d'Israël jusqu'aujourd'hui; pour avoir caché les émissaires que Josué avait envoyé reconnaître Jéricho» (Jos. 6 22-25).
Ce récit est bref et
aurait pu être rédigé par un de nos actuels correspondants de guerre. Il appelle des explications. Aussi rajouta-t-on un récit plus élaboré que l'on plaça au tout début du Livre de Josué (Jos. 2 1-7). Car, qu'avaient tant à reconnaître les espions puisque  Yahvé, déjà, avait promis Jéricho aux Israélites? Les espions, dit-on, avaient charge d'examiner le pays de
Jéricho. Mais Josué, contrairement à un véritable général d'armée, ne dit pas précisément ce qu'ils devaient examiner.
Toutefois, à leur compte-rendu au retour de mission, on s'aperçoit qu'ils témoignent de l'état psychologique des habitants
de la ville. À un sentiment d'entraînement fatal de la population, les espions
peuvent dire qu'Yahvé a livré tout ce pays entre nos
mains et déjà tous ses habitants tremblent devant nous. Il est permis de comprendre que Josué en tira une tactique de guerre psychologique, utilisant la marche quotidienne des prêtres autour de la cité au son des trompes afin de terrifier encore plus une population déjà terrorisée. Cette démoralisation psychologique n''était-elle pas d'ailleurs la raison qui avait poussé Rahab à trahir sa cité? Or
Josué sait que Rahab est toute acquise à la cause
des Israélites. Qui le lui a dit? Les espions avaient finalement peu
à craindre dans Jéricho, où il semble qu'ils n'aient pas beaucoup
vadrouiller, assurés de la bienveillance
de la prostituée. Là est tout le mystère.
Yahvé, déjà, avait promis Jéricho aux Israélites? Les espions, dit-on, avaient charge d'examiner le pays de
Jéricho. Mais Josué, contrairement à un véritable général d'armée, ne dit pas précisément ce qu'ils devaient examiner.
Toutefois, à leur compte-rendu au retour de mission, on s'aperçoit qu'ils témoignent de l'état psychologique des habitants
de la ville. À un sentiment d'entraînement fatal de la population, les espions
peuvent dire qu'Yahvé a livré tout ce pays entre nos
mains et déjà tous ses habitants tremblent devant nous. Il est permis de comprendre que Josué en tira une tactique de guerre psychologique, utilisant la marche quotidienne des prêtres autour de la cité au son des trompes afin de terrifier encore plus une population déjà terrorisée. Cette démoralisation psychologique n''était-elle pas d'ailleurs la raison qui avait poussé Rahab à trahir sa cité? Or
Josué sait que Rahab est toute acquise à la cause
des Israélites. Qui le lui a dit? Les espions avaient finalement peu
à craindre dans Jéricho, où il semble qu'ils n'aient pas beaucoup
vadrouiller, assurés de la bienveillance
de la prostituée. Là est tout le mystère.
Qu'en racontent les historiens? Daniel-Rops, d'abord. Le croyant essaie ici de se faire l'avocat du diable en évoquant de possibles causes naturelles à la chute des murailles de Jéricho :
«Jéricho, sa porte close, confiante dans ses murailles, attendait que la faim obligeât les nomades à partir. Josué mène l'attaque; cela pouvait paraître folie. Mais un nouveau miracle se produit. Suivant l'ordre de Dieu, les prêtres portent l'Arche autour de la ville, sonnant de la trompette. Sept jours de suite, la procession se
répète, comme on le voit sur la miniature de notre Fouquet, pleine de foi, tout le peuple suivant, dans un religieux silence. Au septième jour, à un signal, les quarante mille poitrines des assaillants jettent un cri immense. La muraille s'abat, la ville est prise. On s'est demandé si les sonneries de trompettes n'auraient pas été un moyen de dissimuler un creusement de mines. Les travaux terminés, un autre appel aurait averti les sapeurs d'avoir à sortir des galeries, en mettant le feu au boisage, pour faire écrouler la muraille; mais l'armée israélite n'était-elle pas bien primitive pour être capable de ces travaux de sape? D'autres évoquent une secousse sismique miraculeuse, qui eût traduit la volonté même de Dieu. [Certains archéologues ont cru pouvoir relever la preuve d'un glissement de terrain].
Le terrible hérem, l'anathème religieux, s'appesantit sur la malheureuse cité. Seule Rahab fut épargnée, paiement de sa trahison. Un Israélite qui avait violé la défense sacrée et détourné du butin fut lapidé avec sa famille et ses troupeaux. La peur gagna tout le pays...(etc.)» (Daniel-Rops. Le peuple de Dieu, Paris, Arthème Fayard, rééd. Livre de poche Col. historique, 1943, p. 180).
Que pouvaient
être ces émissaires sinon des sapeurs venus placer des
mines sous les  murs de Jéricho ou, plus simplement, des agents
chargés d'attiser la peur parmi la population? Ayant connu la guerre de 14-18, Daniel-Rops
pouvait projeter sur la guerre antique les méthodes de la guerre
moderne. Par contre, parler de trahison à
propos de Rahab, c'est lui attribuer beaucoup. Il n'est pas dit
qu'elle ait livré aucun secret aux émissaires de Josué, sinon les
conforter dans leur certitude que le moral de la population était au plus bas. Elle était loin d'être une Mata-Hari de l'Antiquité.
Aussi, Yahvé, dans sa toute-puissance, n'avait nul besoin de
l'intervention de cette prostituée dans cette affaire de guerre
sainte.
murs de Jéricho ou, plus simplement, des agents
chargés d'attiser la peur parmi la population? Ayant connu la guerre de 14-18, Daniel-Rops
pouvait projeter sur la guerre antique les méthodes de la guerre
moderne. Par contre, parler de trahison à
propos de Rahab, c'est lui attribuer beaucoup. Il n'est pas dit
qu'elle ait livré aucun secret aux émissaires de Josué, sinon les
conforter dans leur certitude que le moral de la population était au plus bas. Elle était loin d'être une Mata-Hari de l'Antiquité.
Aussi, Yahvé, dans sa toute-puissance, n'avait nul besoin de
l'intervention de cette prostituée dans cette affaire de guerre
sainte.
Bien plus tard, on parlera
d'ultra-sons pour expliquer l'effondrement des murailles de Jéricho
par le son des trompettes et la clameur des Israélites. Toute cette
eau coule comme sur les plumes d'un canard. En effet, comme le
 souligne le Dictionnaire de la Bible d'André-Marie
Gerard : «Que les circonstances retenues par les auteurs
sacrés répètent celles qui entraînent la ruine de la précédente
Jéricho ne fait qu'intégrer l'événement de haute signification
spirituelle dans les réalités bien concrètes : les séismes sont
de tous temps, mais si l'on suppose, non sans raison logique, qu'un
phénomène de cette nature a pu de nouveau priver la ville de ses
murailles, il servait cette fois à point nommé les desseins de
l'Éternel; et si la totale destruction de la cité conquise est une
fois de plus aussi accomplie selon des mœurs guerrières alors fort
répandues, elle devient ici un rite de louange, où l'offrande est
entièrement sacrifiée au Dieu dont les fidèles entendent ce
faisant célébrer la gloire et reconnaître spectaculairement la
totale souveraineté sur les vies et les biens»
(A.-M. Gerard. Dictionnaire de la Bible, Paris,
Robert Laffont, Col. Bouquin, 1989, p. 621).
souligne le Dictionnaire de la Bible d'André-Marie
Gerard : «Que les circonstances retenues par les auteurs
sacrés répètent celles qui entraînent la ruine de la précédente
Jéricho ne fait qu'intégrer l'événement de haute signification
spirituelle dans les réalités bien concrètes : les séismes sont
de tous temps, mais si l'on suppose, non sans raison logique, qu'un
phénomène de cette nature a pu de nouveau priver la ville de ses
murailles, il servait cette fois à point nommé les desseins de
l'Éternel; et si la totale destruction de la cité conquise est une
fois de plus aussi accomplie selon des mœurs guerrières alors fort
répandues, elle devient ici un rite de louange, où l'offrande est
entièrement sacrifiée au Dieu dont les fidèles entendent ce
faisant célébrer la gloire et reconnaître spectaculairement la
totale souveraineté sur les vies et les biens»
(A.-M. Gerard. Dictionnaire de la Bible, Paris,
Robert Laffont, Col. Bouquin, 1989, p. 621).
.jpg) En
fait, le minage auquel fait allusion Daniel-Rops ou le tremblement
de terre évoqué par Gerard ne servent à rien puisque le but des
auteurs sacrés visait
à montrer comment «le récit épique de la première
"conquête" en Terre promise va, mieux que tout autre,
mettre en valeur "le don" de Dieu, et non les hauts faits
des terrestres gens d'armes campés devant Jéricho. Si ces derniers
ont quelque mérite en l'affaire, ils l'acquièrent par la qualité
de leur foi dans la puissance divine»
(A.-M. Gerard. ibid. p. 621).
L'épisode de Rahab est du même eau, sa foi étant le produit moins
d'une conversion que d'un abandon psychologique face au peu de résistance des murs de Jéricho devant les envahisseurs.
En
fait, le minage auquel fait allusion Daniel-Rops ou le tremblement
de terre évoqué par Gerard ne servent à rien puisque le but des
auteurs sacrés visait
à montrer comment «le récit épique de la première
"conquête" en Terre promise va, mieux que tout autre,
mettre en valeur "le don" de Dieu, et non les hauts faits
des terrestres gens d'armes campés devant Jéricho. Si ces derniers
ont quelque mérite en l'affaire, ils l'acquièrent par la qualité
de leur foi dans la puissance divine»
(A.-M. Gerard. ibid. p. 621).
L'épisode de Rahab est du même eau, sa foi étant le produit moins
d'une conversion que d'un abandon psychologique face au peu de résistance des murs de Jéricho devant les envahisseurs.


«L'épître aux Hébreux donne Rahab en exemple pour sa foi, et l'épître de Jacques la loue pour ses œuvres. Les écrits rabbiniques font d'elle l'épouse de Josué.
L'évangéliste Matthieu la place dans la généa-logie du Christ en tant que mère de Booz et donc aïeule de David. Dans cette généalogie, Matthieu cite trois autres femmes : "La femme d'Urie" le Hittite, c'est-à-dire Bethsabée, Tamar, qui était une Cananéenne, et Ruth la Moabite. L'histoire de Rahab contribue à prouver que le Salut n'est pas réservée au fils d'Israël, mais à tous ceux qui reconnaissent en Yahvé "le Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas". (A.-M. Gerard. ibid. p. 1172).
Plus prosaïque, Genovefa Étienne et Claude Moniquet, historiens de l'espionnage mondial relèvent toutefois que...
«L'anecdote est ... des plus intéressantes car elle nous laisse deviner, entre les lignes l'affrontement des espions hébreux avec les "contre-espions" du roi de Jéricho et elle nous fait percevoir des méthodes de travail qui, plus de 2 500 ans plus tard, restent d'actualité pour tout homme du renseignement.
Les deux agents partent donc et trouvent à se loger chez une prostituée du nom de Rahab. Mais déjà l'ennemi est sur leurs traces : "On dit au Roi de Jéricho : voici des
hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays". Qui est ce "on"? Mystère. Il doit s'agir, selon toute vraisemblance, d'un officier de la garde royale ou d'un "informateur" de celle-ci. Le filet se resserre donc autour des deux envoyés de Josué, mais ils seront sauvés par Rahab qui les cache sous son toit et affirme à la patrouille venue pour les arrêter qu'elle ignorait à qui elle avait affaire et que les deux hommes l'ont, de toute façon, déjà quittée». (G. Étienne & C. Moniquet. Histoire de l'espionnage mondial, t. 1 : Les services secrets de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles/Paris, Kiron/Éditions du Félin, 2000, p. 33).
Malgré un soupçon de suspens, nous sommes quand même loin d'Ian Fleming!
Si Dante reconnaît Rahab
dans la sphère céleste de Vénus, c'est moins pour ces aventures
d'espionnage que pour ce qui ressort du dialogue des premiers
versets – ceux rajoutés a posteriori disons-nous
– entre Rahab et les émissaires : Puisque je vous ai
traités  avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la
maison de mon père... et les
émissaires de jurer : Quant Yahvé nous aura livré le
pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté»... - «Tu veux apprendre quelle est cette âme qui étincelle
près de moi, comme un rayon du soleil dans une onde pure. Cette âme
qui goûte une douce paix est celle de Raab, qui, jointe à notre
chœur, y occupe le premier rang. Le triomphe de Jésus-Christ l'a
fait monter la première à ce ciel, où finit l'ombre de votre
monde. Il était bien convenable que Dieu la laissât dans cette
sphère, en signe de la haute victoire que son fils a remportée,
lorsqu'il a laissé lier ses deux mains. N'est-ce pas cette femme qui
a favorisé les premiers succès de Josué, sur cette terre dont le
pape se souvient si peu?»
(traduction Chevalier Artaud de Montor, Verviers, Gérard & Cie,
Col. Bibliothèque Marabout, # G1, s.d., p. 346). Se traiter avec
bonté, n'est-ce pas un privilège si rare sur cette terre, qu'on
peut l'espérer au moins dans l'au-delà?
avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la
maison de mon père... et les
émissaires de jurer : Quant Yahvé nous aura livré le
pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté»... - «Tu veux apprendre quelle est cette âme qui étincelle
près de moi, comme un rayon du soleil dans une onde pure. Cette âme
qui goûte une douce paix est celle de Raab, qui, jointe à notre
chœur, y occupe le premier rang. Le triomphe de Jésus-Christ l'a
fait monter la première à ce ciel, où finit l'ombre de votre
monde. Il était bien convenable que Dieu la laissât dans cette
sphère, en signe de la haute victoire que son fils a remportée,
lorsqu'il a laissé lier ses deux mains. N'est-ce pas cette femme qui
a favorisé les premiers succès de Josué, sur cette terre dont le
pape se souvient si peu?»
(traduction Chevalier Artaud de Montor, Verviers, Gérard & Cie,
Col. Bibliothèque Marabout, # G1, s.d., p. 346). Se traiter avec
bonté, n'est-ce pas un privilège si rare sur cette terre, qu'on
peut l'espérer au moins dans l'au-delà?
Mais une fois passée les récriminations répétées de Dante à l'égard du pape
Boniface VIII, il y a la rencontre, avec Béatrice, du noble
héritier  de la maison d'Anjou qu'il avait reçu, jadis, en mars
1294 à Florence. Ce fils aîné de Charles le Boiteux, qui portait
nom de Charles Martel (ou Martell). Nous ignorons si Dante se
trouvait parmi les chevaliers florentins envoyés à sa rencontre à
Sienne pour lui rendre hommage, toutefois, «il est certain
qu'il se trouvait parmi ceux qui fêtèrent le séjour de Charles à
Florence où il fut reçu "avec grand honneur" nous dit
Vilani. De cette rencontre entre le Prince et le Poète devait naître
cette correspondance d'esprits affectueux qui se fit encore plus
intime et plus solide après d'autres rencontres ultérieures. Dante
nous laisse un souvenir doux et mélancolique de cette communion
d'âme dans le VIIIe chant du Paradis
où l'esprit de Charles se révèle à lui en des termes
chaleureux...» (G. L.
Passerini. Dante et son temps, Paris,
Payot, Col. Bibliothèque historique, 1953, p. 67) :
de la maison d'Anjou qu'il avait reçu, jadis, en mars
1294 à Florence. Ce fils aîné de Charles le Boiteux, qui portait
nom de Charles Martel (ou Martell). Nous ignorons si Dante se
trouvait parmi les chevaliers florentins envoyés à sa rencontre à
Sienne pour lui rendre hommage, toutefois, «il est certain
qu'il se trouvait parmi ceux qui fêtèrent le séjour de Charles à
Florence où il fut reçu "avec grand honneur" nous dit
Vilani. De cette rencontre entre le Prince et le Poète devait naître
cette correspondance d'esprits affectueux qui se fit encore plus
intime et plus solide après d'autres rencontres ultérieures. Dante
nous laisse un souvenir doux et mélancolique de cette communion
d'âme dans le VIIIe chant du Paradis
où l'esprit de Charles se révèle à lui en des termes
chaleureux...» (G. L.
Passerini. Dante et son temps, Paris,
Payot, Col. Bibliothèque historique, 1953, p. 67) :
«Ce jeune prince angevin que Dante avait chéri» (Louis Gillet. Dante, Paris/Montréal, Flammarion/Americ=Edit. 1941, p. 323) avait vécu peu, ce qu'il n'omet pas de rappeler au poète :
.....................Ce bas monde m'a connu
Peu de temps : et si j'y étais demeuré davantageBien des maux auraient pu être évités.La béatitude éternelle me cache à tes yeux,M'enveloppant de son rayonnementComme le ver à soie qu'entoure le cocon.Tu m'as beaucoup aimé, et à juste titreCar si j'étais demeuré ici-bas, je t'aurais montréDe l'amour que j'avais pour toi plus que les simples promesses. (Cité in G. L. Passerini. op. cit. p. 67).
«En mars de cette année-là [1294], Charles d'Anjou, dit Charles Martel ou Charlesle Jeune, fils du roi de Naples et prétendant au trône de Hongrie, séjourna à Florence durant quelques semaines, accueilli par la commune guelfe avec de somptueuses festivités. À cette occasion, il rencontra Dante, qui avait six ans de plus que lui et devait faire partie de l'une des délégations désignées par la commune pour lui faire honneur. Entre eux deux naquit une sympathie immédiate, qui n'eut pas de suite car l'Angevin mourut brusquement l'année suivante. Tout cela se déduit du chant VIII du Paradis, où Charles Martel va à la rencontre de Dante avec joie, et, lui révélant son identité – car son aura lumineuse empêche Dante de le reconnaître...» (A. Barbero. Dante, Flammarion, 2021, p. 157).
Témoignage de cet amour que le jeune prince vouait au poète :
«Juste avant de dire son nom, Charles Martel cite le premier vers d'une chanson de Dante, Vous dont l'esprit meut le troisième ciel, ce qui a fait spéculer sur l'engouement éventuel du jeune prince pour la poésie, qui allait trouver avec Dante un territoire commun suffisant à combler la distance sociale qui devait être respectée entre eux. Mais on ne peut exclure non plus une rencontre dans un tout autre milieu et en une tout autre occasion, c'est-à-dire quand le lecteur du Studium dominicain de Santa Maria Novella, le célèbre prédicateur Remigio del Chiaro Girolami, prononça un sermon en l'honneur de Charles, en commentant le verset Deus indicium tuum regi da et iustitam tuam filio regis» (A. Barbero. ibid. pp. 157-158).
Comme
si souvent dans la vie de Dante et dans ses actions
politiques, nous naviguons surtout sur des spéculations. Les
exégètes, par exemple, se disputent sur la formulation de
l'interpellation de Dante devant l'ombre de Charles qu'il n'a pas
encore  reconnu : Deh, chi siete? - Pour Dieu, qui êtes-vous?.
Certains ont voulu rectifier le vers en le mettant au singulier :
Di', mais le pluriel s'explique si l'on en croit A. Vallone.
P. Pézard «soupçonne dans le pluriel une intention délicate
: Dante s'adresse à Charles Martel, certes, mais du même coup, et
comme d'instinct, à une autre âme toute proche, et comme
inséparable du premier bienheureux, encore que Charles ait fait un
pas de plus vers Dante. Cette seconde âme qui ne parle pas et laisse
parler Charles "seul" pourrait être la "belle
Clémence", son épouse tendrement aimée. L'affectueux appel du
chant IX, vers 1, se justifierait ainsi par une vue immédiate qui
n'a pas besoin d'être décrite davantage. Le saint couple uni par la
Vénus céleste ferait ainsi pendant au couple indissoluble, mais
coupable de "fol amour", qu'entraîne la tourmente de
l'enfer : là aussi, l'un des deux amants se taisait, Inf. V
139-140...» Dante. Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Col.
Bibliothèque de la Pléiade, # 182, 1965, p. 1421, n. 44). Pézard
rappelle ici l'épisode de Francesca da Rimini, accompagné de son
amant, Paolo Malatesta son beau-frère (lui silencieux), tous
deux tués de l'épée de Gianciotto Malatesta et qui paient leur adultère pour l'éternité en Enfer! Le respect de la
morale nuptiale mène les amants au Paradis là où l'adultère les
menait en Enfer.
reconnu : Deh, chi siete? - Pour Dieu, qui êtes-vous?.
Certains ont voulu rectifier le vers en le mettant au singulier :
Di', mais le pluriel s'explique si l'on en croit A. Vallone.
P. Pézard «soupçonne dans le pluriel une intention délicate
: Dante s'adresse à Charles Martel, certes, mais du même coup, et
comme d'instinct, à une autre âme toute proche, et comme
inséparable du premier bienheureux, encore que Charles ait fait un
pas de plus vers Dante. Cette seconde âme qui ne parle pas et laisse
parler Charles "seul" pourrait être la "belle
Clémence", son épouse tendrement aimée. L'affectueux appel du
chant IX, vers 1, se justifierait ainsi par une vue immédiate qui
n'a pas besoin d'être décrite davantage. Le saint couple uni par la
Vénus céleste ferait ainsi pendant au couple indissoluble, mais
coupable de "fol amour", qu'entraîne la tourmente de
l'enfer : là aussi, l'un des deux amants se taisait, Inf. V
139-140...» Dante. Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Col.
Bibliothèque de la Pléiade, # 182, 1965, p. 1421, n. 44). Pézard
rappelle ici l'épisode de Francesca da Rimini, accompagné de son
amant, Paolo Malatesta son beau-frère (lui silencieux), tous
deux tués de l'épée de Gianciotto Malatesta et qui paient leur adultère pour l'éternité en Enfer! Le respect de la
morale nuptiale mène les amants au Paradis là où l'adultère les
menait en Enfer.
Les
premiers vers du Chant IX confirmerait l'hypothèse de Pézard
: Ô belle Clémence, ton Charles éclaircit ainsi mes doutes, et
me prédit ensuite les tromperies que devait  subir sa race. Mais il
ajouta : "Sois discret et laisse voler les années". Je
dois donc me borner à dire que vos malheurs exciteront de justes
regrets. bientôt cette sainte lumière retourna vers Dieu qui la
remplit, comme vers le souverain bien qui suffit à toutes les
créatures. Âmes ingrates, que vous vous abusez! Que vous êtes
impies, lorsque vous dirigez vos pensées vers la vanité en
renonçant à une félicité si parfaite! (traduction modifiée
de Chevalier Artaud de Montor. op. cit. p. 341). L'erreur résiderait ici dans une note de Lamennais qui associe Clémence à
la fille de Charles, cette Clémence de Hongrie appelée à épouser
Louis X le Hutin, roi de France. En
fait, il s'agirait bien de l'épouse de Charles, Clémence de Habsbourg. Le jeune couple, connu pour l'amour sincère qui les
unissait, moururent de la peste à Naples, à quelques mois de
distante, Charles le 12 août avait suivi sa femme, morte depuis le 7
février au moins. Il n'était âgé que de 24 ans. Charles
Martel avait été couronné roi de Hongrie en 1290, quatre ans avant
son passage à Florence. À la couronne de Hongrie s'ajoutait celle
de roi de Naples et comte de Provence, ce qui explique pourquoi le
couple trouva la mort à Naples.
subir sa race. Mais il
ajouta : "Sois discret et laisse voler les années". Je
dois donc me borner à dire que vos malheurs exciteront de justes
regrets. bientôt cette sainte lumière retourna vers Dieu qui la
remplit, comme vers le souverain bien qui suffit à toutes les
créatures. Âmes ingrates, que vous vous abusez! Que vous êtes
impies, lorsque vous dirigez vos pensées vers la vanité en
renonçant à une félicité si parfaite! (traduction modifiée
de Chevalier Artaud de Montor. op. cit. p. 341). L'erreur résiderait ici dans une note de Lamennais qui associe Clémence à
la fille de Charles, cette Clémence de Hongrie appelée à épouser
Louis X le Hutin, roi de France. En
fait, il s'agirait bien de l'épouse de Charles, Clémence de Habsbourg. Le jeune couple, connu pour l'amour sincère qui les
unissait, moururent de la peste à Naples, à quelques mois de
distante, Charles le 12 août avait suivi sa femme, morte depuis le 7
février au moins. Il n'était âgé que de 24 ans. Charles
Martel avait été couronné roi de Hongrie en 1290, quatre ans avant
son passage à Florence. À la couronne de Hongrie s'ajoutait celle
de roi de Naples et comte de Provence, ce qui explique pourquoi le
couple trouva la mort à Naples.
 Après Charles et
Clémence, Béatrice et Dante voient venir vers eux «une autre
de ces splendeurs». Il s'agit
ici de Cunizza da Romano, née en 1198, fille d'Azzelino et sœur du
fameux tyran Azzolino III que Dante et Virgile avaient rencontré en
Enfer. Elle serait morte, très âgée dit-on, en 1279, soit du
vivant de Dante. «Douée d'une nature violente, précise
Pézard, elle eut trois maris et plusieurs amants, entre
autre le troubadour Sordel»,
rencontré, lui, au Purgatoire. Si Dante la monta au Paradis, ce
serait à cause de sa conversion, même tardive, mais surtout pour la
pure charité par laquelle elle affranchit les serfs et mainmortables de
son père et de ses frères (1265).
Après Charles et
Clémence, Béatrice et Dante voient venir vers eux «une autre
de ces splendeurs». Il s'agit
ici de Cunizza da Romano, née en 1198, fille d'Azzelino et sœur du
fameux tyran Azzolino III que Dante et Virgile avaient rencontré en
Enfer. Elle serait morte, très âgée dit-on, en 1279, soit du
vivant de Dante. «Douée d'une nature violente, précise
Pézard, elle eut trois maris et plusieurs amants, entre
autre le troubadour Sordel»,
rencontré, lui, au Purgatoire. Si Dante la monta au Paradis, ce
serait à cause de sa conversion, même tardive, mais surtout pour la
pure charité par laquelle elle affranchit les serfs et mainmortables de
son père et de ses frères (1265).
 Cunizza
appartenait à l'une de ces familles qui, dans la Florence d'avant les Médicis, était reconnue pour ses tyrannies et ses outrages.
Ainsi, la mère enceinte d'Azzolino III, le frère de Cunizza,
avait-elle rêvé qu'elle accouchait d'une torche ardente qui
mettrait le feu à toute la Marche Trévisane :
Cunizza
appartenait à l'une de ces familles qui, dans la Florence d'avant les Médicis, était reconnue pour ses tyrannies et ses outrages.
Ainsi, la mère enceinte d'Azzolino III, le frère de Cunizza,
avait-elle rêvé qu'elle accouchait d'une torche ardente qui
mettrait le feu à toute la Marche Trévisane :
j'eux nom Cunice et ici resplendis
m'étant brûlée aux feux de cette étoile;
Pézard rappelle ici que la référence à Vénus vise moins la planète elle-même que l'expression, les feux de Vénus, qu'il faut entendre au sens physiologique du terme :
bel et gaîment je pardonne à moi-même
ces causes de mon sort, et ne m'en fâche :vulgaire gent s'en pourrait ébahir.
L'intervention de la galante Cunizza, qui avait été si folle de son corps avant de finir dans les bonnes œuvres, semble n'avoir sa raison d'être au Paradis que pour introduire une autre âme : Folquet de Marseille, évêque et troubadour de la seconde moitié du XIIe siècle (±1155-1231) qui, lui aussi, avait tant aimé les femmes «jusqu'à l'âge des cheveux gris». Et, d'ajouter Gillet : «il n'en marque du reste aucune trace de repentir, car la tristesse et le repentir n'entrent pas dans le Paradis» (L. Gillet. op. cit. p. 323).
Un texte médiéval sur les troubadours nous informe que Folquet de Marseille...
«était fils d'un marchand de Gênes qui avait nom Alphonse. Et quand le père
mourut, il laissa Folquet très riche. Celui-ci s'entendait bien en courtoisie et en vaillance, et il se mit au service des barons et des hommes de valeur, rivalisant avec eux de largesse, de générosité, d'allées et de venues. Il fut bien accueilli et honoré par le roi Richard [Cœur de Lion], par le comte Raimon de Toulouse et par Baral, son seigneur de Marseille.
C'était un très bon poète et il était très gracieux de sa personne. Il aima la femme de son seigneur Baral. Il la sollicitait et faisait ses chansons sur elle. Mais ni par prière ni par chansons il ne sut trouver grâce auprès d'elle, car elle ne lui accorda nul bien d'amour. C'est pourquoi il se plaint toujours d'Amour dans ses chansons.
La dame mourut; Baral, mari de la dame, le seigneur qui lui faisait tant d'honneur, et le bon roi Richard et le bon comte Raimon de Toulouse et le roi Alphonse d'Aragon – tous moururent aussi. Folquet, à cause de la tristesse qu'il eut de la mort de sa dame et des princes que je viens de vous nommer, abandonna le monde. Il entra dans l'ordre de Cîteaux avec sa femme et ses deux fils. Il fut fait abbé d'une riche abbaye qui se trouve en Provence et qui a nom Toronet. Puis on le fît évêque de Toulouse; et c'est là qu'il mourut» (M. Egan (éd.) Les vies des Troubadours, Paris, U.G.É. Col. 10/18, # 1663, 1985, pp. 79 et 81; cité in H.-I. Marrou. Les troubadours, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H5, 1971, pp. 34-35).
Folquet – ou Fouquet
comme on l'appelle en français d'oil – était un clerc accompli. Sa
connaissance des classiques se reflète dans ses citations de poètes
latins, comme Ovide  (une quinzaine), et ses vers sont suffisamment
diffusés pour être réutilisés par les Minnesänger Friedrich von Hausen et Rudolf von Fenis-Neuchâtel (H.-I. Marrou. ibid. p. 80). Ce
n'est donc point le moindre des troubadours occitans de la seconde
moitié du XIIe siècle, ce qui explique qu'on le retrouve dans la
Divine Comédie qui «consacre
quatre épisodes aux troubadours Bertrand de Born (Enfer
xxviii), Sordel et
Arnaud Daniel (Purgatoire
vi-ix et xxvi),
Fouquet de Marseille (Paradis
ix)»
(H.-I. Marrou. ibid. p. 180). La question demeure pourquoi, alors que
Bertrand de Born se trouve dans l'Enfer et Arnaud Daniel et Sordel au
Purgatoire, ce qu'a bien pu faire Folquet de Marseille pour se mériter le Paradis?
(une quinzaine), et ses vers sont suffisamment
diffusés pour être réutilisés par les Minnesänger Friedrich von Hausen et Rudolf von Fenis-Neuchâtel (H.-I. Marrou. ibid. p. 80). Ce
n'est donc point le moindre des troubadours occitans de la seconde
moitié du XIIe siècle, ce qui explique qu'on le retrouve dans la
Divine Comédie qui «consacre
quatre épisodes aux troubadours Bertrand de Born (Enfer
xxviii), Sordel et
Arnaud Daniel (Purgatoire
vi-ix et xxvi),
Fouquet de Marseille (Paradis
ix)»
(H.-I. Marrou. ibid. p. 180). La question demeure pourquoi, alors que
Bertrand de Born se trouve dans l'Enfer et Arnaud Daniel et Sordel au
Purgatoire, ce qu'a bien pu faire Folquet de Marseille pour se mériter le Paradis?
Rien au départ
ne le distingue des autres troubadours et
trobairitz du temps : «Bel esprit fameux et en outre bel
homme, il aima et  chanta bien des dames, et en particulier Azalaïs des Baux, la femme de Barral, mais de celle-ci, dit-on, il ne reçut
pas les dernières faveurs. Après qu'elle fut morte, puis Barral à
son tour, et enfin le roi Alphonse d'Aragon, Folquet abandonna le
monde et entra dans l'ordre cistercien».
Aurions-nous là une explication? Comme Cunizza, qui rachète sa vie de
débauche en faisant des bonnes œuvres, serait-ce en étant entré avec
toute sa famille dans l'ordre des cisterciens que Folquet mériterait
d'être propulsé dans la sphère de Vénus? Son éducation et ses vastes
compétences lui auraient-elles mérité d'être élu abbé du Thoronet,
enfin évêque de Toulouse (1205) où il chauffa la guerre contre les
Albigeois? Dans sa Chanson de la croisade, le
comte de Foix prétend que Folquet fit mourir cinq cent mille hommes
et l'appelle Antéchrist. «Enfin, conclut
Pézard, il favorisa la fondation de l'ordre des frères
prêcheurs [Dominicains]
(1215-1216) et c'est sans doute pourquoi Dante lui fait au
ciel une si belle place. Il mourut en 1231. Dante cite un poème de
Folquet, dans le De vulgari
eloquentia II vi 6...) (P. Pézard. op. cit. pp. 1433-1434, n. 82).
chanta bien des dames, et en particulier Azalaïs des Baux, la femme de Barral, mais de celle-ci, dit-on, il ne reçut
pas les dernières faveurs. Après qu'elle fut morte, puis Barral à
son tour, et enfin le roi Alphonse d'Aragon, Folquet abandonna le
monde et entra dans l'ordre cistercien».
Aurions-nous là une explication? Comme Cunizza, qui rachète sa vie de
débauche en faisant des bonnes œuvres, serait-ce en étant entré avec
toute sa famille dans l'ordre des cisterciens que Folquet mériterait
d'être propulsé dans la sphère de Vénus? Son éducation et ses vastes
compétences lui auraient-elles mérité d'être élu abbé du Thoronet,
enfin évêque de Toulouse (1205) où il chauffa la guerre contre les
Albigeois? Dans sa Chanson de la croisade, le
comte de Foix prétend que Folquet fit mourir cinq cent mille hommes
et l'appelle Antéchrist. «Enfin, conclut
Pézard, il favorisa la fondation de l'ordre des frères
prêcheurs [Dominicains]
(1215-1216) et c'est sans doute pourquoi Dante lui fait au
ciel une si belle place. Il mourut en 1231. Dante cite un poème de
Folquet, dans le De vulgari
eloquentia II vi 6...) (P. Pézard. op. cit. pp. 1433-1434, n. 82).
On peut douter du tableau
de chasse des 500 000 Albigeois, l'attribution provenant d'un supporteur de la secte des hérétiques, mais il est vrai qu'il leva une
armée pour appuyer  Simon de Montfort dans sa conquête du comté de
Toulouse. Il semble même être le seul troubadour à avoir troqué le
chant d'amour pour les cris de haine et d'hallali des hérétiques. L'Église
n'a pas été moindre dans les honneurs puisqu'elle l'a béatifié. Ce qui amène à
poser une question. Peut-on avoir commis des actes aussi atroces et
se montrer capable de gestes de bonté? La complexité de l'âme
humaine est telle que bien des attitudes ou des comportements aussi
antithétiques peuvent parfois se côtoyer chez la même personne.
Dans le cas de Folquet, il est vrai, le fait de se faire cistercien
n'est synonyme en rien d'un acte de bonté! Être désigné pour
devenir évêque de Toulouse non plus, même si en arrivant, Folquet
y trouva une situation plutôt anarchique :
Simon de Montfort dans sa conquête du comté de
Toulouse. Il semble même être le seul troubadour à avoir troqué le
chant d'amour pour les cris de haine et d'hallali des hérétiques. L'Église
n'a pas été moindre dans les honneurs puisqu'elle l'a béatifié. Ce qui amène à
poser une question. Peut-on avoir commis des actes aussi atroces et
se montrer capable de gestes de bonté? La complexité de l'âme
humaine est telle que bien des attitudes ou des comportements aussi
antithétiques peuvent parfois se côtoyer chez la même personne.
Dans le cas de Folquet, il est vrai, le fait de se faire cistercien
n'est synonyme en rien d'un acte de bonté! Être désigné pour
devenir évêque de Toulouse non plus, même si en arrivant, Folquet
y trouva une situation plutôt anarchique :
«Toute grande cité avait son évêque, lequel était un puissant seigneur, souvent co-suzerain de la ville, parfois suzerain unique. Béziers, Toulouse, prêtaient hommage à la fois au comte (ou au vicomte) et à l'évêque [...]. Même dans le cas – comme à Toulouse avant l'avènement de Foulques – où l'autorité de l'évêque était pratiquement inexistante, l'évêché disposait d'un vaste appareil administratif, judiciaire, fiscal, qui employait un grand nombre de personnes, des clercs pour la
plupart, qui tra-vaillaient pour lui et en vivaient. Avant la croisade, à l'époque où l'Église était affaiblie et déconsidérée, le Languedoc comptait beaucoup d'abbayes puissantes et prospères; la réforme cistercienne avait créé un renouveau de foi catholique, et le troubadour Foulques de Marseille, loin de se faire cathare, s'était fait moine à Fontfroide. Les couvents n'étaient pas tous pourris ou désertés en masse, les abbayes comme celles de Grandselve ou de Fontfroide étaient des centres d'une intense vie religieuse et les moines qui y vivaient dans le jeûne et la prière pouvaient rivaliser d'austérité avec les parfaits [les cathares]. Le nombre et la grande richesse de ces abbayes montrent que, malgré les lamentations des papes et des évêques, l'Église dans le Languedoc était loin d'être réduite à néant; la haine même qu'elle suscitait témoigne de sa relative puissance, et quand elle n'aurait eu d'autres partisans que les clercs eux-mêmes, ces clercs constituaient déjà, au sein du pays, une minorité numériquement assez faible, mais non négligeable.
Le seul fait qu'ils menaient une vie plutôt aisée et étaient, en tout cas, presque
toujours à l'abri du besoin, leur conférait déjà une sorte de supério-rité. Lettrés, ils étaient des auxiliaires souvent indispen-sables dans la plupart des actes de la vie civile. Secrétaires, comptables, traducteurs, notaires, parfois savants, ingénieurs, architectes, économistes, juristes, etc., ils formaient même en un pays qui se sécularisait à vue d'œil, une élite intellectuelle dont on ne pouvait se passer» (Z. Oldenbourg. Le Bûcher de Montségur, Paris, Gallimard, Col. Trente journées qui ont fait la France, # 6, 1959, pp. 232-233).
Ainsi, être évêque à Toulouse n'était pas moins qu'être pape à Rome :
«...tout comme les grandes villes italiennes de l'époque, Toulouse était sans cesse en proie à des luttes intestines, sans gravité réelle du reste, mais où les clans rivaux
s'affrontaient et se défiaient, les uns prenant parti pour le comte, les autres pour les consuls, les autres pour l'évêque, Toulouse jouait dans la vie de son pays le rôle que Paris devait jouer dans la vie de la France quelques siècles plus tard; plus qu'une ville, un monde, un symbole, un centre de rayonnement, la tête et le cœur de la province. Toutes les tendances, tous les mouvements y étaient représentés, tous y jouissaient du droit de cité dans une liberté souvent orageuse mais réelle. Foulques de Marseille, le jour où il y faut nommé évêque, eut quelque mal à se faire accepter de ses nouveaux paroissiens. Mais, homme éloquent et énergique, il eut vite fait de grouper autour de lui la population catholique de la cité et cinq ans après sa nomination, il était dans Toulouse, une véritable puissance, non en vertu de son mandat d'évêque mais par son influence personnelle» (Z. Oldenbourg. ibid. p. 157).
La richesse du clergé
n'avait d'égal que celle des Cathares, d'où naquirent de grandes jalousies des uns et des autres. Dominée par un protecteur des
hérétiques, le comte Raymond VI, Toulouse vivait  quasi dans
l'anarchie au moment où Folquet en fut nommé évêque. Son
prédécesseur, «l'évêque de Toulouse, Raymond de Rabastens,
issu d'un milieu hérétique, passe sa vie à guerroyer contre ses
vassaux, et pour se procurer des ressources met en gage les terres du
domaine épiscopal. Lorsqu'en 1206 il est enfin déposé pour
simonie, Foulque de Marseille, abbé de Thoronet, son successeur, ne
trouve dans la caisse de l'évêché que quatre-vingt-seize sous
toulousains, et n'a même pas d'escorte pour mener ses mules à
l'abreuvoir (l'autorité de l'évêque est si peu respectée qu'il
n'ose pas envoyer ses mules à l'abreuvoir communal sans escorte
armée). Il est littéralement traqué par les créanciers de son
prédécesseurs qui viennent le déranger jusque dans le chapitre.
L'évêché de Toulouse, dit Guillaume de Puylaurens, "était
mort"» (Z. Oldenbourg.
ibid. p. 58). Mais l'énergique troubadour devenu évêque déploya
une énergie admirable pour redresser la situation du diocèse :
quasi dans
l'anarchie au moment où Folquet en fut nommé évêque. Son
prédécesseur, «l'évêque de Toulouse, Raymond de Rabastens,
issu d'un milieu hérétique, passe sa vie à guerroyer contre ses
vassaux, et pour se procurer des ressources met en gage les terres du
domaine épiscopal. Lorsqu'en 1206 il est enfin déposé pour
simonie, Foulque de Marseille, abbé de Thoronet, son successeur, ne
trouve dans la caisse de l'évêché que quatre-vingt-seize sous
toulousains, et n'a même pas d'escorte pour mener ses mules à
l'abreuvoir (l'autorité de l'évêque est si peu respectée qu'il
n'ose pas envoyer ses mules à l'abreuvoir communal sans escorte
armée). Il est littéralement traqué par les créanciers de son
prédécesseurs qui viennent le déranger jusque dans le chapitre.
L'évêché de Toulouse, dit Guillaume de Puylaurens, "était
mort"» (Z. Oldenbourg.
ibid. p. 58). Mais l'énergique troubadour devenu évêque déploya
une énergie admirable pour redresser la situation du diocèse :
«Arrivé en 1206 dans un évêché ruiné et pour ainsi dire inexistant, Foulques parviendra non seulement à payer les dettes, à rétablir l'ordre dans les affaires (il
n'était pas pour rien issu d'une famille de marchands), il réussira à s'acquérir dans sa ville, une réelle popularité personnelle, du moins parmi les catholiques. L'historien Guillaume de Puylaurens, qui fut notaire à l'évêché de Toulouse dès 1241, et fut de 1242 à 1247 chapelain des comtes de Toulouse, parle de l'évêque, mort depuis quarante ans au moins à l'époque où il rédige sa chronique, avec une vénération admirative : Foulques avait dû laisser un bon souvenir dans les milieux ecclésiastiques du Toulousain (Il n'est que juste de rappeler cela, car ceux à qui il laissait un mauvais souvenir devaient être légion.)» (Z. Oldenbourg. ibid. p. 103).
Il est évident que
Folquet ne misait pas sur la réconciliation et l'unification entre
catholiques et hérétiques. Les Cathares
véhiculaient une hérésie issue des Bogomiles bulgares totalement
imbue de manichéisme, dotant Dieu et le Diable d'une puissance égale et non hiérarchisées. Pour
Folquet, il ne pouvait y avoir de triomphe que celui de la cause
catholique qu'il s'employa à défendre et à organiser de multiples
façons : «"L'évêque Foulques (dit Guillaume de
Puylaurens) qui avait grandement à cœur d'empêcher que tous les
 habitants de Toulouse fussent exclus de toute partici-pation aux
indulgen-ces accor-dées aux étrangers (c'est-à-dire aux croisés),
résolut de les attacher à la cause de l'Église par une pieuse
institution..." Cette pieuse institution n'est autre chose
qu'une confrérie de catholiques militants chargés d'une activité
ouvertement terroriste : les membres de cette confrérie, surnommée
la Confrérie blanche (ils portaient une croix blanche sur leur
poitrine), sévissaient contre les usuriers (les Juifs) et les
hérétiques de la ville et détruisaient leurs maisons "après
les avoir pillées". Les victimes de ces attentats se
défendirent et "crénelèrent leurs demeures", et dès
lors, dit l'historien, "la division régna dans la ville".
Il se forma une autre confrérie, destinée à lutter contre la
Confrérie blanche et qui s'appela de ce fait Confrérie noire.
"Chaque jour, on se rencontrait les armes à la main, bannières
déployées, et même avec de la cavalerie. Par le moyen de l'évêque,
son serviteur, le Seigneur était venu pour mettre entre eux, non une
mauvaise paix, mais un bon glaive"»
(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 157-158).
habitants de Toulouse fussent exclus de toute partici-pation aux
indulgen-ces accor-dées aux étrangers (c'est-à-dire aux croisés),
résolut de les attacher à la cause de l'Église par une pieuse
institution..." Cette pieuse institution n'est autre chose
qu'une confrérie de catholiques militants chargés d'une activité
ouvertement terroriste : les membres de cette confrérie, surnommée
la Confrérie blanche (ils portaient une croix blanche sur leur
poitrine), sévissaient contre les usuriers (les Juifs) et les
hérétiques de la ville et détruisaient leurs maisons "après
les avoir pillées". Les victimes de ces attentats se
défendirent et "crénelèrent leurs demeures", et dès
lors, dit l'historien, "la division régna dans la ville".
Il se forma une autre confrérie, destinée à lutter contre la
Confrérie blanche et qui s'appela de ce fait Confrérie noire.
"Chaque jour, on se rencontrait les armes à la main, bannières
déployées, et même avec de la cavalerie. Par le moyen de l'évêque,
son serviteur, le Seigneur était venu pour mettre entre eux, non une
mauvaise paix, mais un bon glaive"»
(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 157-158).
Nous
possédons un portrait plus juste de Folquet : «En fait,
l'inquiétante figure de l'évêque-troubadour qui parvenu à l'âge
de quatre-vingts ans, mourra en écrivant un cantique sur la venue de
l'aurore céleste, inspire plus d'étonnement que de respect. Nous le
verrons agir avec une énergie qui est plutôt celle d'un chef de
parti extrémiste que celle d'un évêque. Guillaume de Puylaurens le
loue d'apporter aux citoyens de Toulouse "non une mauvaise paix
mais une  bonne guerre". Son éloquence de tribun incitait à une
action réelle et concrète, et c'est à Foulques que revient le
douteux honneur d'avoir été un des seuls à réussir dans la
tentative de soulever les populations catholiques contre leurs frères
hérétiques. Encore ne s'agit-il là que d'un assez petit nombre de
militants fanatisés, et pour le peuple Foulques restera, comme le
diront un jour les bourgeois de la Bessède, "l'évêque des
diables"» (Z. Oldenbourg.
ibid. pp. 103-104).
bonne guerre". Son éloquence de tribun incitait à une
action réelle et concrète, et c'est à Foulques que revient le
douteux honneur d'avoir été un des seuls à réussir dans la
tentative de soulever les populations catholiques contre leurs frères
hérétiques. Encore ne s'agit-il là que d'un assez petit nombre de
militants fanatisés, et pour le peuple Foulques restera, comme le
diront un jour les bourgeois de la Bessède, "l'évêque des
diables"» (Z. Oldenbourg.
ibid. pp. 103-104).
Ce n'était pas en tant que catholique ou évêque
que Folquet se représentait sa mission à Toulouse, mais bien en
chef de guerre, en chef de parti : «La croisade possède
un allié  terrible dans la place. L'évêque Foulques est non
seulement un partisan farouche des mesures les plus radicales; c'est
un ambitieux qui cherche à occuper dans la ville et dans tout
l'évêché cette première place dont le comte excommunié s'est
rendu indigne. Durant toute la croisade, on le verra agir comme si
Toulouse lui appartenait en propre et comme s'il se considérait
comme le maître des corps aussi bien que des âmes des Toulousains.
Son fanatisme est notoire; il a, du reste, hautement encouragé la
mission de saint Dominique, et déjà, depuis 1209, il a créé dans
son diocèse un foyer de prédication catholique et s'est signalé
par son zèle pour la recherche et le châtiment des hérétiques»
(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 156-157).
terrible dans la place. L'évêque Foulques est non
seulement un partisan farouche des mesures les plus radicales; c'est
un ambitieux qui cherche à occuper dans la ville et dans tout
l'évêché cette première place dont le comte excommunié s'est
rendu indigne. Durant toute la croisade, on le verra agir comme si
Toulouse lui appartenait en propre et comme s'il se considérait
comme le maître des corps aussi bien que des âmes des Toulousains.
Son fanatisme est notoire; il a, du reste, hautement encouragé la
mission de saint Dominique, et déjà, depuis 1209, il a créé dans
son diocèse un foyer de prédication catholique et s'est signalé
par son zèle pour la recherche et le châtiment des hérétiques»
(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 156-157).
Devait-il à ses talents
de troubadour, si séduisants pour attirer les femmes et mobiliser
les esprits, que Folquet, en tant qu'évêque, put se permettre de se
faire un parti et d'envoyer  des hommes à la guerre?
Incontes-tablement, Folquet dégageait un rayon-nement charisma-tique
sans lequel il n'aurait pu être si puissant : «Cet évêque, qui
avait déjà réussi à lever, parmi les membres de sa Confrérie,
une milice de cinq cents Toulousains qu'il avait envoyés se battre
avec les croisés devant Lavaur malgré l'opposition formelle du
comte, était, à sa façon, populaire. Ses hommes allaient au combat
en chantant de pieux "sirventès" composés par lui pour
l'occasion. Sa Confrérie de fanatiques créait dans la capitale un
véritable climat de guerre civile. Or, l'évêque était, dès le
début, un ennemi déclaré du comte dont il réprouvait la tolérance
pour les hérétiques. Depuis que le comte était de nouveau
excommunié, il poussait ouvertement les citadins à la révolte
contre leur seigneur. De toute évidence, l'évêque se considérait,
en droit, maître de la ville»
(Z. Oldenbourg. ibid. p. 158).
des hommes à la guerre?
Incontes-tablement, Folquet dégageait un rayon-nement charisma-tique
sans lequel il n'aurait pu être si puissant : «Cet évêque, qui
avait déjà réussi à lever, parmi les membres de sa Confrérie,
une milice de cinq cents Toulousains qu'il avait envoyés se battre
avec les croisés devant Lavaur malgré l'opposition formelle du
comte, était, à sa façon, populaire. Ses hommes allaient au combat
en chantant de pieux "sirventès" composés par lui pour
l'occasion. Sa Confrérie de fanatiques créait dans la capitale un
véritable climat de guerre civile. Or, l'évêque était, dès le
début, un ennemi déclaré du comte dont il réprouvait la tolérance
pour les hérétiques. Depuis que le comte était de nouveau
excommunié, il poussait ouvertement les citadins à la révolte
contre leur seigneur. De toute évidence, l'évêque se considérait,
en droit, maître de la ville»
(Z. Oldenbourg. ibid. p. 158).
Il fallait plus que du
culot pour oser défier le seigneur et maître de la ville et du Toulousain. Alors que les armées de Simon de Montfort, soutenues par le roi de France, menaient une  véritable
croisade comparable à celles qui avaient déferlé sur l'Orient
depuis deux siècles, «le comte, attaqué sur ses terres, menacé
d'un siège, n'a nul besoin de cet ennemi dans la place. Le jour où
Foulques poussera l'insolence jusqu'à l'inviter à faire une
promenade hors de Toulouse parce que la présence d'un excommunié
dans la ville l'empêche de procéder à des ordinations, le comte
fera dire à son évêque "de vider au plus vite Toulouse et
tout le territoire de sa domination". Foulques commence par
faire parade de son intrépidité : "Ce n'est pas, dit-il, le
comte de Toulouse qui m'a fait évêque, ni est-ce par lui que j'ai
été colloqué en cette ville, ni pour lui; l'humilité
ecclésiastique m'a élu et je n'y suis venu par la violence d'un
prince; je n'en sortirai donc à cause de lui. Qu'il vienne, s'il ose
: je suis prêt à recevoir le couteau pour gagner la majesté
bienheureuse par le calice de la passion. Oui, vienne le tyran avec
ses soldats et ses armes, il me trouvera seul et désarmé :
j'attends le prix et je ne crains point ce que l'homme peut me faire"
(Z. Oldenbourg. ibid. p. 158).
Parlant ainsi, Folquet élevait ses prérogatives au-dessus de celles du prince, comme le voulait le césaro-papisme de l'époque, époque où le pape n'était nul autre qu'Innocent III.
véritable
croisade comparable à celles qui avaient déferlé sur l'Orient
depuis deux siècles, «le comte, attaqué sur ses terres, menacé
d'un siège, n'a nul besoin de cet ennemi dans la place. Le jour où
Foulques poussera l'insolence jusqu'à l'inviter à faire une
promenade hors de Toulouse parce que la présence d'un excommunié
dans la ville l'empêche de procéder à des ordinations, le comte
fera dire à son évêque "de vider au plus vite Toulouse et
tout le territoire de sa domination". Foulques commence par
faire parade de son intrépidité : "Ce n'est pas, dit-il, le
comte de Toulouse qui m'a fait évêque, ni est-ce par lui que j'ai
été colloqué en cette ville, ni pour lui; l'humilité
ecclésiastique m'a élu et je n'y suis venu par la violence d'un
prince; je n'en sortirai donc à cause de lui. Qu'il vienne, s'il ose
: je suis prêt à recevoir le couteau pour gagner la majesté
bienheureuse par le calice de la passion. Oui, vienne le tyran avec
ses soldats et ses armes, il me trouvera seul et désarmé :
j'attends le prix et je ne crains point ce que l'homme peut me faire"
(Z. Oldenbourg. ibid. p. 158).
Parlant ainsi, Folquet élevait ses prérogatives au-dessus de celles du prince, comme le voulait le césaro-papisme de l'époque, époque où le pape n'était nul autre qu'Innocent III.
Mais
ne nous laissons pas abuser par la haute rhétorique : «Le
chef de la Confrérie blanche  n'était à coup sûr ni seul ni
désarmé; et Raymond VI ne se souciait nullement de prendre à son
compte le meurtre d'un évêque. Le discours de Foulques était donc
une bravade gratuite et l'homme avait le sens de l'attitude
théâtrale. Au bout de quelques jours, lassé d'attendre un martyre
ou du moins une provocation qui ne venait pas sentant probablement
que sa popularité ne pouvait contrebalancer celle du comte, il
quitta la ville et se rendit au camp des croisés" «Z.
Oldenbourg. ibid. pp. 158-159). Car l'armée des croisés avançait
et les habitants de Toulouse avaient de quoi s'inquiéter. «La
guerre contre Toulouse avait bien commencé».
n'était à coup sûr ni seul ni
désarmé; et Raymond VI ne se souciait nullement de prendre à son
compte le meurtre d'un évêque. Le discours de Foulques était donc
une bravade gratuite et l'homme avait le sens de l'attitude
théâtrale. Au bout de quelques jours, lassé d'attendre un martyre
ou du moins une provocation qui ne venait pas sentant probablement
que sa popularité ne pouvait contrebalancer celle du comte, il
quitta la ville et se rendit au camp des croisés" «Z.
Oldenbourg. ibid. pp. 158-159). Car l'armée des croisés avançait
et les habitants de Toulouse avaient de quoi s'inquiéter. «La
guerre contre Toulouse avait bien commencé».
Les places fortes d'hérétiques tombaient les unes après les autres : «Or,
Toulouse, comme nous l'avons vu, n'était pas une ville hérétique;
les catholiques y étaient nombreux et influents.  L'année
précé-dente, les consuls avaient accompa-gné le comte à Rome pour
obtenir du pape la levée de l'interdit jeté sur leur ville. Les
Tou-lousains tiennent à faire la paix avec leur évêque; Foulques
leur répond par un ultimatum : qu'ils refusent obéissance à leur
seigneur excommunié et le chassent de la ville, sinon Toulouse est
mise au ban de l'Église. Cette proposition est repoussée avec
indignation et Foulques ordonne au clergé de quitter la ville, pieds
nus, emportant le Saint Sacrement. L'interdit est jeté à nouveau
sur la capitale et Toulouse devient la cité hérétique promise au
glaive des croisés» (Z.
Oldenbourg. ibid. p. 159).
L'année
précé-dente, les consuls avaient accompa-gné le comte à Rome pour
obtenir du pape la levée de l'interdit jeté sur leur ville. Les
Tou-lousains tiennent à faire la paix avec leur évêque; Foulques
leur répond par un ultimatum : qu'ils refusent obéissance à leur
seigneur excommunié et le chassent de la ville, sinon Toulouse est
mise au ban de l'Église. Cette proposition est repoussée avec
indignation et Foulques ordonne au clergé de quitter la ville, pieds
nus, emportant le Saint Sacrement. L'interdit est jeté à nouveau
sur la capitale et Toulouse devient la cité hérétique promise au
glaive des croisés» (Z.
Oldenbourg. ibid. p. 159).  Bref,
Toulouse apparaissait une nouvelle Jéricho et les croisés y étaient les nouveaux Israélites - revêtus de la chape des catholiques - venus afin de faire tomber ses murs. À l'instar de Rahab,
Folquet avait quitté la ville assiégée pour rejoindre son véritable
maître.
Bref,
Toulouse apparaissait une nouvelle Jéricho et les croisés y étaient les nouveaux Israélites - revêtus de la chape des catholiques - venus afin de faire tomber ses murs. À l'instar de Rahab,
Folquet avait quitté la ville assiégée pour rejoindre son véritable
maître.
Les tentatives de pourparlers échouèrent sans surprise, et Simon attaqua les forces coalisées autour de Raymond. Le roi d'Aragon, Pierre II, est tué. La débandade s'empare alors des coalisés : les Espagnols franchissent les Pyrénées et s'en retournent chez eux; les autres princes regagnent leurs comtés. C'est la victoire de Muret qui livre à Simon et à l'Église «un pays non pas encore vaincu, mais démoralisé par l'effondrement trop brutal d'un grand espoir».
«Tout comptes faits, c'est la ville de Toulouse qui aura, dans cette affaire payé le plus lourd tribut en vies humaines – et de loin. L'attaque forcenée de la chevalerie française contre l'infanterie toulousaine a été une tuerie plutôt qu'une bataille et, si les Français avaient à venger deux des leurs (Pierre de
Sissey et Roger des Essarts, vieux compa-gnons de Montfort, amenés prison-niers à Toulouse et cruellement torturés avant d'être achevés), Toulouse, "où il n'y a guère de maison qui ne pleurât quelqu'un", n'oubliera pas les massacrés et les noyés de Muret. Au lendemain de sa victoire, Simon ne marchera pas sur la capitale. Il semble bien que la ville immense, même désolée, désemparée, abandonnée par ses défenseurs, représente pour le vainqueur sinon un danger, du moins une source d'ennuis qu'il ne se sent pas encore de taille à affronter» (Z. Oldenbourg. ibid. p. 173).
Et
Folquet de tirer tout le prestige de l'affaire : «Les évêques
y entreront, Foulques en tête; ils essaient de négocier la
soumission de la ville; les consuls font traîner les pourparlers en
longueur, discutent sur le nombre des otages et finissent par refuser
de se soumettre. Montfort, cependant, passe le Rhône, poursuivant la
conquête et la soumission méthodique des domaines du comte et
attendant que, les autres provinces domptées, Toulouse lui tombe
entre les mains comme un fruit mûr»
(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 173-174). Comme
pour tant d'autres situations, l'inconstance fit que la victoire de
Muret ne signifiât pas la fin de la croisade albigeoise. Toulouse ne
pardonnait pas à son évêque le pitoyable rôle qu'il avait joué
dans la croisade et il n'osa reparaître dans la cité. Même les
citoyens catholiques, aidés en cela par les troubadours, ne
reculaient pas devant la haine de  l'Église : «L'Église,
pour ceux-là mêmes qui invo-quaient les saints et véné-raient les reliques, était l'ennemi par définition»
(Z. Oldenbourg. ibid. p. 232). Le
Languedoc se vidait de ses richesses, jusqu'à ce que, comme disait
le Folquet de Dante : «les
bergers fussent transformés en loups».
Le pape Innocent III convoqua à Rome, pour novembre 1215, le quatrième concile de Latran, avec les
grandes assises
en
vue de résoudre les différents problèmes de la Chrétienté, plus
spécifiquement les hérésies. Le 14 novembre, les différents
comtes et barons accusés d'hérésie s'y trouvaient défendus par
Raymond-Roger, comte de Foix.
l'Église : «L'Église,
pour ceux-là mêmes qui invo-quaient les saints et véné-raient les reliques, était l'ennemi par définition»
(Z. Oldenbourg. ibid. p. 232). Le
Languedoc se vidait de ses richesses, jusqu'à ce que, comme disait
le Folquet de Dante : «les
bergers fussent transformés en loups».
Le pape Innocent III convoqua à Rome, pour novembre 1215, le quatrième concile de Latran, avec les
grandes assises
en
vue de résoudre les différents problèmes de la Chrétienté, plus
spécifiquement les hérésies. Le 14 novembre, les différents
comtes et barons accusés d'hérésie s'y trouvaient défendus par
Raymond-Roger, comte de Foix.
Ce
dernier ne cesse de plaider l'orthodoxie catholique des princes
languedociens. Il les présente comme des victimes de la furie de
Simon de Montfort. Il omet le fait que sa propre sœur et sa femme
s'étaient faites parfaites dans des couvents cathares, ce que
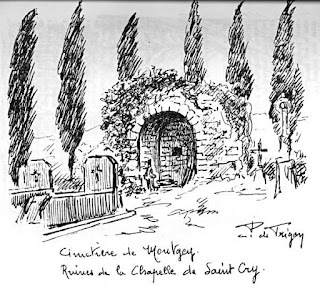 Folquet ne tarde pas à lui rappeler : «Foulques,
pour provoquer l'indignation de l'assistance, parlera des
"...pèlerins dont le comte a tué et mis en pièces un si grand
nombre que le champ de Montgey en est encore couvert, que la France
les pleure encore et que tu (le comte?) en restes déshonoré! Là
dehors, devant la porte, tels sont les plaintes et les cris des
aveugles, des proscrits, des mutilés, qui ne peuvent plus marcher
sans qu'on les guide, que celui qui les a tués, estropiés, mutilés,
ne mérite plus de tenir terre!" (Foulques fait allusion au
massacre, par le comte de Foix, d'un contingent de croisés
allemands, près de Montgey.)»
(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 185-186).
Folquet ne tarde pas à lui rappeler : «Foulques,
pour provoquer l'indignation de l'assistance, parlera des
"...pèlerins dont le comte a tué et mis en pièces un si grand
nombre que le champ de Montgey en est encore couvert, que la France
les pleure encore et que tu (le comte?) en restes déshonoré! Là
dehors, devant la porte, tels sont les plaintes et les cris des
aveugles, des proscrits, des mutilés, qui ne peuvent plus marcher
sans qu'on les guide, que celui qui les a tués, estropiés, mutilés,
ne mérite plus de tenir terre!" (Foulques fait allusion au
massacre, par le comte de Foix, d'un contingent de croisés
allemands, près de Montgey.)»
(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 185-186).
 Le
comte de Foix s'emballe. Il met en doute la légitimité de la croisade.
Il se scandalise qu'on lui donne des actes de cruautés et
«contre-attaque
vigoureusement, et c'est l'évêque de Toulouse lui-même qu'il prend
à partie, l'accusant d'être le principal responsable de tout le mal
qui a été fait dans le Languedoc : "Quant à l'évêque qui
montre tant de véhémence, je vous dis qu'en sa personne, Dieu et
nous sommes trahis... Quand il a été élu évêque de Toulouse, un
tel incendie embrasa toute la terre que jamais il n'y aura assez
d'eau pour l'éteindre. À plus de cinq cent mille, grands et petits,
il y a fait perdre la vie, le corps et l'âme. Par la foi que je vous
dois, à ses actes, à ses paroles, à son maintien, il semble être
plutôt l'Antéchrist qu'un légat de Rome!"»
(Z. Oldenbourg. ibid. p. 186). C'est ici que nous retrouvons les 500
000 victimes attribué à Folquet.
Le
comte de Foix s'emballe. Il met en doute la légitimité de la croisade.
Il se scandalise qu'on lui donne des actes de cruautés et
«contre-attaque
vigoureusement, et c'est l'évêque de Toulouse lui-même qu'il prend
à partie, l'accusant d'être le principal responsable de tout le mal
qui a été fait dans le Languedoc : "Quant à l'évêque qui
montre tant de véhémence, je vous dis qu'en sa personne, Dieu et
nous sommes trahis... Quand il a été élu évêque de Toulouse, un
tel incendie embrasa toute la terre que jamais il n'y aura assez
d'eau pour l'éteindre. À plus de cinq cent mille, grands et petits,
il y a fait perdre la vie, le corps et l'âme. Par la foi que je vous
dois, à ses actes, à ses paroles, à son maintien, il semble être
plutôt l'Antéchrist qu'un légat de Rome!"»
(Z. Oldenbourg. ibid. p. 186). C'est ici que nous retrouvons les 500
000 victimes attribué à Folquet.
À
l'issue des assises, c'est à la dépossession même de leurs droits, de
leurs terres et de leurs biens que pense le comte de Foix, aussi,
essaie-t-il de présenter la croisade comme  une vile entreprise de
banditisme, essayant toutefois d'en écarter la personne du pape. Ce qui
n'empê-chera pas ce dernier de remettre les posses-sions du comte de
Toulouse à son vainqueur, Simon de Montfort, et ce conformément à la règle des croisades : le vainqueur empoche le tout. Tout le comté sera
désormais entre les mains des croisés, poussant à l'exil les
détenteurs officiels des terres et des biens. Du même coup,
Folquet, Simon, Arnaud-Amaury (l'homme de Béziers!) se voyaient
lavés de leurs crimes tout en se partageant les biens des princes excommuniés.
une vile entreprise de
banditisme, essayant toutefois d'en écarter la personne du pape. Ce qui
n'empê-chera pas ce dernier de remettre les posses-sions du comte de
Toulouse à son vainqueur, Simon de Montfort, et ce conformément à la règle des croisades : le vainqueur empoche le tout. Tout le comté sera
désormais entre les mains des croisés, poussant à l'exil les
détenteurs officiels des terres et des biens. Du même coup,
Folquet, Simon, Arnaud-Amaury (l'homme de Béziers!) se voyaient
lavés de leurs crimes tout en se partageant les biens des princes excommuniés.
Malgré
la condamnation et l'exil, le vieux comte de Toulouse était reçu
avec les hommages dus à son rang lors de son passage à Marseille. Les assises
n'avaient pas mis fin à la croisade et les  hérétiques
continuaient à tenir tête aux croisés. Toulouse ne voulait pas se
rendre. Elle ne cessait de conso-lider ses fortifi-cations. En juin 1218,
Simon de Montfort est tué en menant l'assaut de la ville. Son fils
et héritier, Amaury de Montfort, à peine âgé de 20 ans, ne pourra
conserver les terres si mal acquises et Raymond VII de Toulouse, le
fils du comte dépossédé aux assises de Rome, récupérera son bien
patrimonial. Folquet termina sa vie à poursuivre les hérétiques du
Languedoc, traînant
avec lui un jeune prêcheur espagnol, Dominique de Guzmán,
qui travaillait à instituer les tribunaux de l'Inquisition. Il
mourut le 25 décembre 1231 dans sa ville de Toulouse où il avait
entretenu plus de vingt années de guerres meurtrières.
hérétiques
continuaient à tenir tête aux croisés. Toulouse ne voulait pas se
rendre. Elle ne cessait de conso-lider ses fortifi-cations. En juin 1218,
Simon de Montfort est tué en menant l'assaut de la ville. Son fils
et héritier, Amaury de Montfort, à peine âgé de 20 ans, ne pourra
conserver les terres si mal acquises et Raymond VII de Toulouse, le
fils du comte dépossédé aux assises de Rome, récupérera son bien
patrimonial. Folquet termina sa vie à poursuivre les hérétiques du
Languedoc, traînant
avec lui un jeune prêcheur espagnol, Dominique de Guzmán,
qui travaillait à instituer les tribunaux de l'Inquisition. Il
mourut le 25 décembre 1231 dans sa ville de Toulouse où il avait
entretenu plus de vingt années de guerres meurtrières.
 Il
est évident que Dante n'a pas voulu voir la carrière épiscopale de
Folquet. Seul le troubadour dévoré par la passion
d'amour évoquait en lui les raisons pour lesquelles il le plaçait
dans la sphère de Vénus; autrement, Folquet aurait dû se retrouver
dans la sphère de Mars en tant qu'évêque militaire. Il est vrai que pour un Guelfe, la présence
des hérétiques représentait
une menace pour l'intégrité de la Chrétienté. Le fait de ne pas
vouloir voir
les horreurs commises par Folquet à Toulouse provient d'une censure
morale et toute personnelle puisqu'il n'hésitait pas à placer
d'autres troubadours, au passé moins lourd, au Purgatoire ou même
en Enfer. Mais peut-on séparer les âmes au point d'ignorer la cruauté d'un individu en honorant ses ballades amoureuses? La douceur des chants du troubadour suffire à faire
oublier le sang et la souffrance des victimes, aussi bien parmi les
croisés que parmi les parfaits?
Il
est évident que Dante n'a pas voulu voir la carrière épiscopale de
Folquet. Seul le troubadour dévoré par la passion
d'amour évoquait en lui les raisons pour lesquelles il le plaçait
dans la sphère de Vénus; autrement, Folquet aurait dû se retrouver
dans la sphère de Mars en tant qu'évêque militaire. Il est vrai que pour un Guelfe, la présence
des hérétiques représentait
une menace pour l'intégrité de la Chrétienté. Le fait de ne pas
vouloir voir
les horreurs commises par Folquet à Toulouse provient d'une censure
morale et toute personnelle puisqu'il n'hésitait pas à placer
d'autres troubadours, au passé moins lourd, au Purgatoire ou même
en Enfer. Mais peut-on séparer les âmes au point d'ignorer la cruauté d'un individu en honorant ses ballades amoureuses? La douceur des chants du troubadour suffire à faire
oublier le sang et la souffrance des victimes, aussi bien parmi les
croisés que parmi les parfaits?
 À
l'inverse, ne doit-on retenir que la souffrance infligée aux
Amérindiens par les couvertures infestées de variole à eux
distribuées par le général anglais Jeffrey Amherst au point d'obnubiler tout geste de bonté de sa part? Dans le contexte du wokisme,
il
est impensable d'oublier ce génocide qui inaugurait la première guerre
bactériologique moderne de l'histoire. Le contentieux entre les autochtones et le nouveau
gouvernement anglais de transition reposait sur un mépris de la
règle diplomatique instituée du temps de la Nouvelle-France entre
les peuples autochtones et le gouvernement colonial. Cette méprise
força les autochtones vers la rébellion et les troupes anglaises durent
répondre aux attaques des tribus commandées par Pontiac en
1763-1766.
À
l'inverse, ne doit-on retenir que la souffrance infligée aux
Amérindiens par les couvertures infestées de variole à eux
distribuées par le général anglais Jeffrey Amherst au point d'obnubiler tout geste de bonté de sa part? Dans le contexte du wokisme,
il
est impensable d'oublier ce génocide qui inaugurait la première guerre
bactériologique moderne de l'histoire. Le contentieux entre les autochtones et le nouveau
gouvernement anglais de transition reposait sur un mépris de la
règle diplomatique instituée du temps de la Nouvelle-France entre
les peuples autochtones et le gouvernement colonial. Cette méprise
força les autochtones vers la rébellion et les troupes anglaises durent
répondre aux attaques des tribus commandées par Pontiac en
1763-1766.
«Le commandant en chef britannique Jeffrey Amherst (1717-1797) met sans tarder en place un programme d'économies après la chute de Montréal. Les distributions de "cadeaux" sont parmi les premiers éléments du budget coupés, maintenant que
les Français ont quitté les lieux, les Britanniques ne voient aucunement le [sic!] nécessité de maintenir une coutume qui leur semble avoir presque tout de la corruption. Pour sa part, Amherst est résolu à combattre "l'achat de la bonne conduite, soit des Indiens, soit de quiconque". Pourtant, aux yeux des Amérindiens, les cérémonies annuelles de remise de présents ne symbolisaient pas uniquement le renouvellement des alliances anglo-amérindiennes, elles représentaient aussi le prix dont avaient convenu les Indiens pour laisser les Anglais occuper leurs terres. Pour compliquer encore la situation, les Amérindiens avaient fini par compter sur des articles comme les fusils et les munitions. Sir William Johnson (Warraghiyagey, "Celui qui fait beaucoup d'affaires"), surintendant du département des Affaires des Indiens du Nord de 1755 à 1774, a déconseillé fortement à Amherst ces économies, en faisant valoir que "les Indiens sont de plus en plus convaincus que nous jouons avec eux et que nous n'avons pas l'intention de réglementer le commerce ou d'empêcher un seul des abus dont ils se plaignent tous les jours". Amherst n'a pas tenu compte de son avis» (O. P. Dickason. Les Premières Nations du Canada, Sillery, Septentrion, 1996, pp. 175 à 177).
La
conquête du Canada avait été une grande victoire pour les
Britanniques, mais elle leur avait coûté cher. Alors qu'il y avait
tant à reconstruire, Amherst décida de se montrer chiche devant les
autochtones : «Alors
que l'agent auprès des Indiens, George Croghan, et le 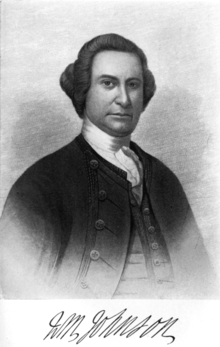 superintendant
William Johnson prônent une attitude généreuse et conciliante à
l'égard des tribus, le général Amherst, commandant en chef des
forces armées, est déterminé à détruire "cette vermine
pernicieuse" contre laquelle "il faudrait lâcher les
chiens". De son côté, le gouvernement britannique, aux prises
avec de graves difficultés financières, renonce à donner aux
Indiens, comme Johnson l'avait recommandé, des indemnités
équivalentes à celles qu'ils recevaient auparavant des Français.
Les tribus se trouvent désemparées, privées de ce qui leur était
devenu nécessaire : armes, vêtements, ustensiles de métal, rhum.
Un prophète delaware se mit à prêcher le retour aux vieilles
coutumes et l'abandon des habitudes acquises qui rendaient les
Indiens dépendants des Blancs...»
(É. Marienstras. Nous,
le peuple, Paris,
Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1988, p. 137). Par ses mesures mesquines, Amherst
prenait le risque d'une nouvelle guerre dans la région des Grands
Lacs. Si la puissante armée britannique avait disposé des armées
françaises le long du Saint-Laurent, il était persuadé qu'elle saurait venir à bout
rapidement de cette
vermine pernicieuse!
superintendant
William Johnson prônent une attitude généreuse et conciliante à
l'égard des tribus, le général Amherst, commandant en chef des
forces armées, est déterminé à détruire "cette vermine
pernicieuse" contre laquelle "il faudrait lâcher les
chiens". De son côté, le gouvernement britannique, aux prises
avec de graves difficultés financières, renonce à donner aux
Indiens, comme Johnson l'avait recommandé, des indemnités
équivalentes à celles qu'ils recevaient auparavant des Français.
Les tribus se trouvent désemparées, privées de ce qui leur était
devenu nécessaire : armes, vêtements, ustensiles de métal, rhum.
Un prophète delaware se mit à prêcher le retour aux vieilles
coutumes et l'abandon des habitudes acquises qui rendaient les
Indiens dépendants des Blancs...»
(É. Marienstras. Nous,
le peuple, Paris,
Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1988, p. 137). Par ses mesures mesquines, Amherst
prenait le risque d'une nouvelle guerre dans la région des Grands
Lacs. Si la puissante armée britannique avait disposé des armées
françaises le long du Saint-Laurent, il était persuadé qu'elle saurait venir à bout
rapidement de cette
vermine pernicieuse!
Ce
en quoi les événements devaient bientôt lui donner tort : «Les
forts anglais tombèrent les  uns après les autres, sauf Détroit qui
dut subir un siège de huit mois. La situation se retourna à la fin
de l'été lorsque, sur le conseil de son adjoint, le colonel Henry
Bouquet, Lord Amherst souffrit qu'on fit parvenir des couvertures
infectées du microbe de la variole aux Delawares en guerre, de sorte
que l'épidémie ravagea les rangs des guerriers indiens»
(É. Marienstras. La
résistance indienne aux États-Unis, Paris,
Gallimard/Julliard, Col. Archives, # 81, 1980, p. 75). La réduction
du soulèvement de Pontiac devait servir de leçon à l'ensemble de
tout l'Amérique du Nord.
uns après les autres, sauf Détroit qui
dut subir un siège de huit mois. La situation se retourna à la fin
de l'été lorsque, sur le conseil de son adjoint, le colonel Henry
Bouquet, Lord Amherst souffrit qu'on fit parvenir des couvertures
infectées du microbe de la variole aux Delawares en guerre, de sorte
que l'épidémie ravagea les rangs des guerriers indiens»
(É. Marienstras. La
résistance indienne aux États-Unis, Paris,
Gallimard/Julliard, Col. Archives, # 81, 1980, p. 75). La réduction
du soulèvement de Pontiac devait servir de leçon à l'ensemble de
tout l'Amérique du Nord.
Que l'affaire soit contemporaine des découvertes médicales de Jenner sur l'inoculation n'est pas sans importance. Les maladies infectieuses avaient décimé les peuples autochtones d'Amérique depuis trois siècles, mais jamais la volonté génocidaire n'avait précédé la contamination ni ne s'exprima avec autant de machiavélisme que dans la missive de sir Jeffrey Amherst. Elle soulève d'indignation le grand humaniste espagnol Salvador de Madariaga plus d'un demi-siècle avant nos wokes :
«Sir Jeffrey Amherst - de qui le Collège Amherst a pris le nom - avait un plan pour exterminer les Indiens. Il était Commandant en chef des forces britanniques en Amérique en 1760 alors que se poursuivait la guerre entre Français et Anglais. Avec tout le respect dû à la perspective historique, le point de vue de l'époque et autres
considérations, son plan vous rend plus ou moins honteux de la race humaine. Son rôle consistait à tuer les Indiens en répandant parmi eux la petite vérole et, pour ce faire, il proposait de leur donner des couvertures infectées par ce mal. On devait offrir ces couvertures comme cadeaux en les accompagnant de sourires et d'expressions de bonne volonté. Il écrivait à un subordonné du Fort Pitt en 1763 : "Vous ferez bien de tenter d'inoculer aux Indiens au moyen de couvertures, et aussi d'essayer toute autre méthode qui peut servir à extirper cette race exécrable. Je serais très heureux de voir réussir votre plan consistant à les chasser avec des chiens". En réponse - apparemment - à cette suggestion, le colonel Bouquet écrivait à Amherst en juillet 1763 : "Je vais essayer d'inoculer la... au moyen de quelques couvertures qui pourront tomber entre leurs mains; j'aimerais employer la méthode espagnole consistant à les chasser avec des chiens"» (S. de Madariaga. L'essor de l'Empire espagnol d'Amérique, Paris, Albin Michel, 1953, p. 458, n. 13).
Toute cette histoire perçue à travers une correspondance a trouvé confirmation à travers des découvertes récentes : «On connaît depuis longtemps la lettre qu'avait écrite de  Philadelphie le général Jeffrey Amherst au colonel Bouquet, lui conseillant d'envoyer, aux Indiens qui encerclaient Fort Pitt, des couvertures infectées par le virus de la variole. On sait aujourd'hui, par le journal d'un commerçant qui se trouvait dans le fort assiégé, que ce n'est pas cette lettre qui a causé la mort par variole de milliers d'Indiens confédérés, mais la décision prise de son propre chef par le capitaine Simeon Ecuyer, de donner à deux chefs delaware venus pour parlementer un viatique de quelques vivres auxquelles il ajouta le virus de la variole : "En signe d'estime pour eux, écrit alors le commerçant William Trent dans son journal, nous leur avons donné deux couvertures et un foulard en soie pris dans l'hôpital de la variole. J'espère que cela fera l'effet désiré". Ce don est attesté par les registres comptables du fort, et ses effets (Stannard dit, sans preuves, qu'il mourut 100 000 Indiens) furent sans conteste la propagation rapide de l'épidémie dans les campements et les villages mingo, delaware, shawnee, et autres nations indiennes de la région, grâce à quoi les Amérindiens durent capituler» (É. Marienstras, in D. El Kenz (éd.) Le massacre, objet d'histoire, Paris, Gallimard, Col. Folio Histoire, # 138, 2005, p. 289). Il importe peu, au final, que ce soit Amherst ou Ecuyer qui fut à l'origine de la première
Philadelphie le général Jeffrey Amherst au colonel Bouquet, lui conseillant d'envoyer, aux Indiens qui encerclaient Fort Pitt, des couvertures infectées par le virus de la variole. On sait aujourd'hui, par le journal d'un commerçant qui se trouvait dans le fort assiégé, que ce n'est pas cette lettre qui a causé la mort par variole de milliers d'Indiens confédérés, mais la décision prise de son propre chef par le capitaine Simeon Ecuyer, de donner à deux chefs delaware venus pour parlementer un viatique de quelques vivres auxquelles il ajouta le virus de la variole : "En signe d'estime pour eux, écrit alors le commerçant William Trent dans son journal, nous leur avons donné deux couvertures et un foulard en soie pris dans l'hôpital de la variole. J'espère que cela fera l'effet désiré". Ce don est attesté par les registres comptables du fort, et ses effets (Stannard dit, sans preuves, qu'il mourut 100 000 Indiens) furent sans conteste la propagation rapide de l'épidémie dans les campements et les villages mingo, delaware, shawnee, et autres nations indiennes de la région, grâce à quoi les Amérindiens durent capituler» (É. Marienstras, in D. El Kenz (éd.) Le massacre, objet d'histoire, Paris, Gallimard, Col. Folio Histoire, # 138, 2005, p. 289). Il importe peu, au final, que ce soit Amherst ou Ecuyer qui fut à l'origine de la première  guerre bactériologique des temps mo-dernes. (Durant l'Antiquité et le Moyen Âge, on catapul-tait des cadavres morts de la peste à l'intérieur des forte-resses assiégées. Amherst, Bouquet et Ecuyer ne firent qu'adapter la même tactique à la guerre américaine.) Le système immunitaire des Indigènes d'Amérique n'était pas préparé à recevoir la contamination européenne au XVIe siècle, les indigènes mourant sans autre volonté que l'action naturelle prise pour volonté divine de nettoyer les terres devant les Pèlerins qui débarquaient des navires anglais ou hollandais. Mais, à la fin du XVIIIe siècle, il en allait tout autrement et la volonté de tuer en usant des microbes et des virus comme armement seule permet de justifier le terme de génocide attribué à l'action des officiers britanniques.
guerre bactériologique des temps mo-dernes. (Durant l'Antiquité et le Moyen Âge, on catapul-tait des cadavres morts de la peste à l'intérieur des forte-resses assiégées. Amherst, Bouquet et Ecuyer ne firent qu'adapter la même tactique à la guerre américaine.) Le système immunitaire des Indigènes d'Amérique n'était pas préparé à recevoir la contamination européenne au XVIe siècle, les indigènes mourant sans autre volonté que l'action naturelle prise pour volonté divine de nettoyer les terres devant les Pèlerins qui débarquaient des navires anglais ou hollandais. Mais, à la fin du XVIIIe siècle, il en allait tout autrement et la volonté de tuer en usant des microbes et des virus comme armement seule permet de justifier le terme de génocide attribué à l'action des officiers britanniques.
De mes souvenirs d'enfance toutefois, je garde une autre image de Amherst. Elle découlait d'une anecdote mettant en scène la fondatrice des Hospitalières, Mère Marguerite d'Youville :
«Mme d'Youville, avec une toute chrétienne impartialité, cachait les fugitifs anglais ou français dans les caveaux de l'église et les nourrissait à la dérobée jusqu'au moment propice de leur évasion. Un jour qu'elle était à coudre une tente dans la salle de communauté, un soldat anglais fait irruption dans la pièce, et à son air égaré, elle comprend qu'il est poursuivi. Soulevant l'immense et lourd matériel, elle lui fait signe de s'y blottir; à peine les plis se sont-ils reposés sur lui qu'un Sauvage brandissant le tomahawk apparaît. Mme d'Youville, toute calme, lui montre du doigt une porte entr'ouverte à l'autre bout de la pièce. L'Indien, croyant poursuivre sa victime, s'engagea dans le couloir qui menait à la sortie. Sans s'en douter, Mme d'Youville venait de sauver sa maison, car lors du siège de Montréal en 1760, ce soldat nommé Southworth, prévint la destruction de l'hôpital. Le général anglais, apercevant cette haute bâtisse hors les murs de la ville, craignit une ruse des Français et donna ordre aux artilleurs de la canonner : c'est alors que le rescapé de Mme d'Youville vint raconter son aventure au commandant, qui députa
des officiers en recon-naissance. Mme d'Youville, dont la politesse native s'était affinée aux enseignements de l'Église : "Rendez... l'honneur à qui vous devez l'honneur", reçut les inquisiteurs avec tant de civilité qu'ils ne doutèrent point de la neutralité de cette oasis de charité» (A. Ferland-Angers. Mère d'Youville, Montréal, Beauchemin, 1945, p. 146).
 Le
général anglais, c'était bien sûr sir Jeffrey Amherst : «Non
seulement Amherst s'empresse de retirer son ordre barbare, mais il
dépêche six officiers pour vérifier l'exactitude de l'assertion.
Sœur d'Youville les reçoit avec politesse, leur sert des
rafraîchissements, leur ouvre les salles des pauvres et surtout
celle des prisonniers anglais. Touchés d'un aussi cordial accueil,
les messagers s'éloignent, emportant de la fondatrice et de sa
communauté le plus réconfortant souvenir»
(G. Laviolette. Marguerite
d'Youville, Québec,
s.é., Col. Gloires nationales, 1944, p. 21).
Le
général anglais, c'était bien sûr sir Jeffrey Amherst : «Non
seulement Amherst s'empresse de retirer son ordre barbare, mais il
dépêche six officiers pour vérifier l'exactitude de l'assertion.
Sœur d'Youville les reçoit avec politesse, leur sert des
rafraîchissements, leur ouvre les salles des pauvres et surtout
celle des prisonniers anglais. Touchés d'un aussi cordial accueil,
les messagers s'éloignent, emportant de la fondatrice et de sa
communauté le plus réconfortant souvenir»
(G. Laviolette. Marguerite
d'Youville, Québec,
s.é., Col. Gloires nationales, 1944, p. 21).
«Reçu dignement par la révérende Mère Catherine Martel, dont l'esprit et la vertu égalaient le courage, l'imposant général se montra fort bienveillant. Il parla aux religieuses avec douceur, rapportent nos manuscrits; il les complimenta sur leur charité et sur la générosité avec laquelle elles avaient peut-être renoncé à de grandes prétentions dans le monde pour se sacrifier au soulagement des malades.
Les relations paraissent avoir été effectivement cordiales, puisque nous voyons le sirop d'érable canadien avoir l'honneur de servir à des fins diplomatiques. Quelques bouteilles de l'onctueuse liqueur, accompagnées des plus beaux fruits du jardin des moniales et d'un billet de circonstance, eurent l'heur de plaire au général victorieux. Celui-ci ne demeura pas en reste de courtoisie. Il répondit par l'envoi de la lettre suivante :
Montréal, ce 25e sep're 1760.
Ma Sœur.
J'ai trop lieu de me loüer des soins dont je me suis apperçu ce matin, que vous avés de nos malades, pourque je ne vous en temoigne pas ma plus vive reconnaissance; cet Echantillon m'est un sur garand que, sans vous en demander la continuation, vous ne relacherai point de Charité et dégard envers Eux. J'ose vous prier de vouloir me permettre de ce présenter à la Communauté une Couple de Cent de Gros Ecus avec deux Douzaines de Vin de Madeire; Ce ne sont que des Erres du bien que je veut à une Société aussi respectable que celle du Monastère de St-Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montreal, qui peuvent compter de la part de la Nation Britannique sur la même protection dont Elle a Joüie sous la domination française.
Daignés agréer mes très humbles remercimens du beau fruit et du sirop qui viennent de m'etre remis de votre part; et souffrés que Je Vous assure du profond Respect avec lequel Je suis
Ma Sœur
Votre très humble et très
Obéissant Serviteur
Jeffrey Amherst» (M. Mondoux. L'Hôtel-Dieu, premier hôpital de Montréal, Montréal, Thérien Frères, 1942).
Ces deux cents écus contrastent avec la dette de cent mille francs que le gouvernement français devait à l'Hôpital Général pour la pension des prisonniers de guerre et les différents travaux qu'il lui avait demandés. Malgré des appels répétés pour le remboursement de cette dette, on ne daigna même pas lui répondre et ce n'est que 60 ans plus tard, après la mort de la fondatrice, qu'un acte de justice répara le tort.
Mais les préventions courtoises d'Amherst ne s'arrêtèrent pas aux religieuses de l'Hôpital Général, comme le montre le fameux placart qu'il fit appliquer publiquement après la prise de la ville. Ici, pas question de pillages ou d'abus :
«Que le peu de secours que le Canada a reçu de la france depuis deux années, l'ayant épuisé de Bien de rafraichissement et de nécessaire. Nous avons pour le bien commun des troupes et de l'habitant recommandé par nos lettres aux différens gouverneurs des Colonies anglaises les plus proximes du Canada d'afficher et publier des avis à leurs Colons pour se transporter icy avec toutes sortes de denrées et de rafraichissements, et nous nous flattons qu'on ne tardera pas de voir remplir ce Projet; et, lorsqu'il Le sera, un chacun en sera instruit pour qu'il puisse y participer au prix courant et sans impots» (cité in Le Boréal Express, t. 1 : 1524-1760, Trois-Rivières, Le Boréal Express éd. s.d. p. 239).
Certes, Amherst et Murray avaient besoin d'amadouer les colons français maintenant que la guerre tirait à sa fin. Ce n'était peut-être pas nécessaire mais c'était préférable. Comme les Hospitalières n'étaient pas tenues de traiter pareillement les soldats blessés français et anglais, le gouvernement militaire n'était pas tenu, non plus, de traiter avec égard la population canadienne au point de songer à l'approvisionner de denrées et de rafraichissements. Dans bien d'autres situations analogues, les garnisons vaincues ne reçurent pas autant d'égards de la part du vainqueur, autant en tous cas qui leur permettaient de conserver leurs capitaines de milice armés et le droit de disposer d'armes. Comme on le sait, ce ne fut pas la manière dont les vainqueurs anglais traitèrent les Acadiens en 1715.
Amherst
était raciste, ceci est incontestable. Et comme tous les
Britanniques d'Amérique du Nord en cette fin de XVIIIe siècle. Il
traita les Indiens séditieux menés par Pontiac avec une  cruauté, égal à la bonté qu'il fît preuve pour les filles de
Mère d'Youville et pour les vaincus de Montréal et des
Trois-Rivières. C'est de bonne casuistique que de reconnaître que même les pires salauds peuvent faire acte(s) de bonté. Cela ne justifie pas toutefois d'honorer leur nom en désignant une rue! Seule la cruauté dont firent preuve Winslow et Lawrence à Grand Pré en Acadie en 1755 appartient à cette même ligne de sauvageries génocidaires. On y retrouve le même paradoxe que dans la noble culture japonaise. Comme les Japonais savent se montrer si raffinés
dans l'art de l'ornementation, ils transportent ces raffinements dans
l'art de supplicier leurs ennemis.
cruauté, égal à la bonté qu'il fît preuve pour les filles de
Mère d'Youville et pour les vaincus de Montréal et des
Trois-Rivières. C'est de bonne casuistique que de reconnaître que même les pires salauds peuvent faire acte(s) de bonté. Cela ne justifie pas toutefois d'honorer leur nom en désignant une rue! Seule la cruauté dont firent preuve Winslow et Lawrence à Grand Pré en Acadie en 1755 appartient à cette même ligne de sauvageries génocidaires. On y retrouve le même paradoxe que dans la noble culture japonaise. Comme les Japonais savent se montrer si raffinés
dans l'art de l'ornementation, ils transportent ces raffinements dans
l'art de supplicier leurs ennemis.
Si
Folquet de Marseille et le général Amherst ne sont peut-être pas dignes de figurer dans la sphère de Vénus, Victor Hugo, par
contre, mérite le privilège incontestable d'y résider, lui,  le poète qui a écrit
qu'«il n'y a
sous le ciel qu'une chose devant laquelle on doive s'incliner : le
génie, et qu'une chose devant laquelle on doive s'agenouiller : la
bonté»
(V. Hugo. Choses
vues, Paris,
Gallimard, Col. Quarto, 2002, p. 843 (26 mars 1854). Les auteurs
romantiques du XIXe siècle, par leur goût du mélodrame,
s'exerçaient à créer des caractères solides, courageux,
déterminés et imbus de bonté. Balzac avec le Père Goriot et Dumas avec le comte de Monte-Cristo pouvaient combiner une gamme de sentiments
qui tournaient autour des comportements les plus délicats, remplis
de mansuétude et surtout d'abnégation de soi. Goriot s'est ruiné
pour ses deux filles qu'il adore mais qui font preuve de négligence
et de rejet; Edmond Dantès découvre, après quatorze années détenu
au château d'If, que sa promise, Mercédès, a épousé l'un des
hommes qu'il croyait son ami et l'a dénoncé, entraînant ainsi son incarcération. Au cœur des intrigues, les
romanciers tentaient d'accéder à la plus haute élévation du
caractère humain.
le poète qui a écrit
qu'«il n'y a
sous le ciel qu'une chose devant laquelle on doive s'incliner : le
génie, et qu'une chose devant laquelle on doive s'agenouiller : la
bonté»
(V. Hugo. Choses
vues, Paris,
Gallimard, Col. Quarto, 2002, p. 843 (26 mars 1854). Les auteurs
romantiques du XIXe siècle, par leur goût du mélodrame,
s'exerçaient à créer des caractères solides, courageux,
déterminés et imbus de bonté. Balzac avec le Père Goriot et Dumas avec le comte de Monte-Cristo pouvaient combiner une gamme de sentiments
qui tournaient autour des comportements les plus délicats, remplis
de mansuétude et surtout d'abnégation de soi. Goriot s'est ruiné
pour ses deux filles qu'il adore mais qui font preuve de négligence
et de rejet; Edmond Dantès découvre, après quatorze années détenu
au château d'If, que sa promise, Mercédès, a épousé l'un des
hommes qu'il croyait son ami et l'a dénoncé, entraînant ainsi son incarcération. Au cœur des intrigues, les
romanciers tentaient d'accéder à la plus haute élévation du
caractère humain.
Dans
ce genre, Victor Hugo demeure indépassable par son génie à développer, au fil du déroulement des intrigues, des âmes plus
grandes que nature : Gwynplaine, le héros de L'homme
qui rit, a été enlevé par des Comprachicos, des achète-petits, qui font du commerce d'enfants qu'ils achètent puis revendent après les avoir mutilés. S'enfuyant sur la Matutina, une hourque qui doit les emmener loin de l'Angleterre (nous sommes au tournant du XVIIIe siècle), celle-ci fait naufrage en laissant Gwynplaine sur la berge. Il est alors âgé de dix ans et comme les Bohémiens lui ont fendu la bouche des deux côtés  jusqu'aux oreilles, il prend l'aspect monstrueux d'un visage qui grimace tout le temps. Appelé à survivre contre la nuit, la neige et la mort, il cherche à retourner vers la ville. Dans son périple, il passe devant un gibet où gît le cadavre d'un condamné et découvre, à quelques pas, le corps d'une femme sur le sein de laquelle est resté accroché un bébé encore vivant. Bon garçon, il se charge de ce fardeau tout en reprenant son chemin. Il croise alors le roulotte d'Ursus, vagabond qui s'habille avec une peau d'ours et accompagné d'un loup. Ursus recueillera Gwynplaine et Dea, le bébé, une fillette qu'ils découvrent aveugle. Avec les années, Dea, qui ne peut être rebuté par l'apparence de Gwynplaine, deviendra l'amour du jeune homme, jusqu'au jour où, reconnu pour un lord baron d'Angleterre, il se retrouve à plaider un discours social enflammé, modèle du genre répété à travers toute l'œuvre de Hugo; en poésie, en romans et en essais. Devant la Chambre des Lords, «il
stigmatise, sous les ricanements de ses pairs, l'injustice sociale»
(P. Ven Tieghem. Dictionnaire
de Victor Hugo, Paris,
Larousse, Col. Dictionnaires de l'homme du XXe siècle, # D35,1970,
p. 107).
jusqu'aux oreilles, il prend l'aspect monstrueux d'un visage qui grimace tout le temps. Appelé à survivre contre la nuit, la neige et la mort, il cherche à retourner vers la ville. Dans son périple, il passe devant un gibet où gît le cadavre d'un condamné et découvre, à quelques pas, le corps d'une femme sur le sein de laquelle est resté accroché un bébé encore vivant. Bon garçon, il se charge de ce fardeau tout en reprenant son chemin. Il croise alors le roulotte d'Ursus, vagabond qui s'habille avec une peau d'ours et accompagné d'un loup. Ursus recueillera Gwynplaine et Dea, le bébé, une fillette qu'ils découvrent aveugle. Avec les années, Dea, qui ne peut être rebuté par l'apparence de Gwynplaine, deviendra l'amour du jeune homme, jusqu'au jour où, reconnu pour un lord baron d'Angleterre, il se retrouve à plaider un discours social enflammé, modèle du genre répété à travers toute l'œuvre de Hugo; en poésie, en romans et en essais. Devant la Chambre des Lords, «il
stigmatise, sous les ricanements de ses pairs, l'injustice sociale»
(P. Ven Tieghem. Dictionnaire
de Victor Hugo, Paris,
Larousse, Col. Dictionnaires de l'homme du XXe siècle, # D35,1970,
p. 107).
«Dans l'obscur et vertigineux débat de sa conscience, que s'était-il dit? ceci : - Le peuple est un silence. Je serai l'immense avocat de ce silence. Je parlerai pour les muets. Je parlerai des petits aux grands et des faibles aux puissants. C'est là le but
de mon sort. Dieu veut ce qu'il veut, et il le fait. [...] Je serai le lord des pauvres. Je parlerai pour tous les taciturnes désespérés. Je traduirai les bégaiements. Je traduirai les grondements, les hurlements, les murmures, la rumeur des foules, les plaintes mal prononcées, les voix inintelligibles, et tous ces cris de bêtes qu'à force d'ignorance et de souffrance on fait pousser aux hommes. Le bruit des hommes est inarticulé comme le bruit du vent; ils crient; mais on ne les comprend pas, crier ainsi équivaut à se taire, et se taire est leur désarmement. Désarmement forcé qui réclame le secours. Moi, je serai le secours. Moi, je serai la dénonciation. Je serai le Verbe du Peuple. Grâce à moi, on comprendra. Je serai la bouche sanglante dont le bâillon est arraché. Je dirai tout. Ce sera grand. -» (V. Hugo. L'homme qui rit, in Romans, t. 3, Paris, Seuil, 1963, p. 402).
 Amoureux
de Dea, Gwynplaine renonce à la pairie pour retourner vivre auprès d'Ursus et de Dea. Ceux-ci ont été enjoint de quitter l'Angleterre le lendemain sous peine d'être emprisonnés. Gwynplaine les rejoint pour voir mourir Dea dans ses bras. Gwynplaine décide de la rejoindre dans la mort en se jetant à l'eau. Cette finale sera reprise, de manière encore plus pathétique, à la fin des Travailleurs de la mer, roman que Hugo dédit «au noble petit peuple de la mer».
Amoureux
de Dea, Gwynplaine renonce à la pairie pour retourner vivre auprès d'Ursus et de Dea. Ceux-ci ont été enjoint de quitter l'Angleterre le lendemain sous peine d'être emprisonnés. Gwynplaine les rejoint pour voir mourir Dea dans ses bras. Gwynplaine décide de la rejoindre dans la mort en se jetant à l'eau. Cette finale sera reprise, de manière encore plus pathétique, à la fin des Travailleurs de la mer, roman que Hugo dédit «au noble petit peuple de la mer».
Gillliatt, le héros des Travailleurs de la mer, est aussi noble d'âme qu'il est laid, voire
monstrueux. Solitaire, on ne sait pas d'où il vient. Il tombe
amoureux de Déruchette, la 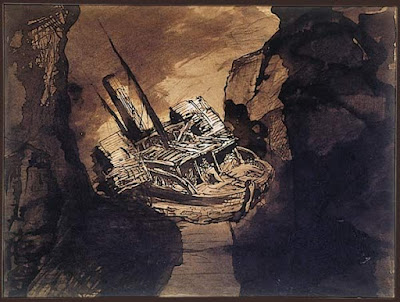 nièce de Mess Lethierry, propriétaire
du vapeur La
Durande. Ce
dernier promet la main de sa nièce à qui récu-pérera la machine de
l'épave coincée entre deux rochers au large de Guernesey. Gilliatt
accepte de relever le défi, ce qui le conduit à maintes péripéties
dont un combat avec un véritable kraken, une pieuvre qui n'est pas
sans ressembler à Moby Dick par son aspect symbolique. Gilliat
réussit à ramener la machine, mais au retour, il découvre que
Déruchette est amoureuse d'un jeune pasteur, Ebenezer, qui l'aime en
retour. Gilliatt commettra le suprême sacrifice en aidant les jeunes
gens à se marier en cachette et à les faire embarquer dans un
sloop, le Cashmere.
Il s'assoit alors dans un rocher au bord de la mer, au moment où
commence le flot de la marée montante :
nièce de Mess Lethierry, propriétaire
du vapeur La
Durande. Ce
dernier promet la main de sa nièce à qui récu-pérera la machine de
l'épave coincée entre deux rochers au large de Guernesey. Gilliatt
accepte de relever le défi, ce qui le conduit à maintes péripéties
dont un combat avec un véritable kraken, une pieuvre qui n'est pas
sans ressembler à Moby Dick par son aspect symbolique. Gilliat
réussit à ramener la machine, mais au retour, il découvre que
Déruchette est amoureuse d'un jeune pasteur, Ebenezer, qui l'aime en
retour. Gilliatt commettra le suprême sacrifice en aidant les jeunes
gens à se marier en cachette et à les faire embarquer dans un
sloop, le Cashmere.
Il s'assoit alors dans un rocher au bord de la mer, au moment où
commence le flot de la marée montante :
«L'œil de Gilliatt, attaché au loin sur le sloop, restait fixe.
Cet œil fixe ne ressemblait à rien de ce qu'on peut voir sur la terre. Dans cette prunelle tragique et calme il y avait de l'inexprimable. Ce regard contenait toute la quantité d'apaisement que laisse le rêve non réalisé, c'était l'acceptation lugubre d'un autre accomplissement. Une fuite d'étoile doit être suivie par des regards pareils. De moment en moment, l'obscurité céleste se faisait sous ce sourcil dont le rayon visuel demeurait fixé à un point de l'espace. En même temps que l'eau infinie autour du rocher Gild-Holm-'Ur, l'immense tranquillité de l'ombre montait dans l'œil profond de Gilliatt.
Le Cashmere, devenu imperceptible, était maintenant une tache mêlée à la brume. Il fallait pour le distinguer savoir où il était.
Peu à peu, cette tache, qui n'était plus une forme, pâlit.
Puis elle s'amoindrit.
Puis elle se dissipa.
À l'instant où le navire s'effaça à l'horizon, la tête disparut sous l'eau.
Il n'y eut plus rien que la mer» (V. Hugo. Les Travailleurs de la mer, in ibid. p. 172).
On ne peut omettre une autre incarnation de l'archétype hugolien : Quasimodo, le bossu de Notre-Dame de Paris :
«Sonneur de cloches à la cathédrale, c'est une sorte de monstre au point de vue physique : il est sourd et contrefait. Recueilli et élevé par le prêtre Claude Frollo, il
vit dans la cathédrale et ne connaît qu'elle. Sa hideur le fait élire pape des fous lors d'un concours de grimaces; mais son ancien protecteur lui arrache ses insignes ecclésiastiques déshonorés par la cérémonie populaire qui fête son élection, et Quasimodo le suit, en chien obéissant. La psychologie du personnage est remarquablement neuve; pour la première fois dans un roman, le narrateur établit avec précision, dans le cas de Quasimodo, les rapports étroits entre les données physiques d'un individu et ses données psychologiques, entre le cadre où il vit, son occupation essentielle, et son monde moral. Son métier a causé sa surdité, celle-ci son isolement intellectuel. Dévoué à Claude Frollo, il a aidé celui-ci dans sa tentative d'enlèvement de la Esmeralda. Arrêté, il subit une parodie de justice et est condamné au pilori. Seule la Esmeralda a pitié de lui et lui donne à boire. Aussi, quand celle-ci est condamnée pour un crime dont elle est innocente, il l'enlève, et, la portant à l'intérieur de la cathédrale, lieu d'asile, il l'arrache aux mains de la justice et de la police. Un autre Quasimodo se révèle alors : sous le masque affreux, dans
le corps grotesque, se cache un cœur re-connais-sant, une âme rayon-nante de lumière. Les truands assaillent la cathédrale pour sauver la Esmeralda, mais Quasimodo croit qu'on vient la chercher pour la livrer à la justice; il défend sa forteresse avec une indomptable énergie. Cependant Claude Frollo enlève la jeune fille et la livre à la justice. Quand elle est pendue à Montfaucon, Quasimodo qui, du haut de la cathédrale, a suivi l'exécution, devinant que son ancien protecteur est la cause de sa mort, le précipite du haut d'une tour et s'en va mourir lui-même en tenant embrassé le cadavre de celle qu'il avait voulu sauver» (P. Van Tieghem. op. cit. p. 176).
On le constatera, ce n'est pas là une comédie musicale, mais bien une tragédie humaine :
«Quasimodo s'était arrêté sous le grand portail. Ses larges pieds semblaient aussi solides sur le pavé de l'église que les lourds piliers romans. Sa grosse tête chevelue s'enfonçait dans ses épaules comme celle des lions qui eux aussi ont une crinière et
pas de cou. Il tenait la jeune fille toute palpitante suspendue à ses mains calleuses comme une draperie blanche; mais il la portait avec tant de précaution qu'il paraissait craindre de la briser ou de la faner. On eût dit qu'il sentait que c'était une chose délicate, exquise et précieuse, faite pour d'autres mains que les siennes. Par moments, il avait l'air de n'oser la toucher, même du souffle. Puis, tout à coup, il la serrait avec étreinte dans ses bras, sur sa poitrine anguleuse, comme son bien, comme son trésor, comme eût fait la mère de cette enfant; son œil de gnome, abaissé sur elle, l'inondait de tendresse, de douleur et de pitié, et se relevait subitement sur elle, l'inondait de tendresse, de douleur et de pitié, et se relevait subitement plein d'éclairs. Alors les femmes riaient et pleuraient, la foule trépignait d'enthousiasme, car en ce moment-là Quasimodo avait vraiment sa beauté. Il était beau, lui, cet orphelin, cet enfant trouvé, ce rebut, il se sentait auguste et fort, il regardait en face cette société dont il était banni, et dans laquelle il intervenait si puissamment, cette injustice humaine à laquelle il avait arraché sa proie tous ces tigres forcés de mâcher à vide, ces sbires, ces juges, ces bourreaux, toute cette force du roi qu'il venait de briser, lui infirme, avec la force de Dieu.
Et puis c'était une chose touchante que cette protection tombée d'un être si difforme sur un être si malheureux, qu'une condamnée à mort sauvée par Quasimodo. C'étaient les deux misères extrêmes de la nature et de la société qui se touchaient et qui s'entr'aidaient» (V. Hugo. Notre-Dame de Paris, in Romans, t. 1, Paris, Seuil, 1963, p. 361).
Mais,
évidemment, le modèle achevé de la bonté se retrouve dans le long
roman, Les
Misérables. Toute
l'intrigue pleine de  rebondissements tient à une rencontre du forçat Jean
Valjean au début du roman : «Sorti
du bagne de Toulon, il voit toutes les portes se fermer devant lui;
un évêque tout de bonté et d'humanité candide l'accueille. Mais
la psychologie du personnage se complique; le bagne a laissé en lui
la marque du mal; il vole son bienfaiteur, et ne retrouve son sens
moral qu'après une nouvelle preuve de la perfection morale de
l'évêque, et encore la volonté du bien ne naît-elle en lui
qu'après un autre vol»
(P. Van Tieghem. op. cit. p. 199).
rebondissements tient à une rencontre du forçat Jean
Valjean au début du roman : «Sorti
du bagne de Toulon, il voit toutes les portes se fermer devant lui;
un évêque tout de bonté et d'humanité candide l'accueille. Mais
la psychologie du personnage se complique; le bagne a laissé en lui
la marque du mal; il vole son bienfaiteur, et ne retrouve son sens
moral qu'après une nouvelle preuve de la perfection morale de
l'évêque, et encore la volonté du bien ne naît-elle en lui
qu'après un autre vol»
(P. Van Tieghem. op. cit. p. 199).
Monsieur Myriel devenu évêque de Digne, Mgr Bienvenu, vit avec sa sœur et sa domestique. Un soir, on frappe à la porte :
«La porte s'ouvrit.
Elle s'ouvrit vivement, toute grande, comme si quelqu'un la poussait avec énergie et résolution.
Un homme entra.
Cet homme, nous le connaissons déjà. C'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure errer cherchant un gîte.
Il entra, fit un pas et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition.
Madame Magloire n'eut même pas la force de jeter un cri. Elle tressaillit, et resta béante.
Mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement, puis, ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée, elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein.
L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille.
Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton, promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et les femmes, et, sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute :
- Voici. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé dix-neuf ans au bagne. Je suis libéré depuis quatre jours et en route pour Pontarlier qui est ma destination. Quatre jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait douze lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge, on m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit : Va-t'en! Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier n'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait, et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre
maison et m'a dit : Frappe là. J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent. Ma masse. Cent neuf francs quinze sous que j'ai gagnés au bagne par mon travail en dix-neuf ans. Je payerai. Qu'est-ce que cela me fait? j'ai de l'argent. Je suis très fatigué, douze lieues à pied, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste?
- Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus.
L'homme fit trois pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table. - Tenez, reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris, ce n'est pas ça. Avez-vous entendu? Je suis un galérien. Un forçat. Je viens des galères. - Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. - Voilà mon passeport. Jaune, comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous lire? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport : "Jean Valjean, forçat libéré, natif de... - cela vous est égal...
- Et resté dix-neuf ans au bagne. Cinq ans pour vol avec effraction. Quatorze ans pour avoir tenté de s'évader quatre fois. Cet homme est très dangereux".
- Voilà! Tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? avez-vous une écurie?
- Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve.
Nous avons déjà expliqué de quelle nature était l'obéissance des deux femmes.
Madame Magloire sortit pour exécuter ces ordres.
L'évêque se tourna vers l'homme.
- Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant, et l'on fera votre lit pendant que vous souperez.
Ici l'homme comprit tout à fait. L'expression de son visage, jusqu'alors sombre et dure, s'empreignit de stupéfaction, de doute, de joie, et devint extraordinaire. Il se mit à balbutier comme un homme fou :
- Vrai? quoi? vous me gardez? vous ne me chassez pas? un forçat! Vous m'appelez monsieur! vous ne me tutoyez pas! Va-t'en, chien! qu'on me dit toujours. Je croyais bien que vous me chasseriez. Aussi j'avais dit tout de suite qui je suis. Oh! la brave femme qui m'a enseigné ici! Je vais souper! un lit! Un lit avec des matelas et des draps! comme tout le monde! il y a dix-neuf ans que je n'ai couché dans un lit! Vous voulez bien que je n'en aille pas! Vous êtes de dignes gens!...» (V. Hugo. Les Misérables, in Romans, t. 2, Paris, Seuil, 1963, pp. 38-39).
Chez Hugo, la méchanceté des uns fait jaillir la bonté des autres car,
en elle-même, la bonté n'est pas un sentiment qui fait lever les
cœurs, contrairement à l'amour ou à la colère. On est même
plutôt cynique face aux gestes débonnaires que l'on prête trop
souvent aux gens qui finissent par en être les dupes. La bonté serait le propre d'une  humanité trop candide. Jean Valjean ne cesse de rappeler qu'il est tenu pour une mauvaise personne. Il s'obstine, insiste, s'acharne à répéter à ses hôtes qu'il est un repris de justice, un bagnard, un criminel : un être dangereux. Mais le calme et la sérénité de Mgr Bienvenu ne s'en trouvent nullement ébranlés. Par contre, la laideur d'un
Jean Frollo, le prêtre pervers de Notre-Dame-de-Paris,
celle des Thénardier face au Père Fauchelevent (Jean Valjean) ou encore l'opiniâtreté bête au service de l'ordre que représente le fonctionnaire Javert dans
Les Misérables, contribuent
à donner à la bonté cette dignité qui échappe à tant d'autres
qualités humaines. Aux yeux de Hugo, cette bonté est contagieuse et
tout le long du roman consiste à voir comment l'action de Mgr
Bienvenu Myriel continuera d'agir tout au long de la vie de Jean Valjean;
jusqu'à la tombe :
humanité trop candide. Jean Valjean ne cesse de rappeler qu'il est tenu pour une mauvaise personne. Il s'obstine, insiste, s'acharne à répéter à ses hôtes qu'il est un repris de justice, un bagnard, un criminel : un être dangereux. Mais le calme et la sérénité de Mgr Bienvenu ne s'en trouvent nullement ébranlés. Par contre, la laideur d'un
Jean Frollo, le prêtre pervers de Notre-Dame-de-Paris,
celle des Thénardier face au Père Fauchelevent (Jean Valjean) ou encore l'opiniâtreté bête au service de l'ordre que représente le fonctionnaire Javert dans
Les Misérables, contribuent
à donner à la bonté cette dignité qui échappe à tant d'autres
qualités humaines. Aux yeux de Hugo, cette bonté est contagieuse et
tout le long du roman consiste à voir comment l'action de Mgr
Bienvenu Myriel continuera d'agir tout au long de la vie de Jean Valjean;
jusqu'à la tombe :
«On y lit aucun nom.
Seulement, voilà de cela bien des années déjà, une main y a écrit au crayon ces quatre vers qui sont devenus peu à peu illisibles sous la pluie et la poussière, et qui probablement sont aujourd'hui effacés :
Il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange;
La chose simplement d'elle-même arriva,
Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va» (V. Hugo. ibid. p. 557)⏳



.jpg)