 |
| John Haley. Caïn et Abel, lithographie |
LE CIRCUIT DE CAÏN
Il est convenu que d’un couple de jumeaux on demande
toujours lequel des deux est le méchant. La  remarque s’adresse moins
spécifiquement aux jumeaux puisque parfois, aussi, aux frères et aux sœurs. On pense
moins au fait à l’extraordinaire de la ressemblance qu’à l’étrangeté de voir
deux êtres si proches l’un de l’autre au point qu’ils deviennent des doubles poussés jusqu’à l’antagonisme.
Et là, nous entrons dans l’univers du fantastique.
remarque s’adresse moins
spécifiquement aux jumeaux puisque parfois, aussi, aux frères et aux sœurs. On pense
moins au fait à l’extraordinaire de la ressemblance qu’à l’étrangeté de voir
deux êtres si proches l’un de l’autre au point qu’ils deviennent des doubles poussés jusqu’à l’antagonisme.
Et là, nous entrons dans l’univers du fantastique.
Le fantastique, c’est-à-dire le doppelgänger. Ce mot d’origine allemande signifie tout simplement
un sosie, un «double» fantomatique d’une personne vivante, d’où son usage dans
les romans du XIXe siècle. On date l’origine du doppelgänger d’un roman de l’auteur  allemand Jean-Paul (Richter), Siebenkäs (1796), où le doppelgänger est définit comme «ceux qui
se voient eux-mêmes». William Wilson d’Edgar
Poe, Le portrait de Dorian Gray d’Oscar
Wilde, reprennent le thème et sont des nouvelles universellement connues et
repiquées de toutes sortes de façon par le cinéma, la bande dessinée, les
séries télé. Souvent, c’est un jumeau maléfique mort qui vient hanter son frère
vivant. Si nous passons du paranormal à la psychologie, nous associons au
double le phénomène de bilocation, l’ubiquité ou tout simplement le fait
d’apercevoir fugitivement sa propre image du coin de l’œil. Rien de fantastique
ici, seulement une sensation de l’étrange. Il est donc préférable de penser en
termes de «double» plutôt que de sosie, utilisé généralement dans le roman
policier, comme dans le conte de Boileau-Narcejac qui inspira le film
d’Hitchcock, Vertigo. Passé à la
superstition, le doppelgänger est
perçu comme un mauvais augure de mort et un Double
vu par des proches serait un signe de malchance ou de maladie à venir. Plus
qu’un thème romantique, le doppelgänger est
devenu un «symptôme» de notre temps car il ramène au cœur de l’existence le
thème de l’identité.
allemand Jean-Paul (Richter), Siebenkäs (1796), où le doppelgänger est définit comme «ceux qui
se voient eux-mêmes». William Wilson d’Edgar
Poe, Le portrait de Dorian Gray d’Oscar
Wilde, reprennent le thème et sont des nouvelles universellement connues et
repiquées de toutes sortes de façon par le cinéma, la bande dessinée, les
séries télé. Souvent, c’est un jumeau maléfique mort qui vient hanter son frère
vivant. Si nous passons du paranormal à la psychologie, nous associons au
double le phénomène de bilocation, l’ubiquité ou tout simplement le fait
d’apercevoir fugitivement sa propre image du coin de l’œil. Rien de fantastique
ici, seulement une sensation de l’étrange. Il est donc préférable de penser en
termes de «double» plutôt que de sosie, utilisé généralement dans le roman
policier, comme dans le conte de Boileau-Narcejac qui inspira le film
d’Hitchcock, Vertigo. Passé à la
superstition, le doppelgänger est
perçu comme un mauvais augure de mort et un Double
vu par des proches serait un signe de malchance ou de maladie à venir. Plus
qu’un thème romantique, le doppelgänger est
devenu un «symptôme» de notre temps car il ramène au cœur de l’existence le
thème de l’identité.
Voilà pourquoi le motif des jumeaux vient concrétiser le
double. Otto Rank, le célèbre psychanalyste, avait très bien compris qu’il
s’agissait d’une conséquence, non pas du phénomène de la naissance gémellaire,
mais  de la croyance en une âme double, l’une mortelle, l’autre immortelle.
Comme dans William Wilson, on a
l’impression que le «bon» est tué par le «mauvais» William Wilson. Un sentiment
de culpabilité pathologique anime cette confrontation qui accuse la soumission
du pervers à ses penchants mauvais, irrécupérable par le Moi collectif. Dans
les cultures primitives, souvent les jumeaux sont dotés de pouvoirs
supranaturels, notamment sur la vie et sur la mort, du fait qu’en venant au
monde le combattant amène son double immortel. Dans certaines cultures
antiques, ils sont associés au caractère civilisateur comme les constructeurs
et fondateurs de ville, Romulus et Remus. Chez les Dogons, ils donnent la
parole, tels les Nommo. Le paradoxe réside dans le fait que c’est par la fracture, le fratricide, que
s’opère l’œuvre civilisatrice; il devient indispensable que l’un des jumeaux tue l’autre, ce qui marquerait la condition de la
survie de l’autre, bref qui assurerait l’identité au survivant. Les doubles ne peuvent cohabiter dans le même monde, trop
petit pour accueillir une identité et son doppelgänger.
de la croyance en une âme double, l’une mortelle, l’autre immortelle.
Comme dans William Wilson, on a
l’impression que le «bon» est tué par le «mauvais» William Wilson. Un sentiment
de culpabilité pathologique anime cette confrontation qui accuse la soumission
du pervers à ses penchants mauvais, irrécupérable par le Moi collectif. Dans
les cultures primitives, souvent les jumeaux sont dotés de pouvoirs
supranaturels, notamment sur la vie et sur la mort, du fait qu’en venant au
monde le combattant amène son double immortel. Dans certaines cultures
antiques, ils sont associés au caractère civilisateur comme les constructeurs
et fondateurs de ville, Romulus et Remus. Chez les Dogons, ils donnent la
parole, tels les Nommo. Le paradoxe réside dans le fait que c’est par la fracture, le fratricide, que
s’opère l’œuvre civilisatrice; il devient indispensable que l’un des jumeaux tue l’autre, ce qui marquerait la condition de la
survie de l’autre, bref qui assurerait l’identité au survivant. Les doubles ne peuvent cohabiter dans le même monde, trop
petit pour accueillir une identité et son doppelgänger.
Le
conflit qui surgit au sein de la gémellité est structurel et dépasse les relations conjoncturelles entre les individus. Ce conflit se nourrit de
l’angoisse de ce que le judiciaire pourrait appeler «un vol d’identité». Ou
plus exactement un substitut identitaire. Ce grand malheur des parents qui adoptent un enfant pour en remplacer un autre, mort, comme dans le cas du peintre Salvador Dali; ou qui s’obstinent à les habiller l’un à l’image de l’autre pour que ceux qui ne s’en seraient pas aperçus reconnaissent qu’il s’agit bien là de  jumeaux. Ce plaisir, non dénué de sadisme, contribue à accentuer l’angoisse de l’identité. Les circons-tances qui font que l’Autre cesse d’être l’autre
pour devenir Moi proviennent toujours de crises intérieures. Ce malaise que nous ressentons précisément lorsque nous
rencontrons notre sosie ou que quelqu’un porte le même nom que soi. Cette
«inquiétante étrangeté», où la ressemblance à la fois nous séduit et nous
inquiète, comme le montre le dernier film de Denis Villeneuve Enemy (2014), appelle la mort de l’un
des deux identiques, car deux identités ne peuvent vivre sur terre nous
l’avons dit, et voilà pourquoi Romulus finit par tuer Remus sans quoi il aurait été
lui-même tué par son frangin. C’est Loki et Thor dans la mythologie germanique.
Pourtant, cela ne semble pas être le cas de Caïn et Abel.
jumeaux. Ce plaisir, non dénué de sadisme, contribue à accentuer l’angoisse de l’identité. Les circons-tances qui font que l’Autre cesse d’être l’autre
pour devenir Moi proviennent toujours de crises intérieures. Ce malaise que nous ressentons précisément lorsque nous
rencontrons notre sosie ou que quelqu’un porte le même nom que soi. Cette
«inquiétante étrangeté», où la ressemblance à la fois nous séduit et nous
inquiète, comme le montre le dernier film de Denis Villeneuve Enemy (2014), appelle la mort de l’un
des deux identiques, car deux identités ne peuvent vivre sur terre nous
l’avons dit, et voilà pourquoi Romulus finit par tuer Remus sans quoi il aurait été
lui-même tué par son frangin. C’est Loki et Thor dans la mythologie germanique.
Pourtant, cela ne semble pas être le cas de Caïn et Abel.
Lorsque j’avais six ans environ, dans ma classe, il y avait de grands tableaux, des reproductions de peintures plutôt kitsch présentant des scènes connues de l’histoire sainte. L’un de ces tableaux, vieux et jauni, montrait Caïn relevant son gourdin et, à ses pieds, le jeune et beau Abel, le crâne fracassé, avec une tache de sang brunâtre s’étendant sous sa tête. Le décor était constitués de grands rochers, de ronces et d’arbres sombres et lugubres. Parmi les premières scènes violentes que j’ai eu à voir, ce tableau m’est vaguement resté comme un souvenir inquiétant.
Pour les civilisations issues du judéo-christianisme, le
modèle du meurtre identitaire demeure le récit de Caïn et Abel, où nulle part
il n’est dit qu’ils étaient jumeaux. La Genèse (4,1) concède un droit d’aînesse
à Caïn. Puis vient Abel. «Or Abel devint pasteur de petit bétail et Caïn
cultivait le sol». L’étymologie du nom pourrait provenir de Qayin qui signifierait
«forgeron». L’homme qui cultive la terre doit fabriquer des charrues, l’éleveur
n’a pas ce problème, aussi le récit fera-t-il de Caïn un constructeur de ville
(4,17). Délaissons l’anthropologie néolithique pour revenir au texte .jpg) mythique.
Rien n’oppose à prime abord Caïn et Abel au sein de la famille d’Adam. C’est
lorsque Caïn présente des produits du sol en offrande à Yahvé «et qu’Abel, de
son côté, [offre] des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse»
que la jalousie s’instille dans le cœur de Caïn. Rien ne dit que les offrandes de Caïn aient été de moindre qualité. «Or Yahvé agréa Abel et son offrande. Mais
il n’agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le
visage abattu». En effet, pourquoi Dieu agréa-t-il l’offrande de l’un et refusa-t-il
celle de l’autre? Dieu est-il d’avantage carnivore que végétarien? Ce n’est
donc pas sans un certain étonnement qu’on lit la suite : «Yahvé dit à
Caïn : “Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu
es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n’es pas bien disposé,
le péché n’est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite et que tu dois
dominer!”» Admettons-le, Yahvé agit ici sournoisement. Il instille
volontairement la jalousie dans le cœur de Caïn par le geste d’accepter
l’offrande d’Abel. Il cultive le ressentiment de Caïn en le tourmentant sur la
culpabilité et le péché. C’est alors qu’intervient le timshel sur lequel l’écrivain américain Steinbeck érigea son roman À l’est d’Éden.
mythique.
Rien n’oppose à prime abord Caïn et Abel au sein de la famille d’Adam. C’est
lorsque Caïn présente des produits du sol en offrande à Yahvé «et qu’Abel, de
son côté, [offre] des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse»
que la jalousie s’instille dans le cœur de Caïn. Rien ne dit que les offrandes de Caïn aient été de moindre qualité. «Or Yahvé agréa Abel et son offrande. Mais
il n’agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le
visage abattu». En effet, pourquoi Dieu agréa-t-il l’offrande de l’un et refusa-t-il
celle de l’autre? Dieu est-il d’avantage carnivore que végétarien? Ce n’est
donc pas sans un certain étonnement qu’on lit la suite : «Yahvé dit à
Caïn : “Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu
es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n’es pas bien disposé,
le péché n’est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite et que tu dois
dominer!”» Admettons-le, Yahvé agit ici sournoisement. Il instille
volontairement la jalousie dans le cœur de Caïn par le geste d’accepter
l’offrande d’Abel. Il cultive le ressentiment de Caïn en le tourmentant sur la
culpabilité et le péché. C’est alors qu’intervient le timshel sur lequel l’écrivain américain Steinbeck érigea son roman À l’est d’Éden.
On rappellera, dans le roman de Steinbeck, que Lee, le
serviteur chinois d’Adam Trask, se lance dans une 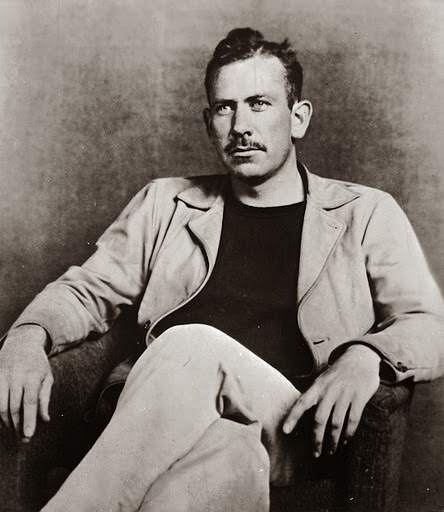 exégèse du fameux passage. «…this was the gold from our mining. “Thou
mayest”. The American Standard translation orders men to triumph over sin
(and you can call sin ignorance). The King James translation makes a promise in “Thou shalt”, meaning that men will
surely triumph over sin. But the Hebrew word timshel – “Thou mayest” – that gives a choice. For if “Thou mayest” – it is
also true that “Thou mayest not”. That makes a man great and that gives him
stature with the gods, for in his weakness and his filth and his murder of his
brother he has still the great choice. He can choose his course and fight it
through and win». L’interprétation timshel
renvoie donc au choix de commettre ou non le mal, ce qui est une lecture
augustinienne de la liberté telle qu’exprimée dans les œuvres de l’évêque
d’Hippone. Dans le conte de Poe William
Wilson, le personnage éponyme était soumis déjà à cette torture morale. Le
mauvais Wilson pouvait toujours supporter la présence de son double accusateur
et délateur. Thou mayest se
disait-il, repoussant son envie de vengeance. Ensuite, il s’encourageait du Thou shalt, essayant de réprimer ses
mœurs
exégèse du fameux passage. «…this was the gold from our mining. “Thou
mayest”. The American Standard translation orders men to triumph over sin
(and you can call sin ignorance). The King James translation makes a promise in “Thou shalt”, meaning that men will
surely triumph over sin. But the Hebrew word timshel – “Thou mayest” – that gives a choice. For if “Thou mayest” – it is
also true that “Thou mayest not”. That makes a man great and that gives him
stature with the gods, for in his weakness and his filth and his murder of his
brother he has still the great choice. He can choose his course and fight it
through and win». L’interprétation timshel
renvoie donc au choix de commettre ou non le mal, ce qui est une lecture
augustinienne de la liberté telle qu’exprimée dans les œuvres de l’évêque
d’Hippone. Dans le conte de Poe William
Wilson, le personnage éponyme était soumis déjà à cette torture morale. Le
mauvais Wilson pouvait toujours supporter la présence de son double accusateur
et délateur. Thou mayest se
disait-il, repoussant son envie de vengeance. Ensuite, il s’encourageait du Thou shalt, essayant de réprimer ses
mœurs  dépravées, trop fortes pour lui. Enfin, lorsque se présenta le Thou mayest not, il décida de tuer le
bon Wilson qui en mourant, lui disait «Tu
as vaincu, et je succombe. Mais dorénavant, tu es mort aussi, mort au Monde, au
Ciel et à l’espérance. En moi tu existais, et vois dans ma mort, vois par cette
image qui est la tienne, comme tu t’es radicalement assassiné toi-même». On
ne peut exprimer plus clairement l’impasse dans laquelle se trouve le doppelgänger. Il ne peut vivre avec son
double. Il ne peut survivre sans son double. Ce qui apparaît au départ comme
une alternative – tu peux comme tu peux ne pas – finit par devenir un aporie
fermé sur lui-même. Avec ou sans, le double identitaire te projette dans une
schizophrénie insoluble.
dépravées, trop fortes pour lui. Enfin, lorsque se présenta le Thou mayest not, il décida de tuer le
bon Wilson qui en mourant, lui disait «Tu
as vaincu, et je succombe. Mais dorénavant, tu es mort aussi, mort au Monde, au
Ciel et à l’espérance. En moi tu existais, et vois dans ma mort, vois par cette
image qui est la tienne, comme tu t’es radicalement assassiné toi-même». On
ne peut exprimer plus clairement l’impasse dans laquelle se trouve le doppelgänger. Il ne peut vivre avec son
double. Il ne peut survivre sans son double. Ce qui apparaît au départ comme
une alternative – tu peux comme tu peux ne pas – finit par devenir un aporie
fermé sur lui-même. Avec ou sans, le double identitaire te projette dans une
schizophrénie insoluble.
Dans le cas de Caïn, on le sait, la vengeance déploie sa
duplicité : «Caïn dit à son frère Abel : “Allons  dehors”, et, comme
ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua».
Débarrassé d’un frère gênant, comme dans le conte de Poe, Caïn n’est pas libre
pour autant, même si vengé. «Yahvé dit à Caïn : “Où est ton frère Abel?”
Il répondit : “Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère?”» Si Caïn
pouvait ruser avec Abel, il ne le peut avec Yahvé qui sait. Et Caïn sait que
Yahvé sait. Qu’à cela ne tienne. Il relance, effrontément, suis-je le gardien de mon frère? C’est là la pierre d’achoppement
entre le thou mayest et le thou mayest not. Si Yahvé n’avait pas de
raison d’accepter les offrandes de Caïn, maintenant il s’en est trouvé une et c’est pour avoir su ce dénouement qu’il refusait les offrandes impures de l’aîné. La
réponse de Caïn rejaillit sur tout le verset 4 de la Genèse.
dehors”, et, comme
ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua».
Débarrassé d’un frère gênant, comme dans le conte de Poe, Caïn n’est pas libre
pour autant, même si vengé. «Yahvé dit à Caïn : “Où est ton frère Abel?”
Il répondit : “Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère?”» Si Caïn
pouvait ruser avec Abel, il ne le peut avec Yahvé qui sait. Et Caïn sait que
Yahvé sait. Qu’à cela ne tienne. Il relance, effrontément, suis-je le gardien de mon frère? C’est là la pierre d’achoppement
entre le thou mayest et le thou mayest not. Si Yahvé n’avait pas de
raison d’accepter les offrandes de Caïn, maintenant il s’en est trouvé une et c’est pour avoir su ce dénouement qu’il refusait les offrandes impures de l’aîné. La
réponse de Caïn rejaillit sur tout le verset 4 de la Genèse.
«Yahvé reprit : “Qu’as-tu fait? Écoute le sang de ton
frère crier vers moi du sol! Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile
qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu
cultives le sol,  il ne te donnera plus son produit : tu seras un errant
parcourant la terre”. Alors Caïn dit à Yahvé : “Ma peine est trop lourde à
porter. Vois! Tu me bannis aujourd’hui du sol fertile, je devrai me cacher loin
de ta face et je serai un errant parcourant la terre : mais, le premier
venu me tuera!”» Mieux que son père
Adam, qui essayait de refiler la culpabilité sur la responsabilité de sa femme,
Ève, qui, elle, accusait le serpent tentateur, Caïn accepte immédiatement sa
faute. Avec lui naît le sentiment de culpabilité essentiel à toute
socialisation (je suis le gardien de mon frère). Comme l’écrit André-Marie
Gérard, dans son Dictionnaire de la
Bible (Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, p. 175) : «Mais Yahvé ne veut pas
que le juste châtiment du coupable l’accule au désespoir et le livre à
l’aveugle vengeance humaine. Qui tuerait Caïn subirait lui-même la vengeance
divine : “sept fois”, c’est-à-dire la plus complète qui puisse être;
et pour que nul n’en ignore, Yahvé marque Caïn d’un “signe” avant qu’il ne
il ne te donnera plus son produit : tu seras un errant
parcourant la terre”. Alors Caïn dit à Yahvé : “Ma peine est trop lourde à
porter. Vois! Tu me bannis aujourd’hui du sol fertile, je devrai me cacher loin
de ta face et je serai un errant parcourant la terre : mais, le premier
venu me tuera!”» Mieux que son père
Adam, qui essayait de refiler la culpabilité sur la responsabilité de sa femme,
Ève, qui, elle, accusait le serpent tentateur, Caïn accepte immédiatement sa
faute. Avec lui naît le sentiment de culpabilité essentiel à toute
socialisation (je suis le gardien de mon frère). Comme l’écrit André-Marie
Gérard, dans son Dictionnaire de la
Bible (Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, p. 175) : «Mais Yahvé ne veut pas
que le juste châtiment du coupable l’accule au désespoir et le livre à
l’aveugle vengeance humaine. Qui tuerait Caïn subirait lui-même la vengeance
divine : “sept fois”, c’est-à-dire la plus complète qui puisse être;
et pour que nul n’en ignore, Yahvé marque Caïn d’un “signe” avant qu’il ne
 Cs’éloigne vers le pays de Nod, celui des “nomades” si l’on s’en réfère à la
racine dont le mot est tiré. […] Rien non plus qu’il appréhende de rencontrer
des exécuteurs sur les chemins de son exil. Quant au “signe” dont le marque
Yahvé, il pourrait être, sans dommage pour l’exégèse du passage, une noble
interprétation du signe tribal des Quénites, cicatrice ou tatouage; et
pourquoi pas d’ailleurs un symbole yahviste» (ibid. p. 176). C’est retiré à l’est d’Éden que Caïn pourra poursuivre sa misérable existence d’errant.
Une forte marque de régression suit le crime et la condamnation. L’homme qui
cultivait un sol riche et généreux se retrouve nomade, prédateur, errant,
damné. Comme le couple Adam et Ève rejeté du Paradis, la nouvelle condamnation
pousse d’un cran plus loin le processus de régression collective.
Cs’éloigne vers le pays de Nod, celui des “nomades” si l’on s’en réfère à la
racine dont le mot est tiré. […] Rien non plus qu’il appréhende de rencontrer
des exécuteurs sur les chemins de son exil. Quant au “signe” dont le marque
Yahvé, il pourrait être, sans dommage pour l’exégèse du passage, une noble
interprétation du signe tribal des Quénites, cicatrice ou tatouage; et
pourquoi pas d’ailleurs un symbole yahviste» (ibid. p. 176). C’est retiré à l’est d’Éden que Caïn pourra poursuivre sa misérable existence d’errant.
Une forte marque de régression suit le crime et la condamnation. L’homme qui
cultivait un sol riche et généreux se retrouve nomade, prédateur, errant,
damné. Comme le couple Adam et Ève rejeté du Paradis, la nouvelle condamnation
pousse d’un cran plus loin le processus de régression collective.
C’est toujours dans cet esprit du châtiment de Caïn que se
poursuit l’histoire du monde. Le Déluge devient une punition divine contre
l’humanité toute entière, à l’exception du patriarche Noé et de ses fils dont
on se demande comment il a pu les épargner considérant ce qui allait se passer
par la suite. Puis la terre se _-_Google_Art_Project.jpg) repeuple et les hommes étant ce qu’ils sont, le
péché de Caïn les poursuit : «L'œil était dans la tombe et regardait Caïn» (V. Hugo). C’est alors qu’on se heurte à la célèbre Tour de
Babel. Le texte indique l’art du forgeron et du bâtisseur de ville qu’était
celui de Caïn. Faut-il croire que Caïn a transmis cet art à sa descendance? «Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes
mots. Comme les hommes se déplaçaient à l’orient [toujours à l’orient d’Éden],
ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s’y établirent. Ils se
dirent l’un à l’autre : “Allons! Faisons des briques et cuisons-les au
feu!” La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils
dirent : “Allons! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet
pénètre les cieux! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la
terre!” (G 11, 1-3). Il paraît inutile d’insister sur l’identité de Babel avec
Babylone et la tour avec la fameuse ziggourat. L’unité de la langue fait ici
ciment entre les individus, les bâtisseurs de la tour. Ce «front linguistique»
prétend s’ériger pour confronter Dieu, la Tour de Babel étant,
étymologiquement, la Porte du Ciel. Cette fois-ci, c’est Yahvé qui semble
angoissé de se retrouver face à un doppelgänger :
«Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient
bâties. Et Yahvé
repeuple et les hommes étant ce qu’ils sont, le
péché de Caïn les poursuit : «L'œil était dans la tombe et regardait Caïn» (V. Hugo). C’est alors qu’on se heurte à la célèbre Tour de
Babel. Le texte indique l’art du forgeron et du bâtisseur de ville qu’était
celui de Caïn. Faut-il croire que Caïn a transmis cet art à sa descendance? «Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes
mots. Comme les hommes se déplaçaient à l’orient [toujours à l’orient d’Éden],
ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s’y établirent. Ils se
dirent l’un à l’autre : “Allons! Faisons des briques et cuisons-les au
feu!” La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils
dirent : “Allons! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet
pénètre les cieux! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la
terre!” (G 11, 1-3). Il paraît inutile d’insister sur l’identité de Babel avec
Babylone et la tour avec la fameuse ziggourat. L’unité de la langue fait ici
ciment entre les individus, les bâtisseurs de la tour. Ce «front linguistique»
prétend s’ériger pour confronter Dieu, la Tour de Babel étant,
étymologiquement, la Porte du Ciel. Cette fois-ci, c’est Yahvé qui semble
angoissé de se retrouver face à un doppelgänger :
«Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient
bâties. Et Yahvé  dit : “Voici que tous font un seul peuple et parlent une
seule langue, et tel est le début de leurs entreprises! Maintenant, aucun
dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons! Descendons! Et là,
confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres”.
Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de
bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c’est là que Yahvé confondit le
langage de tous les habitants de la terre et c’est de là qu’il les dispersa sur
toute la face de la terre». En brouillant le langage et en le fractionnant en
langues incompréhensibles, l’unité du genre humain se voyait brisé et le doppelgänger de Dieu définitivement
vaincu. Comme l’écrit René Caillois, le
monument de l’orgueil était devenu
celui de la confusion. Pour les chrétiens, cette unité ne sera restaurée
que par la Pentecôte après la résurrection du Christ où les langues de feu
permettront aux apôtres de prêcher parmi tous les peuples de toutes les langues
de la terre pour recréer l’œkoumène originale prête à recevoir le message chrétien.
dit : “Voici que tous font un seul peuple et parlent une
seule langue, et tel est le début de leurs entreprises! Maintenant, aucun
dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons! Descendons! Et là,
confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres”.
Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de
bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c’est là que Yahvé confondit le
langage de tous les habitants de la terre et c’est de là qu’il les dispersa sur
toute la face de la terre». En brouillant le langage et en le fractionnant en
langues incompréhensibles, l’unité du genre humain se voyait brisé et le doppelgänger de Dieu définitivement
vaincu. Comme l’écrit René Caillois, le
monument de l’orgueil était devenu
celui de la confusion. Pour les chrétiens, cette unité ne sera restaurée
que par la Pentecôte après la résurrection du Christ où les langues de feu
permettront aux apôtres de prêcher parmi tous les peuples de toutes les langues
de la terre pour recréer l’œkoumène originale prête à recevoir le message chrétien.
D’autres mythologies bibliques appliquent à Nemrod, le
«premier puissant de la terre», cette entreprise démentielle d’ériger une tour qui
s’élève jusqu’aux cieux. Cette association suffit à le précipiter dans l’Inferno  de Dante. Nemrod, que Dante
installe parmi les géants, était reconnu pour être un fier chasseur, un
peu à l’image des bas-reliefs que nous avons du roi Assurbanipal. Mais en
l’associant anachroniquement avec la Tour de Babel, le voilà devenu chasseur de
Dieu. Chasseur d’hommes aussi, une fois la confusion établie. Avec Nemrod naît
surtout la chasse au doppelgänger. Voilà
pourquoi il devient le premier «chef de l’État». Jaloux, comme Yahvé.
Bâtisseur, comme Caïn. Doté de la machine totalitaire qu’est l’État despotique
oriental, Nemrod va multiplier les meurtres tant sur une courbe géométrique que
sur une courbe arithmétique. En s’appropriant à lui seul le droit de laisser
vivre ou de faire mourir, il prend sur ses épaules les désirs de meurtres de
tous ses membres. Avec Nemrod commence l’ère des massacres, des génocides, des
guerres. Le bond quantitatif est aussi un bon qualitatif qui font paraître les
meurtriers cités par Dante comme auteurs de crimes relativement insignifiants.
de Dante. Nemrod, que Dante
installe parmi les géants, était reconnu pour être un fier chasseur, un
peu à l’image des bas-reliefs que nous avons du roi Assurbanipal. Mais en
l’associant anachroniquement avec la Tour de Babel, le voilà devenu chasseur de
Dieu. Chasseur d’hommes aussi, une fois la confusion établie. Avec Nemrod naît
surtout la chasse au doppelgänger. Voilà
pourquoi il devient le premier «chef de l’État». Jaloux, comme Yahvé.
Bâtisseur, comme Caïn. Doté de la machine totalitaire qu’est l’État despotique
oriental, Nemrod va multiplier les meurtres tant sur une courbe géométrique que
sur une courbe arithmétique. En s’appropriant à lui seul le droit de laisser
vivre ou de faire mourir, il prend sur ses épaules les désirs de meurtres de
tous ses membres. Avec Nemrod commence l’ère des massacres, des génocides, des
guerres. Le bond quantitatif est aussi un bon qualitatif qui font paraître les
meurtriers cités par Dante comme auteurs de crimes relativement insignifiants.
 Focaccia Cancellieri, noble de Pistoia, qui coupa la main
d’un de ses cousins et en assassina ensuite le père; Sassolo Maschéroni,
Florentin qui tua un de ses oncles; Alberto Camiccione de’ Pazzi de Valdarno,
qui tua par trahison Ubertino, un parent… Rien de plus que des mafieux qui
règlent des comptes de famille. Aujourd’hui, tout cela relèverait du pur fait
divers. Mais dans le contexte où les rivalités mafieuses interpellaient tous
les citoyens, ces crimes étaient assez odieux pour mériter une mention dans les
enfers. Pour autant que le circuit de Caïn nous y conduit, cherchons ailleurs
la chasse ouverte par Nemrod aux doppelgängers.
Focaccia Cancellieri, noble de Pistoia, qui coupa la main
d’un de ses cousins et en assassina ensuite le père; Sassolo Maschéroni,
Florentin qui tua un de ses oncles; Alberto Camiccione de’ Pazzi de Valdarno,
qui tua par trahison Ubertino, un parent… Rien de plus que des mafieux qui
règlent des comptes de famille. Aujourd’hui, tout cela relèverait du pur fait
divers. Mais dans le contexte où les rivalités mafieuses interpellaient tous
les citoyens, ces crimes étaient assez odieux pour mériter une mention dans les
enfers. Pour autant que le circuit de Caïn nous y conduit, cherchons ailleurs
la chasse ouverte par Nemrod aux doppelgängers.
La rivalité jalouse ne contredit pas le conflit des
identités. On pourrait dire que la première est conséquence «naturelle» du
second. Ici, je marquerai une nette différence entre l’envie et la jalousie,
même si on les tient trop souvent pour synonyme. L’envie marque un désir
d’objet. L’envieux veut ce que l’autre possède, en particulier des biens
détachés de sa personne : des richesses, des terres, des positions
sociales, etc. Le  jaloux est un désir subjectif. Le jaloux veut être ce que
quelqu’un d’autre est. C’est un envie ontolo-gique. Être comme. Être pareil à.
Bref, être identique à un Autre, un modèle, un substitut, etc. On le trouve
dans le désir mimétique en établissant des rivalités entre amoureux pour un
même objet. Mais la jalousie monte plus haut; elle va jusqu’au désir
d’anéantissement de l’Autre pour être certain que le Moi sera sans duplication.
Le fratricide passe alors de l’existentiel à l’essentiel. Le fratricide
existentiel, mû aussi bien par l’envie que par la compétition, se retrouve dans
les cas d’Absalom et de d’Amnon ou encore dans la loi du fratricide ottoman. Par contre, la rivalité d’Étéocle et
Polynice et celle de Romulus et de Remus, appartiennent à la jalousie essentielle. Avec le cas psychopathologique de Pierre Rivière, le fratricide atteint un niveau difficilement explicable à l'esprit humain. Comme si nous atteignions enfin le fond du puits dantesque.
jaloux est un désir subjectif. Le jaloux veut être ce que
quelqu’un d’autre est. C’est un envie ontolo-gique. Être comme. Être pareil à.
Bref, être identique à un Autre, un modèle, un substitut, etc. On le trouve
dans le désir mimétique en établissant des rivalités entre amoureux pour un
même objet. Mais la jalousie monte plus haut; elle va jusqu’au désir
d’anéantissement de l’Autre pour être certain que le Moi sera sans duplication.
Le fratricide passe alors de l’existentiel à l’essentiel. Le fratricide
existentiel, mû aussi bien par l’envie que par la compétition, se retrouve dans
les cas d’Absalom et de d’Amnon ou encore dans la loi du fratricide ottoman. Par contre, la rivalité d’Étéocle et
Polynice et celle de Romulus et de Remus, appartiennent à la jalousie essentielle. Avec le cas psychopathologique de Pierre Rivière, le fratricide atteint un niveau difficilement explicable à l'esprit humain. Comme si nous atteignions enfin le fond du puits dantesque.
La Bible offre un autre cas célèbre de fratricide. Celui
des fils de David, Absalom et Amnon. Ce cas est envieux dans la mesure où il
place la rivalité des deux frères autour de l’inceste sororal. Amnon, le fils
aîné que David a eu d’Ahinoham, convoite Tamar, sa demi-sœur qui, comme Absalom
son frère, sont nés de Maaka. Comme il se meure d’amour pour elle et ne
sait comment la séduire, son perfide conseiller, Yonadab, lui suggère une ruse.
Amnon fait semblant d’être très malade et demande que sa sœur vienne sous sa
tente lui préparer des beignets. Lorsqu’elle les lui apport à son alcôve, Amnon
s’empare d’elle «“Viens, couche avec moi, ma sœur!” Mais elle lui
répondit : “Non, mon frère! Ne me violente pas, car on n’agit pas ainsi en
Israël, ne commets pas cette infamie. Moi, où irais-je porter ma honte? Et toi,
tu serais comme un infâme en Israël! Maintenant parle donc au roi : il ne
refusera pas de me donner à toi”. Mais il ne voulut pas l’entendre, il la
maîtrisa et, lui faisant violence, il coucha avec elle». En effet, Tamar n’est
que la demi-sœur d’Amnon et David pourrait bien «réinterpréter» la loi en la
faveur de son fils bien-aimé. Aussi, ce n’est pas le désir amoureux qui motive
ici Amnon, mais celui de la force, de la puissance de défier la loi et se
passer des consentements de Tamar aussi bien que de David. Ce qui arrive par la
suite est conforme à ce qu’avait annoncé Tamar.
Lorsqu’elle les lui apport à son alcôve, Amnon
s’empare d’elle «“Viens, couche avec moi, ma sœur!” Mais elle lui
répondit : “Non, mon frère! Ne me violente pas, car on n’agit pas ainsi en
Israël, ne commets pas cette infamie. Moi, où irais-je porter ma honte? Et toi,
tu serais comme un infâme en Israël! Maintenant parle donc au roi : il ne
refusera pas de me donner à toi”. Mais il ne voulut pas l’entendre, il la
maîtrisa et, lui faisant violence, il coucha avec elle». En effet, Tamar n’est
que la demi-sœur d’Amnon et David pourrait bien «réinterpréter» la loi en la
faveur de son fils bien-aimé. Aussi, ce n’est pas le désir amoureux qui motive
ici Amnon, mais celui de la force, de la puissance de défier la loi et se
passer des consentements de Tamar aussi bien que de David. Ce qui arrive par la
suite est conforme à ce qu’avait annoncé Tamar.
«Alors Amnon se prit à la haïr très fort – la haine qu’il
lui voua surpassait l’amour dont il l’avait aimée – et Amnon lui dit :
“Lève-toi ! Va-t’en !” Elle lui dit : “Non, mon frère, me
chasser serait pire que l’autre mal que  tu m’as fait”. Mais il ne voulut pas
l’écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit : “Débar-
tu m’as fait”. Mais il ne voulut pas
l’écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit : “Débar-
rasse moi de cette fille, jette-la dehors et verrouille la porte derrière elle!” […] Tamar, prenant de la poussière, la jeta sur sa tête, elle déchira la tunique à longue manches qu’elle portait, mit la main sur sa tête et s’en alla, poussant des cris en marchant. Son frère Absalom lui dit : “Serait-ce que ton frère Amnon a été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi ; c’est ton frère, ne prends pas cette affaire à cœur”. Tamar demeura abandonnée, dans la maison de son frère Absalom. Lorsque le roi David apprit toute cette histoire, il en fut très irrité, mais il ne voulut pas faire de peine à son fils Amnon, qu’il aimait parce que c’était son premier-né. Quant à Absalom, il n’adressa pas la parole à Amnon, car Absalom s’était pris de haine pour Amnon à cause de la violence qu’il avait faite à sa sœur Tamar». La haine de Absalom pour Amnon ne relève donc pas du doppelgänger mais de l’humiliation des enfants nés du sein de Maaka par celui né du sein d’Ahinoham. D’autre part, l’attitude du roi David apparaît comme une réaction de faiblesse. On n’imagine pas un patricien romain réagir ainsi. Elle n’est pas étrangère à la vindicte qu’Absalom prendra plus tard contre son père, le portant jusqu’à le défier par une révolte ouverte.
 Mais, pour le moment, Absalom en est à ruminer sa vengeance
contre Amnon. Deux ans plus tard, «Absalom prépare un festin de roi, et il
donna cet ordre à ses serviteurs : “Faites attention! Lorsque le cœur d’Amnon sera mis en gaîté par le vin et que je vous dirai : ‘Frappez
Amnon!’ vous le mettrez à mort. N’ayez pas peur : n’est-ce pas moi qui
vous l’ai ordonné? Prenez courage et montrez-vous vaillants». Les
serviteurs agirent tel que commandé et firent justice du péché d’Amnon.
Apprenant le fratricide, le roi David leva son armée contre Absalom qui s’enfuit à l’étranger où il résida pendant trois ans, attendant que la peine et
la colère du roi soient enfin apaisées pour revenir. Le fratricide d’Absalom
apparaît donc moins
Mais, pour le moment, Absalom en est à ruminer sa vengeance
contre Amnon. Deux ans plus tard, «Absalom prépare un festin de roi, et il
donna cet ordre à ses serviteurs : “Faites attention! Lorsque le cœur d’Amnon sera mis en gaîté par le vin et que je vous dirai : ‘Frappez
Amnon!’ vous le mettrez à mort. N’ayez pas peur : n’est-ce pas moi qui
vous l’ai ordonné? Prenez courage et montrez-vous vaillants». Les
serviteurs agirent tel que commandé et firent justice du péché d’Amnon.
Apprenant le fratricide, le roi David leva son armée contre Absalom qui s’enfuit à l’étranger où il résida pendant trois ans, attendant que la peine et
la colère du roi soient enfin apaisées pour revenir. Le fratricide d’Absalom
apparaît donc moins  motivé par l’envie que par les ressentiments aussi bien envers
son frère qu’envers son père. Ce drame familial a inspiré la littérature occidentale, en particulier le roman de William Faulkner, Absalom Absalom! (1936), qui ramène le drame dans le sud des
États-Unis après la guerre de Sécession.
motivé par l’envie que par les ressentiments aussi bien envers
son frère qu’envers son père. Ce drame familial a inspiré la littérature occidentale, en particulier le roman de William Faulkner, Absalom Absalom! (1936), qui ramène le drame dans le sud des
États-Unis après la guerre de Sécession.
Étéocle, Polynice, Ismène et Antigone sont les enfants du
mariage incestueux entre Œdipe et sa mère Jocaste. Dans la mythologie grecque,
après le suicide de cette dernière et l’exil d’Œdipe, Robert Graves raconte que
«Polynice et son frère jumeau Étéocle avaient été élus conjointement rois de
Thèbes […]. Ils se mirent d’accord pour régner alternativement pendant une
année, mais Étéocle, à qui il échut de régner le premier, ne voulut pas
abandonner son trône, au terme de l’année, et, invoquant les mauvaises
intentions de Polynice, il le bannit de la ville» (R. Graves. Les mythes grecs,
t. 2, Paris, Fayard, (rééd. Pluriel, # 8400, 1967, §106, p. 13). Polynice se
rend alors à Colone pour obtenir la bénédiction d’Œdipe dans son projet de
lever une armée contre Étéocle. Contrairement à David, Œdipe maudit son
fils : «Va, maudit, chassé et renié par ton père, le plus scélérat des
hommes, emporte avec toi ces imprécations que je fais contre toi, afin que tu
ne t’empares point de la terre, que tu ne retournes jamais dans le creux Argos,
mais que tu tombes sous la main fraternelle et que tu égorges celui par qui tu
as été chassé!» Bien étrange malédiction que Sophocle prête à la bouche du
vieil aveugle! C’est l’épisode tragique des Sept
contre Thèbes. Au bout de cette guerre féroce et sans issue, Polynice «pour
faire cesser l’effusion de sang, proposa que la succession au trône soit
décidée en un combat singulier avec Étéocle. Étéocle accepta le défi, et, au
cours d’un combat acharné, chacun blessa l’autre» à
pendant une
année, mais Étéocle, à qui il échut de régner le premier, ne voulut pas
abandonner son trône, au terme de l’année, et, invoquant les mauvaises
intentions de Polynice, il le bannit de la ville» (R. Graves. Les mythes grecs,
t. 2, Paris, Fayard, (rééd. Pluriel, # 8400, 1967, §106, p. 13). Polynice se
rend alors à Colone pour obtenir la bénédiction d’Œdipe dans son projet de
lever une armée contre Étéocle. Contrairement à David, Œdipe maudit son
fils : «Va, maudit, chassé et renié par ton père, le plus scélérat des
hommes, emporte avec toi ces imprécations que je fais contre toi, afin que tu
ne t’empares point de la terre, que tu ne retournes jamais dans le creux Argos,
mais que tu tombes sous la main fraternelle et que tu égorges celui par qui tu
as été chassé!» Bien étrange malédiction que Sophocle prête à la bouche du
vieil aveugle! C’est l’épisode tragique des Sept
contre Thèbes. Au bout de cette guerre féroce et sans issue, Polynice «pour
faire cesser l’effusion de sang, proposa que la succession au trône soit
décidée en un combat singulier avec Étéocle. Étéocle accepta le défi, et, au
cours d’un combat acharné, chacun blessa l’autre» à  mort et Créon, leur oncle,
prit alors le commandement de l’armée thébaine, poussant à la déroute les
armées ennemies (R. Graves. Ibid. p.
16). Créon acceptera de rendre les hommages de la pompe royale à Étéocle, mais
le rebelle, Polynice restera sans sépulture, l’accusant de trahison et d’avoir
attaqué Thèbes. On sait le parti que tirèrent Eschyle et Sophocle de ce drame à
la fois familial et politique. Si on en reste au point de vue strictement
moral, la faute de la tragédie relève d’Étéocle qui n’a pas respecté l’entente
de l’alternance des frères-rois. Par contre, du point de vue politique, Étéocle
incarne lesens de l’unité de la Cité et
par le fait même il a été le plus fort et Polynice n’avait qu’à s’abstenir de
s’opposer à son frère. Pire, il outragea la Cité en passant des alliances avec
les ennemis de Thèbes et mêler la guerre civile à la guerre entre cités. En
opposant Étéocle et Polynice dans un combat ultime avec la mort des deux
frères, la tragédie poursuit la malédiction rattachée à Œdipe et à sa
progéniture.
mort et Créon, leur oncle,
prit alors le commandement de l’armée thébaine, poussant à la déroute les
armées ennemies (R. Graves. Ibid. p.
16). Créon acceptera de rendre les hommages de la pompe royale à Étéocle, mais
le rebelle, Polynice restera sans sépulture, l’accusant de trahison et d’avoir
attaqué Thèbes. On sait le parti que tirèrent Eschyle et Sophocle de ce drame à
la fois familial et politique. Si on en reste au point de vue strictement
moral, la faute de la tragédie relève d’Étéocle qui n’a pas respecté l’entente
de l’alternance des frères-rois. Par contre, du point de vue politique, Étéocle
incarne lesens de l’unité de la Cité et
par le fait même il a été le plus fort et Polynice n’avait qu’à s’abstenir de
s’opposer à son frère. Pire, il outragea la Cité en passant des alliances avec
les ennemis de Thèbes et mêler la guerre civile à la guerre entre cités. En
opposant Étéocle et Polynice dans un combat ultime avec la mort des deux
frères, la tragédie poursuit la malédiction rattachée à Œdipe et à sa
progéniture.
 Il ne faut pas écarter le fait que la succession par
alternance créait une situation ambiguë entre Étéocle et Polynice qui n’était
pas celle d’Amnon et d’Absalom. En plus d’être jumeaux, Étéocle et Polynice, se
succédant tour à tour, apparaissaient aux yeux des thébains comme deux
identiques. C’est-à-dire qu’ils se valaient l’un l’autre et créaient ainsi une
situation de Doppelgänger, Polynice
repoussé comme méchant double alors qu’Étéocle s’était mis en état d’être la
figure royale, donc positive. La mort des deux jumeaux sur le champ de bataille
dans un duel anticipe la conclusion que Poe donnera à William Wilson. Les deux
frères ne pouvaient exister ensemble, ils ne peuvent toutefois pas vivre l’un
sans l’autre.
Il ne faut pas écarter le fait que la succession par
alternance créait une situation ambiguë entre Étéocle et Polynice qui n’était
pas celle d’Amnon et d’Absalom. En plus d’être jumeaux, Étéocle et Polynice, se
succédant tour à tour, apparaissaient aux yeux des thébains comme deux
identiques. C’est-à-dire qu’ils se valaient l’un l’autre et créaient ainsi une
situation de Doppelgänger, Polynice
repoussé comme méchant double alors qu’Étéocle s’était mis en état d’être la
figure royale, donc positive. La mort des deux jumeaux sur le champ de bataille
dans un duel anticipe la conclusion que Poe donnera à William Wilson. Les deux
frères ne pouvaient exister ensemble, ils ne peuvent toutefois pas vivre l’un
sans l’autre.
.JPG) Ce qui vaut pour Étéocle et Polynice le vaut encore plus
pour Romulus et Remus, les jumeaux fondateurs de l’Urbs, la ville de Rome. Du
moins, c’est ce qu’en dit l’historien Tite-Live. Tout dans les récits de la
fondation de Rome ramène au duel génellaire. Romulus et Remus sont les fils
jumeau de la vestale Rhéa Silvia et du dieu Mars. Leur oncle, roi d’Albe qui a
dépossédé son frère Ascagne fils d’Énée noble troyen ayant fui l’invasion
grecque, Amulius, s’entend pour se débarrasser de ses petits-neveux, de peur
qu’en grandissant, ils réclament leur part d’héritage étant fils d’une vestale
qui avait fait vœu de chasteté. Il ordonne qu’on les jette dans le Tibre. Comme
Moïse, les enfants sont abandonnés dans un panier sur le fleuve. Ils dérivent,
protégés par Mars, jusqu’au mont Palatin. «C’est bien, en effet, à cette
véritable “colline inspirée” du site romain et de la légende des origines de la
Ville qu’est liée, de manière indissociable, la geste de Romulus : c’est
au pied du Palatin que vient échouer le berceau où avaient été mis les deux
jumeaux sur ordre de leur grand-oncle, l’usurpateur Amulius, qui voulait les
faire périr dans les eaux du Tibre;
Ce qui vaut pour Étéocle et Polynice le vaut encore plus
pour Romulus et Remus, les jumeaux fondateurs de l’Urbs, la ville de Rome. Du
moins, c’est ce qu’en dit l’historien Tite-Live. Tout dans les récits de la
fondation de Rome ramène au duel génellaire. Romulus et Remus sont les fils
jumeau de la vestale Rhéa Silvia et du dieu Mars. Leur oncle, roi d’Albe qui a
dépossédé son frère Ascagne fils d’Énée noble troyen ayant fui l’invasion
grecque, Amulius, s’entend pour se débarrasser de ses petits-neveux, de peur
qu’en grandissant, ils réclament leur part d’héritage étant fils d’une vestale
qui avait fait vœu de chasteté. Il ordonne qu’on les jette dans le Tibre. Comme
Moïse, les enfants sont abandonnés dans un panier sur le fleuve. Ils dérivent,
protégés par Mars, jusqu’au mont Palatin. «C’est bien, en effet, à cette
véritable “colline inspirée” du site romain et de la légende des origines de la
Ville qu’est liée, de manière indissociable, la geste de Romulus : c’est
au pied du Palatin que vient échouer le berceau où avaient été mis les deux
jumeaux sur ordre de leur grand-oncle, l’usurpateur Amulius, qui voulait les
faire périr dans les eaux du Tibre;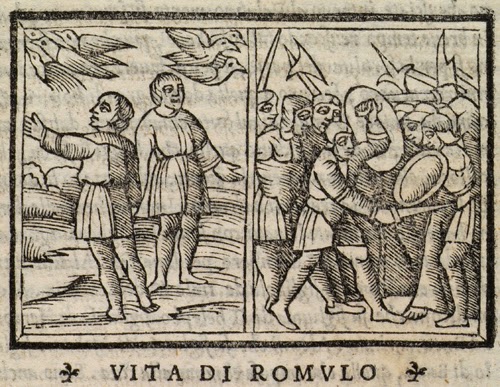 c’est encore au Palatin qu’en pleine
époque classique, on pouvait voir une cabane pieusement et réguliè-rement
entretenue et où avaient vécu, disait-on, Romulus et Remus, au milieu des
bergers qui les avaient sauvés et recueillis; c’est sur le Palatin, alors
que son frère Remus choisit l’Aventin, que Romulus se place pour observer le
vol des oiseaux favorables (des vautours !), dont l’apparition
signifierait l’approbation des dieux à son projet de fondation, et c’est donc
sur la colline survolée par douze vautours que la légende nous le montre,
fondant une cité à laquelle il donnera le nom de Rome. Rome serait ainsi née
sur le Palatin et, s’il faut en croire la légende, c’est là qu’on doit chercher
les signes archéologiques de l’avènement de la cité» (A. Grandazzi. La fondation de Rome, Paris, Les Belles
Lettres, Col. Pluriel, # 8820, 1991, p. 248).
c’est encore au Palatin qu’en pleine
époque classique, on pouvait voir une cabane pieusement et réguliè-rement
entretenue et où avaient vécu, disait-on, Romulus et Remus, au milieu des
bergers qui les avaient sauvés et recueillis; c’est sur le Palatin, alors
que son frère Remus choisit l’Aventin, que Romulus se place pour observer le
vol des oiseaux favorables (des vautours !), dont l’apparition
signifierait l’approbation des dieux à son projet de fondation, et c’est donc
sur la colline survolée par douze vautours que la légende nous le montre,
fondant une cité à laquelle il donnera le nom de Rome. Rome serait ainsi née
sur le Palatin et, s’il faut en croire la légende, c’est là qu’on doit chercher
les signes archéologiques de l’avènement de la cité» (A. Grandazzi. La fondation de Rome, Paris, Les Belles
Lettres, Col. Pluriel, # 8820, 1991, p. 248).
 Vite oublié l’épisode de la louve qui allaita les deux
jumeaux arrivés sains et saufs au Palatin. En fait, cet épisode dit plus sur
l’ambiguïté gémellaire du doppelgänger que
l’on y voit à première vue. Michel Serres le rappelle dès l’ouverture de son
essai sur Rome Le livre des
fondations : «Romulus et Remus, jumeaux albains abandonnés, tètent le
sein sec de la louve, je dis sein sec puisque en latin la louve indique la
putain, une putain de lupanar. Faux fils de putain, vrais fils de vestale et de
Mars, légendaires, fils de violence et de viol, fils du dieu de la guerre et
d’une prêtresse chaste et sauvage, Romulus et Remus sont petits-fils aussi de
frères ennemis. Le meurtre entre les frères n’a pas commencé aujourd’hui.
Romulus, donc, tue Remus et il fonde Rome. […] Romulus tue Remus et Rome fut
fondée» (M. Serres. Rome Le livre des
fondations, Paris, Grasset & Fasquelles, Col. Pluriel, # 873, 1983, p.
21). Serres fait référence ici au combat mythologique entre Hercule et Cacus,
et c’est à Hercule que Romulus sacrifie après le fratricide.
Vite oublié l’épisode de la louve qui allaita les deux
jumeaux arrivés sains et saufs au Palatin. En fait, cet épisode dit plus sur
l’ambiguïté gémellaire du doppelgänger que
l’on y voit à première vue. Michel Serres le rappelle dès l’ouverture de son
essai sur Rome Le livre des
fondations : «Romulus et Remus, jumeaux albains abandonnés, tètent le
sein sec de la louve, je dis sein sec puisque en latin la louve indique la
putain, une putain de lupanar. Faux fils de putain, vrais fils de vestale et de
Mars, légendaires, fils de violence et de viol, fils du dieu de la guerre et
d’une prêtresse chaste et sauvage, Romulus et Remus sont petits-fils aussi de
frères ennemis. Le meurtre entre les frères n’a pas commencé aujourd’hui.
Romulus, donc, tue Remus et il fonde Rome. […] Romulus tue Remus et Rome fut
fondée» (M. Serres. Rome Le livre des
fondations, Paris, Grasset & Fasquelles, Col. Pluriel, # 873, 1983, p.
21). Serres fait référence ici au combat mythologique entre Hercule et Cacus,
et c’est à Hercule que Romulus sacrifie après le fratricide. Le fratricide de Romulus sert de doublet de l’autre, comme on en trouve dans les
Évangiles : «Les dieux passent avant les rois. Un héros devient dieu aux
lieux où le jumeau devient roi. Hercule monte sur l’autel, Romulus sur le
trône. Romulus a tué Remus, Hercule a tué Cacus. Romulus a risqué sa vie dans
la bataille à mort, au milieu de la tourbe. Hercule a risqué sa vie dans la
foule des pâtres du voisinage, tous venus secourir Cacus. Hercule a été reconnu
dieu, fils de dieu par Évandre, Romulus cherche la reconnaissance, il cherche
une légitimité. La légende intervient au milieu du récit légendaire par
changement de langue, par changement de registre, de ton, par changement
d’échelle, d’état, d’espace et de temps, on dirait une métalangue. […] Remus
vient de mourir, soit tué par son frère au voisinage des murailles, de l’autre
bord de leur dessin, soit frappé au milieu de la foule, de la tourbe, qui
discutait passionnément à propos des vautours. Mort déchiré au milieu des
vautours. Romulus, resté seul, sacrifie. Or il sacrifie à Hercule, parmi
d’autres rites albains…» (M. Serres. Ibid.
pp. 22 et 23).
Le fratricide de Romulus sert de doublet de l’autre, comme on en trouve dans les
Évangiles : «Les dieux passent avant les rois. Un héros devient dieu aux
lieux où le jumeau devient roi. Hercule monte sur l’autel, Romulus sur le
trône. Romulus a tué Remus, Hercule a tué Cacus. Romulus a risqué sa vie dans
la bataille à mort, au milieu de la tourbe. Hercule a risqué sa vie dans la
foule des pâtres du voisinage, tous venus secourir Cacus. Hercule a été reconnu
dieu, fils de dieu par Évandre, Romulus cherche la reconnaissance, il cherche
une légitimité. La légende intervient au milieu du récit légendaire par
changement de langue, par changement de registre, de ton, par changement
d’échelle, d’état, d’espace et de temps, on dirait une métalangue. […] Remus
vient de mourir, soit tué par son frère au voisinage des murailles, de l’autre
bord de leur dessin, soit frappé au milieu de la foule, de la tourbe, qui
discutait passionnément à propos des vautours. Mort déchiré au milieu des
vautours. Romulus, resté seul, sacrifie. Or il sacrifie à Hercule, parmi
d’autres rites albains…» (M. Serres. Ibid.
pp. 22 et 23).
Alors que Caïn et Polynice, les révoltés, sont les porteurs
du fratricide et condamnés par cet acte, Romulus est justifié par le modèle
herculéen. Mais, comme Caïn, Romulus apparaît comme un fondateur de ville : «La légende affirme que Rome comme ville ne naît pas d’un miracle,
mais d’un coup de force. D’une volonté. Plantés l’un sur l’Aventin, l’autre sur
le Palatin, Remus et Romulus comptent les oiseaux qui doivent signifier le
choix des dieux entre ces jumeaux. Six vautours d’abord, puis douze. Qui a
gagné ? Celui qui a vu le premier, ou celui qui a vu plus d’oiseaux ?
De toute évidence, l’augure est illisible» (J. Gaillard. Rome, le temps, les choses, s.v., Actes Sud, Col. Babel # 262,
1995, pp. 35-36). Le métalangage est aussi indéchiffrable que les augures.
Vraie ou fausse légende, la morale est  évidente et les deux jumeaux ne peuvent
fonder chacun une ville sans que l’autre ne se porte à sa destruction :
«Là-dessus, des Grecs feraient une dissertation, pèseraient le pour et le
contre, instruiraient une casuistique et chercheraient où est la ruse. Les
Romains, sachant qu’ils ne savent pas lire, ont l’ordinaire comportement des
hommes en cas de telle rivalité : ils se battent. Comme des chiffonniers,
comme des hooligans, bande contre bande, supporters contre supporters. C’est la
première version donnée par Tite-Live : il s’ensuit que Remus est tué,
vive Romulus. Autre version que la mémoire a retenue – plus dramatique, et sans
doute plus forte : Romulus a pris la charrue, tracé un sillon, Remus le
nargue en bondissant par-dessus ce mur symbolique ; Romulus le tue, vive
Romulus. Et qui proclame : “Périsse ainsi quiconque franchira mes
murailles !” (J. Gaillard. Ibid. p.
36).
évidente et les deux jumeaux ne peuvent
fonder chacun une ville sans que l’autre ne se porte à sa destruction :
«Là-dessus, des Grecs feraient une dissertation, pèseraient le pour et le
contre, instruiraient une casuistique et chercheraient où est la ruse. Les
Romains, sachant qu’ils ne savent pas lire, ont l’ordinaire comportement des
hommes en cas de telle rivalité : ils se battent. Comme des chiffonniers,
comme des hooligans, bande contre bande, supporters contre supporters. C’est la
première version donnée par Tite-Live : il s’ensuit que Remus est tué,
vive Romulus. Autre version que la mémoire a retenue – plus dramatique, et sans
doute plus forte : Romulus a pris la charrue, tracé un sillon, Remus le
nargue en bondissant par-dessus ce mur symbolique ; Romulus le tue, vive
Romulus. Et qui proclame : “Périsse ainsi quiconque franchira mes
murailles !” (J. Gaillard. Ibid. p.
36).
Étrange synchronisme qui nous fait retrouver la charrue de Caïn entre les mains de Romulus. Les chrétiens s’en serviront pour créer un syncrétisme le moment venu. Mais, en aucun cas Remus n’est le doublet d’Abel. Il a mérité son sort, comme Polynice. Le récit mythologique de Romulus efface en un sens le «signe» porté par Caïn. Le péché du fratricide est effacé par l’Urbs appelée à devenir éternelle; à devenir éternellement le centre du monde chrétien.
Gaillard poursuit : «Deux versions, dont l’une, la
première, énonce simplement la loi du plus fort de deux groupes; c’est une
manière de voir comment se règlent souvent les conflits politiques. Par une
violence confuse, une rixe sans loi et sans doute sans esprit. L’autre version
dit bien qu’il y a des morts utiles, et c’est déjà une loi politique, dont la
République fera grand usage. Affreux en soi, le  fratricide peut prendre des airs
de sacrifice. Néanmoins, le recours à cette force brutale fait froid dans le
dos, et, à l’heure des guerres civiles, le meurtre romuléen donnera des
cauchemars aux Romains – parce qu’il est profondément primitif et radical.
C’est le radicalisme qui fait les rois : Romulus supprime son frère comme
Alexandre tranche le nœud gordien, d’un bon coup de glaive. La priorité va à
celui qui a osé faire, à ce laboureur qui n’entend pas perdre son temps à
discuter, et trace le rempart tandis que les autres en sont encore à se battre
pour savoir qui conduira les bœufs. S’il a raison, les dieux lui donneront
raison. Et si son frère lui donne tort, il le tue. Pragmatiquement. Pour sortir
de l’impasse. Et bien faire comprendre qu’on ne plaisante pas avec la Ville.
C’est sérieux. La gravitas peut, le
cas échéant, se révéler contondante» (J. Gaillard. Ibid. pp. 36-37). On comprend comment l’Église du Christ, née à
Jérusalem, s’est vite transposée à Rome où les nouveaux jumeaux devenaient les
apôtres martyres Pierre et Paul, sacrifiés tous deux par l’imperium de Néron.
Romulus et Remus des origines réconciliés dans
fratricide peut prendre des airs
de sacrifice. Néanmoins, le recours à cette force brutale fait froid dans le
dos, et, à l’heure des guerres civiles, le meurtre romuléen donnera des
cauchemars aux Romains – parce qu’il est profondément primitif et radical.
C’est le radicalisme qui fait les rois : Romulus supprime son frère comme
Alexandre tranche le nœud gordien, d’un bon coup de glaive. La priorité va à
celui qui a osé faire, à ce laboureur qui n’entend pas perdre son temps à
discuter, et trace le rempart tandis que les autres en sont encore à se battre
pour savoir qui conduira les bœufs. S’il a raison, les dieux lui donneront
raison. Et si son frère lui donne tort, il le tue. Pragmatiquement. Pour sortir
de l’impasse. Et bien faire comprendre qu’on ne plaisante pas avec la Ville.
C’est sérieux. La gravitas peut, le
cas échéant, se révéler contondante» (J. Gaillard. Ibid. pp. 36-37). On comprend comment l’Église du Christ, née à
Jérusalem, s’est vite transposée à Rome où les nouveaux jumeaux devenaient les
apôtres martyres Pierre et Paul, sacrifiés tous deux par l’imperium de Néron.
Romulus et Remus des origines réconciliés dans  la vocation chrétienne de
l’Urbs. S’il est possible de tuer son frère parce qu’il ne rejoint pas la Vraie
Foi, c’est parce que la mythologie romaine enseigne ce qui ne se trouve pas
dans la mythologie biblique. Caïn, Absalom sont aussi faibles qu’ils sont
envieux. Étéocle et Romulus aussi forts qu’ils sont tyranniques. Des premiers
naissent les villes; des seconds les États. Abel, Amnon, Polynice, Remus
peuvent être doux, violents, rebelles, outrecuidants, peu importe ils sont
stériles, voire une menace pour la civilisation. Ne cherchons pas d’autres
morales que celle de Machiavel et c’est pour cela que l’auteur du Prince fut le commentateur le plus
brillant de Tite-Live.
Nous comprenons également que l’avenir du fratricide procédera de l’envie des
forts et de la jalousie identitaire des faibles qui n'auront pas reconnu leur force.
la vocation chrétienne de
l’Urbs. S’il est possible de tuer son frère parce qu’il ne rejoint pas la Vraie
Foi, c’est parce que la mythologie romaine enseigne ce qui ne se trouve pas
dans la mythologie biblique. Caïn, Absalom sont aussi faibles qu’ils sont
envieux. Étéocle et Romulus aussi forts qu’ils sont tyranniques. Des premiers
naissent les villes; des seconds les États. Abel, Amnon, Polynice, Remus
peuvent être doux, violents, rebelles, outrecuidants, peu importe ils sont
stériles, voire une menace pour la civilisation. Ne cherchons pas d’autres
morales que celle de Machiavel et c’est pour cela que l’auteur du Prince fut le commentateur le plus
brillant de Tite-Live.
Nous comprenons également que l’avenir du fratricide procédera de l’envie des
forts et de la jalousie identitaire des faibles qui n'auront pas reconnu leur force.
Tel fut le cas de César Borgia, précisément le héros de Machiavel et qui l’inspira pour sa rédaction du Prince. César Borgia a-t-il couché avec sa sœur, comme Amnon avec Tamar? Le sait-on vraiment nous qui ne prêtons qu’aux riches? Mais qu’il ait tué son frère, ça nous le savons, et si inceste il y a eu, il ne fut pas à l’origine de l’assassinat du duc de Gandie.
Le duc de Gandie (1476-1497), frère aîné de César Borgia et fils préféré de son père, le pape Alexandre VI, subit un destin aussi tragique que bien des jeunes gens au cours des vendettas italiennes sous la  Renaissance. Juan Borgia «n’avait pas les qualités nécessaires pour devenir le valeureux condottieri rêvé par son père, ni même celles lui permettant de devenir simplement un bon capitaine. Jeune, beau, riche, Juan Borgia ne désirait rien d’autre que jouir des avantages offerts par la vie et passer son temps dans la compagnie des femmes qui lui plaisaient…» (M. Bellonci. Lucrèce Borgia, Paris, Plon, rééd. Livre de poche Col. historique, # 679-680, s.d., pp. 48-49). Mais le frère de Juan, César, ne partageait pas la même admiration pour son frère. Les deux frères se tenaient en inimitié pour le contrôle de la Romagne. Dans un climat de complots, de traquenards de délinquants, le crime se produisit au sortir d’un souper chez la Vannozza, le 14 juin 1497, où le duc de Gandie et son frère César étaient reçus par leur mère. Il n’y eut aucun témoin de l’affaire, aucun spectacle offert en guise de pédagogie politique, aucun mot d’humaniste pour racheter le tout. La conjuration se transformait en crime crapuleux et l’homme d’élite se retrouva dans la cloaca maxima, la vase des égouts de Rome : «Finalement un certain Giorgio Schiavone, qui était couché dans une barque amarrée au bord du Tibre, où il gardait une cargaison de bois, fut interrogé. Il dit qu’il avait vu deux hommes à pied sortir de la rue à gauche de l’hôpital de Saint-Gérôme des Esclavons, sur la route qui mène du château Saint-Ange à l’église de Sainte-Marie du Peuple en longeant le fleuve, tout près du moderne pont Cavour, à côté de la fontaine. C’était juste après le lever du soleil. Ils regardèrent autour d’eux pour voir s’il n’y avait
Renaissance. Juan Borgia «n’avait pas les qualités nécessaires pour devenir le valeureux condottieri rêvé par son père, ni même celles lui permettant de devenir simplement un bon capitaine. Jeune, beau, riche, Juan Borgia ne désirait rien d’autre que jouir des avantages offerts par la vie et passer son temps dans la compagnie des femmes qui lui plaisaient…» (M. Bellonci. Lucrèce Borgia, Paris, Plon, rééd. Livre de poche Col. historique, # 679-680, s.d., pp. 48-49). Mais le frère de Juan, César, ne partageait pas la même admiration pour son frère. Les deux frères se tenaient en inimitié pour le contrôle de la Romagne. Dans un climat de complots, de traquenards de délinquants, le crime se produisit au sortir d’un souper chez la Vannozza, le 14 juin 1497, où le duc de Gandie et son frère César étaient reçus par leur mère. Il n’y eut aucun témoin de l’affaire, aucun spectacle offert en guise de pédagogie politique, aucun mot d’humaniste pour racheter le tout. La conjuration se transformait en crime crapuleux et l’homme d’élite se retrouva dans la cloaca maxima, la vase des égouts de Rome : «Finalement un certain Giorgio Schiavone, qui était couché dans une barque amarrée au bord du Tibre, où il gardait une cargaison de bois, fut interrogé. Il dit qu’il avait vu deux hommes à pied sortir de la rue à gauche de l’hôpital de Saint-Gérôme des Esclavons, sur la route qui mène du château Saint-Ange à l’église de Sainte-Marie du Peuple en longeant le fleuve, tout près du moderne pont Cavour, à côté de la fontaine. C’était juste après le lever du soleil. Ils regardèrent autour d’eux pour voir s’il n’y avait  personne, puis s’en retour-nèrent. Ils furent suivis par deux autres, qui, après avoir aussi regardé aux alentours, firent un signal. Quelqu’un monté sur un cheval blanc sortit alors de la ruelle avec le corps d’un homme à travers de sa bête. Deux hommes à pied marchaient à côté en tenant ce corps pour l’empêcher de tomber. Ils arrivèrent ainsi jusqu’au bord du fleuve, à l’endroit où l’on vidait les chariots d’ordure. Le cheval fut tourné la croupe vers le Tibre, les deux hommes prirent le cadavre par les mains et par les pieds et le lancèrent dans le courant de toute leur force, le plus loin possible. Le cavalier leur demanda s’il était enfoncé et ils répondirent : "Oui messire". Il regarda alors le fleuve, aperçut le manteau du mort qui flottait et demanda ce qu’était cet objet noir. On jeta des pierres pour le faire couler. Puis ils s’en allèrent tous, y compris les deux premiers qui étaient restés à regarder. Quand on demanda au témoin pourquoi il n’avait pas parlé plus tôt, il répondit qu’il avait vu jeter là nuitamment au fleuve cent cadavres et que nul ne s’en était inquiété. On fit draguer le fleuve par trois cents bateliers et pécheurs. Vers l’heure des vêpres le cadavre du duc fut retrouvé avec la gorge coupée et huit autres blessures. Il était tout habillé, ses gants encore à sa ceinture et trente ducats dans sa bourse, ce qui prouvait qu’il n’avait pas été tué par des voleurs mais pour des raisons personnelles. Il avait les mains liées» (L. Collison-Morley. Histoire des Borgia, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1951, pp. 90-91).
personne, puis s’en retour-nèrent. Ils furent suivis par deux autres, qui, après avoir aussi regardé aux alentours, firent un signal. Quelqu’un monté sur un cheval blanc sortit alors de la ruelle avec le corps d’un homme à travers de sa bête. Deux hommes à pied marchaient à côté en tenant ce corps pour l’empêcher de tomber. Ils arrivèrent ainsi jusqu’au bord du fleuve, à l’endroit où l’on vidait les chariots d’ordure. Le cheval fut tourné la croupe vers le Tibre, les deux hommes prirent le cadavre par les mains et par les pieds et le lancèrent dans le courant de toute leur force, le plus loin possible. Le cavalier leur demanda s’il était enfoncé et ils répondirent : "Oui messire". Il regarda alors le fleuve, aperçut le manteau du mort qui flottait et demanda ce qu’était cet objet noir. On jeta des pierres pour le faire couler. Puis ils s’en allèrent tous, y compris les deux premiers qui étaient restés à regarder. Quand on demanda au témoin pourquoi il n’avait pas parlé plus tôt, il répondit qu’il avait vu jeter là nuitamment au fleuve cent cadavres et que nul ne s’en était inquiété. On fit draguer le fleuve par trois cents bateliers et pécheurs. Vers l’heure des vêpres le cadavre du duc fut retrouvé avec la gorge coupée et huit autres blessures. Il était tout habillé, ses gants encore à sa ceinture et trente ducats dans sa bourse, ce qui prouvait qu’il n’avait pas été tué par des voleurs mais pour des raisons personnelles. Il avait les mains liées» (L. Collison-Morley. Histoire des Borgia, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1951, pp. 90-91).
La postérité, comme les enquêteurs de l’époque, se sont perdus en conjecture sur l’assassinat du duc de Gandie, mais les soupçons reviennent toujours sur son frère César. Le pape, son père, en fit une crise -  momentanée - de désespoir : «Alexandre était accablé de douleur à l’idée que le fils en qui il avait mis ses espérances pour la future gloire de sa maison eût été jeté au Tibre "comme de l’ordure". Enfermé dans sa chambre et pleurant amèrement, il refusa de manger et de boire pendant trois jours» (L. Collison-Morley. ibid. p. 92). Puis, l’ordinaire reprit le dessus, le silence tacite du pape laissant prise à la violence licencieuse de son fils pervers : «Quelques mois plus tard, une tragédie encore plus mystérieuse, mais moins retentissante, fit marcher toutes les langues. Des pécheurs avaient sorti du Tibre le cadavre d’un jeune homme d’une extraordinaire beauté, premier camérier de Sa Sainteté, et l’un de ses favoris. Bientôt l’on chuchota tout bas que César Borgia était le meurtrier. Il aurait poignardé le jeune homme, réfugié sous le manteau d’Alexandre VI, dans les bras de son père indigné. "Le sang aurait rejailli sur le visage du pape dont messire Perotto était le favori." Une fois de plus on se perdait en conjectures sur les raisons de ce meurtre et, faute de mieux, on laissait entendre que César avait puni l’amant de sa sœur, la blonde Lucrèce que Pinturicchio
momentanée - de désespoir : «Alexandre était accablé de douleur à l’idée que le fils en qui il avait mis ses espérances pour la future gloire de sa maison eût été jeté au Tibre "comme de l’ordure". Enfermé dans sa chambre et pleurant amèrement, il refusa de manger et de boire pendant trois jours» (L. Collison-Morley. ibid. p. 92). Puis, l’ordinaire reprit le dessus, le silence tacite du pape laissant prise à la violence licencieuse de son fils pervers : «Quelques mois plus tard, une tragédie encore plus mystérieuse, mais moins retentissante, fit marcher toutes les langues. Des pécheurs avaient sorti du Tibre le cadavre d’un jeune homme d’une extraordinaire beauté, premier camérier de Sa Sainteté, et l’un de ses favoris. Bientôt l’on chuchota tout bas que César Borgia était le meurtrier. Il aurait poignardé le jeune homme, réfugié sous le manteau d’Alexandre VI, dans les bras de son père indigné. "Le sang aurait rejailli sur le visage du pape dont messire Perotto était le favori." Une fois de plus on se perdait en conjectures sur les raisons de ce meurtre et, faute de mieux, on laissait entendre que César avait puni l’amant de sa sœur, la blonde Lucrèce que Pinturicchio  avait peinte, trois ou quatre ans auparavant, sous les traits de sainte Catherine d’Alexandrie. Hypothèse toute gratuite, bien entendu. Lucrèce, en juillet 1498, épousait le duc de Bisenglie, fils du roi de Naples, Alphonse II, jeune homme d’une grande beauté et d’un caractère charmant qui conquit aussitôt le cœur de sa jeune femme. Ils s’aimèrent passionnément, on n’en saurait douter, car tous les rapports du temps parlent de leur gaieté, de leur exubérance, de leur bonheur. Puis ils eurent un fils et la joie d’Alexandre VI fut si grande qu’il fit notifier la naissance de l’enfant à tous les ambassadeurs et à tous les cardinaux. Mais quelques mois plus tard, le duc de Bisenglie était assailli, sur les degrés du Vatican, par une bande de spadassins et grièvement blessé à la tête, au bras et à la jambe. Transporté dans les appartements pontificaux, gardé, sur l’ordre du pape, par seize estafiers, il fut si bien soigné par sa femme qu’il entra bientôt en convalescence. Un jour, César, récemment fait duc de Valentinois par le nouveau roi de France, Louis XII, pénétra en coup de vent dans la chambre du duc, en chassa tout le monde, puis donna l’ordre à son bourreau qui l’accompagnait, d’étrangler le jeune homme sous ses yeux. Le désespoir de Lucrèce fut si grand qu’il excita une compassion universelle. Quant au pape, depuis la mort du duc de Gandie, "jeté comme une ordure dans le Tibre", il avait
avait peinte, trois ou quatre ans auparavant, sous les traits de sainte Catherine d’Alexandrie. Hypothèse toute gratuite, bien entendu. Lucrèce, en juillet 1498, épousait le duc de Bisenglie, fils du roi de Naples, Alphonse II, jeune homme d’une grande beauté et d’un caractère charmant qui conquit aussitôt le cœur de sa jeune femme. Ils s’aimèrent passionnément, on n’en saurait douter, car tous les rapports du temps parlent de leur gaieté, de leur exubérance, de leur bonheur. Puis ils eurent un fils et la joie d’Alexandre VI fut si grande qu’il fit notifier la naissance de l’enfant à tous les ambassadeurs et à tous les cardinaux. Mais quelques mois plus tard, le duc de Bisenglie était assailli, sur les degrés du Vatican, par une bande de spadassins et grièvement blessé à la tête, au bras et à la jambe. Transporté dans les appartements pontificaux, gardé, sur l’ordre du pape, par seize estafiers, il fut si bien soigné par sa femme qu’il entra bientôt en convalescence. Un jour, César, récemment fait duc de Valentinois par le nouveau roi de France, Louis XII, pénétra en coup de vent dans la chambre du duc, en chassa tout le monde, puis donna l’ordre à son bourreau qui l’accompagnait, d’étrangler le jeune homme sous ses yeux. Le désespoir de Lucrèce fut si grand qu’il excita une compassion universelle. Quant au pape, depuis la mort du duc de Gandie, "jeté comme une ordure dans le Tibre", il avait  beaucoup vieilli et était victime de fréquentes syncopes…» (F. Bérence. Michel-Ange, Paris, La Colombe, 1947, pp. 115-116). Si César Borgia assassina par jalousie incestueuse son beau-frère, le duc de Bisenglie, c’est par jalousie filiale qu’il tua Juan, son frère aîné. César supportait difficilement l’idée d’être le second dans la famille : second après son frère, second après son beau-frère. Juan n’était pas moins pervers que César et César pas plus aimé de sa sœur que le duc de Bisenglie, les circonstances des luttes romaines créaient l’occasion à ce surhomme d’accomplir ses crimes personnels, multipliant les souvenirs d’une «nuit, le cadavre découvert, beau de cette désespérante beauté qui masque le visage des jeunes morts…» (M. Bellonci. op. cit. p. 108).
beaucoup vieilli et était victime de fréquentes syncopes…» (F. Bérence. Michel-Ange, Paris, La Colombe, 1947, pp. 115-116). Si César Borgia assassina par jalousie incestueuse son beau-frère, le duc de Bisenglie, c’est par jalousie filiale qu’il tua Juan, son frère aîné. César supportait difficilement l’idée d’être le second dans la famille : second après son frère, second après son beau-frère. Juan n’était pas moins pervers que César et César pas plus aimé de sa sœur que le duc de Bisenglie, les circonstances des luttes romaines créaient l’occasion à ce surhomme d’accomplir ses crimes personnels, multipliant les souvenirs d’une «nuit, le cadavre découvert, beau de cette désespérante beauté qui masque le visage des jeunes morts…» (M. Bellonci. op. cit. p. 108).
Les fratricides sont de toutes les civilisations. On en retrouve dans l’Empire byzantin, le tsarat de Russie, l’empire chinois, dans le Räj indien. Mais c’est dans l’État universel osmanlis que le fratricide apparaît  comme une politique systématique de gouvernement, ce qu’on appelait le devoir de fratricide. Cette mesure fut instituée par le sultan Mahomet II le Conquérant, celui qui fit tomber Constantinople aux mains des Turcs en 1453. L’origine de cette loi provient d’un traumatisme à l’accession de Mehmed au trône de son père Mourad II, en 1451. Comme toujours dans ces moments, les conjurations s’ourdissent dans les antichambres et les vizirs s’activent autour du jeune sultan. «Ishâq [pacha] prit donc le chemin de l’Anatolie avec la dépouille mortelle de son ancien maître. Une grande pompe avait été déployée et, en chemin, d’importantes sommes d’argent furent distribuées parmi les pauvres. Mais, en même temps que le cercueil de Mourad, une deuxième bière partit pour l’ancienne capitale Brousse. Pendant que la belle-mère de Mehmed, la fille d’Isfendiyâr-oghlou, était apparue dans la salle du trône pour exprimer au nouveau souverain sa douleur pour la perte de son époux, du moins à ce que rapporte encore Doukas [le chroniqueur], le sultan avait envoyé Ali beg, fils de l’Evrénos, dans les appartements des femmes pour y étouffer dans son bain le plus jeune des fils de Mourad "né dans la pourpre", Kutchuk
comme une politique systématique de gouvernement, ce qu’on appelait le devoir de fratricide. Cette mesure fut instituée par le sultan Mahomet II le Conquérant, celui qui fit tomber Constantinople aux mains des Turcs en 1453. L’origine de cette loi provient d’un traumatisme à l’accession de Mehmed au trône de son père Mourad II, en 1451. Comme toujours dans ces moments, les conjurations s’ourdissent dans les antichambres et les vizirs s’activent autour du jeune sultan. «Ishâq [pacha] prit donc le chemin de l’Anatolie avec la dépouille mortelle de son ancien maître. Une grande pompe avait été déployée et, en chemin, d’importantes sommes d’argent furent distribuées parmi les pauvres. Mais, en même temps que le cercueil de Mourad, une deuxième bière partit pour l’ancienne capitale Brousse. Pendant que la belle-mère de Mehmed, la fille d’Isfendiyâr-oghlou, était apparue dans la salle du trône pour exprimer au nouveau souverain sa douleur pour la perte de son époux, du moins à ce que rapporte encore Doukas [le chroniqueur], le sultan avait envoyé Ali beg, fils de l’Evrénos, dans les appartements des femmes pour y étouffer dans son bain le plus jeune des fils de Mourad "né dans la pourpre", Kutchuk  (c’est-à-dire : le petit) Ahmed tchélébi. La loi du fratricide, qui allait être appliquée pendant de longs siècles à chaque changement de règne fut appliquée ici pour la première fois et d’une façon particu-lièrement cruelle par Mehmed II. Dans la suite, le même sultan a donné force de loi au fratricide en donnant à son édit le libellé suivant : "Quel que soit celui de mes fils à qui écherra le règne de sultan, il devra dans l’intérêt de l’ordre mondial, tuer ses frères. La plupart des jurisconsultes ont aussi approuvé cela. C’est donc ainsi qu’ils agiront". Si l’indication souvent attestée que le jeune prince n’était âgé que de huit mois est exacte, il y aurait lieu de s’étonner qu’il soit venu au monde si tard, alors que ses parents étaient déjà mariés depuis 26 ans» (F. Babinger. Mahomet II le Conquérant, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1954, p. 86). C’était une mesure assez drastique et la justification politique semble satisfaire à ceux qui se penchent sur les raisons d’une telle loi.
(c’est-à-dire : le petit) Ahmed tchélébi. La loi du fratricide, qui allait être appliquée pendant de longs siècles à chaque changement de règne fut appliquée ici pour la première fois et d’une façon particu-lièrement cruelle par Mehmed II. Dans la suite, le même sultan a donné force de loi au fratricide en donnant à son édit le libellé suivant : "Quel que soit celui de mes fils à qui écherra le règne de sultan, il devra dans l’intérêt de l’ordre mondial, tuer ses frères. La plupart des jurisconsultes ont aussi approuvé cela. C’est donc ainsi qu’ils agiront". Si l’indication souvent attestée que le jeune prince n’était âgé que de huit mois est exacte, il y aurait lieu de s’étonner qu’il soit venu au monde si tard, alors que ses parents étaient déjà mariés depuis 26 ans» (F. Babinger. Mahomet II le Conquérant, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1954, p. 86). C’était une mesure assez drastique et la justification politique semble satisfaire à ceux qui se penchent sur les raisons d’une telle loi.
Pourtant la règle de succession ottomane ne divergeait guère des autres puissances. Il paraissait évident que le fils du sultan lui succède. «Toutefois, le fait qu’aucune règle stricte ne venait les départager, qu’il n’existait pas de principe successoral à proprement parler, constituait, comme plusieurs épisodes l’ont montré au long du XVe siècle, un germe redoutable de troubles et même de dissolution de l’État. Dans ces conditions, la pratique s’établit chez les princes qui venaient d’accéder au trône de faire périr étouffés tous leurs frères. De cette précaution Mehmed II fit une règle, la fameuse "loi du fratricide",  décrétée "pour le bien de l’État", avec l’approbation d’"une majorité d’oulémas". Par cette terrible mesure qui contribua grandement à l’horreur durable inspirée par le régime ottoman aux observateurs occidentaux, le souverain assurait efficacement la solidité de son pouvoir, comme les droits de sa propre progéniture. Peut-être était-il aussi guidé par l’idée - là encore une ancienne conception turque - selon laquelle son succès sanctionnait un choix divin dont il ne faisait que tirer les conséquences. Seul survivant des fils de Selim Ier, Süleymân [dit Soliman le Magnifique] fut dispensé d’accomplir à son avènement la macabre besogne. Il ne s’en montra pas moins fidèle ultérieurement à la logique dont elle procédait : on rapporte qu’après la prise de Rhodes, il fit mettre à mort le fils et le petit-fils de son grand-oncle, Djem, réfugiés auprès des chevaliers de Saint-Jean. De même, il ne se contenta pas de faire exécuter ses deux fils, Mustafâ et Bâyazid, qui avaient défié son autorité, puisqu’il s’acharna aussi bien sur leurs rejetons afin de retrancher ces deux rameaux de la compétition successorale future» (G. Veinstein, in R. Mantran (éd.) Histoire de l’empire ottoman, Paris, Fayard, 1989, p. 165). Cette terrible mesure ne tarda pas toutefois à s’adoucir au fur et à mesure que les héritiers se voyaient enfermés dans des «cages» dorés, c’est-à-dire des harems retirés oû des femmes plus ou moins stériles étaient servies avec la dolce vitæ d’un empire à son apogée. Plus que jamais, aussi, l’idée du dédoublement de l’État par des prétendants et des compétiteurs était perçue non sans une certaine angoisse psychologique. Prenant la succession d’un empire (le Byzantin) qui avait connu tant de drames sanglants dans le cours de la succession à l’imperium, il était normal qu’une population encore nomade finisse par prendre les grands moyens pour s’assurer leur permanence sur leur nouvelle acquisition.
décrétée "pour le bien de l’État", avec l’approbation d’"une majorité d’oulémas". Par cette terrible mesure qui contribua grandement à l’horreur durable inspirée par le régime ottoman aux observateurs occidentaux, le souverain assurait efficacement la solidité de son pouvoir, comme les droits de sa propre progéniture. Peut-être était-il aussi guidé par l’idée - là encore une ancienne conception turque - selon laquelle son succès sanctionnait un choix divin dont il ne faisait que tirer les conséquences. Seul survivant des fils de Selim Ier, Süleymân [dit Soliman le Magnifique] fut dispensé d’accomplir à son avènement la macabre besogne. Il ne s’en montra pas moins fidèle ultérieurement à la logique dont elle procédait : on rapporte qu’après la prise de Rhodes, il fit mettre à mort le fils et le petit-fils de son grand-oncle, Djem, réfugiés auprès des chevaliers de Saint-Jean. De même, il ne se contenta pas de faire exécuter ses deux fils, Mustafâ et Bâyazid, qui avaient défié son autorité, puisqu’il s’acharna aussi bien sur leurs rejetons afin de retrancher ces deux rameaux de la compétition successorale future» (G. Veinstein, in R. Mantran (éd.) Histoire de l’empire ottoman, Paris, Fayard, 1989, p. 165). Cette terrible mesure ne tarda pas toutefois à s’adoucir au fur et à mesure que les héritiers se voyaient enfermés dans des «cages» dorés, c’est-à-dire des harems retirés oû des femmes plus ou moins stériles étaient servies avec la dolce vitæ d’un empire à son apogée. Plus que jamais, aussi, l’idée du dédoublement de l’État par des prétendants et des compétiteurs était perçue non sans une certaine angoisse psychologique. Prenant la succession d’un empire (le Byzantin) qui avait connu tant de drames sanglants dans le cours de la succession à l’imperium, il était normal qu’une population encore nomade finisse par prendre les grands moyens pour s’assurer leur permanence sur leur nouvelle acquisition.
Pour fantastique que soit le doppelgänger, le fratricide n’est pas un acte courant. Les mécanismes  psychologiques sont faits de telle façon que l’identité bien assumée reste la meilleure alternative à l’angoisse du double. L’autre extrémité de cette angoisse confine à la schizophrénie, ce qui ne semble pas toucher les collectivités. À l’échelle des nations et des civilisations, il m’est inconnu de groupes qui vivraient un dédoublement d’identité ou «de personnalité.....». Pourtant, à l’intérieur des groupes, des tendances marquées à la multiplication de problèmes d’identité peuvent conduire à des fratricides. Michel Foucault a étudié un cas célèbre en France du XIXe siècle, celui de Pierre Rivière «ayant égorgé» sa mère, sa sœur et son frère. Foucault a exhumé les pièces du dossier, dont le procès-verbal qui décrit assez bien la scène de crime :
psychologiques sont faits de telle façon que l’identité bien assumée reste la meilleure alternative à l’angoisse du double. L’autre extrémité de cette angoisse confine à la schizophrénie, ce qui ne semble pas toucher les collectivités. À l’échelle des nations et des civilisations, il m’est inconnu de groupes qui vivraient un dédoublement d’identité ou «de personnalité.....». Pourtant, à l’intérieur des groupes, des tendances marquées à la multiplication de problèmes d’identité peuvent conduire à des fratricides. Michel Foucault a étudié un cas célèbre en France du XIXe siècle, celui de Pierre Rivière «ayant égorgé» sa mère, sa sœur et son frère. Foucault a exhumé les pièces du dossier, dont le procès-verbal qui décrit assez bien la scène de crime :
«Aujourd'hui, 3 juin 1835, une heure après midi.
Nous, François-Édouard Baudouin, juge de paix du canton d'Aunay, assisté de Louis-Léandre Langliney, notre greffier.
À l'instant informé par M. le maire de la commune d'Aunay, qu'un meurtre épouvantable vient d'être commis en ladite commune d'Aunay, village dit la Faucterie, au domicile du sieur Pierre-Margrin Rivière, propriétaire cultivateur, absent de chez lui, nous dit-on, depuis le matin; nous nous sommes immédiatement transportés audit domicile, accompagnés de M. le maire d'Aunay et encore de MM. Morin, docteur en médecine et Cordier, officier de santé, l'un et l'autre domiciliés à Aunay; venus sur notre réquisition conformément à la loi. Entrés dans une maison au rez-de-chaussée, à usage de salle, joutée au nord par le chemin vicinal d'Aunay à Saint-Agnan, éclairée au midi par une croisée et une porte, et au nord par une porte vitrée, nous y avons trouvé trois cadavres
gisant par terre : /° une femme d'environ quarante ans renversée sur le dos en face la cheminée où il paraît qu'elle était occupée, au moment où elle a été assassinée, à faire cuire de la bouillie qui était encore dans une casserole sur le foyer. Cette femme est vêtue comme à son ordinaire, décoiffée; elle a le cou et le derrière du crâne coupés et coutelassés. 2° Un petit garçon de sept à huit ans, vêtu d'une blouse bleue, pantalon, bas, et souliers, tombé sur le ventre le visage contre terre, ayant la tête fendue par derrière à une très grande profondeur. 3° Une fille vêtue d'indienne, bas, sans souliers ni sabots, tombée sur le dos, les pieds sur le seuil de la porte donnant sur la cour, vers midi, son métier à dentelle posé sur son ventre, son bonnet de coton à ses pieds, et une forte poignée de cheveux qui paraissent lui avoir été arrachés lors du meurtre, le côté droit de la figure et le cou coutelassés à une très grande profondeur. Il paraîtrait que cette malheureuse jeune personne travaillait à sa dentelle, près de la porte vitrée opposée à celle où elle est tombée, ses sabots étant restés au pied de la chaise qui y est placée.
Ce triple assassinat paraît avoir été commis avec un instrument tranchant.
Ces victimes se nomment : la première, Victoire Brion, épouse de Pierre-Margrin Rivière; la seconde, Jules Rivière; la troisième, Victoire Rivière; les deux dernières, enfants de la première.
La vindicte publique désignant comme auteur de ce crime le nommé Pierre Rivière, fils et frère des assassinés…» (Cité in M. Foucault. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…, Paris, Gallimard/Julliard, Col. Archives, # 49, 1973, pp. 21-22)







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire