 |
| Anonyme. La mort de Pompée |
LE CIRCUIT DE PTOLÉMÉE
Comment peut-on passer de l’identité individuelle à l’identité collective et quelles sont les problèmes qui se posent au second niveau que nous ne retrouvons pas au premier? Le doppelgänger ou phénomène du double, bien qu’il hante la mythologie et la littérature fantastique, semble inconnu des collectivités. En effet, quelles collectivités ont pu se laisser mourir d’avoir crû qu’une autre collectivité était son double? Terrifiées qu’elles aient été de voir les explorateurs et les colons occidentaux débarquer sur leurs rives et les refouler devant leurs marches, aucune civilisation amérindienne n’a pris ceux-ci pour des «doubles» de ce qu’elles étaient. Le schisme de l’âme qui se produit lors de la rupture de l’auto-détermination d’une civilisation se ramène généralement à deux attitudes contraires devant un même défi.
Telles
sont les solution antagoniques relevées par Toynbee dans son célèbre ouvrage A Study of History.Le schisme moral,
atteignant les membres d’une société qui se désagrège, se présente sous de
multiples formes attendu qu’il apparaît dans les différentes manières de se
comporter, de sentir et de vivre qui caractérisent l’activité des êtres humains
jouant leur rôle dans la genèse et le développement des civilisations. Pendant
la phase de désagrégation, chacune de ces lignes d’action peut se scinder en
deux variations ou substitutions, mutuellement antithétiques et antipathiques
suivant lesquelles la riposte au défi a le choix entre deux positions, l’une
passive, l’autre active, aucune des deux n’étant créatrice. La seule liberté,
laissée à une âme qui a perdu l’occasion (mais nullement la capacité) d’une
action créatrice assumant un rôle dans la tragédie de la désagrégation sociale,
est l’option entre l’activité et la passivité. Au fur et à mesure que le
processus de désagrégation évolue, les deux alternatives tendent à se raidir
dans leurs limites, devenant plus extrêmes dans leur divergence et plus lourdes
de conséquences. C’est dire que l’expérience spirituelle du schisme offre aux âmes
la possibilité d’un mouvement dynamique et non une situation statique.
On enregistre deux
manières différentes de se comporter, c’est-à-dire deux substitutions possibles
de l’exercice de la faculté créatrice. L’une et l’autre sont des tentatives
d’expression personnelle. Passive, elle consiste en un abandon où l’âme se laisse aller, jugeant qu’en donnant libre cours à ses
appétits et aversions spontanés elle vit selon les lois naturelles et doit
recevoir automatiquement en échange de la part de cette mystérieuse déesse, le
don précieux de créativité qu’elle a conscience d’avoir perdu. L’autre manière,
celle de l’action, est un effort de contrôle de soi où l’âme ”se prend en mains” et essaye de discipliner ses passions
instinctives. Elle croit ici, contrairement à la première donnée, que la nature
empêche la créativité et n’en est donc pas la source. Le seul moyen d’acquérir
de nouveau la faculté créatrice perdue est donc de maîtriser la nature» (A.
J. Toynbee. L’Histoire Un essai d’interprétation,
Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des Idées, 1951, pp. 471-472)
Arrêtons-nous
un instant sur ces deux paragraphes. Contrairement au doppelgänger qui se projette à l’extérieur de l’individu et marque une crise d’identité
qu’il faut vaincre (métaphore du meurtre du double) afin d'affirmer l’identité
de l’individu, de la personne, les civilisations ou les nations vivent leur
crise d’identité  de l’intérieur; elles l’introjecte au même rythme, par exemple, qu’elles subissent des
schismes au sein du corps social (luttes de classes, de castes ou de clans,
guerres intercités dans l’Antiquité, conflits dynastiques féodaux ou guerres
internationales dans le monde moderne). Les deux vont de paires. Active, la
manifestation du schisme de l’âme confine à la morale du stoïcisme,
c’est-à-dire de l’action «malgré tout», malgré l’annonce du dépérissement et de
l’inéluctable mort. Passive, la manifestation du schisme de l’âme confine
plutôt à l’épicurisme, vivant des sentiments et des sensations plutôt que de la
critique rationnelle ou de la réflexion intériorisée. Toynbee s’inspirait
beaucoup de sa connaissance de la civilisation hellénique pour définir les
états d’une âme collective en crise. Redonnons lui la parole :
de l’intérieur; elles l’introjecte au même rythme, par exemple, qu’elles subissent des
schismes au sein du corps social (luttes de classes, de castes ou de clans,
guerres intercités dans l’Antiquité, conflits dynastiques féodaux ou guerres
internationales dans le monde moderne). Les deux vont de paires. Active, la
manifestation du schisme de l’âme confine à la morale du stoïcisme,
c’est-à-dire de l’action «malgré tout», malgré l’annonce du dépérissement et de
l’inéluctable mort. Passive, la manifestation du schisme de l’âme confine
plutôt à l’épicurisme, vivant des sentiments et des sensations plutôt que de la
critique rationnelle ou de la réflexion intériorisée. Toynbee s’inspirait
beaucoup de sa connaissance de la civilisation hellénique pour définir les
états d’une âme collective en crise. Redonnons lui la parole :
Viennent ensuite deux comportements, substitutions possibles à ce mimétisme des personnalités créatrices dont nous avons dit qu'il est un raccourci nécessaire quoique périlleux, sur la longue voie de l'évolution sociale. Ces deux substitutions du mimétisme 
sont les tentatives de sortir des rangs d'un groupe où "l'exercice social" n'a pu s'exécuter en bon ordre. Faire l'école buissonnière est la manière passive de sortir de l'impasse. Le soldat s'aperçoit avec consternation que son régiment a perdu la discipline qui, jusqu'à présent, avait fait sa force. En l'occurrence, il s'autorise à croire qu'il est relevé de ses devoirs. Dans cet état d'esprit peu édifiant, le tire-au-flanc s'échappe des rangs, abandonnant ses camarades en mauvaise posture, avec l'espoir vain de sauver sa peau. Il existe toutefois une autre manière de faire face à la même épreuve, c'est ce qu'on nomme le martyre. Un martyr est le soldat qui, de sa propre initiative, sort des rangs, va de l'avant, au-delà de ce que réclame son devoir strict. Tandis que dans les circonstances normales, le devoir exige seulement d'un soldat qu'il risque sa vie, le martyr court à la mort au nom d'un idéal. (A. J. Toynbee. ibid. p. 472)
Lorsque
des héros parviennent à construire une civilisation, que ce soient des héros
mythiques comme Caïn, Œdipe ou Romulus ou de véritables héros historiques comme
Solon, Moïse ou Laurent de Médicis, les périodes de schisme dans le corps
social invitent les civilisés à répéter des gestes fondateurs. Cette invitation
peut être refusée : c’est le tire-au-flanc qui déserte sa fonction, sa
mission voire même ses motivations les plus profondes. Cette démission, poussée
à son extrémité donnera le lâche, le traître, le vendu. L’autre  alternative est
de répondre à l’invitation, au défi écrivait
Toynbee, qui demande un minimum d’engagement, mais qui, poussée encore là à son
extrémité, aboutit au fanatique. En ce sens, le martyr devient plus qu’un
témoin et nombre d’anecdotes hagiographiques montrent que les martyrs chrétiens
du temps du schisme du corps social de la civilisation hellénique, à son époque
dite d’Antiquité tardive, provoquaient
les situations où ils aspiraient au sacrifice ultime. Le but du martyre étant
de se donner en exemplum, le «témoin»
appelait d’autres à l’imiter contre les tires-au-flanc qui se ralliaient au
pouvoir dominant. Cette bilocation interne se retrouve aussi bien à la fondation du christianisme,
lors de la crise du corps social romain, que lors de la Réforme et de la
Contre-Réforme à l’âge baroque, enfin depuis la Révolution française. Au-delà
des conflits produits des contradictions de toutes sociétés, la traîtrise et le
fanatisme sont les excès alternatifs et antagoniques des civilisations dont le
processus de désagrégation est à peine amorcé.
alternative est
de répondre à l’invitation, au défi écrivait
Toynbee, qui demande un minimum d’engagement, mais qui, poussée encore là à son
extrémité, aboutit au fanatique. En ce sens, le martyr devient plus qu’un
témoin et nombre d’anecdotes hagiographiques montrent que les martyrs chrétiens
du temps du schisme du corps social de la civilisation hellénique, à son époque
dite d’Antiquité tardive, provoquaient
les situations où ils aspiraient au sacrifice ultime. Le but du martyre étant
de se donner en exemplum, le «témoin»
appelait d’autres à l’imiter contre les tires-au-flanc qui se ralliaient au
pouvoir dominant. Cette bilocation interne se retrouve aussi bien à la fondation du christianisme,
lors de la crise du corps social romain, que lors de la Réforme et de la
Contre-Réforme à l’âge baroque, enfin depuis la Révolution française. Au-delà
des conflits produits des contradictions de toutes sociétés, la traîtrise et le
fanatisme sont les excès alternatifs et antagoniques des civilisations dont le
processus de désagrégation est à peine amorcé.
Passant du plan de la conduite à celui du sentiment, nous notons, tout d’abord, deux sortes de réactions possibles en face du renversement de ce “mouvement d’élan”. Dans les deux cas naît la pénible conscience que l’être est mené par les forces du mal ayant pris l’offensive et imposé leur empire. L’expression passive de cette conscience d’une défaite morale continue est l’impression d’entraînement
fatal. L’âme en déroute est prostrée sous le sentiment de son manque de contrôle sur son milieu. Elle en arrive à croire que l’univers est à la merci d’une puissance irrationnelle tout autant qu’invincible : cette déesse au double visage, sans aucune origine divine, bien accueillie quand elle porte le nom de “Chance” et seulement supportée sous le nom de “Nécessité”. La défaite morale au contraire, qui ravage l’âme déroutée, peut être ressentie comme un défaut de maîtrise ou de contrôle sur elle-même. Dans ce cas, au lieu du sentiment d’abandon, il y a sentiment de péché. (A. J. Toynbee. Ibid. pp. 472-473)
Nous tenons là un élément essentiel du sentiment qui accompagne «l’exercice social», c’est-à-dire le pressentiment – car ce n’est qu’un état d’angoisse indéfini – qu’une force des choses, comme disait Saint-Just, agit à travers la civilisation. Cet élan, la voie passive le suit, allant où il va. C’est l’entraînement fatal qui conduit les «traîtres» à abandonner leurs semblables au moment du choix décisif. «Avec un peu de chance», pensent-ils, ils bénéficieront de la Fortuna qui accompagne cet entraînement fatal. De l’autre côté, les fanatiques, les jusqu’au-boutistes, s’engageront dans la nécessité historique, le fatum qui conduit à leur propre sacrifice si nécessaire. La tautologie est de mise :
La réponse passive se manifeste dans l’esprit de confusion suivant laquelle l’âme se soumet au creuset social où tout se refond. […] La réaction active considère
l’abandon d’un genre de vie lié à un lieu particulier et à une époque passagère comme un avantage et fait appel à un autre style de caractère universel et durable : quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Cette réaction active révèle la découverte du sens de l’unité qui s’étend et s’approfondit au fur et à mesure que la vision s’élargit, progressant de l’unité humaine à l’unité cosmique, pour embrasser l’unité de Dieu. (A. J. Toynbee. Ibid. p. 473)
Nous avons donc ainsi deux profils nettement opposés, nettement antagoniques, qui s’affrontent au moment où une crise majeure affecte aussi bien le Socius que la Psyché. D’une part, le mouvement d’abandon, renforcé par l’acte de désertion sous l’impulsion d’un sentiment d’entraînement fatal. De l’autre, un contrôle de soi qui peut pousser jusqu’au sacrifice ultime en vue de restaurer le sens de l’unité perdu par le péché et la faillite de l’auto-détermination à l’origine de la croissance de la civilisation ou de la nation.
Au moment
où un Dante décrivait le cercle des traîtres, la civilisation occidentale se
dégageait de sa chrysalide constituée par l’Église romaine. C’était donc à petite
échelle que le dédoublement du corps social  affectait certaines cités, telle Pise,
au détriment d’une autre, Florence. Ceux qui trahis-
affectait certaines cités, telle Pise,
au détriment d’une autre, Florence. Ceux qui trahis-
saient leurs sembla-
bles, leurs
frères en la cité, apparaissaient donc comme de misérables lâches, corrompus par
l’argent, détachés déjà de tout sentiment d’appartenance au groupe. Carlino de’
Pazzi, du parti des Blancs, qui livra
par trahison le château de Piano di tre
vigne aux Noirs de Florence, pour
une grosse somme d’argent; Bocca Degli Abati, un Guelfe partisan du Pape,
corrompu par l’argent des Gibelins, partisans de l’Empereur et de Florence,
en s’approchant, au milieu de la bataille de Monte-Aperto, où Jacques Pazzi, tenait le principal étendard, lui coupa la main. Les Guelfes, ne voyant plus
cet étendard, se crurent vaincus et prirent la fuite. Tous ces crimes se
situent dans les rivalités propres aux cités italiennes à la fin du Moyen Âge.
Il en va encore ainsi de Buoso da Duéra de Crémone, qui laissa passer sans
l’attaquer, l’armée commandée par le général Français, Guy de Montfort, après
avoir reçu de ce général une somme considérable. Beccheria (de Pavie ou de
Parme, on se dispute son origine) qui, suivant  Landino et Mouton-
Landino et Mouton-
net, fut abbé de Vallom-
broso mais résidait à Florence comme légat du pape. On découvrit qu’il avait conjuré en faveur des Gibelins contre les Guelfes, et on le condamna à être décapité à Florence même. Gianni del Soldaniéro, Gibelin qui trahit son parti et favorisa les guelfes; Ganelon, dont le conseil perfide poussa Marsile, roi des Sarrasins, à attaquer l’armée de Charlemagne dans un défilé et gagna la fameuse bataille de Roncevaux; Tribaldello de’ Manfredi de Faenza qui, lui, remit la nuit une porte de cette ville aux Français qui avaient été appelés en Italie par le pape Martin IV et qui étaient commandés par Jean de Pas. Toutes ces petites trahisons appartiennent au monde que Jan Huizinga appelait l’automne du Moyen Âge, et sont d’une relative insignifiance car elles ne relèvent d’une structure semblable à celle que nous venons de voir à travers l’analyse de Toynbee. Le nec plus ultra de ces situations conflictuelles et cruelles est celui du comte Ugolino della Gherardesca, né vers 1220 à Pise et mort dans la même ville en 1289.
Si nous nous tournons maintenant vers cette trahison de Ptolémée, nous commençons à mieux pénétrer l’esprit «passif» que Toynbee associe à la personnalité du «traître».
Au moment
où la civilisation hellénique avait entrepris sa désagrégation, en Grèce à
partir de la guerre du Péloponnèse et à Rome à partir des troubles sociaux liés
à la révolte des Gracques, la civilisation égyptienne était depuis longtemps
désintégrée. Conquise successivement par les Perses et les Grecs, elle était
devenue  la cible des ambitions romaines qui étaient à constituer leur État
universel en faisant de la Méditer-
la cible des ambitions romaines qui étaient à constituer leur État
universel en faisant de la Méditer-
ranée la mare nostrum. L’Égypte restait indépendante et riche. L’Égypte était le grenier de la Méditerranée. Tout chez elle n’était plus que syncrétisme. Sérapis, le dieu à la mode, était une fabrication grecque. Son art, depuis l’époque Saïte, avait rompu avec ses traditions et était de l’art grec. Alexandrie, sa nouvelle capitale, était une ville cosmopolite dominée par la culture grecque. Plus qu’Athènes, elle était la capitale culturelle du monde hellénistique. Son phare était considéré comme une merveille du monde et sa bibliothèque la plus riche. Enfin, sa dynastie régnante, les Lagides – la dernière de ces longues dynasties qui remontaient à près de quatre millénaires -, était elle-même un métissage où le grec l’emportait sur l’égyptien.
Si
Rome avait une armée, l’Égypte avait une marine. Une marine puissante qui
tenait la Méditerranée orientale. Le jeune roi Ptolémée XIII partageait, selon
la tradition égyptienne, le royaume avec sa sœur et  épouse Cléopâtre. La fin de
la dynastie des Lagides qu’avait imposé Alexandre le Grand lors de sa conquête
du monde oriental fut une suite de tragédies shakespeariennes. Sylla, le
dictateur romain, avait plus que tout autre, interféré dans les affaires
intérieures de l’Égypte. Marié en désespoir de cause à sa propre fille,
Bérénice, qui avait déjà été l’épouse de son frère Ptolémée XI, Ptolémée X
mourut en laissant à celle-ci tout le pouvoir. Sylla se servit d’un fils de
Ptolémée XI pour créer un état de tension à Alexandrie et obliger Bérénice à
épouser celui qui allait devenir Ptolémée XII. À peine dix-neuf jours après
leur mariage, Ptolémée XII assassina Bérénice, ce qui lui valut d’être
assassiné à son tour par des soldats révoltés (80 av. J.-C.). «De ce fait la
descendance des Lagides en ligne directe se trouvait éteinte». On résolut à en
appeler à un fils bâtard de Ptolémée X, qui devint Ptolémée XIII.
épouse Cléopâtre. La fin de
la dynastie des Lagides qu’avait imposé Alexandre le Grand lors de sa conquête
du monde oriental fut une suite de tragédies shakespeariennes. Sylla, le
dictateur romain, avait plus que tout autre, interféré dans les affaires
intérieures de l’Égypte. Marié en désespoir de cause à sa propre fille,
Bérénice, qui avait déjà été l’épouse de son frère Ptolémée XI, Ptolémée X
mourut en laissant à celle-ci tout le pouvoir. Sylla se servit d’un fils de
Ptolémée XI pour créer un état de tension à Alexandrie et obliger Bérénice à
épouser celui qui allait devenir Ptolémée XII. À peine dix-neuf jours après
leur mariage, Ptolémée XII assassina Bérénice, ce qui lui valut d’être
assassiné à son tour par des soldats révoltés (80 av. J.-C.). «De ce fait la
descendance des Lagides en ligne directe se trouvait éteinte». On résolut à en
appeler à un fils bâtard de Ptolémée X, qui devint Ptolémée XIII.
Oscar de
Wertheimer, dans sa biographie de la reine Cléopâtre, fille (et/ou sœur) de Ptolémée XIII,
raconte les conditions qui firent de Ptolémée XIII le personnage retenu par
Dante comme le modèle des traîtres :
«En Égypte, Ptolémée XIII avait été élevé à la royauté en l’an 80 dans les circonstances que nous avons vues. Rome refusa de le reconnaître. Le bruit courut d’un testament du dernier Ptolémée, le protégé de Sylla, par lequel ce prince faisait de Rome l’héritière de sa couronne. Ptolémée XII avait-il réellement mis à si haut prix le concours de Sylla? Mais qu’attendait-on alors pour présenter ce testament au sénat? Les testaments jouaient un grand rôle à cette époque. […] Si
l’heure ne semblait pas encore venue de l’annexer, de la réduire au rang de province romaine, ce qui importait pour le moment était de la tenir en étroite dépendance. Dans l’annexion le sénat redoutait autre chose : confier à un légat une aussi riche province, n’était-ce pas mettre un trop grand pouvoir dans une seule main ? Que va donc faire Rome? En refusant de reconnaître Aulète, en insinuant qu’il n’est qu’un bâtard, en agitant le spectre du dernier Ptolémée et de son testament, elle fera peser sur la tête du malheureux souverain l’épée de Damoclès d’une déposition toujours pendante, et le rendra ainsi souple à ses volontés. Une telle politique servait admirablement les intérêts de Rome en assurant son influence sur l’Égypte et en préparant sa mainmise sur le pays. Mais elle ne servait pas moins les intérêts privés des maîtres de l’heure, qui en tenant le sort d’Aulète entre leurs mains avaient un moyen facile de lui extorquer constamment de l’argent. Telles furent les composantes du destin à la fois tragique et ridicule de Ptolémée XIII». (O. de Wertheimer. Cléopâtre reine des Rois, Paris, Payot, rééd. Livre de poche Col. historique, # 1159-1160, pp.62 et 63-64).
Il est difficile de nier le schisme moral qui déchirait non seulement le pharaon, mais l’ensemble de l’Égypte au premier point, puis le reste de la civilisation hellénique. La position égyptienne, depuis Ptolémée XII au moins, était strictement passive. Les dictateurs romains faisaient et défaisaient ses rois. Mais Rome ne fasait rien de plus qu’élargir son œcoumène. Rien ne se créait autrement que par des syncrétisme dont la veine était épuisée depuis longtemps. Il n’y avait plus qu’à se laisser entraîner sur la pente fatale pour l’Égypte que d’être la marionnette et pour Rome d’être le marionnettiste. Le sentiment qui naissait alors chez Ptolémée est précisément décrit par notre historien :
«Nul souverain ne fut plus craintif, plus tourmenté, plus harcelé que lui. Il était maître absolu dans son pays, c’est entendu, mais que décideraient demain les puissants de Rome? À tout instant le malheur pouvait fondre sur lui; à tout instant, sous un prétexte quelconque, Rome pouvait occuper l’Égypte. Aussi entretenait-il en permanence des agents à Rome, qui le renseignaient jour par jour sur ce qui se passait dans la capitale. Il vivait à Alexandrie dans l’abondance et la débauche, mais le bon temps des grands ancêtres était loin. Ptolémée XIII s’était surnommé lui-même Philopator (ami de son père), Philométor (ami de sa mère) et aussi
“nouveau Dionysos”. Mais le peuple l’appelait simplement Aulète, le joueur de flûte. Il y avait plus de raillerie que de respect dans ce surnom, quoique le dieu Pan parcourût les campagnes en jouant du syrinx et qu’Apollon non plus ne le dédaignât pas. Mais on rougissait d’un roi qui prenait part à des concours et se prostituait dans les fêtes, sa flûte aux lèvres, parmi les joueuses professionnelles, qui n’étaient en fin de compte que des filles publiques, des hétaïres. Il se consolait de son impuissance à tenir le sceptre en tirant de son instrument des sons plaintifs, ou, comme fera plus tard Néron, en écrivant de mauvais vers et composant de médiocres chansons. Et cependant Aulète, s’il était dépourvu des fortes qualités qui font le souverain, était sage, réfléchi et avisé» (O. de Wertheimer. Ibid. pp. 64-65).
Ne
surestimons pas la chance de Ptolémée XIII face à la situation qui le
protégeait de l’annexion romaine. L’attribution de titres ampoulés à son égard
compense le mépris populaire qui saisit parfaitement le double  sens du «joueur
de flûte» depuis que la déesse Isis ramena à la vie Osiris en suçant son pénis. Comme le roi Hérode en Palestine, Ptolémée XIII était le
jouet de Rome. Le «joueur de flûte» ne pouvait être que celui qui pratiquait
une «fellation romaine» pour rester sur son trône et en cela réside sa sagesse
et sa réflexion. Devant les exigences romaines, Ptolémée tire-au-flanc,
déserte, abandonne ce qui reste de son pouvoir en même temps que de la liberté
égyptienne, pour autant que cette liberté ait encore un sens :
sens du «joueur
de flûte» depuis que la déesse Isis ramena à la vie Osiris en suçant son pénis. Comme le roi Hérode en Palestine, Ptolémée XIII était le
jouet de Rome. Le «joueur de flûte» ne pouvait être que celui qui pratiquait
une «fellation romaine» pour rester sur son trône et en cela réside sa sagesse
et sa réflexion. Devant les exigences romaines, Ptolémée tire-au-flanc,
déserte, abandonne ce qui reste de son pouvoir en même temps que de la liberté
égyptienne, pour autant que cette liberté ait encore un sens :
«C’est cet homme, et son empire à travers lui, que la proposition de Crassus visait à frapper au cœur. Crassus proposa d’abord que l’Égypte fût astreinte à payer tribut. Mais la motion ne parut pas recevable, car après tout l’Égypte était officiellement l’alliée de Rome! Crassus demanda alors qu’elle fût purement et simplement incorporée comme province à l’empire romain. Le but caché de cette motion était de faire confier à César le commandement de la nouvelle province, de manière à lui permettre de lui fournir un gage, à lui Crassus, pour les énormes dettes qu’il avait contractées envers lui. Le parti du sénat mit cette motion en
échec, dans la crainte que les livraisons de blé de l’Égypte ne fussent exploitées par les démocrates pour leurs fins personnelles. Une année passa ainsi, tout entière occupée par les luttes intérieures. Il semblait vraiment que les hauts fonctionnaires de l’État n’eussent rien de mieux à faire que de s’empêcher et de se paralyser mutuellement dans leur action. L’année suivante, le projet de Crassus fut repris sous une autre forme, Crassus proposa de charger une commission de dix membres d’organiser les fournitures de blé de tous les territoires relevant de Rome et situés hors d’Italie. Par ce détour les décemvirs, parmi lesquels César et Crassus joueraient naturellement le rôle principal, auraient la haute main sur l’Égypte. Nouveau rejet du projet, dû encore à la résistance du sénat. Alors les démocrates agissaient en ennemis d’Aulète, et les aristocrates intervenaient pour sa défense. Mais aucun des deux partis n’agissait par haine ou affection particulière envers le roi : ils suivaient l’un comme l’autre leurs intérêts du moment, et voilà tout». (O. de Wertheimer. Ibid. pp. 65-66)
Ce qui
se passait était simple. Ptolémée XIII et l’enjeu de l’Égypte
se voyaient incorporés progressivement à l’intérieur de la guerre civile romaine. D’une part les
«démocrates», partisans des arrivistes comme Crassus et César, de l’autre les
«aristocrates», les patriciens, les sénateurs et Pompée qui maintenaient l’indépendance de l’Égypte pour ne pas la voir confiée à un
ambitieux. Pompée et le sénat sauvaient, temporairement, l’indépendance de
l’Égypte afin de contrer l’influence des démocrates. Ils tenaient l’Égypte pour
allié. Et c’est ainsi que se mettait en place le processus qui allait faire de
Ptolémée XIII le modèle des traîtres, car…
«C’est à cette époque qu’Aulète fut requis par Pompée de lever plusieurs milliers de
cavaliers en soutien des forces expédition-naires romaines en Orient. Cette mesure, s’ajoutant à la menace que le peuple sentait peser sur l’Égypte et à l’épuisement financier du pays pressuré par son roi, souleva à Alexandrie une immense émotion. Aulète n’en envoya pas moins à Pompée, en outre des cavaliers, de magnifiques présents. Mais tandis que le général romain ouvrait sa main toute grande pour les recevoir, son oreille restait fermée aux appels de détresse du souverain égyptien». (O. de Wertheimer. Ibid. p. 66).
Finalement,
c’est à Rome que le destin de l’Égypte se précipita. La formation du premier triumvirat César-Pompée-Crassus mis
Ptolémée en panique. Plus que jamais le tire-au-flanc n’avait d’autres
solutions que de «tâcher de s’arranger
avec ces nouveaux maîtres». Il s’agissait tout simplement de payer une
rançon : «Il  paierait une fois pour toutes
la somme qu’il faudrait, cela valait mieux que d’être périodiquement dépouillé
et de continuer à trembler pour sa place. Le plan réussit : Aulète fit un
traité avec César et Pompée, aux termes duquel il leur paierait une somme de
6,000 talents d’or (près de 23 millions de nos francs). En échange César
s’engageait à faire voter un projet de loi reconnaissant Aulète et le
proclamant souverain ami et allié du peuple romain. Aulète avait donc obtenu de
son plus cruel ennemi l’accomplissement du plus audacieux de ses vœux. Le fait
acquis était d’importance, mais la question égyptienne ne jouait pas encore un
rôle de premier plan dans la politique romaine» (O. de Wertheimer. Ibid. p. 68).
paierait une fois pour toutes
la somme qu’il faudrait, cela valait mieux que d’être périodiquement dépouillé
et de continuer à trembler pour sa place. Le plan réussit : Aulète fit un
traité avec César et Pompée, aux termes duquel il leur paierait une somme de
6,000 talents d’or (près de 23 millions de nos francs). En échange César
s’engageait à faire voter un projet de loi reconnaissant Aulète et le
proclamant souverain ami et allié du peuple romain. Aulète avait donc obtenu de
son plus cruel ennemi l’accomplissement du plus audacieux de ses vœux. Le fait
acquis était d’importance, mais la question égyptienne ne jouait pas encore un
rôle de premier plan dans la politique romaine» (O. de Wertheimer. Ibid. p. 68).
C’est
alors que César s’engagea dans sa campagne contre les Gaules. Retenu loin de
Rome, Crassus et son parti regardèrent à nouveau vers l'Égypte. Les
choses tournaient au vinaigre à Alexandrie et le roi dut fuir sa capitale. Il
chercha refuge auprès de Rome. Il fut reçu froidement par Crassus, mais Pompée
le reçut à bras  ouverts. Il devint littéralement le protecteur du roi en
fuite : «Il l’invita chez lui, à sa
villa d’Albano. Le geste n’était pas seulement amical : en logeant le roi
Pompée s’assurait de sa personne et en faisait l’instrument docile de sa
politique. Aulète arriva, comme il convient à un roi, avec une nombreuse suite.
Comme il lui fallait de grosses sommes pour arriver à ses fins, et que ses
sujets étaient trop loin pour pouvoir être facilement exploités, il lui fallut
bien se procurer de l’argent par d’autres moyens. Il emprunta, signa des
traites, hypothéqua son royaume. Son principal créancier était un certain
Rabirius, gros financier qui, au contraire de Crassus, n’avait pas d’ambitions
politiques. On le trouvait dans toutes les grandes entreprises; il prêtait des
capitaux à gros intérêt aux municipalités, aux gens d’affaires, aux politiciens»
(O. de Wertheimer. Ibid. p. 72).
ouverts. Il devint littéralement le protecteur du roi en
fuite : «Il l’invita chez lui, à sa
villa d’Albano. Le geste n’était pas seulement amical : en logeant le roi
Pompée s’assurait de sa personne et en faisait l’instrument docile de sa
politique. Aulète arriva, comme il convient à un roi, avec une nombreuse suite.
Comme il lui fallait de grosses sommes pour arriver à ses fins, et que ses
sujets étaient trop loin pour pouvoir être facilement exploités, il lui fallut
bien se procurer de l’argent par d’autres moyens. Il emprunta, signa des
traites, hypothéqua son royaume. Son principal créancier était un certain
Rabirius, gros financier qui, au contraire de Crassus, n’avait pas d’ambitions
politiques. On le trouvait dans toutes les grandes entreprises; il prêtait des
capitaux à gros intérêt aux municipalités, aux gens d’affaires, aux politiciens»
(O. de Wertheimer. Ibid. p. 72).
Là où le
capitalisme mène la règle du jeu, là le sang coule : «À peine les gens d’Alexandrie eurent-ils
appris que leur roi était à Rome et y travaillait à sa restauration qu’ils
envoyèrent une députation de  cent membres, sous la direction du savant Dion,
pour protester contre cette entreprise. Au moment où la délégation venait de
débarquer à Pouzzoles, le grand port romain de Campanie qui assurait les
relations avec l’Orient, elle fut traîtreusement assaillie par des assassins à
gages; un grand nombre de ses membres périrent; d’autres s’enfuirent et
parvinrent à Rome. Ces quelques survivants furent facilement circonvenus ou
achetés. Leur chef lui-même, Dion le philosophe, se tut; il logeait chez un
Romain du nom de Luccius qu’il connaissait d’Alexandrie» (O. de Wertheimer.
Ibid. p. 73). L’alliance de
Pompée-Ptolémée se voyait maintenant marquée du sceau du sang.
cent membres, sous la direction du savant Dion,
pour protester contre cette entreprise. Au moment où la délégation venait de
débarquer à Pouzzoles, le grand port romain de Campanie qui assurait les
relations avec l’Orient, elle fut traîtreusement assaillie par des assassins à
gages; un grand nombre de ses membres périrent; d’autres s’enfuirent et
parvinrent à Rome. Ces quelques survivants furent facilement circonvenus ou
achetés. Leur chef lui-même, Dion le philosophe, se tut; il logeait chez un
Romain du nom de Luccius qu’il connaissait d’Alexandrie» (O. de Wertheimer.
Ibid. p. 73). L’alliance de
Pompée-Ptolémée se voyait maintenant marquée du sceau du sang.
Dion fut
bientôt assassiné et Ptolémée prit peur. Il devint alors un errant dans les
différents ports du Moyen-Orient. Pompée, qui le gardait comme une carte en
réserve, parvint à lui faire restituer son trône à l'aide de légions romaines qui s'installèrent à demeure et devaient, finalement, se retourner contre lui. Car le pacte des
triumvirs était rompu. Crassus mort, César et Pompée s’affrontèrent dans une
bataille décisive, à Pharsale  «sa chute
laissa ses partisans anéantis. L’homme qui avait écrasé le soulève-
«sa chute
laissa ses partisans anéantis. L’homme qui avait écrasé le soulève-
ment de Spartacus, dispersé les pirates, vaincu le grand Mithridate, l’homme qui incarnait aux yeux de l’Orient la force et la grandeur romaine, Pompée était vaincu en dépit d’une évidente supériorité de force!» (O. de Wertheimer. Ibid. pp. 77-78). Voilà que Ptolémée avait récupéré son royaume et que Pompée était, à son tour, chassé de la République. Après de nombreuses tribulations, il décida d’aller chercher refuge auprès de celui qu’il avait protégé contre l’avidité de César et les ambitions de Crassus. Avec Pharsale, c’était au tour de Pompée de connaître ce sentiment qui terrorisait Ptolémée, celui du sentiment de la pente fatale : «cette sensation de vide, de totale impuissance dut lui faire apparaître son malheur comme définitif. Il s’enfuit de la mêlée, se réfugie dans son camp, jette son écharpe de commandement et demeure abattu, sans voix, la main fixe, le cerveau absent» (O. de Wertheimer. Ibid. p. 78).
Pour
l’heure, l’Égypte était en pleine guerre civile elle aussi. Ptolémée XIII
s’opposait à sa fille (ou sa sœur, les sources sont contradictoires) CléopâtreVII, la célèbre reine. Pompée ne se rendit pas directement à  Alexandrie mais vers
la côte, près de Péluse, où campait l’armée de Ptolémée. «Et c’est alors que furent commis la trahison et le crime, l’assassinat
de Pompée dans le petit bateau qui servait au débarquement. Le meurtre fut
accompli par l’officier “gabinien” [du nom du proconsul romain Gabinius
placé à Alexandrie par Rome] Septimius,
par ordre de la cabale du palais, et sous les yeux d’Achillas, qui avait
lui-même pris place dans le bateau pour surveiller l’exécution de ses ordres.
[…] Ptolémée, drapé dans sa chlamyde de pourpre était sur la côte, d’où il
observait la scène (septembre 48 av. J.-C.)» (E. Bevan. Histoire des Lagides, Paris, Payot, 1934, pp. 403-404). Ce conseil comprenait
Pothin et Théodote, deux cabalistes ralliés à César sous le prétexte, selon
Plutarque, que «recevoir Pompée, c’est se
donner César pour ennemi et Pompée pour maître; le repousser, c’est faire
que Pompée nous en voudra de l’avoir chassé, et César d’être obligé de le
poursuivre. Le mieux est donc de l’envoyer chercher et de le faire périr.
Ainsi, nous obligerons l’un sans avoir à redouter l’autre. Et il ajoute,
dit-on, en souriant : un mort ne mord pas» (Cité in E. Bevan. Ibid. p. 404, n. 1).
Alexandrie mais vers
la côte, près de Péluse, où campait l’armée de Ptolémée. «Et c’est alors que furent commis la trahison et le crime, l’assassinat
de Pompée dans le petit bateau qui servait au débarquement. Le meurtre fut
accompli par l’officier “gabinien” [du nom du proconsul romain Gabinius
placé à Alexandrie par Rome] Septimius,
par ordre de la cabale du palais, et sous les yeux d’Achillas, qui avait
lui-même pris place dans le bateau pour surveiller l’exécution de ses ordres.
[…] Ptolémée, drapé dans sa chlamyde de pourpre était sur la côte, d’où il
observait la scène (septembre 48 av. J.-C.)» (E. Bevan. Histoire des Lagides, Paris, Payot, 1934, pp. 403-404). Ce conseil comprenait
Pothin et Théodote, deux cabalistes ralliés à César sous le prétexte, selon
Plutarque, que «recevoir Pompée, c’est se
donner César pour ennemi et Pompée pour maître; le repousser, c’est faire
que Pompée nous en voudra de l’avoir chassé, et César d’être obligé de le
poursuivre. Le mieux est donc de l’envoyer chercher et de le faire périr.
Ainsi, nous obligerons l’un sans avoir à redouter l’autre. Et il ajoute,
dit-on, en souriant : un mort ne mord pas» (Cité in E. Bevan. Ibid. p. 404, n. 1).
Le récit original du crime reste celui de Plutarque (Ier siècle apr. J.-C.) qui devait inspirer plus tard la célèbre pièce de Corneille, La mort de Pompée :
«L’abominable plan fut suivi de point en point. Pendant que les envoyés de Pompée allaient porter à leur maître l’invitation royale, Achillas, accompagné de deux officiers gabiniens qui avaient accepté ce triste rôle, le tribun militaire L. Septimius
et le centurion Salvius, et de trois ou quatre valets, Achillas, dis-je, monta dans une simple barque de pêcheur, où il n’y avait plus de place que pour quelques personnes. C’était une précaution prise pour isoler Pompée et prévenir toute résistance de sa part. En même temps, l’armée se déployait sur le rivage, le roi, vêtu de pourpre, au milieu et les vaisseaux de guerre se garnissaient de leurs équipages. Ces allures étranges, tant de pompe, d’une part, de l’autre, une mauvaise barque pour aller chercher l’hôte du roi, parurent suspectes aux amis de Pompée. Il était encore temps de fuir : Pompée attendit. Cependant le bateau s’approcha, et Septimius, s’étant levé le premier, salua Pompée en latin du titre d’imperator. Achillas lui fit ses politesses en grec et l’invita à descendre dans la barque, sous prétexte qu’il y avait beaucoup de bas-fonds, et que, à cause des bancs de sable, la mer n’avait pas assez d’eau pour porter une trière. Pompée embrasse Cornélie [sa femme] qui le pleurait déjà comme perdu, et il ordonne à deux centurions de sa suite à son affranchi Philippe et à un serviteur nommé Scythès, d’embarquer avant lui. Au moment où Achillas lui tendait la main du bateau, se retournant vers sa femme et son fils, il prononça ces vers de Sophocle : “Tout homme qui entre chez un tyran est son esclave, y fût-il venu libre”. Ce furent les dernières paroles qu’il adressa aux siens, et il entra dans la barque.
La distance était longue de la trière au rivage. Comme, durant le trajet, personne ne lui adressait un mot aimable, il se tourna vers Septimius. “N’avons-nous pas”, dit-il, “si je ne me trompe, fait la guerre ensemble?” Septimius ne fit qu’un signe de tête, sans une parole, sans marque d’intérêt. Il se fit de nouveau un profond silence. Pompée prit un petit cahier où il avait écrit un discours en grec qu’il se proposait d’adresser à Ptolémée, et se mit à lire. Lorsqu’ils furent près de terre, Cornélie, inquiète, regardait avec ses amis, du haut de la trière, ce qui allait arriver. Elle commençait à se rassurer en voyant les gens du roi venir en foule au débarquement, comme pour le recevoir avec honneur. À ce moment, Pompée prenait la main de Philippe pour se lever plus facilement. Septimius lui porte par derrière un premier coup d’épée au travers du corps; puis Salvius après lui, puis Achillas tirèrent leurs coutelas. Pompée, prenant sa toge des deux mains, s’en couvre le visage, et, sans rien dire ni faire d’indigne de lui, poussant simplement un soupir, s’abandonne à leurs coups» (Cité in E.Bevan. ibid. p. 404, n. 2).
Pour être
moins pathétique que le récit d’Ugolino, celui de Plutarque rend bien tout le
tragique de la situation. Achillas trancha la tête de Pompée afin de la porter à César, ce qui ne sera pas suffisant pour convaincre le dictateur de retourner à Rome. César continua donc son avance vers l'Égypte. Tant qu'au corps, lavé, il fut  brûlé sur un bûcher. Deux tires-au-flanc se retrou-
brûlé sur un bûcher. Deux tires-au-flanc se retrou-
vaient et dans le but de complaire à César et déjà dévoré par la peur, l'un sacrifia son ancien protecteur de la plus lâche manière. Et comme toutes les solutions passives, ce meurtre ne ramena pas la sécurité sur l’Égypte. Ptolémée XIII se serait noyé accidentellement le 15 janvier 47 av. J.-C., laissant régner côte à côte Cléopâtre et son jeune frère Ptolémée XIV. Suivant l’exemple de son père (ou son frère), Cléopâtre devint la maîtresse de César jusqu’à lui donner un fils. Il sera échu à Octave, lors de sa victoire à Actium sur la flotte égyptienne ralliée au parti de Marc-Antoine de faire passer l’annexion pleine et entière de l’Égypte dans l’Empire romain.
Tout au long de cette histoire, sur laquelle nous nous sommes attardés, nous rencontrons l’exactitude de l’explication de Toynbee sur les mécanismes de la traîtrise. D’une part, le mouvement d’abandon, renforcé par l’acte de désertion sous l’impulsion d’un sentiment d’entraînement fatal frappe aussi bien le destin égyptien que la Fortuna du règne de Ptolémée XIII. Il en va de même de Pompée. Pharsale, malgré la supériorité en forces de Pompée, concrétise le sentiment fatal. Pompée déserte comme Ptolémée avant lui. Il cherche refuge auprès du roi restauré et celui-ci, toujours apeuré par la force romaine, fait tuer son invité sous ses yeux. Il apparaît impossible de restaurer le sens de l’unité perdu et pallier à la faillite de l’auto-détermination. Une auto-détermination depuis longtemps perdue en Égypte et un double schisme du corps et de l’âme dans le camp hellénique.
Ce qui
enracine le sentiment d’entraînement fatal ici, c'est l'accumulation des circonstances. La
logique conjoncturelle de l’histoire qui précipite aussi bien un passif
(Ptolémée XIII) qu’un actif (Pompée) dans la  pente irrémédiable de la faillite
de l’auto-détermination, fait de la déroute une véritable structure, une «nécessité» qui génère une telle
attitude. L’angoisse d’être porté par un courant fataliste s’empare de tous
ceux pour qui la Fortuna ne semble
pas avoir élu. La supériorité des forces romaines viendra à bout d’une
civilisation multimillénaire tandis que les siècles commencent déjà à être
comptés pour l’imperium romain
lui-même.
pente irrémédiable de la faillite
de l’auto-détermination, fait de la déroute une véritable structure, une «nécessité» qui génère une telle
attitude. L’angoisse d’être porté par un courant fataliste s’empare de tous
ceux pour qui la Fortuna ne semble
pas avoir élu. La supériorité des forces romaines viendra à bout d’une
civilisation multimillénaire tandis que les siècles commencent déjà à être
comptés pour l’imperium romain
lui-même.
N’empêche,
la trahison de Ptolémée XIII est devenue un moyen, une stratégie de faibles dans
les conditions qui étaient celles à son avènement sur le trône égyptien.
Paradoxalement, sa passivité a joué en sa faveur  même si elle en a fait un hère
méprisé et méprisable. La justification idéologique des traîtres est d’affirmer
ostensiblement que leur «stratégie» était la bonne et qu’elle bénéficie au plus
grand nombre. Il ne s’agit plus de vertu, d’honneurs, de dignité, mais de
survie, de tirer son épingle du jeu ou les marrons du feu. Voilà pourquoi
le fanatisme, le terrorisme et le martyre sont les opposés de la désertion passive. Les excès contraires sont motivés par de mêmes angoisses, de mêmes
craintes et un même effondrement moral. Le dédoublement interne de la
collectivité se polarise sur deux figures qui assurent que leur seule stratégie
peut sauver le sens de l’unité perdu et restaurer l’auto-détermination du
groupe contre ses voisins envahissants ou oppressants. Il ne s’est trouvé aucun
fanatique pour sacrifier sa vie pour Ptolémée ou celle de Pompée. Non seulement
la passivité animait les individus, mais elle baignait tout l’ensemble
civilisationnel.
même si elle en a fait un hère
méprisé et méprisable. La justification idéologique des traîtres est d’affirmer
ostensiblement que leur «stratégie» était la bonne et qu’elle bénéficie au plus
grand nombre. Il ne s’agit plus de vertu, d’honneurs, de dignité, mais de
survie, de tirer son épingle du jeu ou les marrons du feu. Voilà pourquoi
le fanatisme, le terrorisme et le martyre sont les opposés de la désertion passive. Les excès contraires sont motivés par de mêmes angoisses, de mêmes
craintes et un même effondrement moral. Le dédoublement interne de la
collectivité se polarise sur deux figures qui assurent que leur seule stratégie
peut sauver le sens de l’unité perdu et restaurer l’auto-détermination du
groupe contre ses voisins envahissants ou oppressants. Il ne s’est trouvé aucun
fanatique pour sacrifier sa vie pour Ptolémée ou celle de Pompée. Non seulement
la passivité animait les individus, mais elle baignait tout l’ensemble
civilisationnel.
Cela fait
paraître les trahisons occasionnelles, comme celles retenues dans l’Italie du
Dante, comme une  affaire de «personnalités» et non de symptôme du corps social
lui-même. Que le prince Eugène de Savoie (1663-1736), par dépit, délaisse Louis
XIV pour se mettre au service des Habsbourg, c’est une affaire strictement
personnelle. Il en va de même du général Bernadotte, une fois que Napoléon l’a
fait roi de Suède sous le titre de Charles XIV et qu’ensuite il se porte aux côtés des alliés pour combattre l’empereur, là encore c’est une «trahison»
stratégique. Le sentiment de la pente fatale qui attend la collectivité est
parfois dominée par l’attitude active. Voilà pourquoi les puissances vainqueurs
sécrètent peu de traîtres en leur sein. Prenons les Etats-Unis d’Amérique. Si
Benedict Arnold est devenu le modèle des traîtres, les
affaire de «personnalités» et non de symptôme du corps social
lui-même. Que le prince Eugène de Savoie (1663-1736), par dépit, délaisse Louis
XIV pour se mettre au service des Habsbourg, c’est une affaire strictement
personnelle. Il en va de même du général Bernadotte, une fois que Napoléon l’a
fait roi de Suède sous le titre de Charles XIV et qu’ensuite il se porte aux côtés des alliés pour combattre l’empereur, là encore c’est une «trahison»
stratégique. Le sentiment de la pente fatale qui attend la collectivité est
parfois dominée par l’attitude active. Voilà pourquoi les puissances vainqueurs
sécrètent peu de traîtres en leur sein. Prenons les Etats-Unis d’Amérique. Si
Benedict Arnold est devenu le modèle des traîtres, les  «trahisons» successives des officiers Bradley Manning et
Edward Snowden, qui ont révélé au grand publique américain les agissements des
appareils d’État comme la CIA et le NSA dans les attaques vicieuses
en Afghanistan et en Irak et la surveillance des citoyens américains, partagent le
sentiment intime que leur pays glisse sur une pente fatale; accepte de déserter
leur poste; se sentent revêtus du fardeau du «péché» de leur pays face à ses
propres idéaux, ses principes «sacrés», et sa «nécessité» historique.
«trahisons» successives des officiers Bradley Manning et
Edward Snowden, qui ont révélé au grand publique américain les agissements des
appareils d’État comme la CIA et le NSA dans les attaques vicieuses
en Afghanistan et en Irak et la surveillance des citoyens américains, partagent le
sentiment intime que leur pays glisse sur une pente fatale; accepte de déserter
leur poste; se sentent revêtus du fardeau du «péché» de leur pays face à ses
propres idéaux, ses principes «sacrés», et sa «nécessité» historique.
Benedict
Arnold s’est fait une réputation de traître dans l’histoire américaine pour
avoir livré West Point aux Anglais lors de la guerre d’Indépendance.
Contrairement à Cugnet, le Français qui aurait indiqué aux Anglais le passage
de l’Anse-aux-Foulons en 1759, précédant la bataille des  Plaines d’Abraham,
Arnold a laissé une trace consciente et fort vivace dans la mythologie
américaine. Ancien apothicaire puis libraire du Connecticut, Benedict Arnold (1741-1801) fut un officier courageux et audacieux de la jeune république américaine. Officier vaillant, il s'empara du fort Ticonderoga (1775), participa au siège de Québec qui fut fatal à son supérieur, le général Montgomery (31 décembre 1775), enfin défit Burgoyne à la bataille de Saratoga en 1777, victoire décisive qui invita les Français et les Espagnols à appuyer les treize colonies rebelles contre leur mère-patrie. En juin 1778, il épousa la fille d'un Loyaliste, adversaire de la révolution, au moment même où il se vit l'objet de griefs de toutes sortes de la part de collègues qui cherchaient à obtenir un vote de blâme de la part du Congrès. Disgracié des hautes fonctions militaires qu'il détenait, Washington, qui l'estimait quand même beaucoup, lui confia le commandement du fort de West Point, poste-clé sur le fleuve Hudson, défense de la ville de New York, occupée alors par les troupes britanniques de sir Henry Clinton. Toujours à court d'argent à cause de dépenses smptuaires, Arnold se figurait-il vraiment «que la possession de l'Hudson jointe aux points d'appui que les Anglais avaient pris dans le Sud, terminerait promptement la guerre en leur faveur, et qu'alors il deviendrait le héros de l'heure?» (H. W. Elson. Histoire des États-Unis, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1930, p. 285). Chimère que tout cela! Depuis l'alliance française et la bataille de Monmouth (28 juin 1778), le sort des états du Nord était scellé en faveur des révolutionnaires. Autre chose eut été les conséquences de la trahison au début de la guerre d'Indépendance.
Plaines d’Abraham,
Arnold a laissé une trace consciente et fort vivace dans la mythologie
américaine. Ancien apothicaire puis libraire du Connecticut, Benedict Arnold (1741-1801) fut un officier courageux et audacieux de la jeune république américaine. Officier vaillant, il s'empara du fort Ticonderoga (1775), participa au siège de Québec qui fut fatal à son supérieur, le général Montgomery (31 décembre 1775), enfin défit Burgoyne à la bataille de Saratoga en 1777, victoire décisive qui invita les Français et les Espagnols à appuyer les treize colonies rebelles contre leur mère-patrie. En juin 1778, il épousa la fille d'un Loyaliste, adversaire de la révolution, au moment même où il se vit l'objet de griefs de toutes sortes de la part de collègues qui cherchaient à obtenir un vote de blâme de la part du Congrès. Disgracié des hautes fonctions militaires qu'il détenait, Washington, qui l'estimait quand même beaucoup, lui confia le commandement du fort de West Point, poste-clé sur le fleuve Hudson, défense de la ville de New York, occupée alors par les troupes britanniques de sir Henry Clinton. Toujours à court d'argent à cause de dépenses smptuaires, Arnold se figurait-il vraiment «que la possession de l'Hudson jointe aux points d'appui que les Anglais avaient pris dans le Sud, terminerait promptement la guerre en leur faveur, et qu'alors il deviendrait le héros de l'heure?» (H. W. Elson. Histoire des États-Unis, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1930, p. 285). Chimère que tout cela! Depuis l'alliance française et la bataille de Monmouth (28 juin 1778), le sort des états du Nord était scellé en faveur des révolutionnaires. Autre chose eut été les conséquences de la trahison au début de la guerre d'Indépendance.
«Quoi qu'il en soit, Arnold accepta des pourparlers secrets avec Clinton par l'intermédiaire d'un certain major André qui fut capturé un soir par des soldats américains. On trouva, dans l'une de ses bottes, la correspondance compromettante, ce
qui avorta la trahison. Arnold put s'enfuir en Angleterre pendant qu'André se balançait au bout d'une corde. Washington se montra navré et les patriotes scandalisés de la trahison de Arnold, mais leur cause n'en souffrit pas. Pas plus qu'elle ne souffrit des tentatives avortées de Clinton et de ses comparses pour convertir à la cause royale des patriotes comme Ethan Allen, Philip Schuyler, John Sullivan et le général Samuel Holden Parsons, du Connecticut. En définitive, les manœuvres de corruption des Anglais s’avérèrent moins efficaces que leurs armes» (J. R. Alden. La guerre d’indépendance, Paris, Seghers, Col. Vent d’ouest, # 12, 1965, p. 307).
Même
si elle eut lieu dans un contexte exacerbé de fièvre obsidionale,
lorsque les troupes anglaises occupaient l'ensemble des états du Nord,
la trahison de Arnold impressionna suffisamment l'affect répulsif pour
scandaliser les combattants de la Révolution. D'autres traîtres, moins
célèbres et plus symboliques que  dangereux, furent affublés d'un même symbole de répulsion, tel Aaron Burr qui, après avoir tué en duel le
brillant avocat Alexander Hamilton, l'un des principaux artisans de la
Constitution américaine, voulut détacher une partie de l'ouest américain
en vue d'y instaurer un empire personnel, aventure qui échoua de
manière burlesque en 1805 lorsque son complice, le général Wilkinson,
vendit la mèche au président
dangereux, furent affublés d'un même symbole de répulsion, tel Aaron Burr qui, après avoir tué en duel le
brillant avocat Alexander Hamilton, l'un des principaux artisans de la
Constitution américaine, voulut détacher une partie de l'ouest américain
en vue d'y instaurer un empire personnel, aventure qui échoua de
manière burlesque en 1805 lorsque son complice, le général Wilkinson,
vendit la mèche au président  Jefferson. Enfin, le poète Ezra Pound
(1885-1972), qui osa animer des émissions radiophoniques de propagande
en faveur de Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale fut affligé de
charges de trahison déposées contre lui, mais qui furent plus tard
retirées. On le voit, c'est parce qu'ils se sentaient attiré par un
mouvement d'ascension et non une pente fatale, même aux pires moments de
la guerre contre une puissance beaucoup plus forte, plus riche et mieux
équipée que les indépendantistes américains évitèrent le piège de
l'action passive des traîtres.
Jefferson. Enfin, le poète Ezra Pound
(1885-1972), qui osa animer des émissions radiophoniques de propagande
en faveur de Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale fut affligé de
charges de trahison déposées contre lui, mais qui furent plus tard
retirées. On le voit, c'est parce qu'ils se sentaient attiré par un
mouvement d'ascension et non une pente fatale, même aux pires moments de
la guerre contre une puissance beaucoup plus forte, plus riche et mieux
équipée que les indépendantistes américains évitèrent le piège de
l'action passive des traîtres.













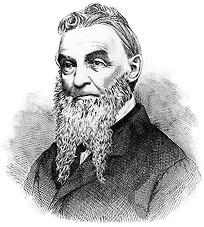



















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire