 |
| Jeune Martiniquais regardant les ruines de Saint-Pierre, 1902 |
 torpiller les projets du
seigneur de Ferrare, répandit contre lui les accu-
torpiller les projets du
seigneur de Ferrare, répandit contre lui les accu-sations les plus ou-
tragean-
tes. Le temps de sa magis-
trature étant expiré, del Cassero fut mandé à Milan par Maffeo Visconti pour y remplir d’identiques fonctions. C’est lorsqu’il se rendait dans cette ville, passant à Oriaco, entre Venise et Padoue, qu’il fut assailli et tué par les sicaires d’Azzon. C’est ainsi que Portirelli nous livre l’histoire du podestat. On raconte qu’en s’enfuyant, del Cassero se serait embarrassé les pieds dans les boues et les joncs d’un marais où il avait cherché un refuge, devenant ainsi une proie facile pour ses poursuivants. Il est certain que la stratégie de Cassero lui valut une haine indéfectible de la part d’Azzon III et que sa mort gratuite et violente en fut le résultat. Répandre inutilement du mal sur un ennemi n’est pas le meilleur moyen de se faire apprécier, et les campagnes négatives dont nous sommes témoins aujourd’hui lors de scrutins démocratiques n’aident pas à faire apprécier la qualité de jugement des électeurs qui y adhèrent.
 L’historien Tomassi a voulu discréditer la légende en
affirmant, dans son Histoire de Sienne, que
le comte Nello, son époux, ne se porta contre elle à un tel excès que pour
satisfaire son désir de passer à de secondes noces en épousant la comtesse
Marguerite de Santa Fiora, jeune et riche. Néanmoins, une autre version, la
plus accréditée peut-être parce qu’elle est la plus odieuse, la Pia,
coupable envers son mari, aurait été surprise et emmenée par lui dans la
Maremme. Alors livrée à l’action lente, mais certaine de cet air pestilentiel,
elle aurait expié, par une longue agonie suivie de la mort, l’outrage fait à un
époux respectable. Ce supplice atroce, commis avec un tel sang-froid, n’est
pourtant pas repris par tous. Bref, le Dante nous laisse dans l’incertitude,
sinon que la Pia fut bien tuée par son époux. Adultère ou convoitise de la part
de l’une ou de l’autre? le résultat est le même. Les uns n’existent que dans la
mesure où ils sont utiles pour les caprices des autres.
L’historien Tomassi a voulu discréditer la légende en
affirmant, dans son Histoire de Sienne, que
le comte Nello, son époux, ne se porta contre elle à un tel excès que pour
satisfaire son désir de passer à de secondes noces en épousant la comtesse
Marguerite de Santa Fiora, jeune et riche. Néanmoins, une autre version, la
plus accréditée peut-être parce qu’elle est la plus odieuse, la Pia,
coupable envers son mari, aurait été surprise et emmenée par lui dans la
Maremme. Alors livrée à l’action lente, mais certaine de cet air pestilentiel,
elle aurait expié, par une longue agonie suivie de la mort, l’outrage fait à un
époux respectable. Ce supplice atroce, commis avec un tel sang-froid, n’est
pourtant pas repris par tous. Bref, le Dante nous laisse dans l’incertitude,
sinon que la Pia fut bien tuée par son époux. Adultère ou convoitise de la part
de l’une ou de l’autre? le résultat est le même. Les uns n’existent que dans la
mesure où ils sont utiles pour les caprices des autres. auditeur de rote et le tua sur son siège même, lui
coupant la tête qu’il emporta hors de Rome en s’enfu-
auditeur de rote et le tua sur son siège même, lui
coupant la tête qu’il emporta hors de Rome en s’enfu-yant : «C’estoit, dit Grangier, un grand voleur, mais libéral tout outre, si bien qu’il ne desroboit à autre intention que pour donner aux uns et aux autres; n’ayant jamais tué ou permis que l’on tuast un prisonnier qui venoit entre ses mains, mais vouloit qu’eux-mesmes se missent à rançon, et puys leur en rendoit une bonne partie; ce qu’entendant le pape Boniface, le fit venir à Romme, et l’honora du titre de chevalier, lui donnant moyen de vivre honorablement suivant sa qualité». Ce fait servit de précédent pour ses successeurs, car on a vu des bandits célèbres, achetés par le gouvernement trop faible pour les punir, être parfois chargés de la police des chemins où ils avaient exercé leurs brigandages. On a qu’à penser à Vidocq, ancien bandit recruté sous la Restauration comme chef de police.
 Ce type de meurtre sanglant et vindicatif alterne, parmi ceux qui entourent Dante, avec des actes de
violence où la passion conduit de manière burlesque à des destins tragiques.
Voici Cione ou Ciacco de’ Tarlati, d’une famille noble et puissante d’Arezzo.
En poursuivant les Bostoli, ses ennemis, son cheval l’emporta dans l’Arno où il
se noya. J’ignore si le vocable «tarla, ou tarlais» pour désigner un maladroit
ne viendrait pas de ce Cione de’ Tarlati! Puis, c’est au tour de Frederigo
Novello, fils du comte Guiddode Battifolle. Il aurait été tué traitreusement,
selon Volpi, par un de la famille Bostoli, surnommé il Fornainolo, le Boulanger.
Ce type de meurtre sanglant et vindicatif alterne, parmi ceux qui entourent Dante, avec des actes de
violence où la passion conduit de manière burlesque à des destins tragiques.
Voici Cione ou Ciacco de’ Tarlati, d’une famille noble et puissante d’Arezzo.
En poursuivant les Bostoli, ses ennemis, son cheval l’emporta dans l’Arno où il
se noya. J’ignore si le vocable «tarla, ou tarlais» pour désigner un maladroit
ne viendrait pas de ce Cione de’ Tarlati! Puis, c’est au tour de Frederigo
Novello, fils du comte Guiddode Battifolle. Il aurait été tué traitreusement,
selon Volpi, par un de la famille Bostoli, surnommé il Fornainolo, le Boulanger..JPG) haut niveau de
compor-
haut niveau de
compor-tement, au stade de Kohlberg, était peu courant à une époque où la loi du talion pré-
dominait et la vendetta la façon la plus courante de résoudre les conflits entre familles. Puis vient le comte Orso. On disait d’Orso qu’il était de la famille des Alberti et qu’il fut tué en trahison par les siens. D’autres, au contraire, prétendent qu’il ait été fils du comte Napoléone de Carbaïa, et disent qu’il fut tué par son oncle, le comte Alberto de Mangona. Tous ces noms n’ont cessé d’intriguer les enquêteurs de la petite histoire italienne tant elle foisonne de noms et de crimes locaux sordides.
 l’envie. De plus, n’avait-il pas
accusé lui-même la reine, sans preuves, d’avoir empoisonné le prince Louis,
l’aîné des enfants royaux du premier mariage? La reine Marie n’avait donc fait
qu’user de représailles. Selon Achille Jubinal, Pierre de La Brosse n’aurait
pas la basse extraction qu’on lui aurait attribué. Ses ancêtres auraient pris
leur nom d’un lieu noble en Touraine, appelé la Broce, et lui-même, loin d’avoir été le barbier de saint Louis,
était intitulé dans une ordonnance du roi, rendue en 1248, «escuyer ou officier
domestique en la maison royale». Après avoir épousé Philippa de Saint-Venant,
il reçut du roi la châtellenie de Nogent-le-Roi; puis le monarque le nomma
chambellan, charge dans laquelle il fut confirmé par Philippe le Hardi. On
terminera ce tour d’horizon avec cette âme lombarde qui se nommerait Sordel ou
Sordello. Né à Mantoue (qui n’est pas en Lombardie pourtant), nous ne savons
l’envie. De plus, n’avait-il pas
accusé lui-même la reine, sans preuves, d’avoir empoisonné le prince Louis,
l’aîné des enfants royaux du premier mariage? La reine Marie n’avait donc fait
qu’user de représailles. Selon Achille Jubinal, Pierre de La Brosse n’aurait
pas la basse extraction qu’on lui aurait attribué. Ses ancêtres auraient pris
leur nom d’un lieu noble en Touraine, appelé la Broce, et lui-même, loin d’avoir été le barbier de saint Louis,
était intitulé dans une ordonnance du roi, rendue en 1248, «escuyer ou officier
domestique en la maison royale». Après avoir épousé Philippa de Saint-Venant,
il reçut du roi la châtellenie de Nogent-le-Roi; puis le monarque le nomma
chambellan, charge dans laquelle il fut confirmé par Philippe le Hardi. On
terminera ce tour d’horizon avec cette âme lombarde qui se nommerait Sordel ou
Sordello. Né à Mantoue (qui n’est pas en Lombardie pourtant), nous ne savons
 pratiquement rien de lui. On soupçonne qu’il fut gibelin et bien considéré de
son parti. De génération en génération, les historiens, les auteurs de recueils
d’anecdotes ou de chants ont galvaudé une vie de Sordello. Ce qui reste de
certain à travers ce fatras, c’est qu’il a été un des troubadours italiens qui se
sont le plus illustrés dans la langue et dans la poésie des Provençaux. Son
chant élégiaque sur la mort de Blacas, chevalier également renommé comme preux
et comme troubadour, indique qu’il florissait au commencement du règne de saint
Louis, c’est-à-dire à l’époque où la littérature du midi brillait de tout son
éclat. On n’hésita pas à lui associer des faits merveilleux et qui rendait
encore moins crédible ce qu’on racontait sur son compte. Sa rencontre au
Purgatoire par le Dante est celle d’un poète avec un autre poète après un
cortège d’hommes militaires et de princes fous ou assassins.
pratiquement rien de lui. On soupçonne qu’il fut gibelin et bien considéré de
son parti. De génération en génération, les historiens, les auteurs de recueils
d’anecdotes ou de chants ont galvaudé une vie de Sordello. Ce qui reste de
certain à travers ce fatras, c’est qu’il a été un des troubadours italiens qui se
sont le plus illustrés dans la langue et dans la poésie des Provençaux. Son
chant élégiaque sur la mort de Blacas, chevalier également renommé comme preux
et comme troubadour, indique qu’il florissait au commencement du règne de saint
Louis, c’est-à-dire à l’époque où la littérature du midi brillait de tout son
éclat. On n’hésita pas à lui associer des faits merveilleux et qui rendait
encore moins crédible ce qu’on racontait sur son compte. Sa rencontre au
Purgatoire par le Dante est celle d’un poète avec un autre poète après un
cortège d’hommes militaires et de princes fous ou assassins. négligences qui conduisent à des
morts tragiques, et de là au Purgatoire. Voici un podestat qui s’attire une
haine personnelle inutile et qui le conduira à la mort; un autre est tué et
décapité loin de chez lui par la vengeance d’un bandit pour le meurtre de son
frère; une femme est tirée par les jambes par un mari cocu ou en attente d’un
second mariage. Un arriviste est tué par la jalousie d’une reine qui ne peut
supporter son arrogance et ses accusations. Les faits sont malheureux, mais
mineurs dans l’ensemble sur le parcours de la grande Histoire. Dante le sait. Mais
il n’en a cure. Comme Machiavel plus tard, il se veut un moraliste. Non du
pouvoir certes – il ne veut pas enseigner comment prendre le contrôle de l’État
ni le maintenir contre ses ennemis -, mais il veut montrer qu’en toutes
situations, il faut être avisé des conséquences possibles des gestes posés. Y
déroger, c’est de la pure négligence. Pire, dirait Talleyrand, des fautes à ne
pas commettre.
négligences qui conduisent à des
morts tragiques, et de là au Purgatoire. Voici un podestat qui s’attire une
haine personnelle inutile et qui le conduira à la mort; un autre est tué et
décapité loin de chez lui par la vengeance d’un bandit pour le meurtre de son
frère; une femme est tirée par les jambes par un mari cocu ou en attente d’un
second mariage. Un arriviste est tué par la jalousie d’une reine qui ne peut
supporter son arrogance et ses accusations. Les faits sont malheureux, mais
mineurs dans l’ensemble sur le parcours de la grande Histoire. Dante le sait. Mais
il n’en a cure. Comme Machiavel plus tard, il se veut un moraliste. Non du
pouvoir certes – il ne veut pas enseigner comment prendre le contrôle de l’État
ni le maintenir contre ses ennemis -, mais il veut montrer qu’en toutes
situations, il faut être avisé des conséquences possibles des gestes posés. Y
déroger, c’est de la pure négligence. Pire, dirait Talleyrand, des fautes à ne
pas commettre. Il en est ainsi des princes qui ont des ambitions spirituelles et
qui ne voient pas au bon fonctionnement de l’État et des mœurs. Pour Machiavel,
ce serait là le comble de l’incompétence. Qui ambitionne les choses de ce monde
ne doit pas se laisser divertir par celles de l’autre. L’État est chose
terrestre et profondément humaine. Ceux qui placent les aspirations au-dessus
des contraintes, si noble que soit l’intention, courent de risques sérieux de
voir tout s’effondrer autour d’eux et finalement les emporter – avec leurs
rêves impossibles – dans le cours du fleuve du temps.
Il en est ainsi des princes qui ont des ambitions spirituelles et
qui ne voient pas au bon fonctionnement de l’État et des mœurs. Pour Machiavel,
ce serait là le comble de l’incompétence. Qui ambitionne les choses de ce monde
ne doit pas se laisser divertir par celles de l’autre. L’État est chose
terrestre et profondément humaine. Ceux qui placent les aspirations au-dessus
des contraintes, si noble que soit l’intention, courent de risques sérieux de
voir tout s’effondrer autour d’eux et finalement les emporter – avec leurs
rêves impossibles – dans le cours du fleuve du temps. individualité de l’histoire. Le pharaon Aménophis IV était l'héritier d’un puissant roi, Aménophis III, qui régnait sur un empire, le royaume d'Égype, qui avait été étendu par son père jusqu'au Proche-Orient. Sa mère, la reine Tiyi le surprotégeait à cause des difformités physiques dont il souffrait. Un peu pour toutes ces raisons, il
porta son attention sur le monde des esprits. Après tout, le pharaon
n’était-il pas, parmi les princes de ce monde, seul à partager avec l’empereur de
l’Empire du Soleil Levant, le privilège d’être un dieu vivant? Aux heures les
plus glorieuses du Nouvel Empire (± 1500 à 1000 av. J.-C.), la dynastie des
Aménophis, la XVIIIe dynastie (1552 à 1292 av. J.-C.), prédisposa l'Égypte a devenir un puissant empire international sous la
XIXe dynastie – celle des Ramsès – qui s'étendra sur une partie du Moyen-Orient
ancien.
individualité de l’histoire. Le pharaon Aménophis IV était l'héritier d’un puissant roi, Aménophis III, qui régnait sur un empire, le royaume d'Égype, qui avait été étendu par son père jusqu'au Proche-Orient. Sa mère, la reine Tiyi le surprotégeait à cause des difformités physiques dont il souffrait. Un peu pour toutes ces raisons, il
porta son attention sur le monde des esprits. Après tout, le pharaon
n’était-il pas, parmi les princes de ce monde, seul à partager avec l’empereur de
l’Empire du Soleil Levant, le privilège d’être un dieu vivant? Aux heures les
plus glorieuses du Nouvel Empire (± 1500 à 1000 av. J.-C.), la dynastie des
Aménophis, la XVIIIe dynastie (1552 à 1292 av. J.-C.), prédisposa l'Égypte a devenir un puissant empire international sous la
XIXe dynastie – celle des Ramsès – qui s'étendra sur une partie du Moyen-Orient
ancien. archéologues tombèrent sur des documents relevant de sa
chancellerie. On y apprit alors l’extraordinaire histoire qui devait hanter
tout le XXe siècle, celui d’un prince qui voulut opérer une révolution par en haut dès la haute
Antiquité. Aménophis IV, dérogeant à son père, Aménophis III, chasseur de
lions, se tourna vers le monde de l’esprit, de la poésie et de la beauté. Il se
révolta contre l’un des plus puissants clergés de l’Histoire, le clergé d’Amon,
en en appelant au dieu soleil de l’Ancien Empire, Atoum. Le dieu Amon devint
alors le dieu Aton, et le pharaon son unique et véritable prophète. Voilà
pourquoi nombre d’auteurs virent en lui le fondateur du monothéisme. Cette
révolution pourrait évoquer la querelle des Investitures, mais jamais l’Empereur du
Saint-Empire germanique ne voulut spolier le Dieu des chrétiens et soumettre
spirituellement l’Église à sa main. Cette comparaison montre la puissance
potentielle contenue dans la réforme d’Akhenaton – puisque c’est le nom que
prit le pharaon – et qui devait provoquer des bouleversements dans l’administration et
la diplomatie égyptienne.
archéologues tombèrent sur des documents relevant de sa
chancellerie. On y apprit alors l’extraordinaire histoire qui devait hanter
tout le XXe siècle, celui d’un prince qui voulut opérer une révolution par en haut dès la haute
Antiquité. Aménophis IV, dérogeant à son père, Aménophis III, chasseur de
lions, se tourna vers le monde de l’esprit, de la poésie et de la beauté. Il se
révolta contre l’un des plus puissants clergés de l’Histoire, le clergé d’Amon,
en en appelant au dieu soleil de l’Ancien Empire, Atoum. Le dieu Amon devint
alors le dieu Aton, et le pharaon son unique et véritable prophète. Voilà
pourquoi nombre d’auteurs virent en lui le fondateur du monothéisme. Cette
révolution pourrait évoquer la querelle des Investitures, mais jamais l’Empereur du
Saint-Empire germanique ne voulut spolier le Dieu des chrétiens et soumettre
spirituellement l’Église à sa main. Cette comparaison montre la puissance
potentielle contenue dans la réforme d’Akhenaton – puisque c’est le nom que
prit le pharaon – et qui devait provoquer des bouleversements dans l’administration et
la diplomatie égyptienne. Le règne d’Amé-
Le règne d’Amé-nophis III avait été un règne de grandeur et l’affi-
nement de la pro-
duction culturelle n’avait jamais été aussi subtile dans les arts de l’ancienne Égypte. Déjà, le terreau était préparé pour une «révolution amarnienne», c’est-à-dire une révolution à tous les niveaux de la civilisation. L’égyptologue allemand Adolphe Erman le reconnaît ouvertement lorsqu’il écrit :
«…toutes sortes d’idées commençaient à fermenter dans l’esprit du peuple égyptien, car la grande révolution, qui devait éclater sous le règne de son successeur, ne peut se comprendre autrement. On était las de vivre dans des conditions d’existence héritées des temps antérieurs et qui apparaissaient comme des mensonges aux gens les mieux disposés. On ne voulait plus écrire dans une langue vieillie depuis longtemps; on ne voulait plus représenter les hommes sous un aspect gracieux et avec des visages au sourire aimable, puisqu’on était capable de rendre les traits d’un visage dans toute leur vérité; et, avant tout, on était las de servir une religion traînant après elle tant de choses qui ne signifiaient plus rien pour des gens de bons sens [Ed. Meyer… voit dans ce mouvement une révolution des classes cultivées]. On voulait adorer et aimer la divinité dont on voyait et sentait les bienfaits : le soleil. C’était donc à la vérité qu’aspirait cette nouvelle génération.
Le fait que vers la fin du règne d'Aménophis III un temple du soleil fut construit à Karnak prouve assez que cette nouvelle orientation remonte à ce règne. Et certes, ce mouvement était général [Ed. Meyer mentionne avec raison que de tels mouvements ne pouvaient être déclenchés par les prêtres eux-mêmes]. […] Tous les intellectuels durent applaudir le jeune héritier du trône, lorsqu’il eut l’audace, à son avènement, d’inaugurer l’ère nouvelle. On ne pouvait mesurer l’abîme qu’une telle décision devait creuser» (A. Erman. La religion des Égyptiens, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1952, pp. 138-139).
«Il devait paraître plus compréhensible au peuple que l’on ne représentât plus comme autrefois le dieu du soleil sous l’aspect d’un homme à tête de faucon, mais tout simplement avec l’image de l’astre lui-même. Du soleil émanent des rayons terminés par des mains; ces mains signifient que le soleil donne à l’homme la vie et tout ce qui est bon. Quelquefois seulement est fixé au bord inférieur du disque son vieil emblème, le serpent, comme dernier vestige des anciennes représentations.
Le véritable contenu de cette nouvelle croyance nousest livré par toutes sortes d’hymnes et de prières, que nous pouvons lire dans les tombeaux de Tell el Amarna. Il ne s’y trouve rien qui touche à la dogmatique et à la théologie et pour elle le dieu du soleil n’est que l’aimable créateur et soutien de tous les êtres vivants…» (A. Erman. Ibid. p. 139).
 grand prêtre du dieu, l’«Unique de Rè»,
son favori. C’est le vieux dieu des ancêtres, Rè-Hor-akhti qui prend un nom nouveau
et se rend étranger au clergé d’Amon. La révolution culturelle opérée par
Aménophis IV-Akhenaton poursuivait celle amorcée sous son père. On construisit des
temples nouveaux, chefs-d’œuvre de l’antiquité égyptienne. Le réalisme apparut
dans les fresques. L’orfèvrerie produisit des œuvres inégalées avec l’or qui
feront l’envie des pilleurs de tombes. Enfin, le pharaon annonça qu’il allait quitter Thèbes, la capitale, pour se rendre dans sa cité d’Akhet•aton (Horizon du soleil) – lieu qui porte
aujourd’hui le nom de Tell el Amarna -, construite sur les hauts plateaux
éloignés.
grand prêtre du dieu, l’«Unique de Rè»,
son favori. C’est le vieux dieu des ancêtres, Rè-Hor-akhti qui prend un nom nouveau
et se rend étranger au clergé d’Amon. La révolution culturelle opérée par
Aménophis IV-Akhenaton poursuivait celle amorcée sous son père. On construisit des
temples nouveaux, chefs-d’œuvre de l’antiquité égyptienne. Le réalisme apparut
dans les fresques. L’orfèvrerie produisit des œuvres inégalées avec l’or qui
feront l’envie des pilleurs de tombes. Enfin, le pharaon annonça qu’il allait quitter Thèbes, la capitale, pour se rendre dans sa cité d’Akhet•aton (Horizon du soleil) – lieu qui porte
aujourd’hui le nom de Tell el Amarna -, construite sur les hauts plateaux
éloignés.«Subitement éclate, dans une véritable furie contre Amon, un mouvement dont les traces se voient aujourd’hui encore partout en Égypte, après trois mille trois cents ans. Partout où se rencontre le nom d’Amon, il est martelé. On ne peut croire que cette persécutiond’Amon soit l’œuvre du roi seulement; il dut y avoir une foule de fanatiques, qui envahirent tous les temples et tous les tombeaux pour effacer le nom haï d’Amon, sans se soucier des outrages que l’on faisait subir aux plus beaux monuments. Comme toujours, quand il se passe de telles folies, le côté ridicule ne manque pas. Ne vous semble-t-il pas comique que le savant scribe du roi ait parcouru, dans son bureau des archives, les lettres écrites en cunéiformes des souverains asiatiques, pour voir si le nom d’Amon n’était pas à supprimer quelque part, bien que personne ne fût capable de les lire à part lui? Il n’est pas moins comique de constater comment n’importe quel mot inoffensif qui montrait quelque analogie avec le nom d’Amon devait être sacrifié au fanatisme des sectateurs de la foi nouvelle» (A. Erman. Ibid. pp. 144-145).
 n’y avait rien aupa-
n’y avait rien aupa-ravant, la construc-
tion d’une grande ville, avec des temp-
les, des palais et de longues rues bordées de maisons et de jardins et tous les architectes et tous les sculpteurs prirent part au grand œuvre. L’art eut là tout le champ libre pour se développer à sa guise, en faisant table rase de toutes les traditions et en s’efforçant d’atteindre la vérité. Que cette vérité ait pu se manifester de manières très diverses suivant le tempérament des différents artistes qu’à côté des merveilleux portraits trouvés par Borchardt dans l’atelier d’un sculpteur il pût y avoir aussi de véritables caricatures, c’est là une conséquence logique de cette émancipation de l’art» (A. Erman. Ibid. p. 147).
 Akh•en•aton avait épousé une princesse d’origine
mitanienne dit-on, ce que les égyptologues modernes contestent. Reconnue
jusqu’à nos jours par les bustes qui en sont restés pour son exceptionnelle
beauté : Neferti•ti, ne donna que des filles à son royal époux qui,
contrairement à la tradition machiste orientale, firent la joie du pharaon.
Dans l’entourage du pharaon, des personnages douteux se profilaient à
l’arrière-plan. D’abord, la reine-mère Tiyi, dominatrice et castatrice. Elle
établira sa résidence dans la nouvelle ville d’Akhet•aton où elle finit par
mourir. Si Akh•en•aton n’est pas le pacifiste qu’on a voulu croire, il n’a pas
été non plus le chef de guerre qu’il a voulu laisser paraître. Ainsi,
l’influence de l’Égypte recule-t-elle au Proche-Orient alors que les royaumes
du Mitanni et du Hatti se livrent des guerres
Akh•en•aton avait épousé une princesse d’origine
mitanienne dit-on, ce que les égyptologues modernes contestent. Reconnue
jusqu’à nos jours par les bustes qui en sont restés pour son exceptionnelle
beauté : Neferti•ti, ne donna que des filles à son royal époux qui,
contrairement à la tradition machiste orientale, firent la joie du pharaon.
Dans l’entourage du pharaon, des personnages douteux se profilaient à
l’arrière-plan. D’abord, la reine-mère Tiyi, dominatrice et castatrice. Elle
établira sa résidence dans la nouvelle ville d’Akhet•aton où elle finit par
mourir. Si Akh•en•aton n’est pas le pacifiste qu’on a voulu croire, il n’a pas
été non plus le chef de guerre qu’il a voulu laisser paraître. Ainsi,
l’influence de l’Égypte recule-t-elle au Proche-Orient alors que les royaumes
du Mitanni et du Hatti se livrent des guerres  sanglantes. «Le recul en Syrie et la perte de l’influence égyptienne dans les États
vassaux dut avoir pour effet de provoquer certains troubles dans d’autres
secteurs asiatiques où l’influence de l’Égypte se faisait sentir. De tels
revers étaient probablement inévitables après le succès incontesté que les
armées égyptiennes avaient connu depuis l’époque de Touthmôsis III, mais ce fut
une malchance pour Akhenaton que le déclin de la puissance égyptienne en Asie
ait commencé en un temps où son nouveau dieu Aton assumait la charge du
bien-être de l’Égypte et de ses dépendances» (C. Aldred. Akhenaton, Paris, Tallandier, 1973, pp.
240-241). Une telle situation dut rapprocher le camp des officiers militaires
de celui des prêtres d’Amon.
sanglantes. «Le recul en Syrie et la perte de l’influence égyptienne dans les États
vassaux dut avoir pour effet de provoquer certains troubles dans d’autres
secteurs asiatiques où l’influence de l’Égypte se faisait sentir. De tels
revers étaient probablement inévitables après le succès incontesté que les
armées égyptiennes avaient connu depuis l’époque de Touthmôsis III, mais ce fut
une malchance pour Akhenaton que le déclin de la puissance égyptienne en Asie
ait commencé en un temps où son nouveau dieu Aton assumait la charge du
bien-être de l’Égypte et de ses dépendances» (C. Aldred. Akhenaton, Paris, Tallandier, 1973, pp.
240-241). Une telle situation dut rapprocher le camp des officiers militaires
de celui des prêtres d’Amon.«Lorsqu’Akh•en•aton était monté sur le trône, le roi des Hittites était Suppilluliuma, lequel était en passe de devenir un ami de l’Égypte. Mais certains de ses sujets traversèrent la frontière de Mitanni et furent repoussés par Tusratta, le roi de ce pays. Cetincident mit du froid entre Suppiluliuma et le pharaon et, bien que celui-ci envoyât une ambassade à la Cité de l’Horizon, les relations épistolaires entre les deux monarques cessèrent bientôt. […] Bientôt nous voyons ces Hittites, dans l’impossibilité d’envahir le pays de Mitanni, se diriger le long de la route orientale et prendre possession du pays d’Amki, situé sur la mer entre les monts Amanus et le Liban. Ce mouvement aurait pu être arrêté par Aziru, un prince amorrite qui régnait sur le territoire s’étendant entre l’Amki et le Mitanni et dont le devoir était, en tant que vassal égyptien, d’arrêter les incursions des Hittites vers le sud. Mais Aziru était aussi ambitieux et aussi dépourvu de bonne foi que l’avait été avant lui son père Abdashirta et ses relations avec les Hittites et les Égyptiens dans les années qui suivirent révélèrent chez lui une absence totale de scrupules. Sa politique fut de dresser une nation contre l’autre et d’étendre la portée de son pouvoir au détriment des deux à la fois» (A. Weigall. Le pharaon Akh•en•aton, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1936, pp. 187-188).
«Après les temps d’intenses campagnes militaires de Thoutmosis III et d’Aménophis II, les armées égyptiennes avaient recruté de plus en plus d’auxiliaires : lanciers sémites, archers nubiens, frondeurs libyens et "escarmoucheurs" bédouins. Les commissaires égyptiens devaient recruter ces mercenaires, y compris des bandes errantes d’Apirou coupeurs de gorge, afin de soutenir les vassaux loyaux dans leur effort pour maintenir la paix pharaonique. Ce que les temps exigeaient, c’était la présence de Pharaon, puissant seigneur de la guerre à la tête de ses troupes, avec ses chars et ses archers, pour remporter la victoire sur les insolents et les perfides et soutenir le moral des loyaux et des résolus.
Mais l’habitude qu’avaient les pharaons de faire de temps à autre des promenades triomphales à travers les territoires qu’ils contrôlaient et de régler à cette occasion les querelles des souverains locaux, cette habitude était apparemment tombée en désuétude pendant la dernière partie du règne d’Aménophis III et le règne de son fils. L’armée, qui avait été entraînée en combattant sur le champ de bataille sous le commandement de pharaons vaillants, était devenue un instrument de police intérieure centralisé; elle était désormais plus préoccupée de travailler dans les carrières et de réaliser de grands projets de construction que de combattre sur des théâtres d’opérations étrangers. La diminution du rôle joué par les personnels des anciens temples réduisait également la perception des impôts auprès des fermiers des domaines des temples, et rendait plus nécessaire le recours à une soldatesque rapace pour les collecter. Cela créait des abus auxquels il faudrait par la suite mettre fin d’une main de fer. Une armée démoralisée par l’inaction et qui négligeait les vertus martiales n’était pas en position de partir en campagne, même menée par un chef dynamique; d’où le recours à des mercenaires qui manquaient de discipline, comme par exemple les turbulentes troupes nubiennes qui surgirent dans le palais d’Abdicheba, le prince de Jérusalem, qu’ils étaient censés protéger et qu’ils assassinèrent presque. Il n’est pas surprenant par conséquent d’entendre parler dans les Lettres d’Amarna de défaites et de retraites non seulement en Syrie, mais plus au sud, dans le centre de la Palestine, où une menace sérieuse se développait avec les ambitions d’un chef de guérilla des Apirou, Labaya de Sichem. Lui du moins trouva la mort dans une escarmouche qui l’opposa aux forces royales; mais ses fils, qui lui succédèrent n’étaient pas moins factieux. Vers la fin du règne, l’agitation qui régnait à Gezer mettait en danger toute la position égyptienne dans le centre de la Palestine et il semblerait qu’hommes et matériel étaient disposés pour une campagne sérieuse; celle-ci a dû être organisée sous un règne postérieur, car rien n’indique qu’Akhenaton lui-même soit jamais parti en campagne à la manière de ses prédécesseurs» (C. Aldred. Akhenaton, Paris, Seuil, 1997, pp. 275-276).
«Si la situation était menaçante en Asie, en particulier du fait de l’impuissance ou de la nonchalance des Égyptiens, à l’intérieur du pays elle n’était pas moins sombre. La peste faisait rage au Proche-Orient. Nous apprenons par le roi d’Alachia que Nergal, dieu de la pestilence, séjournait dans son pays (Chypre?), réduisant ainsi la production de lingots decuivre destinés au pharaon. La peste est également mentionnée sur le continent, à Byblos et à Soumoura. Par la suite, elle se répandit à partir de la région d’Amqa au Liban jusque dans les terres hittites, où elle coûta la vie à Souppilouliouma. Étant donné les relations étroites qui existaient entre l’Égypte et les régions côtières du Levant, les allées et venues de soldats, de prisonniers, de fonctionnaires et de commerçants, sans compter l’importation de servantes, de spécialistes des travaux d’aiguilles, de musiciennes, et d’esclaves dans les cercles de la cour, il serait surprenant que les Égyptiens aient pu échapper aux épidémies. Les 700 statues, ou plus, érigées par Aménophis III pour Sekmet, déesse égyptienne de la peste, sont très significatives; il s’agit d’une mesure prophylactique pour écarter la maladie de la nation, tout comme le roi hittite cherchait à écarter le courroux divin de son peuple en offrant des “prières contre la peste” aux dieux offensés.
La première mort notable, à ce moment-là, fut peut-être celle de la seconde fille d’Akhenaton, Maketaton, dont la veillée funéraire est représentée dans la chambre gamma de la tombe royale; on y voit un corps étendu sur un lit dans une chambre du palais. La princesse est déplorée par la cour tout entière et surtout par Akhenaton etNéfertiti qui pleurent, se lamentent et répandent de la poussière sur leur tête.. Pourtant, Maketaton ne mourut pas de maladie, mais en donnant naissance à un enfant, comme cela apparaît avec évidence du fait de la présence d’une nourrice allaitant un bébé juste devant la chambre mortuaire; que deux flabellifères l’assistent dénote bien le rang élevé de l’enfant. L’effacement du texte à cet endroit nous a privés du nom de l’enfant, à supposer qu’il y ait jamais été inscrit; mais on peut de toute façon douter que le bébé ait survécu longtemps, car il n’existe aucune autre mention de son existence» (C. Aldred. Ibid. pp. 277-278).
 Cette disparition n’était que la première. Puis vint la
reine Tiyi, et peut-être, vers l’an 14 du règne, Néferti•ti elle-même. C’est
ensuite qu’Akh•en•aton aurait commencé à «épouser» ses filles. Un co-régent,
Smenkharé, déclaré «aimé d’Akhenaton», pour sa part, laisse perplexe.
Cette disparition n’était que la première. Puis vint la
reine Tiyi, et peut-être, vers l’an 14 du règne, Néferti•ti elle-même. C’est
ensuite qu’Akh•en•aton aurait commencé à «épouser» ses filles. Un co-régent,
Smenkharé, déclaré «aimé d’Akhenaton», pour sa part, laisse perplexe. «Mais à quoi bon s’assurer un successeur au pouvoir quand ce pouvoir a été ébranlé jusqu’en son fondement et semble près de s’effondrer tout à fait? Akh•en•Aton est incapable de retarder ou d’empêcher la catastrophe imminente; de toutes parts se groupent les forces qui vont l’écraser. Son gouvernement est désorganisé. Les complots et les projets des prêtres d’Amon annoncent un succès prochain. Le courroux des clergés des autres dieux d’Égypte suspend sa menace au-dessus du palais comme un nuage de tempête. Les soldats, impatients de marcher sur la Syrie, comme au temps du grand Touthmosis III, s’irritent d’être forcés à l’inaction et assistent avec une agitation grandissante au démembrement de l’empire.
Dans les rues de la ville, on voit passer des messagers fourbus s’empressant vers le palais; les dépêches dont ils sont porteurs ne sont plus des appels au secours de rois ou de généraux en détresse, mais l’annonce de la chute des dernières cités de Syrie et du massacre de leurs derniers chefs. Les restes épars des garnisons emboîtent le pas, tantbien que mal, de ces messagers, et s’en reviennent sur les bords du Nil, poursuivis jusqu’aux frontières mêmes de l’Égypte par les Asiatiques triomphants. Du nord, les Hittites se déversent en Syrie; du sud, les Khabiri envahissent en masse le pays. Comme à travers un rideau qui se déchire sur le spectacle d’une mêlée tumultueuse, le regard aperçoit soudain le fourbe Aziru, les mains encore rouges du sang de Ribaddi et de bien d’autres princes loyaux, se précipiter avec férocité sur une cité, en écraser une autre. Il a finalement jeté son masque et cherche à apaiser, avec le tribut promis à l’Égypte, les hordes montantes des Hittites, dont il est bien obligé d’admettre la suzeraineté.
Les contributions ayant cessé, le trésor égyptien fut vite épuisé, car le gouvernement du pays souffrait trop de la confusion générale pour oser prélever lui-même des taxes et s’occuper de l’exploitation des mines d’or. La construction de la Cité de l’Horizon avait coûté les yeux de la tête et le roi ne savait plus où se tourner pour obtenir de l’argent. Dans l’espace de quelques années, l’Égypte avait été réduite, de puissance mondiale qu'elle était, à la situation d’un petit État, de la plus riche contrée connue à la condition d’un royaume insolvable.
Dans les derniers moments de sa vie, lorsqu’il eut constaté l’effondrement complet de ses espoirs, Akh•en•Aton dut offrir à ses proches le spectacle pitoyable d’un homme prostré, à la mâchoire tombante, aux yeux fixement ouverts. Il avait sacrifié la Syrie à ses principes, mais son sacrifice était vain puisque ses doctrines n’avaient même pas pris racine en Égypte. Il savait maintenant que la religion atonienne ne lui survivrait pas et que la révélation au monde de l’amour divin était prématurée. Les psaumes en l’honneur d’Aton n’en continuaient pas moins à résonner à ses oreilles, les hymnes au Dieu qui l’avait abandonné à pénétrer dans le palais avec le parfum des fleurs; les oiseaux qu’il aimait chantaient aussi joyeusement dans les jardins luxuriants qu’ils l’avaient fait lorsqu’ils inspirèrent au roi un passage de son grand poème. Mais le désespoir s’était abattu sur lui et déjà les ombres de la mort commençaient à l’encercler. Le malheur d’avoir échoué l’avait déprimé aussi profondément qu’eussent pu le jeter bas les montagnes mêmes de l’ouest; son pauvre corps affaibli ne pouvait plus supporter l’idée même de tout ce qu’il avait perdu.
L’histoire nous raconte seulement qu’au moment où son empire s’écroula, Akh•en•Aton mourut. Les médecins qui ont examiné son corps déclarent que sa mort est due sans doute à une attaque. Mais par l’imagination nous entendons à travers les siècles retentir un cri de complet désespoir et nous voyons la maigre silhouette de ce “bel enfant de l’Aton” s’abattre sur le pavement décoré du palais et s’allonger parmi les pavots rouges et les papillons gracieux qui s’y trouvaient peints» (A Weigall. Op. cit. pp. 209-211).
 Smenkharé, suivi de celui de
Tout•ankh•aton, gendre
Smenkharé, suivi de celui de
Tout•ankh•aton, gendred’Akh•en•
aton, qui ramena son nom à Tout•ankh
•amon signifia le triomphe du clergé d’Amon. Aussitôt, toutes les traces du pharaon hérétique furent effacées. La cité d’Akhet•aton fut désertée et les documents de la chancelleries abandonnées aux sables du désert, de même que les œuvres d’art que les égyptologues redécouvrirent à la fin du XIXe siècle. Longtemps, Aménophis IV ne fut qu’un pharaon parmi d’autres dans la succession anonyme des rois de la XVIIIe dynastie. Quel ne fut pas l’étonnement des savants de
 découvri-
découvri-rent ce pan censuré de l’histoire égyp-
tienne! Le corps du pharaon maudit fut découvert dans la tombe de sa mère, la reine Tiyi. Après le meurtre (semble-t-il avéré) de Tout•ankh•amon, vers l’âge de 19 ans, avec le vieux pharaon Aÿ et son successeur Hor•em•heb, les soldats retournèrent en campagne vers la Syrie. Le clergé d’Amon renfloua à nouveau ses précieuses cassettes d’or. Tout cela n’avait été qu’une aventure sans lendemain, l’Égypte retrouvant sa puissance mondiale sous la dynastie suivante des Ramessides.
 fanatique religieux et l’âme
sensible. Les deux ont concouru à précipiter la civili-
fanatique religieux et l’âme
sensible. Les deux ont concouru à précipiter la civili-sation égyp-
tienne vers une fin pré-
maturée. Si le pharaon avait survécu quelques années encore, il aurait plongé son empire en pleine guerre civile de manière concomitante avec une invasion des Hittites et de leurs satellites. L’histoire moderne de l’Amérique latine a connu un exemplaire de chacune de ces deux sous-personnalités : une en Équateur et l’autre au Mexique. Et leur présence à la tête de leur pays engendra des troubles, voire une guerre civile des plus meurtrière du XXe siècle.
.jpg) République de
l’Équateur, Gabriel García Moreno (1821-1875), le pays fut livré à la
théocratie la plus dictatoriale. Président du pays à deux reprises (1861-1865)
et 1869-1875), ce fervent catholique alla jusqu’à consacrer son pays au
Sacré-Cœur en 1873. L’arrivée de García Moreno au pouvoir, supporté par les
grands propriétaires fonciers et le patronat, mit un terme à une période
d’instabilité politique : «Grand par
la sincérité absolue et la probité de l’homme, le gouvernement de García Moreno
avait été cruel et étouffant pour la bourgeoisie cultivée qui s’inspirait d’un
autre idéal» (V.-L. Tapié. Histoire
de l’Amérique latine au XIXe siècle, Paris, Aubier, s.d., p. 227). García
Moreno avait quand même réunifié son pays en 1860 en chassant de Guayaquil le
général Franco qui bénéficiait du soutien du dictateur du pays voisin, le Pérou.
République de
l’Équateur, Gabriel García Moreno (1821-1875), le pays fut livré à la
théocratie la plus dictatoriale. Président du pays à deux reprises (1861-1865)
et 1869-1875), ce fervent catholique alla jusqu’à consacrer son pays au
Sacré-Cœur en 1873. L’arrivée de García Moreno au pouvoir, supporté par les
grands propriétaires fonciers et le patronat, mit un terme à une période
d’instabilité politique : «Grand par
la sincérité absolue et la probité de l’homme, le gouvernement de García Moreno
avait été cruel et étouffant pour la bourgeoisie cultivée qui s’inspirait d’un
autre idéal» (V.-L. Tapié. Histoire
de l’Amérique latine au XIXe siècle, Paris, Aubier, s.d., p. 227). García
Moreno avait quand même réunifié son pays en 1860 en chassant de Guayaquil le
général Franco qui bénéficiait du soutien du dictateur du pays voisin, le Pérou. théocratique” de García
Moreno» (F. Chevalier. L’Amérique
latine : De l’indépendance à nos jours, Paris, P.U.F., Col. Nouvelle
Clio, # 44, 1977, p. 422) marqua un rare exemple de prospérité «libérale». Or,
cette bourgeoisie cultivée qui
souffrait le plus la théocratie de García Moreno était essentiellement libérale
et, mue par les pamphlets de Juan Montalvo (1833-1889), se rassembla autour de
son ami, Eloy Alfaro qui menait un véritable duel avec le président-dictateur.
Montalvo publia un pamphlet Contre la tyrannie perpétuelle, interdit bien
sûr par la censure. Mais la brochure pénètra «clandestinement, malgré la police, en Équateur, [et] produit une véritable fermentation
intellectuelle et politique hostile au terrible dictateur clérical qui termina
sa vie sous le couteau d’un assassin» (L. Manigat. L’Amérique latine au XXe siècle 1889-1929, Paris, Éditions
Richelieu, s.d., p. 161). Et, pour les anticléricaux poussés dit-on par l’action
subtile de la Franc-Maçonnerie, avoir proclamé la Royauté sociale du Christ suffisait seul à susciter
l’exaspération.
théocratique” de García
Moreno» (F. Chevalier. L’Amérique
latine : De l’indépendance à nos jours, Paris, P.U.F., Col. Nouvelle
Clio, # 44, 1977, p. 422) marqua un rare exemple de prospérité «libérale». Or,
cette bourgeoisie cultivée qui
souffrait le plus la théocratie de García Moreno était essentiellement libérale
et, mue par les pamphlets de Juan Montalvo (1833-1889), se rassembla autour de
son ami, Eloy Alfaro qui menait un véritable duel avec le président-dictateur.
Montalvo publia un pamphlet Contre la tyrannie perpétuelle, interdit bien
sûr par la censure. Mais la brochure pénètra «clandestinement, malgré la police, en Équateur, [et] produit une véritable fermentation
intellectuelle et politique hostile au terrible dictateur clérical qui termina
sa vie sous le couteau d’un assassin» (L. Manigat. L’Amérique latine au XXe siècle 1889-1929, Paris, Éditions
Richelieu, s.d., p. 161). Et, pour les anticléricaux poussés dit-on par l’action
subtile de la Franc-Maçonnerie, avoir proclamé la Royauté sociale du Christ suffisait seul à susciter
l’exaspération.«Gabriel García Moreno était né à Guayaquil en 1821, d’une famille d’origine castillane. Il tenait de ses ancêtres l’esprit de domination qui caractérise le Castillan et la solidité dela foi chrétienne. D’une précoce intelligence, il fit d’excellentes études à l’Université de Quito et s’imposa à ses camarades par cette étonnante énergie qui apparaît bien comme le caractère fondamental de sa nature. Il savait se gouverner lui-même : la discipline à laquelle il se contraignit, les actes de volonté qu’il accomplit révèlent une maîtrise de l’âme extraordinaire, presque effrayante chez un jeune homme. Durant un séjour à Paris, il subit une crise de doute religieux dont il triompha. Il étudia les sciences mathématiques, physiques et chimiques, pour lesquelles il était fort bien doué. Mais il se proposa d’être avant tout un juriste et un journaliste; à son gré, c’était par les Sciences morales et politiques que devait se former l’élite d’une nation et tout particulièrement d’un État comme l’Équateur qui, pour un million d’habitants n’en comptait guère plus de 30,000 de race blanche. À Paris, il se lia d’amitié avec le chimiste et agronome Boussignault qui explora l’Équateur, la Colombie, la Plata et fit l’ascension du Chimborazo. Il lui dut certainement ce goût très vif pour les sciences qu’il conserva toujours et qui l’éleva au premier rang des intelligences américaines. […] Disciple résolu du Christ, il s’initiait à la doctrine sociale du catholicisme» (J.-T. Bertrand. Histoire de l’Amérique espagnole, t. 2 : Les guerres de l’Indépendance. La période contemporaine. Paris, Éditions Spes, 1928, pp. 261-262).
 Il ne
fait aucun doute que García Moreno était un homme courageux, surtout
lorsqu’il livra la lutte au président Urvina, considéré comme l’agent des
Francs-Maçons. Et comme tous les présidents, dictateurs ou autres chefs d’État
des Amériques latines, il voulait un exécutif fort et stable. Sa vision
théocratique n’était pas un simple relent idéologique. Ce qui désarme chez lui,
c’est la conviction profonde qui l’anime :
Il ne
fait aucun doute que García Moreno était un homme courageux, surtout
lorsqu’il livra la lutte au président Urvina, considéré comme l’agent des
Francs-Maçons. Et comme tous les présidents, dictateurs ou autres chefs d’État
des Amériques latines, il voulait un exécutif fort et stable. Sa vision
théocratique n’était pas un simple relent idéologique. Ce qui désarme chez lui,
c’est la conviction profonde qui l’anime :«García Moreno fut un vrai chef, selon l’idéal espagnol et selon l’idéal chrétien. Il se considéra comme le vicaire de Dieu, chargé de diriger vers le bien le peuple qui l’avait choisi. Aussi n’hésitait-t-il point à user d’une rigueur parfois extrême à l’encontre des fauteurs de désordre. Il s’estimait responsable devant ses concitoyens et leur rendait compte clair, scrupuleux et très concret de sa gestion, dans ses Messages annuels. Il s’estimait surtout responsable devant Dieu. À elle seule, cette conscience très nette et très loyale de la double responsabilité des hommes politiques, suffirait à le différencier des autres caudillos. Elle donne à chacun de ses actes publics une signification et une portée originale, un retentissement profond» (J.-T. Bertrand. Ibid. p. 263).
 Il faut
reconnaître que, contrairement à Akh•en•aton, García Moreno ne négligea pas les intérêts matériels de
son pays. Sa formation de savant positiviste faisait sans doute un étrange
contraste avec sa dévotion catholique, mais à l’époque où le sociologue français Frédéric Le Play
travaillait à développer l’idéologie corporatiste et le paternalisme social, García Moreno comprenait
très bien l’importance des infrastructures dans le développement économique de
son pays :
Il faut
reconnaître que, contrairement à Akh•en•aton, García Moreno ne négligea pas les intérêts matériels de
son pays. Sa formation de savant positiviste faisait sans doute un étrange
contraste avec sa dévotion catholique, mais à l’époque où le sociologue français Frédéric Le Play
travaillait à développer l’idéologie corporatiste et le paternalisme social, García Moreno comprenait
très bien l’importance des infrastructures dans le développement économique de
son pays : «Vouloir la volonté divine et coopérer à l’avènement du Sacré Cœur de Jésus, du Christ-Roi, n’empêchait point García Moreno de songer au pain quotidien, à la prospérité matérielle de sa patrie et de travailler à relever l’Équateur de l’humiliante misère où l’avaient jeté les incessantes guerres civiles. Il amortit dans une assez large mesure, la dette publique. En quatre ans, les excédents de recettes passèrent de 1,400,000 pesos à 2,900,000. Le président pouvait annoncer dans son Message de l’an 1872, que le résultat avait été obtenu – sans renier aucune des dettes de la Nation, ni diminuer les traitements ou les pensions justement dus. “Non seulement,ajoutait-il, je ne demande pas l’augmentation des impôts, mais j’exige qu’on supprime du rôle des dépenses l’indemnité promise lors de la libération des esclaves à leurs propriétaires, puisque cette dette est entièrement soldée”. On avait payé 227,000 pesos de la Dette étrangère, on avait dépensé 442,000 pesos pour le seul ministère de l’Instruction publique ; on en avait employé un million deux cent mille en travaux d’utilité publique : routes, ponts, digues, etc… Tous ceux qui ont voyagé dans les Andes savent combien est difficile et dangereux le chemin du port de Guayaquil à la ville de Quito, laquelle se trouve à l’altitude, de 2, 850 mètres. García Moreno résolut de donner à sa patrie la grande artère indispensable. Et en 1873, il pouvait dire, dans son Message : “La route du Sud a déjà plus de 260 kilomètres, avec cent ponts et quatre cents viaducs. Il ne manque pour unir le point terminal au port de Guayaquil, qu’une petite ligne ferrée, qui va être entreprise”. Voilà, en résumé l’œuvre de celui que Juan Montalvo appelait “un monstre abominable, un fléau de l’humanité, la terreur des pusillanimes, la ruine des hommes courageux, ennemi de Dieu et des hommes, que l’on peut impunément tuer comme un tigre ou une couleuvre”» (J.-T. Bertrand. Ibid. pp. 265-266).
 laquelle il se rendait tous les jours), García Moreno se vit attaqué par quatre hommes armés de
machettes et de pistolets. Faustino Rayo, Robert Andrade, Abelardo Moncayo et
Manuel Cornejo. Il tenta de leur résister, mais il succomba très vite, n’ayant
que le temps de justifier : «Dios no
muere!» (Dieu ne meurt pas!). Les quatre meurtriers, membres de cette bourgeoisie éclairée frustrée par la
ferveur religieuse du président, voire même un membre de l’armée et un
ex-jésuite (Moncayo). Cornejo se vit comme un modèle à la Plutarque, se
sacrifiant contre un dictateur (il sera exécuté le 27 août). Rayo, lui, sera
exécuté sur le champ. C’était un maroquinier, ancien employé du gouvernement de
García Moreno
dans province de Napo. Le matin même du meurtre, on l’aurait vu discuter du
prix d’une selle avec sa future victime.
laquelle il se rendait tous les jours), García Moreno se vit attaqué par quatre hommes armés de
machettes et de pistolets. Faustino Rayo, Robert Andrade, Abelardo Moncayo et
Manuel Cornejo. Il tenta de leur résister, mais il succomba très vite, n’ayant
que le temps de justifier : «Dios no
muere!» (Dieu ne meurt pas!). Les quatre meurtriers, membres de cette bourgeoisie éclairée frustrée par la
ferveur religieuse du président, voire même un membre de l’armée et un
ex-jésuite (Moncayo). Cornejo se vit comme un modèle à la Plutarque, se
sacrifiant contre un dictateur (il sera exécuté le 27 août). Rayo, lui, sera
exécuté sur le champ. C’était un maroquinier, ancien employé du gouvernement de
García Moreno
dans province de Napo. Le matin même du meurtre, on l’aurait vu discuter du
prix d’une selle avec sa future victime. automatique avec laquelle furent exécutés Rayo et Cornejo et les inégalités de
traitement dans la poursuite des personnes impliquées. Il restait toujours le
pamphlétaire Montalvo qui s’attribua, non sans remords, la responsabilité du
crime : Mi pluma lo mató (C’est
ma plume qui l’a tué). À l’homme à la poigne de fer succéda un président
intermédiaire vite renversé par une junte militaire. Dans la foulée de
l’anticléricalisme qui avait voué à la mort García Moreno, l’archevêque de
Quito, la capitale, José Ignacio Checa y Barba, le 30 mars 1877, alors qu’il
célébrait la messe dans la même cathédrale où García Moreno avait été assassiné
sur les marches y conduisant, sentit un vif malaise et dut céder l’office. Il
sortit en se précipitant. Atteint de fortes douleurs abdominales et vomissant,
il s’effondra mort dans une ruelle en clamant «¡Hidos mios, he sido envenenado!» (Mes enfants, j'ai été empoisonné!). De fait, on
trouva de la strychnine dans le calice où il avait bu ce qu’il croyait
être le sang du Christ.
automatique avec laquelle furent exécutés Rayo et Cornejo et les inégalités de
traitement dans la poursuite des personnes impliquées. Il restait toujours le
pamphlétaire Montalvo qui s’attribua, non sans remords, la responsabilité du
crime : Mi pluma lo mató (C’est
ma plume qui l’a tué). À l’homme à la poigne de fer succéda un président
intermédiaire vite renversé par une junte militaire. Dans la foulée de
l’anticléricalisme qui avait voué à la mort García Moreno, l’archevêque de
Quito, la capitale, José Ignacio Checa y Barba, le 30 mars 1877, alors qu’il
célébrait la messe dans la même cathédrale où García Moreno avait été assassiné
sur les marches y conduisant, sentit un vif malaise et dut céder l’office. Il
sortit en se précipitant. Atteint de fortes douleurs abdominales et vomissant,
il s’effondra mort dans une ruelle en clamant «¡Hidos mios, he sido envenenado!» (Mes enfants, j'ai été empoisonné!). De fait, on
trouva de la strychnine dans le calice où il avait bu ce qu’il croyait
être le sang du Christ.Quelle fut la véritable négligence de García Moreno? Nous l’avons dit. La surestimation de son pouvoir moral appuyé sur ses réussites politiques et économiques. Mais à une époque où la liberté de conscience et le droit à la parole étaient de plus en plus considérés comme des droits fondamentaux, la tyrannie et la censure ne pouvaient plus être subies sans résistance poussée jusqu'à l'agressivité. L’individu peut avoir la liberté en affaires et viser des fortunes faramineuses; il peut accéder à la forme de démocratie la plus libérale où ses représentants gèrent son pays dans les intérêts de la bourgeoisie plus que du peuple. Mais lorsque quelqu’un lui dit quoi penser et ne pas penser; quoi dire et quoi taire, il se rebelle comme s’il souffrait d’une contrainte intolérable. Tant de libertés permises et cette seule obstruction créent un contraste qui rend la vie misérable pour beaucoup. Comme le constatait Rousseau, l’homme préfère décider de lui-même à qui il doit confier les chaînes qui entraveront sa liberté.
 comme Porfirio Díaz au
Mexique, en se faisant l’Apôtre de la
Révolution, mais cela n’a pas été suffisant pour Francisco Ignacio Madero González (1873-1913). Élève des Jésuites, ayant étudié aux États-Unis, ce
richissime entrepreneur voulait établir une démocratie à l’américaine par des
moyens pacifiques et évincer la dictature de Porfirio Díaz, dont les élections
se succédaient sans oppositions. D’où son slogan à succès :
comme Porfirio Díaz au
Mexique, en se faisant l’Apôtre de la
Révolution, mais cela n’a pas été suffisant pour Francisco Ignacio Madero González (1873-1913). Élève des Jésuites, ayant étudié aux États-Unis, ce
richissime entrepreneur voulait établir une démocratie à l’américaine par des
moyens pacifiques et évincer la dictature de Porfirio Díaz, dont les élections
se succédaient sans oppositions. D’où son slogan à succès :  sufragio efectivo, no
reelección (suffrage effectif et pas de
réélection). Diaz était président de la République mexicaine depuis 1876 et on
était en 1910. Madero fonda le Parti national anti-réélectionnis-
sufragio efectivo, no
reelección (suffrage effectif et pas de
réélection). Diaz était président de la République mexicaine depuis 1876 et on
était en 1910. Madero fonda le Parti national anti-réélectionnis-te, Persécuté par Diaz, forcé de se cacher aux États-Unis, Madero rédigea son programme économique et social, le Plan de San Luis Potozi (de l’endroit où il fut publié au Mexique). Le Plan était essentiellement politique, mais Madero y ajouta une partie sur la condition des agriculteurs qu’il entendait améliorer. La paysannerie mexicaine était pauvre, étranglée par les grands propriétaires fonciers qui soutenaient Díaz depuis quarante ans. En 1910, Diaz crut faire un bon coup, misant sur sa popularité, en autorisant des élections libres où Madero pouvait se présenter. À son grand étonnement, il fut battu. Ne voulant céder le pouvoir, une vaste coalition s’organisa pour l'en chasser.
«En mai 1911, il devient évident que Diaz est perdu. Madero descend lentement mais sûrement. Pancho Villa enlève d’assaut Ciudad Juarez. Zapata, dont la cause s’est étendue de Morelos aux états voisins, s’empare du nœud ferroviaire de Cuautla. Les troupes, les garnisons, l’armée de Diaz se mutinent et se débandent. Les “trois glorieuses” de Mexico achèvent la victoire. En réalité, il s’agit des deux dernières journées révolutionnaires des 24 et 25 mai. La première journée est une importante manifestation rassemblant des milliers de citoyens lançant des slogans révolutionnaires et hostiles à Diaz; la seconde est marquée par la fusillade de la place de la Reforma, à partir de quoi, le contrôle de la situation échappe à l’octogénaire qui, abandonné et désormais sans défense, démissionne et part pour l’exil. “Liberté, constitution, élections libres et honnêtes, terre, eau, écoles, le Mexique aux Mexicains, justice sociale, etc.” : tout cela triomphe confusément, charrié par des slogans au cri desquels s’annonce l’ère de la révolution. Le 7 juin 1911 Madero fait une entrée triomphale dans la capitale en liesse; Madero le Sans Tache, Madero l’Incorruptible, Madero le Rédempteur. Le héros du jour se trouve au confluent de différents courants revendicatifs des différentes classes composant la coalition victorieuse» (L. Manigat. Op. c it. p. 197).
 particulier ceux d’Amérique centrale;
investisse-
particulier ceux d’Amérique centrale;
investisse-ment des fonds publics au bénéfice du pays; impôts équitablement répartis» (A. Nunes. Les révolutions du Mexique, Paris, Flammarion, Col. Questions d’histoire, # 37, 1975, p. 70). Madero anticipait ainsi le Plan de San Luis Potosi, publié alors qu’il était en exil, six mois plus tard. Ce programme semait de grandes attentes socialement contradictoires dans toute la société. Diaz, qui tout au long de son «règne» avait bénéficié du soutien des Américains, forçait Madero a chercher de l’appui auprès des autres pays latino-américains. Aussi, lorsque Diaz ne fut plus qu’un mauvais souvenir, Madero put rentrer à Mexico dans la gloire et la liesse et organiser les premières élections vraiment libres de l’histoire du Mexique. «Madero fit son entrée à Mexico en juin; il y fut reçu dans un enthousiasme qui dépassait de bien loin ls ovations données jadis aux chefs militaires. Le petit homme à la voix aiguë était devenu un demi-dieu qui avait délivré le peuple de la servitude. Comme le fit remarquer Francisco Bulnes, il rivalisait avec la Vierge de Guadalupe. Sa candidature à la présidence de la république ne rencontrait pas d’opposition…» (H. B. Parkes. Histoire du Mexique, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1971, p. 334).
«Le chef le plus désintéressé qu’ait eu le Mexique depuis Morelos avait substitué à son Parti antiréélectionniste un Parti constitutionnel progressiste, qui prit pour programme le Plan de San Luis Potosi, complété par diverses mesures tendant à instituer un suffrage direct, à mieux assurer la liberté individuelle et l’égalité fiscale, à développer la petite propriété. La Convention du parti désigna Madero et Pino Suárez, avocat et journaliste, comme candidats à la présidence et à la vice-présidence. Ils furent élus, Madero avec 90% des voix. Leur triomphe était celui des classes moyennes qui aspiraient à participer à la direction du pays. Mais, dépourvus d’expérience politique, Madero et les madéristess’étaient laissé prendre de vitesse par les hommes du Porfiriat, retranchés dans les ministères, le Congrès et les législatures des états, face aux gouverneurs mis en place par la Révolution. Libérée par Madero, la presse ne se privait pas de l’attaquer. Les conservateurs se moquaient de ce petit homme à barbiche, végétarien, abstinent et adepte du spiritisme, de sa sensibilité maladive, de son idéalisme utopique. Les révolutionnaires vainqueurs se divisaient. Les frères Vázquez Gómez reprochaient au président son indulgence envers les officiers et les fonctionnaires fédéraux et sa propension à s’entourer de membres de sa famille liés avec les Cientificos. D’autres, comme Orozco et Zapata, poussaient aux réformes sociales dont Madero ne semblait pas comprendre l’urgence. Une demi-douzaine de partis politiques s’étaient formés : un Parti catholique dont les succès brillants aux élections législatives de 1912 furent en grande partie annulés sous la pression de ses adversaires, ce qui le rendit hostile à Madero, un Parti républicain qui soutint B. Reyes, un Parti libéral national qui le combattit, mais se distingua du Parti libéral mexicain des frères Flores Magón. Finalement, Madero dut faire face à deux catégories de dangers : des pronunciamientos de type classique et des soulèvements qui tendaient à exploiter la victoire de la révolution politique en la doublant d’une révolution sociale. Pris entre ceux qui essayaient de perpétuer l’ordre ancien et les révolutionnaires qui le poussaient à modifier tout de suite les structures de la société, il tenta vainement de maintenir un équilibre impossible» (F. Weymuller. Histoire du Mexique, Paris, Horvath, Col. Histoire des pays, s.d., p. 277).
 ainsi plus ridi-
ainsi plus ridi-cules aux yeux de la popula-
tion. «Madero, généreux mais naïf, était une cible facile pour les flèches empoi-
nalistes de l’ancien régime» (J. S. Herzog. La révolution mexicaine, Paris, Maspero, Col. FM/petite collection maspero, # 185, 1968, p. 155). Madero pensait qu’il avait été porté par les ailes de la liberté, alors que, comme le mentionne Parkes, il «ne comprit jamais à quel point c’était aux mécontentements qu’il devait d’être devenu héros national» (H. B. Parkes. Op. cit. p. 335). «Francesco I Madero (I comme innocent croyaient médire ses ennemis» (J. Meyer. La révolution mexicaine, Paris, Tallandier, Col. Texto, 2010, p. 38) Et Parkes de préciser :
«Avec ou sans programme, il était d’ailleurs incapable de gouverner le Mexique. Il voulait donner à toute la population l’intégrité des droits démocratiques, à une époque où les trois quarts de ses membres étaient illettrés; il voulait administrer dans une atmosphère de conciliation et de bonté pendant que les généraux et les propriétaires terriens préparaient des coups d’État. Tandis qu’il rêvait de régénérer son pays par la simple puissance d’un exemple analogue à celui du Christ, son entourage était animéd’intentions bien différentes. Sa famille s’était installée avec lui au Palais National; il donna des fonctions dans son cabinet à plusieurs de ses parents, répondant aux accusations de despotisme qu’il les avait choisis à cause de leur honnêteté; or, pendant qu’il faisait ses apologies de la liberté, son frère Gustavo s’érigeait en boss, en directeur politique du gouvernement, commandant au congrès et intervenant dans les élections, son oncle Ernesto et son cousin Rafael Hernández administraient les départements du Trésor et du Fomento selon leurs opinions de cientificos. Ainsi, le gouvernement de Madero ne fut ni vraiment idéaliste, ni effectivement dictatorial et, dès que l’absence de tout programme apparut avec évidence, sa popularité s’évanouit autour de lui avec la soudaineté d’une catastrophe. Sa voix aiguë, ses façons maniérées et nerveuses, son inhabileté à recevoir les délégations, les larmes qu’il répandit à un concert public, pendant l’ouverture de “1812”, de Tchaïkowski, sa foi dans les prophéties faites au cours de séances spiritualistes, tout cela contribuait à le rendre victime de la moquerie générale» (H. B. Parkes. Op. cit. p. 336).
 Parce que la plupart des
grands problèmes sociaux demeurent sans solutions, des soulèvements éclatent
ici et là durant les années 1912 et 1913. Les ouvriers des villes, et en
particulier du secteur pétrolier, à dominance anglo-américaine, se syndicalisent
et deviennent des forces rouges de
contestation du gouvernement libéral. Les agriculteurs, déçus par la non
application du Plan
Parce que la plupart des
grands problèmes sociaux demeurent sans solutions, des soulèvements éclatent
ici et là durant les années 1912 et 1913. Les ouvriers des villes, et en
particulier du secteur pétrolier, à dominance anglo-américaine, se syndicalisent
et deviennent des forces rouges de
contestation du gouvernement libéral. Les agriculteurs, déçus par la non
application du Plan  de San Luis Potosi prennent les armes, et les indiens du
Morelos sont les plus vindicatifs avec, à leur tête, leur chef Emiliano Zapata.
Au nord, c’est Pancho Villa qui reprend du service, financé sans doute par des
intérêts américains. Madero essaie de discuter avec tout le monde. Les généraux
putchistes condamnés à la peine de mort sont graciés par un président qui ne croit
pas à la violence.
de San Luis Potosi prennent les armes, et les indiens du
Morelos sont les plus vindicatifs avec, à leur tête, leur chef Emiliano Zapata.
Au nord, c’est Pancho Villa qui reprend du service, financé sans doute par des
intérêts américains. Madero essaie de discuter avec tout le monde. Les généraux
putchistes condamnés à la peine de mort sont graciés par un président qui ne croit
pas à la violence. «Madero n’était pas le doux idéaliste, le spirite disciple de Tolstoï, le rêveur évangélique que l’on a dit; il était tout cela, mais il voulait lucidement trouver l’équilibre, entre deux éléments contraires, la
 liberté et
l’autorité, il exigeait des élections générales, la liberté illimitée de la
presse et de réunion; il ne voulait pas que la vie publique s’éteigne de
nouveau et se limite à une douzaine de chefs de parti et à leurs troupes
parlementaires, il ne voulait pas de retour à la clique, même élargie, même
rajeunie» (J. Meyer. Op. cit. p.
42). Mais les conditions d’analphabétisme et de népotisme «bien placé» rendaient
la chose impossible. La présidence de Madero allait durer seize mois au cours
desquels les crises sociales intérieures allaient venir à bout, aidées en cela par l’intervention américaine de l’ambassadeur Henry Lane Wilson qui avait
l’oreille du président Taft, et dont le but premier était de protéger les intérêts
américains menacés par la politique nationaliste de Madero.
liberté et
l’autorité, il exigeait des élections générales, la liberté illimitée de la
presse et de réunion; il ne voulait pas que la vie publique s’éteigne de
nouveau et se limite à une douzaine de chefs de parti et à leurs troupes
parlementaires, il ne voulait pas de retour à la clique, même élargie, même
rajeunie» (J. Meyer. Op. cit. p.
42). Mais les conditions d’analphabétisme et de népotisme «bien placé» rendaient
la chose impossible. La présidence de Madero allait durer seize mois au cours
desquels les crises sociales intérieures allaient venir à bout, aidées en cela par l’intervention américaine de l’ambassadeur Henry Lane Wilson qui avait
l’oreille du président Taft, et dont le but premier était de protéger les intérêts
américains menacés par la politique nationaliste de Madero.«À la chambre des députés, parlait del Bosque, tandis qu’un public agressif se pressait aux galeries : “Si M. Madero avait quelques connaissances économiques, il aurait fermé les vannes du Trésor d’où coulent à flots les millions gaspillés”. “Si M. Madero était un homme d’État, il en aurait fini avec le Droit marqué par le crime et la corruption porfiriste, si M. Madero…” “Si ma grand-mère avait des roulettes, elle serait une charrette!” criait-on d’une galerie. “Que nous a apporté la révolution? Désastre, ruine, banditisme, assassinat. Qu’est-ce que le Plan de San Luis? Logomachie!” Et un madériste de répondre à la tribune : “Oui, Messieurs, le crime de Madero c’est de ne pas avoir invité au gouvernement tous les cuistres et tous les charlatans qui pendant la dictature ont léché les pieds du tyran”. (Applaudissements suivis d’un tumulte général. Les députés se retirent, le public se bat jusqu’à l’arrivée de la police.) Toute la capitale parlait maintenant de la chute imminente de Madero; les cadets de Cavalerie et deux régiments avaient libéré Reyes et Díaz [auteurs de tentatives de pronunciamiento qui avaient échoués. Madero avait gracié les deux rebelles], le premier était tombé en attaquant le palais national, le second s’était enfermé dans la citadelle avec 350 hommes; au commandant de la place, blessé, avait été substitué Victoriano Huerta. Commençait alors la “décade tragique”, que certains malins appelaient “magiques”. Le généralBlanquet, secrètement féliciste, faisait massacrer les régiments maderistes, en les envoyant sous le feu des mitrailleuses rebelles, dûment prévenues. Huerta attendait, araignée dans sa toile. L’ambassadeur américain, fort plein de lui-même, sentait que l’heure était historique et cherchait à passer à l’histoire. Il commença par réunir le corps diplomatique pour demander à Madero de démissionner afin d’éviter plus de souffrances aux civils; en effet, Huerta faisait bombarder la citadelle avec une telle inefficacité que seuls les immeubles avoisinants étaient touchés. Reyistes et Felicistes des classes moyennes étaient dans la rue, attendaient le dénouement. La nuit, Huerta rencontrait les chefs rebelles à l’ambassade américaine et laissait les autres tirer les marrons du feu. Pour conclure le pacte, Felix Díaz lui demanda en gage la personne de Gustavo Madero, qui veillait sur la sûreté du président. Huerta invita Gustavo à déjeuner, lui promettant de prendre la citadelle dans l’après-midi du même jour, et le livra aux félicistes qui le massacrèrent. Et l’œil de verre de Gustavo passa de main en main comme un trophée. La révolution sanglante commençait» (J. Meyer. Ibid. pp. 47-48).
«Quant à la situation militaire, ajoute Jesus Silva Herzog, elle appelle quelques observations. Les rebelles de la citadelle étaient pratiquement encerclés et l’on aurait pu aisément éviter qu’ils reçoivent des vivres. Dans tout le reste du pays, l’armée fédérale demeura fidèle au gouvernement pendant toute la durée de la “décade tragique”. Les forces commandées par Huerta étaient supérieures à celles de Díaz dès l’arrivée du général Angeles, et il était possible d’augmenter encore les effectifs de la capitale grâceaux troupes qui étaient en garnison dans d’autres villes. D’après l’opinion des experts, la citadelle aurait pu être investie en l’espace de quelques heures. En réalité, le général en chef commença dès les premiers instants à tresser les fils de la trahison. Certains proches collaborateurs de Madero conçurent très vite des soupçons sur la conduite de Huerta et le lui firent savoir; mais le président, toujours naïf et bienveillant, ne prêta pas foi à ses véritables amis; il estimait peut-être que le cœur humain ne pouvait embrasser tant de perversité, et il paya très cher sa crédulité et sa profonde ignorance des hommes, les seuls vraiment cruels parmi tous les animaux de la création.
D’après les estimations approximatives, la “décade tragique” fit deux mille morts et six mille blessés, sans distinction entre les combattants et les citoyens pacifiques, victimes de leur curiosité. Ce fut une lutte stérile et sanglante, en même temps que criminelle et déshonorante» (J. S. Herzog. Ibid. p. 155).
«Dans la journée du 18 furent arrêtés Gustavo Madero et Adolfo Bassó. Ce dernier était un marin de valeur et intendant des résidences présidentielles. Il avait défendu aveccourage le Palais national contre l’attaque du général Reyes. Sur l’ordre de Huerta, Bassó et Gustavo Madero furent livrés à la soldatesque de la citadelle qui, après une si facile victoire, était assoiffée de sang et d’alcool. Gustavo Madero fut insulté et injurié par les soldats ivres. L’un d’eux creva le seul œil qui lui restait d’un coup de bayonnette [sic!], puis, aveugle et titubant, il fut achevé à l’arme blanche et au revolver. D’après l’ingénieur Alberto J. Pani, son cadavre était couvert de trente-sept blessures. Bassó fut passé par les armes, pour délit de loyauté envers le gouvernement qu’il avait servi. Il mourut avec une sérénité admirable en contemplant l’étoile polaire qui, d’après ses dernières paroles, l’avait si souvent guidé au cours de ses voyages en mer. Manuel Oviedo, chef politique de Tacubaya, madériste convaincu, fut également assassiné. Mais l’orgie de sang ne faisait que commencer» (J. S. Herzog. Ibid. pp. 155-156).
 Pendant ce temps, le
président Madero et le vice-
Pendant ce temps, le
président Madero et le vice-président Suárez était capturé par Huerta. Leur sort ne fut pas fixé immédiatement :
«Quant à Madero, Huerta avait encore à l’utiliser; avant d’être tué, le malheureux président devait permettre à l’usurpateur d’être investi de l’autorité légale. Madero et Pino Suárez furent donc amenés, par la promesse d’une amnistie pour eux et pour leurs compagnons, à donner leur démission; c’était là une faute que Madero n’aurait jamais dû commettre, mais qui, comme toutes ses fautes, fut causée par son désir d’éviter les effusions de sang et par sa trop grande confiance dans la bonté de la nature humaine. La présidence échut alors à Pedro Lascurain, qui fut alors persuadé de nommer Huerta ministre des affaires étrangères, puis de démissionner à son tour. Avant d’accepter, toutefois, il pria Huerta de promettre que Madero aurait la vie sauve. Huerta ouvrit sa chemise, en tira des médailles de la Vierge de Guadalupe et du Sacré-Cœur de Jésus, qu’il portait à son cou et jura le plus solennellement du monde que Madero serait autorisé à se retirer en exil. Les démissions furent alors transmises au congrès qui, surpris par la légalité du procédé et aussi intimidé par les troupes dont disposait Huerta, l’accepta comme président à la quasi-unanimité.
Madero et Pino Suárez s’attendaient à être envoyés à Veracruz; leurs femmes et leurs enfants allèrent les attendre à la gare Colonia. Huerta, cependant, continua de les garder au Palais, ne libérant qu’Angeles. Des diplomates étrangers et des membres de la famille Madero prièrent Henry Lane Wilson d’intercéder auprès du nouveau président; maisl’ambassadeur se contenta de répondre qu’il ne pouvait intervenir dans les affaires intérieures du Mexique. Il dit à Huerta de faire pour le mieux dans l’intérêt de la paix nationale et il déclara à ses amis que la vraie place de Madero était dans un asile d’aliénés et que Pino Suárez était un criminel qui mériterait d’être fusillé. Le 22 au soir, les deux hommes furent extraits du Palais et, sur le chemin du pénitencier, furent invités à sortir de leurs voitures et fusillés. On annonça officiellement qu’une troupe armée avait tenté de les enlever et qu’ils avaient été tués accidentellement dans la confusion générale. Henry Lane Wilson fit savoir à Washington qu’il était disposé à accepter cette explication et pria les consuls américains au Mexique d’user de leur influence en faveur du nouveau gouvernement» (H. B. Parkes. Op. cit. pp. 343-344).
«Le 22, aux environs de minuit, Madero et Pino Suárez furent conduits hors du Palais national et immédiatement séparés; puis on les fit monter dans des automobiles différentes sous prétexte de les transférer à la maison d’arrêt pour leur plus grande commodité. Parvenus non loin de la prison, ils furent lâchement assassinés, aumoment où ils descendaient de voiture, par les agents qui les conduisaient. Celui qui assassina Madero était un certain Francisco Cárdenas, major des forces rurales. Un groupe de gendarmes commandé par le féliciste Cecilio Ocón simula une attaque des véhicules, et c’est à ce moment-là que le crime fut perpétré. Le lendemain matin, les journaux en donnèrent une version officielle : au moment où Madero et Pino Suárez étaient conduits en prison, un groupe de leurs partisans avait tenté de les libérer et une lutte au révolver se serait engagé entre ceux-ci et les policiers qui les conduisaient. Les deux hommes politiques auraient été tués pendant ce combat. Personne ne le crut. Et, avec une indignation plus ou moins manifeste, le coupable fut immédiatement désigné comme étant Victoriano Huerta (J. S. Herzo. Op. cit. p. 163).
 de la démocratie et l’apôtre de la liberté. Le crime avait été perpétré avec la
complicité de l’ambassadeur Wilson, qui avait refusé d’écouter les
supplications de l’épouse de Madero, le complot entre Huerta et Díaz s’étant
fomenté à l’ambassade même. Le député Luis Manuel Rojas lança un «J’accuse»
d’un courage téméraire contre l’ambassadeur qui fut finalement rappelé par le
nouveau président des États-Unis. Huerta pouvait toujours penser que la mort de
Madero allait ramener l’ordre traditionnel qui avait régné durant les mandats
incontestés de Porfirio Díaz, mais il allait en être autrement et les dix jours
de conspirations contre le mandat de Madero se transformèrent en dix années de
guerres civiles cruelles et meurtrières.
de la démocratie et l’apôtre de la liberté. Le crime avait été perpétré avec la
complicité de l’ambassadeur Wilson, qui avait refusé d’écouter les
supplications de l’épouse de Madero, le complot entre Huerta et Díaz s’étant
fomenté à l’ambassade même. Le député Luis Manuel Rojas lança un «J’accuse»
d’un courage téméraire contre l’ambassadeur qui fut finalement rappelé par le
nouveau président des États-Unis. Huerta pouvait toujours penser que la mort de
Madero allait ramener l’ordre traditionnel qui avait régné durant les mandats
incontestés de Porfirio Díaz, mais il allait en être autrement et les dix jours
de conspirations contre le mandat de Madero se transformèrent en dix années de
guerres civiles cruelles et meurtrières. son environnement. En bon scienti-
son environnement. En bon scienti-fique, Diamond choisit des sociétés insulaires ou isolés dans leur milieu géogra-
phique (de l’île de Pâques à l’Islande), des civilisations qui ont connu un «effondrement» (c’est le titre français du livre) après une période d’expansion maxima (les Incas ou les Normands). Au moment où les questions concernant le réchauffement climatique et ses effets sur les différentes populations concernent la planète entière, le but idéologique du livre n’est pas innocent. Comme il l’écrit à propos de l’île de Pâques : «L’isolement de l’île de Pâques en fait l’exemple le plus flagrant d’une société qui a contribué à sa propre destruction en surexploitant ses ressources» (J. Diamond. Effondrement, Paris, Gallimard, Col. Folio-essais, # 513, 2006, p. 183). Même si Jared Diamond ne pense pas que la fin du monde est pour demain, la mise en garde est là. D’où ce besoin de distinguer ce que certaines sociétés ont réussi de celles qui ont échoué. Et le cas de l’île de Pâques est intéressant dans la mesure où les Polynésiens qui l’ont colonisé ont épuisé les ressources naturelles de l’île.
«L’île de Pâques est une île triangulaire composée de trois volcans qui ont émergé de l’océan très près les uns des autres, il y a de cela un ou plusieurs millions d’années, et qui sont restés en sommeil durant toute la période d’occupation humaine de l’île. Le plus ancien volcan, le Poike, est entré en éruption il y a environ six cent mille ans (peut-être même il y a trois millions d’années) et forme à présent l’angle sud-est du triangle, tandis que l’éruption du Rano Kau, survenue ultérieurement, a formé l’angle sud-ouest. Il y a environ deux cent mille ans, l’éruption du Terevaka, le plus jeune volcan situé près de l’angle nord du triangle, a recouvert de lave 95% de l’île.
La surface de l’île, qui est de cent soixante et onze kilomètres carrés, et son altitude maximale, qui est de cinq cent neuf mètres, sont modestes comparées au reste de la Polynésie. La topographie de l’île est globalement peu accidentée : on y retrouve pas les vallées profondes auxquelles sont habitués les visiteurs des îles hawaïennes. Sauf au niveau du cratère des volcans et des cônes de scories, dont les pentes sont assez raides, j’ai pu, sur presque toute l’île, marcher sans aucun risque et sans faire de détours pour atteindre n’importe quel point dans les environs, alors qu’à Hawaï ou dans les îles Marquises, je me serais très vite trouvé au-dessus d’une falaise.
Sa situation subtropicale à une latitude de vingt-sept degrés sud – à une distance au sud de l’équateur approximativement identique à celle qui sépare Miami et Taïpei de l’équateur au nord – adoucit le climat de l’île, tandis que ses origines volcaniques récentes lui assurent des sols fertiles. En eux-mêmes, ces atouts combinés auraient dû faire de Pâques un paradis miniature, épargné par les problèmes qui accablent la plupart des autres régions du globe. Et pourtant, la géographie de l’île a posé un certain nombre de difficultés aux hommes qui l’ont colonisée» (J. Diamond. Ibid. pp. 118-119).À lire cette description géographique, on se croirait transporté sur l’une des planètes du Petit Prince. Trop éloignée de l’équateur pour produire des fruits tropicaux, l’île est également soumise à des vents qui causent
 des problèmes aux agri-
des problèmes aux agri-culteurs qui survivent toujours sur l’île. Enfin, l’île est épargnée par les fortes pluviosités qui font des îles du Pacifique Sud des archipels luxuriants. Les premiers Polynésiens à accéder à l’île ne le firent qu’entre 400 et 1200 de notre ère. Entre les deux dates, l’an 900 semble la plus probable, quoique rien n’interdit de penser que l’île fut plusieurs fois atteintes par des pirogues provenant de l’ouest de l’Océan Pacifique. Par contre 900 semble la date la plus plausible pour une véritable colonisation de l’île. De quoi vivaient ces nouveaux indigènes?
«Au moment de l’arrivée des Européens, ils vivaient essentiellement de l’agriculture, cultivant la patate douce, l’igname, le taro, la banane et la canne à sucre, et de l’élevage de leur seul animal domestique, le poulet. L’absence d’une barrière de corail ou d’un lagon impliquait qu’ils mangeaient moins de poisson et de crustacés que les habitants des autres îles Polynésiennes. Des oiseaux de mer, des oiseaux terrestres et des marsouins purent être consommés par les premiers colons, mais ces espèces […], diminuèrent ou disparurent par la suite. Le régime des insulaires était donc très riche en glucides, d’autant qu’ils compensaient les faibles ressources en eau douce de l’île en buvant de grandes quantités de jus de canne à sucre» (J. Diamond. Ibid. p. 128).
Aussi intéressantes sont les observations démographiques de l’évolution de cette population :
«On a calculé le chiffre de population maximal de l’île de Pâques avec différentes méthodes. […] Le résultat est une fourchette de six mille à trente mille personnes, ce qui donne une moyenne de quatre-vingt-dix à quatre cent cinquante habitants au mile carré [de trente-cinq à cent soixante-treize habitants au kilomètre carré]. Certaines zones de l’île, comme la péninsule de Poike et les régions les plus élevées, étaient moins facilement cultivables, la densité de population devait donc être plus importante sur les meilleures terres, mais sans doute pas beaucoup plus, car les fouilles archéologiques montrent qu’une grande partie des terres était utilisée.
[…] Par ailleurs, les premiers recensements fiables de la population de l’île de Pâques quiaient été effectués l’ont été par des missionnaires qui s’étaient installés en 1864, immédiatement après une épidémie de variole qui avait décimé la majeure partie de la population. Et cette épidémie elle-même avait été précédée par la capture d’environ mille cinq cents insulaires par des marchands d’esclaves péruviens en 1862-1863, par deux épidémies de variole attestées survenues en 1836 et par d’autres épidémies dont on est pratiquement sûr qu’elles furent déclenchées par les arrivées régulières d’Européens à partir de 1770, et enfin par une chute vertigineuse de la population qui commença au début du XVIIe siècle…» (J. Diamond. Ibid. pp. 129-130).
«L’année 1862 fut décisive dans l’histoire de l’île de Pâques. Elle vit la fin de sa civilisation dont la plupart des aspects devaient nous devenir, en plein XIXe siècle, aussi lointains et imprécis que si nous en étions séparés par la nuit des temps.
En 1859, l’exploitation des gisements de guano sur la côte du Pérou constituait une entreprise fort prospère, qui ne rencontrait d’autre obstacle que le manque de main-d’œuvre. La fatigue, l’alimentation défectueuse et les épidémies décimaient les malheureux travailleurs asservis à cette dure besogne sur des îlots arides et brûlés par le soleil. Les Compagnies recrutaient leurs ouvriers à l’aide d’aventuriers qui recouraient, selon les circonstances, à la force ou à la ruse. Ces chasseurs d’esclaves d’un nouveau genre entreprirent une expédition en règle contre l’île de Pâques qui était, de toutes les îles polynésiennes, la plus proche du Pérou. Une flottille arriva devant la baie d’Hanga-roa le 12 décembre 1862. Les quelques insulaires, qui sans défiance, étaient montés à bord, furent aussitôt saisis, enchaînés et jetés à fond de cale. Comme personne ne se présentait plus, les négriers péruviens débarquèrent et à coups de fusil rabattirent vers le rivage tous les indigènes qu’ils purent atteindre. Dans leur épouvante, ceux-ci n’offrirent qu’une faible résistance.
Une autre version de la razzia donne des détails différents : les traitants péruviens auraient attiré les Pascuans vers le bord de la mer par un étalage de présents, puis, à un signal donné, les auraient massacrés et capturés en grand nombre. En 1914, lors du voyage de Mrs Routledge, il y avait encore quelques vieillards qui se souvenaient de ces scènes. Ils décrivaient les coups de fusil, la fuite des femmes et des enfants et les lamentations des captifs maintenus contre le sol, pendant qu’on les ligotait comme des bêtes. En un mot, toute l’horreur des razzias d’esclaves en Afrique noire. Dans leur épouvante, ceux-ci n’offrirent qu’une faible résistance.
Ce misérable chargement de chair humaine arriva au Pérou et fut immédiatement vendu aux Compagnies d’exploitation de guano. En quelques mois, les maladies, les mauvais traitements et la nostalgie réduisirent les 1,000 ou 900 indigènes emmenés en servitude àune centaine. Grâce à l’intervention de Mgr Jaussen, le Gouvernement français fit au Pérou des représentations auxquelles les Anglais s’associèrent. Des ordres officiels furent donnés pour le rapatriement de la poignée de Pascuans qui avaient survécu à ces mois de travaux forcés. Ils furent mis à bord d’un bateau qui devait les ramener dans leur île, mais la plupart moururent en cours de route de la tuberculose ou de la petite vérole. Une quinzaine seulement regagna l’île pour le plus grand malheur de la population qui y était demeurée : peu de temps après leur retour, la petite vérole dont ils portaient les germes, se déclara dans l’île et la transforma en un vaste charnier. Les cadavres étaient si nombreux que, ne pouvant être ensevelis dans les mausolées familiaux, ils étaient jetés dans les fissures de rocher ou traînés dans des couloirs souterrains. […]
À cette épidémie meurtrière, s’ajoutèrent les guerres intestines : l’ordre social fut sapé, les champs restèrent sans propriétaires et l’on se battit pour s’en assurer la possession. Puis ce fut la famine; la population tomba à environ 600 individus. La plupart des membres de la classe sacerdotale disparut en emportant les secrets du passé. Quand, l’année suivante, les premiers missionnaires s’établirent dans l’île, ils n’y trouvèrent plusqu’une civilisation agonisante : le système religieux et social était détruit et une lourde apathie s’était emparée des rescapés de ce désastre. Ce peuple sans passé et sans avenir, brisé physiquement et moralement, allait être gagné au Christianisme sinon sans efforts, du moins en peu de temps» (A. Métraux. L’île de Pâques, Paris, Gallimard, Col. Tel, # 46, 1941, pp. 36-37).
 leur fabrication nous permet de compren-
leur fabrication nous permet de compren-dre mieux le lent dépéris-
sement des Pascuans, dont l’inter-
vention occiden-
tale ne fut que le coup de grâce. Lorsque nous con-
sidérons le patrimoine archéologique de l’île, nous découvrons que celle-ci comprend environ 887 statues de basalte volcanique, les moaï de 4 m de hauteur moyenne et près de 300 terrasses empierrées au pied de ces statues, les ahû. Ces ahû auraient servi d’appuis afin de hisser les statues de pierre après les avoir acheminées des carrières vers les rives océanes. Diamond estime d’abord un premier fait non sans importance :
«Tout ce travail de construction de statues et de plates-formes fut certainement très coûteux en termes de ressources alimentaires, dont le stockage, le transport et la distribution devaient être assurés par les chefs commanditaires des statues. Il fallait nourrir vingt sculpteurs pendant un mois, qui peut-être étaient également payés en nourriture, puis il fallait nourrir une équipe de cinquante à cinq cents transporteurs, et enfin il fallait nourrir une même équipe d’hommes chargés de l’érection des statues alors qu’ils effectuaient un travail physique très dur qui augmentait d’autant leur consommation de nourriture. Il y eut probablement aussi de nombreuses célébrations au sein du clan possesseur de l’ahu et dans les clans dont il fallait traverser le territoire pour transporter les statues. Les archéologues qui ont les premiers tenté de calculer la quantité de travail effectué, les calories brûlées et donc la quantité de nourriture consommée n’ont pas pris en considération le fait que la statue elle-même ne constituait que la plus petite partie des opérations : un ahu était environ vingt fois plus lourd que ses statues et il fallait également transporter toutes les pierres qui serviraient à le construire» (J. Diamond. Op. cit. p. 151).
 terres intérieures de l’île produisit un important excédent de nourriture par
rapport aux quantités disponi-
terres intérieures de l’île produisit un important excédent de nourriture par
rapport aux quantités disponi-bles aupa-
ravant. Si l’on considère que la période de construction des moaï s’étend du XIe siècle jusque vers 1600, l’on constate également une progression dans le gigantisme des statues d’une période à l’autre. Les dernière statues seraient restées à mi-chemin, inachevées. Ces monolithes pesant plusieurs tonnes, devaient requérir un nombre imposants de guerriers et nécessiter des cultivateurs pour la production de tout cet excès de nourriture. Mais cet accroissement de dépenses énergétiques n’est qu’un premier indice troublant :
«La construction et l’érection des statues exigeaient non seulement de grandes quantités de nourriture mais également de grandes quantités de grosses cordes (fabriquées en Polynésie à partir d’écorce d’arbre ligneuse) grâce auxquelles cinquante à cinq cents hommes pouvaient remorquer des statues pesant de dix à quatre-vingt-dix tonnes, ainsi qu’un nombre important de grands arbres solides dans lesquels on pouvait tailler les traîneaux, les rails et les leviers. Mais sur l’île de Pâques que découvrirent Roggeveen, puis d’autres visiteurs européens, il y avait très peu d’arbres, et ceux qu’ils y virent étaient tous chétifs et mesuraient moins de trois mètres cinquante : c’était en fait l’île la moins arborée de toute la Polynésie. Où se trouvaient alors les arbres qui fournirent la corde et le bois nécessaires?» (J. Diamond. Ibid. p. 152).
 possède plus au-
possède plus au-jourd’hui, montre que n'a survécu aucune espèce indigène à ce jour. Bref, l’île de Pâques, au moment où les premiers Polynésiens l’accostèrent, vers l’an 1000, était couverte de palmiers dont le tronc pouvait atteindre un diamètre supérieur à deux mètres! Outre des palmiers, l’île aurait eu aussi cinq autres espèces d’arbres disparus, et seize autres espèces végétales qui se rapprochent des espèces encore répandues sur l’île. La végétation de l’île de Pâques était donc tout à fait comparable à n’importe quelle autre île de l’Océan Pacifique Sud. Et ce qui vaut pour la flore vaut également pour la faune :
«Le zooarchéologue David Steadman s’est quant à lui penché sur six mille quatre cent trente-trois os d’oiseaux et d’autres vertébrés retrouvés sur d’anciens dépotoirs sur la plage d’Anakena, qui fut probablement le premier lieu de débarquement et le premier sitede colonisation humaine de l’île de Pâques. […] Steadman a appris à distinguer jusqu’aux os d’une dizaine d’espèces de pétrels très proches les unes des autres. Il a ainsi prouvé que l’île de Pâques, qui aujourd’hui n’abrite pas la moindre espèce d’oiseau terrestre indigène, était autrefois habitée par au moins six espèces, parmi lesquelles une espèce de héron, deux râles proches du poulet, deux perroquets et une effraie. Plus impressionnant encore, l’île comptait un total prodigieux d’au moins vingt-cinq espèces d’oiseaux de mer lorsque ceux-ci étaient en période de nidification, elle était donc autrefois le site de reproduction le plus riche de toute la Polynésie et probablement de tout le Pacifique. On y trouvait des albatros, des fous, des frégates, des fulmars, des pétrels, des prions, des puffins, des océanites, des sternes et des phaétons, attirés par la situation éloignée de l’île
de Pâques et par l’absence totale de prédateurs qui en firent un site idéal de reproduction, jusqu’à l’arrivée des humains. David Steadman a également découvert quelques os de phoques, qui aujourd’hui se reproduisent dans les Galapagos et sur les îles Juan Fernandez à l’est de l’île, mais on ne peut dire avec certitude si ces quelques os de phoques retrouvés sur l’île de Pâques ont été laissés par de véritables colonies de reproduction ou seulement par quelques individus de passage» (J. Diamond. Ibid. pp. 156-157).
«Les premiers colons de l’île de Pâques purent donc consommer la chair des marsouins,des poissons, des crustacés, des oiseaux et des rats, mais ce n’était pas tout. J’ai déjà mentionné des traces laissées par quelques phoques, mais d’autres os attestent encore de la présence occasionnelle de tortues de mer et peut-être de grands lézards. Tous ces mets délicieux étaient cuisinés sur des feux dont on a pu montrer qu’ils étaient nourris grâce au bois des forêts de l’île qui disparurent par la suite» (J. Diamond. Ibid. p. 158).
«Sur l’ensemble des îles du Pacifique, seule Pâques finit par voir disparaître tous ses oiseaux terrestres. Sur les vingt-cinq – ou plus – espèces d’oiseaux de mer qui précédemment se reproduisaient sur l’île de Pâques, vingt-quatre ne se reproduisent désormais plus sur l’île elle-même, en raison de la surexploitation des terres et de la prédation par les rats, neuf espèces environ sont à présent condamnées à se reproduire sur quelques îlots rocheux au large des côtes de l’île et quinze espèces ont été éliminées, y compris sur ces îlots. Même les coquillages furent surexploités, si bien que la population finit par consommer moins de grosses porcelaines, qui étaient très appréciées, et plus d’escargots noirs, plus petits et ne constituant qu’une nourriture de second choix. La taille des coquilles de porcelaines aussi bien que d’escargots retrouvés dans les dépotoirs diminue au fil du temps car les habitants avaient effectué un ramassage excessif des pus gros individus» (J. Diamond. ibid. p. 159)
 Pascuans de leur environnement pour atteindre à l’excès spirituel fut la première qui ouvrit la voie à toutes les possibili-
Pascuans de leur environnement pour atteindre à l’excès spirituel fut la première qui ouvrit la voie à toutes les possibili-«La déforestation a probablement commencé peu de temps après l’arrivée des humains,autour de l’an 900 après J.-C., et devait être achevée vers 1722, lorsque Roggeveen arriva et n’aperçut aucun arbre d’une taille supérieure à trois mètres cinquante. Sommes nous en mesure de donner une date plus précise, entre 900 et 1722, marquant le début de la déforestation? Nous disposons pour cela de quatre types d’indices. La plupart des dates déduites de la radiodatation des noix de palmier elles-mêmes se situent avant 1500, suggérant que le palmier se raréfia ou disparut ensuite. Sur la péninsule de Poike, où se trouvent les sols les plus infertiles de l’île et qui donc fut probablement la première à être déboisée, les palmiers disparurent aux environs de 1400, et le charbon de bois résultat du déboisement disparut vers 1440, bien que les signes plus tardifs d’activités agricoles attestent du maintien d’une présence humaine à cet endroit. Les échantillons de charbon de bois datés au radiocarbone et prélevés dans les fours et sur les dépôts de détritus par Catherine Orliac montrent que le charbon de bois fut remplacé comme combustible par des herbes et des graminées après 1640, y compris dans les demeures de l’aristocratie qui aurait pu confisquer les derniers précieux arbres quand n’en resta plus aucun pour les
paysans. Les prélèvements de pollen effectués par Flenley attestent de la disparition des pollens du palmier, de la Scalesia pedunculata (une espèce endémique de la famille du tournesol), du toromiro et des arbustes et de leur remplacement par des pollens d’herbes et de graminées, entre 900 et 1300, mais les dates obtenues par le radiocarbone sur les carottes de sédiments sont moins fiables, lorsqu’il s’agit d’établir la chronologie de la déforestation, que ne le sont les dates obtenues directement sur les palmiers et leurs noix. Enfin, les plantations des hautes terres qui ont été étudiées par Chris Stevenson et dont la période d’activité correspond peut-être à la période d’utilisation maximale du bois d’œuvre et de la corde pour les statues furent exploitées entre les premières années du XVe siècle et le XVIIe siècle. Tout cela laisse penser que le déboisement commença peu de temps après l’arrivée des humains, qu’il atteignit son maximum vers 1400 et qu’il était quasi achevé à des dates qui varièrent localement et qui se situent entre le début du XVe siècle t le XVIIe siècle» (J. Diamond. Ibid. pp. 161-162).
 la source des
combustibles, de sorte qu’on alla jeter les cadavres dans les anfractuo-
la source des
combustibles, de sorte qu’on alla jeter les cadavres dans les anfractuo-sités de l’île. Les chutes de tempéra-
ture, la nuit, l’hiver, atteignirent 10º Celsius! Les chefs durent se faire de terribles guerres pour conserver les dernières friches de forêts. La plupart des ressources alimentaires sauvages disparurent. L’érosion s’accentua sous la poussée des vents et des pluies. De la déforestation, on passait carrément à la désertification. C’est dans cet état que les Occidentaux abordèrent l’île de Pâques.
 dans l’atmosphère et dans l’océan. La
mise en garde de Jade Diamond peut forcer certains traits au détriment de
d’autres pour expliquer l’effondrement de
la société pascuane, mais c’est bien l’ensemble de la population qui participa
à cette exploitation forcenée, pensant que les ressources de l’île étaient inépuisables
et que les dieux, dont on honorait la présence avec de colossales statues munies
d’yeux en coquillages regardant l’horizon, les protégeraient coûte que coûte.
Victimes de son goût culturel du gigantisme, les Pascuans n’avaient ni l’espace ni la démographie des Égyptiens ou des Chinois pour entreprendre des
œuvres de civilisation aussi coûteuses. L'île s’épuisa plus vite qu’elle ne
récupéra et fit de sa population, ce que Toynbee appelait une civilisation avortée.
dans l’atmosphère et dans l’océan. La
mise en garde de Jade Diamond peut forcer certains traits au détriment de
d’autres pour expliquer l’effondrement de
la société pascuane, mais c’est bien l’ensemble de la population qui participa
à cette exploitation forcenée, pensant que les ressources de l’île étaient inépuisables
et que les dieux, dont on honorait la présence avec de colossales statues munies
d’yeux en coquillages regardant l’horizon, les protégeraient coûte que coûte.
Victimes de son goût culturel du gigantisme, les Pascuans n’avaient ni l’espace ni la démographie des Égyptiens ou des Chinois pour entreprendre des
œuvres de civilisation aussi coûteuses. L'île s’épuisa plus vite qu’elle ne
récupéra et fit de sa population, ce que Toynbee appelait une civilisation avortée.Par deux fois depuis que la Martinique avait été colonisée par les Français, la Montagne Pelée (dont le nom ne vient pas de la déesse hawaïenne Pele comme le suggèrent les historiens américains Thomas et Witts [déformation ethnocentrique], mais du sommet dégarni par les laves vomies de son cratère et qui avaient rasé toute végétation), avait connu deux éruptions. Une en 1792, où elle avait craché une mince couche de
 cendres autour de son cratère. «Un début d’érup-
cendres autour de son cratère. «Un début d’érup-tion, vite avorté, eut lieu en 1871. Au cours du prin-
temps, les habitants des hauteurs du Prêcheur perçurent une odeur d’acide sulf-hydrique. Le 5 août, un peu avant minuit, ils furent réveillés par de sourdes détonations et purent observer, le lendemain, qu’une mince couche de cendre recouvrait la Montagne Pelée et ses abords jusqu’à Saint-Pierre. Un panache de fumée surmontait le volcan. Une autre manifestation du même genre se renouvela au mois d’octobre» (E. Aubert de la Rüe, L’homme et les volcans, Paris, Gallimard, Col. Géographie humaine, # 30, 1958, p. 218). Un violent orage étant survenu peu après, tout le manteau de cendre avait été nettoyé. Donc, il devient compréhensible que, malgré les signes inquiétants de 1902, les habitants de la ville, située entre le volcan et la mer, n’aient pas cru que la prochaine éruption pourrait être d’une violence inimaginable.
«Les premiers symptômes indiquant le réveil prochain de l’activité interne apparurent trois ans plus tôt, en 1899, lorsque des fumerolles d’hydrogène sulfuré se manifestèrent da le vieux cratère de l’Étang Sec. Ces émanations gazeuses s’amplifièrent au cours des années suivantes. À partir de février 1902 elle commencèrent à incommoder fortement les habitants des hauteurs du Prêcheur, mais ne furent ressenties que plus tard à Saint-Pierre. De légères secousses ébranlèrent les abords du volcan le 22 avril. Le 24, une violente détonation se fit entendre et l’on vit pour la première fois s’élever une colonne noire de vapeurs, chargées de cendres, montant à 500 m de hauteur. Elle provenait d’une fissure qui venait de s’ouvrir dans la caldeira de l’Étang Sec, située à l’altitude de 600 m. Un nuage de cendres fines recouvrit le jour suivant le bourg du Prêcheur. Ainsi se précisait le point faible où allait désormais se concentrer l’activité du volcan. Une activité accrue se manifeste à partir du 28 avec de forts grondements, des pluies de cendres plus abondantes. Des sources sont brusquement taries. Le 5 mai, les projections et la condensation des vapeurs dégagées par l’éruption naissante provoquent une avalanche d’eau boueuse qui se précipite dans le lit de la Rivière Blanche, entraînant la destruction totale des Usines Guérin et la mort de 23 personnes. Une centaine d’autres furent également tuées par le passage de cette avalanche» (E. Aubert de la Rüe. Ibid. pp. 218-219).
 Cette
fois-ci, les alertes étaient trop
sérieuses pour ne pas semer l’inquié-
Cette
fois-ci, les alertes étaient trop
sérieuses pour ne pas semer l’inquié-tude dans la popu-
lation. Par quelle négligence la population de Saint-Pierre, ainsi informée que la ville était menacée, décida-t-elle de rester under the volcanoe?
«Les premières vibrations du sol et les rumeurs souterraines survenues dans le courant d’avril auraient dû inciter les autorités à prendre les mesures de sécurité qui s’imposaient et à alerter la population. À Saint-Pierre, dans les débuts, on ne s’émut guère de la menace qui pesait sur la ville, d’autant plus que le volcan tout proche n’avait jamais manifesté sa présence par aucune catastrophe. Alertée et bientôt terrifiée par les soubresauts de plus en plus violents du volcan, la population de Saint-Pierre s’apprêtait finalement à fuir pour se réfugier à Fort-de-France. Mais des élections municipales étaient sur le point d’avoir lieu et les candidats appréhendaient la dispersion de leurs électeurs. En empêchant l’exode des Saint-Pierrais, les politiciens locaux sont dans une certaine mesure responsables de la mort de dizaines de milliers de personnes. Il est vrai que le gouvernement Mouttet, qui devait lui-même périr dans la catastrophe, avait nommé une commission, aussitôt après la destruction de l’usine à sucre de la plantation Guérin par les premières manifestations alarmantes de la Montagne Pelée, mais celle-ci avait déclaré que la ville de Saint-Pierre n’était pas en danger» (E. Aubert de la Rüe. Ibid. p. 219).
 politicien-né, avait compris quel danger il pouvait
représenter. S’il continuait à menacer Saint-Pierre, il y avait un risque de
panique. Et une panique coûterait des voix précieuses au parti progressiste»
(G. Thomas et M. Morgan Witts. Le volcan
arrive!, Paris, Robert Laffont, Col. Ce jour-là, 1970, p. 39). C’est alors
que la négligence du gouverneur commença à véritablement tricoter son filet qui
allait s’étendre bientôt sur les Saint-Pierrais : il commença par
neutraliser la presse afin que le journal Les Colonies,
rassurent les citoyens sur la non-dangerosité du volcan. Puis, il resta
froid devant le rapport inquiétant du capitaine du Topaz, un navire britannique ancré à proximité de Saint-Pierre :
politicien-né, avait compris quel danger il pouvait
représenter. S’il continuait à menacer Saint-Pierre, il y avait un risque de
panique. Et une panique coûterait des voix précieuses au parti progressiste»
(G. Thomas et M. Morgan Witts. Le volcan
arrive!, Paris, Robert Laffont, Col. Ce jour-là, 1970, p. 39). C’est alors
que la négligence du gouverneur commença à véritablement tricoter son filet qui
allait s’étendre bientôt sur les Saint-Pierrais : il commença par
neutraliser la presse afin que le journal Les Colonies,
rassurent les citoyens sur la non-dangerosité du volcan. Puis, il resta
froid devant le rapport inquiétant du capitaine du Topaz, un navire britannique ancré à proximité de Saint-Pierre :«Dans son journal, Mouttet écrivit qu’après tout, la ville affrontait calmement une situation éprouvante et qu’aucun signe de panique n’avait été relevé. Il omettait volontairement qu’un cordonnier s’était conduit bizarrement. L’homme avait passé la journée dans son échoppe de la place Bertin, refusant d’ouvrir à quiconque et criant à tue-tête que le Jugement Dernier approchait. Il était vite devenu un objet de moquerie et Mouttet, comme tout bon politicien, connaissait la valeur du ridicule pour masquer des problèmes plus importants…
Il avait également écarté les deux requêtes que des messagers de Fernand Clerc [un riche propriétaire de la région] avaient présentées à la Résidence. Clerc réclamait une visite du gouverneur à Saint-Pierre pour qu’il juge par lui-même de la situation.
Mais Mouttet refusa. Il viendrait à Saint-Pierre la veille de l’Ascension pour le banquet annuel du maire. Avec sa femme, il traverserait officiellement la ville et montrerait ainsi aux citoyens ce qu’il pensait de la menace de la Montagne Pelée» (G. Thomas et M. Morgan Witts. Ibid. pp. 39-40).
«Le président de la commission serait le lieutenant-colonel Jules Gerbaud, sous-gouverneur et commandant de l’artillerie de l’île. Ses membres, Paul Alphonse Mirville, pharmacien-chef des troupes coloniales, William Léonce, ingénieur civil, Eugène-Jean Doze et Gaston-Jean-Marie-Théodore Landes, tous deux professeursd’histoire naturelle au Lycée de Saint-Pierre.
Landes, âgé de 42 ans, était un savant dont la réputation avait franchi les limites de l’île. Il donnerait à la commission le poids dont elle avait grandement besoin.
Mais cela ne suffirait pas à la sauver des accusations qui pèseraient sur elle plus tard. Des commissions précédentes avaient déjà pris des mois pour étudier les faits ; leurs membres avaient été choisis pour leur notoire impartialité et leurs nominations avaient été ratifiées ultérieurement par le gouvernement français. Mais Mouttet dans son désir de rétablir le calme et de surmonter le scepticisme des étrangers avait décidé de ne pas recourir aux méthodes traditionnelles dans sa constitution d’une commission.
La commission Mouttet était dès le départ marquée du sceau de l’absurde. Hormis Landes, aucun de ses membres n’était scientifiquement compétent pour juger de la conduite ultérieure du volcan. Au lieu de mois, elle aurait deux jours pour évaluer la menace pesant sur Saint-Pierre. Ses conclusions devaient être publiées dans Les Colonies le mercredi suivant.
[…] le rôle de cette commission était clair, elle devait tranquiliser et endosser en quelque sorte l’opinion personnelle de Mouttet sur la situation» (G. Thomas et M. Morgan Witts. Ibid. p. 92).
 prisonniers (essentiellement des Noirs) dans la prison de Saint-Pierre fut
apaisée par une rafale de mousquets. Au cours des délibérations de la
Commission, Mouttet répéta à ses membres «que
le rôle de la commission était surtout de démontrer que Saint-Pierre était à
l’abri et non d’épiloguer sur le volcan. […] “Votre mission est d’estimer scientifiquement combien de temps
Saint-Pierre peut supporter l’épreuve de la cendre et du soufre”». Bref, il
fallait passer le jour des élections, et ensuite on évacuerait la ville. Pendant ce temps, Saint-Pierre ne
cessait de se remplir de réfugiés fuyant les zones dévastées par les coulées de
boues. Mouttet, lui, faisait parvenir au ministère un rapport rassurant,
omettant les points majeurs de l’éruption de la Montagne Pelée, y compris les
200 morts et l’état de panique qui commençait à s’emparer de la population. Il
restait un dernier tour de scrutin à effectuer avant que l’élection des
Radicaux soit assurée. Les 200 morts de la Rivière Blanche ne comptaient pas
plus que Mouttet avait totalement perdu le sens de la réalité. Enfoncé dans son
fauteuil de son palais à Fort-de-France, il ne voyait pas les bêtes fuir la
région ni le manque de provisions qui commençait à faire des Saint-Pierrais
des gens assiégés. Enfin, le rapport livra au gouverneur les résultats dont il
en attendait. Mouttet s’était ainsi rassuré. Tous les autres messages parlant
de coulée de lave ou autres manifestations le laissèrent froid. Saint-Pierre
n’avait rien à craindre. Comble de la situation, la vérole commençait à faire
des ravages : 112 personnes étaient mortes dans la journée du lundi 5 mai.
prisonniers (essentiellement des Noirs) dans la prison de Saint-Pierre fut
apaisée par une rafale de mousquets. Au cours des délibérations de la
Commission, Mouttet répéta à ses membres «que
le rôle de la commission était surtout de démontrer que Saint-Pierre était à
l’abri et non d’épiloguer sur le volcan. […] “Votre mission est d’estimer scientifiquement combien de temps
Saint-Pierre peut supporter l’épreuve de la cendre et du soufre”». Bref, il
fallait passer le jour des élections, et ensuite on évacuerait la ville. Pendant ce temps, Saint-Pierre ne
cessait de se remplir de réfugiés fuyant les zones dévastées par les coulées de
boues. Mouttet, lui, faisait parvenir au ministère un rapport rassurant,
omettant les points majeurs de l’éruption de la Montagne Pelée, y compris les
200 morts et l’état de panique qui commençait à s’emparer de la population. Il
restait un dernier tour de scrutin à effectuer avant que l’élection des
Radicaux soit assurée. Les 200 morts de la Rivière Blanche ne comptaient pas
plus que Mouttet avait totalement perdu le sens de la réalité. Enfoncé dans son
fauteuil de son palais à Fort-de-France, il ne voyait pas les bêtes fuir la
région ni le manque de provisions qui commençait à faire des Saint-Pierrais
des gens assiégés. Enfin, le rapport livra au gouverneur les résultats dont il
en attendait. Mouttet s’était ainsi rassuré. Tous les autres messages parlant
de coulée de lave ou autres manifestations le laissèrent froid. Saint-Pierre
n’avait rien à craindre. Comble de la situation, la vérole commençait à faire
des ravages : 112 personnes étaient mortes dans la journée du lundi 5 mai. conster-
conster-nation de ceux-ci, il se veut rassurant en mention-
nant les vivres et les objets de première nécessité distribués par le gouverneur. Il y prétendait que les vallées qui séparaient le volcan de la ville sauraient épargner Saint-Pierre d’éventuels dangers. Il fit imprimer la proclamation à 100 exemplaires distribués dans la ville. Dans les faits, des gens commencent à fuir la ville. C’est pour les y repousser qu’une troupe est dépêchée pour couper la retraite. Il est évidemment que les Saint-pierrais sont maintenant prisonniers ou confinés dans leur ville. Comment Mouttet en était-il arrivé à cette décision absurde?
«[Edouard L’Heurre] avait trente ans, des ambitions et un sens aigu de l’observation. C’était lui qui, de par ses fonctions, était pratiquement chargé de l’administration de l’île au jour le jour. Il avait réussi à garder la confiance des radicaux et des progressistes et le respect de son gouverneur. Il jouerait un rôle essentiel dans les jours à venir.
Il fut choqué des changements survenus chez Mouttet et fit remarquer par la suite que celui-ci montrait des signes évidents de “malaise”. Quand L’Heurre lui fit remarquer que la nouvelle de la catastrophe [la destruction de l'Usine Guérin], il rétorqua que les radicaux avaient intérêt à semer l’alarme. Quand il découvrit que Knight avait télégraphié au ministre, il devint soudain agité, répétant sans cesse que cette intervention était destinée à lui créer des histoires. Enfin, quand un premier télégramme de Fouché parvint, avec les détails sur sa proclamation, il se calma à nouveau et, avec un soulagement évident, déclara que tout ceci prouvait qu’il n’y avait pas à s’inquiéter et que les gens obéiraient à leur maire. À ce moment-là arriva un second message réclamant des pouvoirs supplémentaires. Mouttet s’agita à nouveau; il lui paraissait clair que le maire craignait que les radicaux ne suscitent des troubles. Il décida, impulsivement, d’envoyer des troupes assurer le maintien de l’ordre et renforcer la garnison. L’Heurre répliqua que cela ne ferait qu’empirer les choses, et qu’on accuserait l’administration coloniale d’ingérence dans les affaires politiques.
Cette pensée déprima à nouveau Mouttet ; il s’enfonça dans son fauteuil avec un air absent et vague. Il finit par convenir qu’il était peu diplomate d’envoyer des soldats en ville mais qu’on les posterait sur la route à l’extérieur, avec un ordre d’empêcher l’exode des réfugiés qui sèmeraient inutilement l’alarme dans l’île. L’Heurre répliqua à cela qu’à sa connaissance, toute l’île était au courant de ce qui se passait et qu’il était inutile de poster des troupes, mais Mouttet s’entêta et exigea que son ordre fût exécuté.
Son obsession des élections, sa crise dépressive, sa suggestion que les radicaux complotaient contre lui, jointes à son indécision et finalement à son indifférence, tout ceci prouve amplement que le gouverneur perdait de plus en plus le sens des réalités. La tragédie venait de ce que, tandis que L’Heurre comprenait que quelque chose ne tournait pas rond, il ne pouvait mesurer à quel point le gouverneur n’était pas dans un état normal. Son récit des événements de l’après-midi est une pénible description de la marche progressive du gouverneur vers la folie.
Ce dernier, après que l’Heurre eut envoyé des soldats avec l’ordre de montrer de lasympathie, lui ordonna de convoquer les membres de la commission d’enquête. Quand ils furent là, il leur déclara qu’ils allaient tous partir inspecter la région dévastée par la boue. Il leur fit clairement comprendre que malgré sa gravité, ce n’était qu’un épisode, rien ne permettait d’affirmer que la situation d’ensemble ait changé. Landes était du reste de cet avis et il était évident que son opinion serait celle des autres membres. Arrivé au bord de la coulée de boue, Mouttet se plaignit qu’il n’y eût pas grand-chose à voir et qu’au fond ils aient perdu leur temps. Landes malgré tout réagit; il fit remarquer que près de 160 personnes étaient mortes là; pourtant il fut d’accord avec le gouverneur pour affirmer que cette émission de lave avait dû créer une certaine détente au sein du cratère qui réduisait d’autant la menace de nouvelles éruptions» (G. Thomas et M. Morgan Witts. ibid. pp. 182-184).
 roches étaient chauffées de plus
en plus de l’intérieur, le reflet s’inten-
roches étaient chauffées de plus
en plus de l’intérieur, le reflet s’inten-sifia. Soudain la tache fut projetée dans le ciel comme dans une nuée ardente. Les rocs éjectés traversèrent l’air obscur pour s’écraser sur les pentes et les vallées alentour. Par le trou près du sommet, d’où ils s’étaient échappés, jaillit un jet de poussière blanche et brûlante, de vapeur et de lave incandescente. Un sifflement aigu fut clairement entendu jusqu’à Fort-de-France. L’entendant, Mouttet se précipita à la fenêtre de son bureau. Une fois de plus, Mouttet se campa dans son déni : «Qui a jamais entendu siffler un volcan?». Non, ce ne pouvait être que le sifflement d’un navire au rade.
 Sur la route de
Saint-Pierre, il devint de plus en plus sombre. Arrivé à Saint-Pierre, il découvrit
l’étendue des dom-
Sur la route de
Saint-Pierre, il devint de plus en plus sombre. Arrivé à Saint-Pierre, il découvrit
l’étendue des dom-mages. Les signes d’un désastre étaient évidents. Une épaisse couche de cendres s’étendait partout, on ne pouvait avancer que lentement. Les gens dévisageaient la voiture sans réagir. Le gouverneur essaya de susciter leur attention. Peines perdues. La rue avait perdu son animation de la semaine précédente, lorsqu’on débattait politique. La majorité des magasins était fermée, les persiennes bien closes. Saint-Pierre était morte avant d’être détruite. L’Heurre en venait à la conclusion qu’il était plus que temps d’évacuer la ville.
«Le gouverneur proposa que l’on discute sur-le-champ de cette mesure et Fouché s’y opposa vivement. Pour lui, partir serait un désastre. Le parti progressiste, à cause de la dispersion de ses adhérents citadins, perdrait les élections alors que les radicaux pourraient compter sur leurs nombreux partisans des campagnes. Saint-Pierre ne se relèverait pas sur le plan commercial. Il ajouta enfin qu’il y avait le banquet et que songer à l’évacuation après tout le mal qu’il s’était donné, était impossible. L’Heurre lui dit alors que tout était annulé mais il ne réagit pas. Il se tourna vers le gouverneur qui hocha la tête en signe d’acquiescement. Il entra alors dans une violente colère contre Landes d’abord, puis contre L’Heurre. Il montra sur son bureau son “plan” qui devait se dérouler envers et contre tout. L’écouter c’était prêter l’oreille à un homme venant d’une autre planète. Il répétait avec insistance que toutes les mesures avaient été prises pour que la fête fût un succès, le personnel devait dépoussiérer la table et les rideaux! D’autres préposés devaient éventer les invités ! L’orchestre avait répété tout le jour! C’était un catalogue de futilités incongrues. Il revenait sans cesse à son “plan” comme un prestidigitateur dévoile en cascade des surprises, mais, pour ses auditeurs, la seule surprise c’était justement qu’il avait perdu son bon sens et qu’il était inconscient de ce qui se passait à sa porte. L’Heurre lui demanda s’il avait parcouru la ville, et il hurla qu’il avait été bien trop absorbé par l’élaboration de son “plan” et qu’au surplus s’il s’était passé quelque chose d’important on l’en aurait informé. Bref, il était obsédé par ses préparatifs et il ne se tut que lorsque L’Heurre lui apprit que beaucoup de personnalités avaient décliné son invitation. Il demanda alors pourquoi et qui. Il était de toute évidence aussi coupé de la réalité et égaré que le gouverneur l’avait été précédemment. Ce dernier prit enfin la parole pour demander que tout le monde soit informé de l’annulation des fêtes. Comme il était tard, Madame Mouttet, lui-même et les membres de la commission ne retourneraient pas à Fort-de-France et passeraient la nuit à l’hôtel de l’Indépendance. Ils assisteraient à la messe dans la cathédrale le lendemain matin. L’Heurre par contre prié de rejoindre Fort-de-France pour y attendre un éventuel message du ministre des Colonies. Il ne fut guère satisfait de cette mission car il redoutait les raids nocturnes des adorateurs du vaudou.
Douze heures plus tard, L’Heurre se rendrait compte que cet ordre du gouverneur lui avait sauvé la vie» (G. Thomas et M. Morgan Witts. ibid. pp. 238-239).
«Le 8 mai 1902, dans la matinée, après s’être subitement ouvert en deux, le volcan lançait droit dans la direction de Saint-Pierre la première et la plus dévastatrice de ses nuées ardentes. Dévalant à la vitesse de 150 km à l’heure, elle provoqua la catastrophe que l’on sait. Ce fut une trombe de gaz asphyxiant à haute température, de cendres brûlantes et d’énormes blocs de lave, dont le passage rasa la ville en quelques instants, tuant ses 28.000 habitants. Après quelques jours d’accalmie relative, limitée à des chutes de cendres, la Montagne Pelée était le siège d’une nouvelle explosion avec expulsion d’une nouvelle nuée ardente qui, partant du même point, acheva de détruire ce qui restait encore debout. Ce deuxième cataclysme ne fit guère de victimes, pour la bonne raison qu’il n,y avait pas de survivants.» (E. Aubert de la Rüe. Op. cit. pp. 219-220).
 En
fait, il devait y avoir un survivant, un prisonnier enfermé dans une cellule
réduite, un Noir, Auguste Ciparis. Son corps était couvert de brûlures atroces.
Trois jours plus tard, il fut retrouvé dans les décombres et sauvé par un
prêtre. Il devait finir sa vie comme exhibition dans le cirque Barnum, avec une
réplique de sa cellule! Quelques marins dans les navires à vapeur anglais et
canadiens qui mouillaient dans le port et qui s’enfuyaient, rattrapés par la
nuée ardente, parvinrent également à survivre. L’éruption se poursuivit durant
les mois suivants, une nouvelle nuée ardente détruisit
le bourg de Morne Rouge, vers l’Est, et
partiellement l’agglomération d’Ajoupa-Bouillon, faisant un millier de victimes
de plus.
En
fait, il devait y avoir un survivant, un prisonnier enfermé dans une cellule
réduite, un Noir, Auguste Ciparis. Son corps était couvert de brûlures atroces.
Trois jours plus tard, il fut retrouvé dans les décombres et sauvé par un
prêtre. Il devait finir sa vie comme exhibition dans le cirque Barnum, avec une
réplique de sa cellule! Quelques marins dans les navires à vapeur anglais et
canadiens qui mouillaient dans le port et qui s’enfuyaient, rattrapés par la
nuée ardente, parvinrent également à survivre. L’éruption se poursuivit durant
les mois suivants, une nouvelle nuée ardente détruisit
le bourg de Morne Rouge, vers l’Est, et
partiellement l’agglomération d’Ajoupa-Bouillon, faisant un millier de victimes
de plus.«La nuée ardente du 8 mai, responsable de la destruction de Saint-Pierre, s’épancha par une éruption latérale qui fit sauter partiellement l’ancienne coupole de lave. Cette masse de gaz et de débris incandescents dévala de la montagne à la vitesse vertigineuse de 150 m à la seconde, avec une température estimée à 800º environ. Elle parvint en peu d’instants sur la ville et sa haute température carbonisa tout mais, par suite du manque d’oxygène, rien ne fut consumé. Tout ce qu’il y avait de volatil disparut. Les effets mécaniques de cette nuée furent d’une violence incroyable. Parmi toutes celles qui lui succédèrent au cours des mois suivants, seule celle du 30 août eut une puissance dévastatrice comparable» (E. Aubert de La Rüe. Ibid. pp. 221-222).
Si, au début, les habitants de Saint-Pierre se montrèrent insouciants devant les manifestations de la Montagne Pelée, après la destruction de la plantation et de l’usine Guérin et l’exil des habitants proches du volcan
 vers la ville
susci-
vers la ville
susci-tèrent une inquiétude que les autorités parvinrent mal à gérer. Le fait que le maire Fouché et le gouverneur Mouttet s’obstinaient à ne rien voir de la menace imminente et s’attachaient seulement à l’élection et aux fêtes qui s’en suivraient, voilà où réside la négligence criminelle de l’affaire. Entre la négligence des peuples et celle des individus, des dirigeants en particulier, il est clair que la voie est unique et part toujours du haut pour aller vers le bas. Seulement, c’est en partant du bas et en remontant vers le haut que l’on découvre le mieux les articulations logiques imbriquées les unes dans les autres qui constituent la négligence même. Cette logique est essentiellement contingente, conjoncturelle. Comme si un chapelet de hasards, qui auraient pu se nouer des milliers de fois, ne s’était finalement produit qu’au bout d’un certain temps, et alors, l’addition des négligences les unes avec les autres, finit par causer une catastrophe irréparable.
 descend à vive allure la pente fortement inclinée de la voie qui
mène vers la petite ville de Lac Mégantic, en Estrie. Ces wagons contien-
descend à vive allure la pente fortement inclinée de la voie qui
mène vers la petite ville de Lac Mégantic, en Estrie. Ces wagons contien-nent du pétrole brut en provenance de l’ouest. Les locomotives se détachent du convoi sous la forte vitesse et les wagons viennent se heurter et s’empiler les uns sur les autres en plein centre-ville, provoquant une explosion fantastique et un incendie qui détruit ou endommage une quarantaine d’édifices dans une zone de 2 km², tuant 47 personnes par cette chaude nuit d’été.
 laissant fonctionner sans
sur-
laissant fonctionner sans
sur-veillance la locomo-
tive de tête en attente d’un autre équipage. Comme c’est une opération courante, Harding embarque dans un taxi pour le conduire à l’hôtel de Lac Mégantic. Cependant, il part avec une certaine inquiétude, puisque l’engin crachait de l’huile ainsi qu’une épaisse fumée noire. Vers 23 h 32, les pompiers sont avisés qu’un incendie fait rage dans une locomotive stationnée. Douze pompiers se rendent sur les lieux une dizaine de minutes plus tard et parviennent à éteindre l’incendie. Le feu avait pris origine dans une conduite d’huile ou de carburant. Les flammes sortaient de la cheminée. Une dizaine de minutes plus tard, les pompiers communiquent avec le contrôleur du trafic ferroviaire stationné à Farnham pour signaler l’incendie. Les pompiers coupent le moteur et quittent le train après l’avoir remis à deux représentants de la MM&A arrivés sur les lieux.
 sur une
distance de 800 mètres tandis que le convoi déraille sur une courbe en plein
centre-
sur une
distance de 800 mètres tandis que le convoi déraille sur une courbe en plein
centre-ville avec les résultats que l’on connaît. Aussitôt, des enquêtes sont ouvertes pour comprendre ce qui s’est passé. Après l’enquête du coroner pour identifier les victimes, une autre enquête est ouverte par le Bureau de la sécurité des transports, organisme fédéral canadien responsable de la sécurité dans les transports. Une semaine après la catastrophe, on retrouve la boîte noire du train. Les enquêteurs comprennent que la locomotive avait un piston brisé, ce qui a permis à du gas-oil de s’accumuler dans le moteur, engendrant des fumées, des étincelles et finalement un incendie. Lorsque les pompiers éteignirent le feu, ils arrêtèrent le moteur, ce qui eut pour effet de désactiver
 le système de freinage hydraulique. Le
train a donc pu se remettre en marche et prendre de la vitesse en dévalant la
pente pour finir par dérailler. Les wagon-citernes de la Western Petroleum
transportaient du pétrole de shiste, type particulièrement léger et volatil, prompt
à exploser et à s’enflammer en cas d’impact. Ces compagnies auraient dû classer ce pétrole
comme produit dangereux de classe 2 et non 3, et le manipuler en
conséquente. De plus, les wagon-citernes étaient de type Dot 111 dont la
minceur de l’enveloppe était propice à se déchirer sous un impact et entraîner
l’écoulement du pétrole. Bref, c’étaient des wagons inadéquats.
le système de freinage hydraulique. Le
train a donc pu se remettre en marche et prendre de la vitesse en dévalant la
pente pour finir par dérailler. Les wagon-citernes de la Western Petroleum
transportaient du pétrole de shiste, type particulièrement léger et volatil, prompt
à exploser et à s’enflammer en cas d’impact. Ces compagnies auraient dû classer ce pétrole
comme produit dangereux de classe 2 et non 3, et le manipuler en
conséquente. De plus, les wagon-citernes étaient de type Dot 111 dont la
minceur de l’enveloppe était propice à se déchirer sous un impact et entraîner
l’écoulement du pétrole. Bref, c’étaient des wagons inadéquats. dernier négligent de la catastrophe, il faut, immédiate-
dernier négligent de la catastrophe, il faut, immédiate-ment au-dessus de lui reconnaî-
tre que les deux employés à qui les pompiers et les policiers avaient laissé la locomotive sur la voie principale après l’incendie et qui ont immédiatement disparu par après sont également coupables de négligence. S’ils étaient restés sur place en attendant l’équipe de relais, ils auraient pu empêcher la locomotive, dont les freins avaient été levés par les pompiers afin de permettre d’éteindre l’incendie, de repartir comme un convoi fou.
 que sur une voie de
garage munie d’un dérailleur. Le train était déjà arrêté sur la pente, l’effet
gravitationnel devenait suffisant pour l’attirer vers le bas. Burckhardt détenait
75% des actions de la compagnie, mais pouvait refuser toute responsabilité dans l’accident.
N’empêche qu’il avait reçu des subventions importantes de la part des
gouvernements canadien et québécois, et même de la Caisse de dépôt et placement
du Québec, pour investir dans l’amélioration de la vieille ligne ferroviaire,
mais Burckhardt avait transféré cet argent pour l’entretien de ses lignes sur
le territoire américain.
que sur une voie de
garage munie d’un dérailleur. Le train était déjà arrêté sur la pente, l’effet
gravitationnel devenait suffisant pour l’attirer vers le bas. Burckhardt détenait
75% des actions de la compagnie, mais pouvait refuser toute responsabilité dans l’accident.
N’empêche qu’il avait reçu des subventions importantes de la part des
gouvernements canadien et québécois, et même de la Caisse de dépôt et placement
du Québec, pour investir dans l’amélioration de la vieille ligne ferroviaire,
mais Burckhardt avait transféré cet argent pour l’entretien de ses lignes sur
le territoire américain.Pourquoi? Parce la surveillance des réseaux ferroviaires aux États-Unis et les amendes encourus sont plus
 élevés qu’au Canada. C’est ici que faute le Bureau de la sécurité des transports du Canada qui n’a pas joué son rôle de surveillant avec la
célérité qu’il fallait. Les coupures budgétaires dans les services
gouvernemen-
élevés qu’au Canada. C’est ici que faute le Bureau de la sécurité des transports du Canada qui n’a pas joué son rôle de surveillant avec la
célérité qu’il fallait. Les coupures budgétaires dans les services
gouvernemen-taux est en grande partie responsable de cette déficience due à des mesures budgétaires du gouvernement conservateur du Canada, avec Stephen Harper en tête, qui reste le premier fautif puisqu’il n’a pas fourni les budgets pour le personnel et les équipements indispensables à l’accomplissement de sa tâche. Voilà comment quelques négligences du personnel de base a fini par révéler au grand jour l’incurie des services de l’État à la sécurité de ses populations. Tom Harding n’est que le dernier maillon d’une chaîne dont les paliers supérieurs sont Ed Burckhardt, le propriétaire fraudeur de la MM&A et le gouvernement Harper qui n’a pas vu à la police nécessaire des délinquants industriels.
 dit que
du mal peut naître le bien. Il n’y a aucun bien qui ne peut vraiment naître de
négligen-
dit que
du mal peut naître le bien. Il n’y a aucun bien qui ne peut vraiment naître de
négligen-ces ou de suite de négligen-
ces qui condui-
sent à une culture de l’effort minimum, de l’incompétence, de l’irresponsabilité et de la négligence. Telle est cette culture qui en ce moment détruit l’ensemble de la civilisation occidentale. La prudence, la responsabilité, l’imputabilité, la compétence et l’ardeur à l’effort sont des valeurs ouvertement combattues par la société de consommation. Une telle déchéance est le meilleur indice que du mythe de la fin de civilisation, nous sommes réellement passé au déclin irréversible⌛





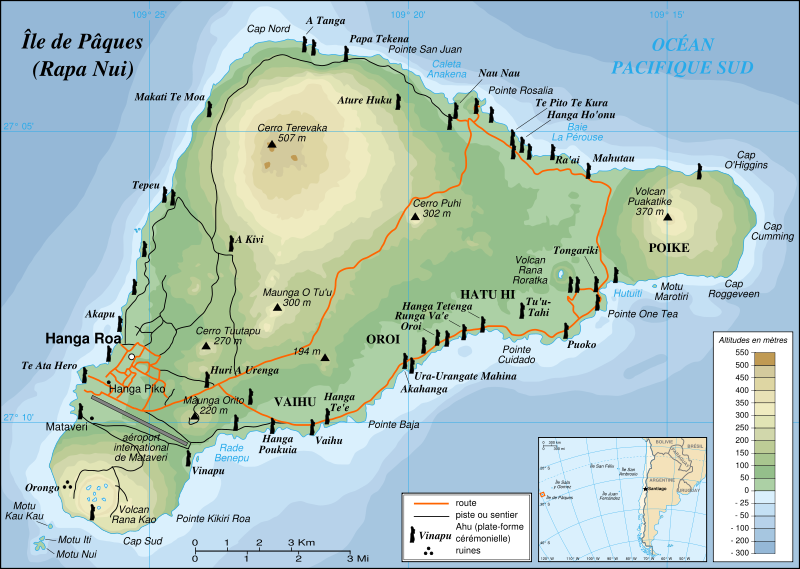












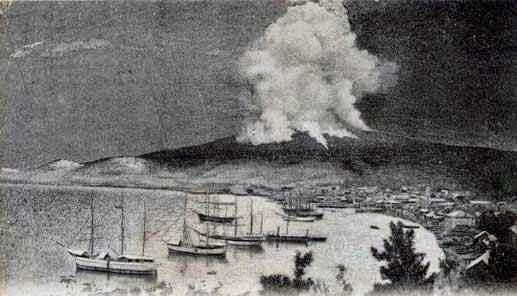



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire