 |
| Le pape Innocent IV excommuniant l’Empereur Frédéric II |
lique ne pratique plus l’excom-munica-
tion qu’en de très rares occasion où le dogme ou l'orga-
nisation ecclésiale sont au cœur de controverses. L’excommunication est une «mise hors de la communauté» de chrétiens qui défient l’ordre clérical; entendre un ostracisme qui est plus qu’une simple affaire religieuse, mais également – et surtout – une affaire politique. C’est la plus lourde des peines canoniques. On la retrouve dans les deux principales Églises chrétiennes, la catholique et l’orthodoxe, mais certaines sectes protestantes, comme les Témoins de Jéhovah, possèdent également leur rite d’excommunication. L’excommunication ne signifie pas l’exclusion de l’Église elle-même, mais des sacrements, et en particulier l’eucharistie, qui est le plus important, puisqu’il s’agit de recevoir le corps et le sang de la divinité chrétienne. En tant que baptisé,
 l’excommunié demeure en
possibilité d’abjurer ses erreurs, d’exprimer le regret en confession et obtenir la levé de
l’excom-
l’excommunié demeure en
possibilité d’abjurer ses erreurs, d’exprimer le regret en confession et obtenir la levé de
l’excom-munication. En fait, il s’agit d’une pleine soumission à l’autorité spirituelle et morale de l’Église. E,t au temps où l’Église revendiquait le double glaive – le glaive spirituel et le glaive temporel -, l’excommunication était un moyen facile pour le pape d’obtenir la soumission d’un prince turbulent en le menaçant ainsi de libérer ses vassaux et provoquer des luttes au sein de sa principauté. Dans la guerre que se livraient dans l’Italie du XIIe siècle guelfes (partisans du pape) et gibelins (partisans du pouvoir temporel de l’Empereur), on comprend qu’on y allait pas de main morte avec les proclamations d’excommunication puisque les princes n’avaient pas d’instruments psychologiques semblables à opposer au pape ou aux évêques, sinon que de noyauter un concile et demander la destitution d’un pape politiquement agressif.
 compassion pour ceux qui sont bafoués par l’autorité
pontificale et jetés hors de la rédemption. L’excom-
compassion pour ceux qui sont bafoués par l’autorité
pontificale et jetés hors de la rédemption. L’excom-munié devient alors un symbole, une victime de l’utilisation perverse du pouvoir spirituel dans une affaire purement temporelle. Mais Dante est suffisamment intelligent pour savoir que tous les excommuniés ne sont pas d’égale innocence. Aussi, choisit-il de rencontrer celui qui, à ses yeux, représente sans doute l’excommunié typique, victime des haines privées des pontifes et exclus de la communion des chrétiens pour des raisons politiques. Il s’agit de Mainfroy, le fils favori (et bâtard) de l’empereur Frédéric II Hohenstaufen, le prince qui règne sur le royaume de Sicile.
 directe dans un ouvrage
qu’il consacre à la langue italienne, De Vulgari Eloquentia, dans lequel on peut lire : “En
vérité, deux illustres personnages, Frédéric Empereur et Manfred, son fils bien
né, montrant à découvert la noblesse et droiture de leur âme, tant que la
fortune le permit, se conduisirent en hommes véritables dédaignant la manière
de vivre des bêtes. Ainsi, tous ceux qui avaient de la noblesse de cœur et des
dons divins s’efforcèrent de rester attachés à la majesté de tels princes; si
bien que tout ce que les esprits les plus éminents d’Italie produisaient à
cette époque-là voyait le jour à la Cour de ces insignes souverains” Sans remettre en cause la tradition
présentant Frédéric II comme un homme sans foi, Dante, gibelin sui generis,
accorde une place éminente à cet empereur
qui a su, de son vivant, garantir la paix générale entre ses États et favoriser
le développement de sa première langue» (J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris, Fayard,
2009, p. 184.
directe dans un ouvrage
qu’il consacre à la langue italienne, De Vulgari Eloquentia, dans lequel on peut lire : “En
vérité, deux illustres personnages, Frédéric Empereur et Manfred, son fils bien
né, montrant à découvert la noblesse et droiture de leur âme, tant que la
fortune le permit, se conduisirent en hommes véritables dédaignant la manière
de vivre des bêtes. Ainsi, tous ceux qui avaient de la noblesse de cœur et des
dons divins s’efforcèrent de rester attachés à la majesté de tels princes; si
bien que tout ce que les esprits les plus éminents d’Italie produisaient à
cette époque-là voyait le jour à la Cour de ces insignes souverains” Sans remettre en cause la tradition
présentant Frédéric II comme un homme sans foi, Dante, gibelin sui generis,
accorde une place éminente à cet empereur
qui a su, de son vivant, garantir la paix générale entre ses États et favoriser
le développement de sa première langue» (J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris, Fayard,
2009, p. 184. regardai fixement cet esprit : des cheveux blonds accompagnaient une figure douce et agréable; une blessure avait partagé en deux un de ses sourcils. Quand je lui eus répondu que je ne l'avais jamais vu, il ajouta: "Tiens, vois," et il me montra une autre blessure au milieu de sa poitrine. Il reprit en souriant : “Je suis
Mainfroy, le petit-fils de l'impératrice Constance : aussi je t'en conjure, quand tu retourneras sur la terre, va près de ma noble fille, la mère de ces princes qui sont l'honneur de la Sicile et de l'Aragon : et si on a cherché à l'abuser, dis-lui la vérité. Quand on eut rompu ma vie de deux coups mortels, je me dévouai à Dieu qui pardonne volontiers : mes péchés furent horribles, mais la bonté de Dieu ouvre ses bras généreux à tout ce qui lui demande grâce. Si le pasteur de Cosence, qui reçut de Clément l'ordre d'aller à la chasse de mes ossements, avait lu en Dieu combien sa bonté est grande, ils reposeraient encore à la tête du pont de Bénévent, sous la protection des pierres énormes qui les recouvraient : maintenant la pluie souille ces ossements; ils sont la proie des vents, hors du royaume, près du cours du Verde, où ce prélat les fit jeter avec la malédiction des torches éteintes. Mais la malédiction de ces pontifes n'est pas telle, que
regardai fixement cet esprit : des cheveux blonds accompagnaient une figure douce et agréable; une blessure avait partagé en deux un de ses sourcils. Quand je lui eus répondu que je ne l'avais jamais vu, il ajouta: "Tiens, vois," et il me montra une autre blessure au milieu de sa poitrine. Il reprit en souriant : “Je suis
Mainfroy, le petit-fils de l'impératrice Constance : aussi je t'en conjure, quand tu retourneras sur la terre, va près de ma noble fille, la mère de ces princes qui sont l'honneur de la Sicile et de l'Aragon : et si on a cherché à l'abuser, dis-lui la vérité. Quand on eut rompu ma vie de deux coups mortels, je me dévouai à Dieu qui pardonne volontiers : mes péchés furent horribles, mais la bonté de Dieu ouvre ses bras généreux à tout ce qui lui demande grâce. Si le pasteur de Cosence, qui reçut de Clément l'ordre d'aller à la chasse de mes ossements, avait lu en Dieu combien sa bonté est grande, ils reposeraient encore à la tête du pont de Bénévent, sous la protection des pierres énormes qui les recouvraient : maintenant la pluie souille ces ossements; ils sont la proie des vents, hors du royaume, près du cours du Verde, où ce prélat les fit jeter avec la malédiction des torches éteintes. Mais la malédiction de ces pontifes n'est pas telle, que  l'amour éternel ne puisse nous rendre ses bienfaits tant que la mort n'a pas desséché l'espéran-
l'amour éternel ne puisse nous rendre ses bienfaits tant que la mort n'a pas desséché l'espéran-ce. Il est vrai que celui qui meurt contuma-
ce envers la sainte Église, quand même il se repentirait à la fin, doit rester en dehors de ce rocher trente fois autant de temps qu'il en a mis à persister dans sa résistance, à moins que des prières secourables n'abrègent la durée de ses tourments. Vois donc si tu peux me réjouir en révélant à ma tendre Constance que tu m'as vu, et que tu as su de moi la longueur du retard qui nous éloigne du saint royaume; car les prières de là-haut nous soulagent beaucoup dans ce séjour”» Manfred nous dit bien qu’il est au Purgatoire car il est mort rebelle à la sainte Église, mais qu’il s’est repenti depuis et que ses os ayant été jetés à la rivière est une injustice. Il est vrai, selon ce que raconte Villani, le grand chroniqueur italien du Moyen Âge, le roi Charles d’Anjou, vainqueur de Manfred, ne voulut pas que le corps de Manfred, mort excommunié, soit déposé en terre consacrée. Il le fit enterrer au bout du pont de Bénévent, où chaque soldat de l’armée jeta une pierre sur sa fosse. Cette sorte d’amas de pierres s’appelait mora. Villani, moins certains, ajoute, qu’au dire de quelques-uns, l’archevêque de Constanza, par ordre du pape, fit enlever de ce lieu, qui était de terre d’Église, et transporter près du fleuve Verde, les os de Manfred. C’est tout cela que l’ombre raconte à Dante.
 épousé, Manfred,
né vers 1232 en dehors des liens matrimoniaux, dut rester toute sa vie
le bâtard de l’Empereur. C’était bien pourtant le fils préféré de Frédéric II,
qui lui avait dédicacé son traité De arte
venandi cum avibus, et était resté près de lui, présent encore à son chevet
au moment de sa mort. Beaucoup des contemporains s'étonnaient de sa
ressemblance à la fois physique et intellectuelle avec son père. Frédéric ne
changera pas pour autant la règle de succession qui revient à ses fils
légitimes. Manfred n’est que le troisième héritier du royaume de Sicile, ce qui
rend peu possible son accession au trône, aussi, en vue de compenser, Frédéric
l’a-t-il nommé Vicaire du Regnum Italiæ et
du Regnum Siciliæ. Les heurs et
malheurs de l’Empire, confronté au pouvoir romain, vont décider de son avenir.
épousé, Manfred,
né vers 1232 en dehors des liens matrimoniaux, dut rester toute sa vie
le bâtard de l’Empereur. C’était bien pourtant le fils préféré de Frédéric II,
qui lui avait dédicacé son traité De arte
venandi cum avibus, et était resté près de lui, présent encore à son chevet
au moment de sa mort. Beaucoup des contemporains s'étonnaient de sa
ressemblance à la fois physique et intellectuelle avec son père. Frédéric ne
changera pas pour autant la règle de succession qui revient à ses fils
légitimes. Manfred n’est que le troisième héritier du royaume de Sicile, ce qui
rend peu possible son accession au trône, aussi, en vue de compenser, Frédéric
l’a-t-il nommé Vicaire du Regnum Italiæ et
du Regnum Siciliæ. Les heurs et
malheurs de l’Empire, confronté au pouvoir romain, vont décider de son avenir. avec son ennemi, Conrad IV,
le premier héritier de la Sicile. Chassé d’Allemagne par une croisade prêchée
par le pape Innocent IV, Conrad se rend en Italie et lève les armes contre
Manfred. Comme l’écrit avec justesse Frétigné : «autant Manfred est un prince italien, autant Conrad est un aristocrate
allemand ne connaissant rien des réalités de la péninsule italienne dont il
ignore jusqu’à la langue. Mais il est appuyé par la famille des Hohenstaufen et
par leurs familiers, au premier rang desquels le puissant Bertold von
Hohenburg. Le bâtard sicilien trouve, quant à lui, ses soutiens auprès de la
noblesse italienne et en particulier auprès des Lancia, la puissante famille de
sa mère» (J.-Y. Frétigné. ibid. pp.
210-211). C’est le sort qui va finalement jouer en faveur de Manfred.
L’empereur Henri et Conrad IV décèdent coup sur coup. Ne reste d’adversaire que
le pape.
avec son ennemi, Conrad IV,
le premier héritier de la Sicile. Chassé d’Allemagne par une croisade prêchée
par le pape Innocent IV, Conrad se rend en Italie et lève les armes contre
Manfred. Comme l’écrit avec justesse Frétigné : «autant Manfred est un prince italien, autant Conrad est un aristocrate
allemand ne connaissant rien des réalités de la péninsule italienne dont il
ignore jusqu’à la langue. Mais il est appuyé par la famille des Hohenstaufen et
par leurs familiers, au premier rang desquels le puissant Bertold von
Hohenburg. Le bâtard sicilien trouve, quant à lui, ses soutiens auprès de la
noblesse italienne et en particulier auprès des Lancia, la puissante famille de
sa mère» (J.-Y. Frétigné. ibid. pp.
210-211). C’est le sort qui va finalement jouer en faveur de Manfred.
L’empereur Henri et Conrad IV décèdent coup sur coup. Ne reste d’adversaire que
le pape. naissance à une ligue qui décide de se mettre sous la
protec-
naissance à une ligue qui décide de se mettre sous la
protec-tion du pape. Tout est donc en place pour que repren-
ne la lutte entre les guelfes et les gibelins. Mais dans son combat contre Rome, Manfred ne dispose plus, à la différence de son père, du soutien de l’Empire et il doit se trouver de nouveaux alliés. Au regard de la situation géographique de son royaume, il est pleinement logique qu’il les recherche en Méditerranée. Ainsi épouse-t-il, en secondes noces, Hélène, la fille du despote d’Épire à la tête de l’éphémère Empire latin d’Orient. Mais son choix le plus judicieux et le plus lourd de conséquences pour l’avenir est le mariage de sa fille Constance avec Pierre (1239-1285), fils aîné de Jacques Ier, roi d’Aragon et de Catalogne (1208-1276, roi à partir de 1213). Avec l’Angleterre et la France, le royaume d’Aragon est la troisième grande puissance européenne. Mais à la différence des deux premières, elle conduit une politique plus autonome par rapport à Rome.
 Dans un premier
temps, Manfred réussit à s’imposer sur le plan militaire. Après avoir triomphé
de l’armée pontificale, il rétablit l’ordre dans son royaume. Aussi confie-t-il
à son oncle maternel, Frédéric Lancia, la mission de réprimer sans pitié les
cités siciliennes qui se sont révoltées contre son autorité : Trapani est
rasée au sol et plusieurs villes de moindre importance voient leurs populations
déportées. Arguant du droit de conquête – Manfred n’a-t-il pas conquis le
royaume occupé par les troupes pontificales? -, il se fait couronner roi de
Sicile en la cathédrale de Palerme. La cérémonie a lieu le 11 août 1258 en
présence des plus hauts dignitaires du clergé de l’île. […]
Dans un premier
temps, Manfred réussit à s’imposer sur le plan militaire. Après avoir triomphé
de l’armée pontificale, il rétablit l’ordre dans son royaume. Aussi confie-t-il
à son oncle maternel, Frédéric Lancia, la mission de réprimer sans pitié les
cités siciliennes qui se sont révoltées contre son autorité : Trapani est
rasée au sol et plusieurs villes de moindre importance voient leurs populations
déportées. Arguant du droit de conquête – Manfred n’a-t-il pas conquis le
royaume occupé par les troupes pontificales? -, il se fait couronner roi de
Sicile en la cathédrale de Palerme. La cérémonie a lieu le 11 août 1258 en
présence des plus hauts dignitaires du clergé de l’île. […] cinquante jours après le couronnement de Charles d’Anjou, Manfred soit
vaincu à Bénévent. En ce jour du 26 février 1266, comprenant qu’il ne peut
vaincre, il se jette à corps perdu dans la bataille afin d’y trouver une mort
héroïque et digne du nom qu’il porte. Bien qu’il soit peu enclin aux sentiments
de pitié, Charles d’Anjou est touché par sa bravoure et décide d’assurer une
sépulture décente à son ennemi, pourtant excommunié. Mais le pape Clément IV ne
l’entend pas ainsi et il charge l’archevêque Cosenza de déterrer le
mort pour disperser ses os dans les flots du Garigliano ou fleuve Vert :
terrible vengeance posthume de la papauté contre l’avant-dernier Hohenstaufen à
lui avoir résisté…» (J.-Y. Frétigné. ibid. pp. 211 à 213)
cinquante jours après le couronnement de Charles d’Anjou, Manfred soit
vaincu à Bénévent. En ce jour du 26 février 1266, comprenant qu’il ne peut
vaincre, il se jette à corps perdu dans la bataille afin d’y trouver une mort
héroïque et digne du nom qu’il porte. Bien qu’il soit peu enclin aux sentiments
de pitié, Charles d’Anjou est touché par sa bravoure et décide d’assurer une
sépulture décente à son ennemi, pourtant excommunié. Mais le pape Clément IV ne
l’entend pas ainsi et il charge l’archevêque Cosenza de déterrer le
mort pour disperser ses os dans les flots du Garigliano ou fleuve Vert :
terrible vengeance posthume de la papauté contre l’avant-dernier Hohenstaufen à
lui avoir résisté…» (J.-Y. Frétigné. ibid. pp. 211 à 213) réputation pour des siècles. D’après leur description, Photius
était un homme sans scrupules et si ambitieux d’être patriarche qu’il conspira
avec le gouvernement de Michel III et de Bardas pour détrôner Théodora, puis
leur prêta son assistance pour se défaire d’Ignace, dont le seul tort était
d’avoir fustigé Bardas pour son immortalité. Quand Ignace refusa d’abdiquer,
Photius s’empara de son trône et persécuta sans merci Ignace et les siens.
Aveuglé par son orgueil et son ambition, Photius essaya d’obtenir
l’approbation officielle du pape Nicolas Ier en travestissant toute cette
histoire, mais le pape, tenu au courant par les émissaires d’Ignace, refusa de
reconnaître un patriarche qui s’était hissé au pouvoir en défi du droit canon.
Sans tenir compte de ce verdict, Photius rassembla un synode de l’Église
orientale, déposa le pape et créa le premier schisme. Ce ne fut que quand le
pieux empereur Basile Ier eut tué l’inique empereur Michel III, dont le règne
avait fait le dégoût de Byzance, que Photius reçut son châtiment. Il fut
réputation pour des siècles. D’après leur description, Photius
était un homme sans scrupules et si ambitieux d’être patriarche qu’il conspira
avec le gouvernement de Michel III et de Bardas pour détrôner Théodora, puis
leur prêta son assistance pour se défaire d’Ignace, dont le seul tort était
d’avoir fustigé Bardas pour son immortalité. Quand Ignace refusa d’abdiquer,
Photius s’empara de son trône et persécuta sans merci Ignace et les siens.
Aveuglé par son orgueil et son ambition, Photius essaya d’obtenir
l’approbation officielle du pape Nicolas Ier en travestissant toute cette
histoire, mais le pape, tenu au courant par les émissaires d’Ignace, refusa de
reconnaître un patriarche qui s’était hissé au pouvoir en défi du droit canon.
Sans tenir compte de ce verdict, Photius rassembla un synode de l’Église
orientale, déposa le pape et créa le premier schisme. Ce ne fut que quand le
pieux empereur Basile Ier eut tué l’inique empereur Michel III, dont le règne
avait fait le dégoût de Byzance, que Photius reçut son châtiment. Il fut
 détrôné et condamné solennellement par le huitième concile œcuménique
(869-870), la grande source de la législation canonique en Occident au moyen
âge. Après la mort d’Ignace, Photius revint en faveur auprès de l’empereur et
reprit possession du trône; pour s’assurer l’approbation du pape qui inclinait
à la conciliation, il trompa celui-ci en faussant ses lettres et celles que le
pape avait envoyées à l’empereur et aux Pères du concile réunis pour examiner
son cas, suborna les légats du pape et falsifia les actes du concile. Quand
Jean VIII se rendit compte de la supercherie du Grec, il l’excommunia sans
cérémonie. De là le second schisme qui devait durer jusqu’à la fin du IXe siècle
et assombrir le Xe. Enfin se produisit la grande rupture entre l’Occident et
l’Orient qui a résisté à tous les efforts de réconciliation et fut si
désastreuse pour le christianisme [1054]» (F. Dvornik. Le schisme de Photius, Paris, Éditions du Cerf, 1950, pp. 32-33).
détrôné et condamné solennellement par le huitième concile œcuménique
(869-870), la grande source de la législation canonique en Occident au moyen
âge. Après la mort d’Ignace, Photius revint en faveur auprès de l’empereur et
reprit possession du trône; pour s’assurer l’approbation du pape qui inclinait
à la conciliation, il trompa celui-ci en faussant ses lettres et celles que le
pape avait envoyées à l’empereur et aux Pères du concile réunis pour examiner
son cas, suborna les légats du pape et falsifia les actes du concile. Quand
Jean VIII se rendit compte de la supercherie du Grec, il l’excommunia sans
cérémonie. De là le second schisme qui devait durer jusqu’à la fin du IXe siècle
et assombrir le Xe. Enfin se produisit la grande rupture entre l’Occident et
l’Orient qui a résisté à tous les efforts de réconciliation et fut si
désastreuse pour le christianisme [1054]» (F. Dvornik. Le schisme de Photius, Paris, Éditions du Cerf, 1950, pp. 32-33). homo novus; il appartenait bien au
parti libéral, mais n’avait pas eu encore l’occasion de montrer ouvertement ses
couleurs. Son orthodoxie était hors de doute, car il avait été persécuté par
les iconoclastes. Il était parent de Théodora dont les évêques ignatiens
regrettaient vivement le gouvernement; il y avait donc quelque espoir qu’il se
montrât moins empressé au service du nouveau régime. D’un autre côté, il était
parent de Bardas et ce fait le recommandait au gouvernement. Mais il ne faut
pas oublier que Photius devait sa carrière à Théoctiste, le logothète, qui
l’avait d’abord nommé professeur à l’Université de Constantinople, puis
directeur de la chancellerie impériale. C’est surtout cette circonstance qui le
recommandait aux intransigeants, amis du régime de Théoctiste et de Théodora»
(F.Dvornik. ibid. pp. 91 et 92). Le
reste consistait à des formalités : en six jours, il reçut tous les degrés
de la prêtrise. Des évêques des deux partis acceptèrent de donner l’onction à
Photius comme patriarche de Constantinople en décembre 858.
homo novus; il appartenait bien au
parti libéral, mais n’avait pas eu encore l’occasion de montrer ouvertement ses
couleurs. Son orthodoxie était hors de doute, car il avait été persécuté par
les iconoclastes. Il était parent de Théodora dont les évêques ignatiens
regrettaient vivement le gouvernement; il y avait donc quelque espoir qu’il se
montrât moins empressé au service du nouveau régime. D’un autre côté, il était
parent de Bardas et ce fait le recommandait au gouvernement. Mais il ne faut
pas oublier que Photius devait sa carrière à Théoctiste, le logothète, qui
l’avait d’abord nommé professeur à l’Université de Constantinople, puis
directeur de la chancellerie impériale. C’est surtout cette circonstance qui le
recommandait aux intransigeants, amis du régime de Théoctiste et de Théodora»
(F.Dvornik. ibid. pp. 91 et 92). Le
reste consistait à des formalités : en six jours, il reçut tous les degrés
de la prêtrise. Des évêques des deux partis acceptèrent de donner l’onction à
Photius comme patriarche de Constantinople en décembre 858. la révolte. Dans une de ses lettres à Bardas, probablement la première
après la crise, il se plaignit amèrement de la brutalité du gouvernement dans
sa poursuite des coupables. Un petit passage de cette lettre semble dire que la
vraie raison de la nouvelle dissension dans le clergé byzantin était sa loyauté
envers le nouveau régime et que les révoltés avaient gravement transgressé les
lois du pays. “Nous aurions de beaucoup préféré – écrit-il à Bardas – trouver
en vous l’homme qui punirait les coupables et non celui qui se rendrait
coupable de tels méfaits.” Le patriarche se plaint aussi de ce que la moitié de
sa juridiction soit perdue […], et il
ajoute, esquissant une menace de démission, qu’il préférerait perdre le tout. À
une autre occasion il intercède pour le secrétaire Christodoulos, probablement
l’un des chefs de la révolte, et pour le chartophylax Blasius, qui eut la
langue coupée» (F. Dvornik. Ibid. p.
104). Tout ce temps, le pape Nicolas Ier se montre conciliant envers Bardas et Michel III, mais il doute que le procès
intenté à Ignace soit juste.
la révolte. Dans une de ses lettres à Bardas, probablement la première
après la crise, il se plaignit amèrement de la brutalité du gouvernement dans
sa poursuite des coupables. Un petit passage de cette lettre semble dire que la
vraie raison de la nouvelle dissension dans le clergé byzantin était sa loyauté
envers le nouveau régime et que les révoltés avaient gravement transgressé les
lois du pays. “Nous aurions de beaucoup préféré – écrit-il à Bardas – trouver
en vous l’homme qui punirait les coupables et non celui qui se rendrait
coupable de tels méfaits.” Le patriarche se plaint aussi de ce que la moitié de
sa juridiction soit perdue […], et il
ajoute, esquissant une menace de démission, qu’il préférerait perdre le tout. À
une autre occasion il intercède pour le secrétaire Christodoulos, probablement
l’un des chefs de la révolte, et pour le chartophylax Blasius, qui eut la
langue coupée» (F. Dvornik. Ibid. p.
104). Tout ce temps, le pape Nicolas Ier se montre conciliant envers Bardas et Michel III, mais il doute que le procès
intenté à Ignace soit juste. que mener à un concile tenu en 867
à Constantinople dont, nous dit Dvornik, «nous
ne pouvons en déduire d’une façon sûre que les faits suivants : le concile
eut réellement lieu, quoique certains ignatiens aient voulu nier son existence
même. Les Pères ayant pris part à ce concile furent très nombreux. Le pape
Nicolas y fut jugé et condamné. Enfin, Louis II [le Germanique, empereur
romain d’Occident] fut acclamé à la fin du concile, comme empereur, et cela en
présence et avec le consentement de Michel et de Basile» (F. Dvornik. Ibid. pp. 181-182). Bref, les Pères
entendaient que Louis II destitue le pape de sa fonction. Dans ce scénario,
Photius, en excommuniant Nicolas, voulait gagner l’aide des Occidentaux, d’où
la promotion d’un prince allemand au titre impérial. Ce qui était au cœur de
l’affaire, c’était la Bulgarie et la condamnation des évêques occidentaux
envoyés par le pape faire du missionnariat dans une zone que Byzance
s’attribuait exclusivement. Dans sa correspondance avec Boris, le roi bulgare,
Photius tend à mettre de l’avant le Patriarche de Constantinople devant le
pontife romain. Tout convergeait vers une dissociation de l’Église chrétienne.
que mener à un concile tenu en 867
à Constantinople dont, nous dit Dvornik, «nous
ne pouvons en déduire d’une façon sûre que les faits suivants : le concile
eut réellement lieu, quoique certains ignatiens aient voulu nier son existence
même. Les Pères ayant pris part à ce concile furent très nombreux. Le pape
Nicolas y fut jugé et condamné. Enfin, Louis II [le Germanique, empereur
romain d’Occident] fut acclamé à la fin du concile, comme empereur, et cela en
présence et avec le consentement de Michel et de Basile» (F. Dvornik. Ibid. pp. 181-182). Bref, les Pères
entendaient que Louis II destitue le pape de sa fonction. Dans ce scénario,
Photius, en excommuniant Nicolas, voulait gagner l’aide des Occidentaux, d’où
la promotion d’un prince allemand au titre impérial. Ce qui était au cœur de
l’affaire, c’était la Bulgarie et la condamnation des évêques occidentaux
envoyés par le pape faire du missionnariat dans une zone que Byzance
s’attribuait exclusivement. Dans sa correspondance avec Boris, le roi bulgare,
Photius tend à mettre de l’avant le Patriarche de Constantinople devant le
pontife romain. Tout convergeait vers une dissociation de l’Église chrétienne. d’abandonner son attitude de calme attente. La Providence était en train
d’arranger les choses et le patriarche n’avait qu’à se confier à elle. Nicolas
était mort le 13 novembre, ignorant la sentence lancée contre lui par les
Orientaux. Une lettre d’Anastase le Bibliothécaire à Ado de Vienne, écrite le
14 décembre 867, nous apprend que le mécontentement suscité par la politique de
Nicolas était alors général à Rome. Anastase, son principal collaborateur,
craignait fort pour l’avenir de toute l’œuvre du pape. L’attitude de son
successeur, Adrien II, n’était pas encore connue, et Anastase se demandait avec
inquiétude si le nouveau pape, se laissant gagner par les ennemis de son
prédécesseur, n’allait pas inaugurer une toute autre politique» (F. Dvornik. Ibid. pp.
193-194).
d’abandonner son attitude de calme attente. La Providence était en train
d’arranger les choses et le patriarche n’avait qu’à se confier à elle. Nicolas
était mort le 13 novembre, ignorant la sentence lancée contre lui par les
Orientaux. Une lettre d’Anastase le Bibliothécaire à Ado de Vienne, écrite le
14 décembre 867, nous apprend que le mécontentement suscité par la politique de
Nicolas était alors général à Rome. Anastase, son principal collaborateur,
craignait fort pour l’avenir de toute l’œuvre du pape. L’attitude de son
successeur, Adrien II, n’était pas encore connue, et Anastase se demandait avec
inquiétude si le nouveau pape, se laissant gagner par les ennemis de son
prédécesseur, n’allait pas inaugurer une toute autre politique» (F. Dvornik. Ibid. pp.
193-194)._from_the_Chronikon_of_Ioannis_Skylitzes.jpg) 21 août 866. Un an plus tard, le 23 septembre 867, c’est au tour de Basile de
faire assas-
21 août 866. Un an plus tard, le 23 septembre 867, c’est au tour de Basile de
faire assas-siner Michel, juste après le synode de l’été 867 où Photius avait déclaré la papauté et l’Église latine hérétiques sur plusieurs points, notamment l’ajout du Filioque au Credo, l’exclusion des hommes mariés du sacerdoce, le jeûne du samedi, l’usage du pain azyme pour l’eucharistie et déposer et excommunier le pape. Tandis que le pape Adrien reprit à son compte la politique de Nicolas, Basile devenait empereur. Photius, pris dans une situation délicate, refusa la communion à l’empereur et le blâma pour les assassinats commis. Arrêté, Photius fut ensuite conduit devant un tribunal qui le condamna, lui et son consécrateur. Officiellement déposé, accusé d’hérésie pour avoir soutenu que l’être humain était doté de deux âmes différentes, il se voyait condamné à la relégation dans le monastère de Sténos, sur le Bosphore en 870. Adrien demanda le retour d’Ignace et le roi Boris son retour au sein de l’Église orthodoxe. Il semblait que tout revenait au point de départ.
 Léon, déclenchant même des scènes assez
violentes en public. La chose frôla l’accu-
Léon, déclenchant même des scènes assez
violentes en public. La chose frôla l’accu-sation de complot et Léon échappa de peu à la sentence ordinaire dans ces cas : l’aveuglement. Tout ce temps, Photius avait soutenu vivement Basile et, à sa mort, Léon devint empereur byzantin (29 août 886). C’est alors que l’étau se referma sur Photius. D’abord, il est évident que Photius s’est détaché des résolutions du concile de 879-880, mais surtout, Léon VI désirant se débarrasser de Photius, le força à la démission (29 septembre 886) pour le remplacer par son jeune frère, Étienne. Photius serait mort en février 892 peu de temps avant l’arrivée de son excommunication officielle.
 selon la parole du Seigneur : “Vous serez ou
un bon arbre et ses fruits seront bons, ou un mauvais arbre et ses fruits
seront mauvais”. Est-ce qu’un figuier peut porter des raisins et une vigne des
figues? Cette [notre] Église à laquelle appartiennent de telles choses devrait
infliger les punitions les plus sévères pour qu’ainsi la vôtre soit bien
épurée. Mais notre bonté et notre clémence nous en empêchent et elles nous
conseillent de tolérer une chose, mais d’en déraciner complètement une autre.
C’est dans ce but que nous avons envoyé de notre côté (a latere nostro) les très pieux évêques Landulphe de Capoue
et Romain. Nous invitons Ta Sainteté à s’entendre avec eux. De même
Théophylacte, métropolite d’Ancyre, et Pierre, notre fidèle. Mais veillez à ce
qu’avant tout la sentence concernant Photius le transgresseur et le violateur
de la loi, sentence prononcée synodiquement par nos prédécesseurs, les pontifes
œcuméniques, et confirmée en outre par notre Humilité, demeure à jamais ferme
et inchangée. Quant à ceux qui ont été ordonnés par Photius, nous avons
prononcé une sentence clémente : ils auront à présenter les libelli en reconnaissant qu’ils ont péché et à
demander pardon par la pénitence en promettant de ne jamais retomber dans ce
péché. Ayant fait ceci, Ta Sainteté accomplira aussi le reste, conformément à
notre ordre et d’accord avec les légats mentionnés plus haut, sans y ajouter et
sans y changer quoi que ce soit. Lorsqu’ils auront été reçus par nous et par Ta
Révérence dans la communion des fidèles, en tant que laïcs, le scandale aura
disparu. Quand tout cela sera accompli, si quelqu’un par mieux se refusait à
communier avec vous, qu’il sache qu’il serait également séparé de notre
communion. Portez-vous bien dans le Christ» (Cité in F. Dvornik. Ibid. pp. 348-349).
selon la parole du Seigneur : “Vous serez ou
un bon arbre et ses fruits seront bons, ou un mauvais arbre et ses fruits
seront mauvais”. Est-ce qu’un figuier peut porter des raisins et une vigne des
figues? Cette [notre] Église à laquelle appartiennent de telles choses devrait
infliger les punitions les plus sévères pour qu’ainsi la vôtre soit bien
épurée. Mais notre bonté et notre clémence nous en empêchent et elles nous
conseillent de tolérer une chose, mais d’en déraciner complètement une autre.
C’est dans ce but que nous avons envoyé de notre côté (a latere nostro) les très pieux évêques Landulphe de Capoue
et Romain. Nous invitons Ta Sainteté à s’entendre avec eux. De même
Théophylacte, métropolite d’Ancyre, et Pierre, notre fidèle. Mais veillez à ce
qu’avant tout la sentence concernant Photius le transgresseur et le violateur
de la loi, sentence prononcée synodiquement par nos prédécesseurs, les pontifes
œcuméniques, et confirmée en outre par notre Humilité, demeure à jamais ferme
et inchangée. Quant à ceux qui ont été ordonnés par Photius, nous avons
prononcé une sentence clémente : ils auront à présenter les libelli en reconnaissant qu’ils ont péché et à
demander pardon par la pénitence en promettant de ne jamais retomber dans ce
péché. Ayant fait ceci, Ta Sainteté accomplira aussi le reste, conformément à
notre ordre et d’accord avec les légats mentionnés plus haut, sans y ajouter et
sans y changer quoi que ce soit. Lorsqu’ils auront été reçus par nous et par Ta
Révérence dans la communion des fidèles, en tant que laïcs, le scandale aura
disparu. Quand tout cela sera accompli, si quelqu’un par mieux se refusait à
communier avec vous, qu’il sache qu’il serait également séparé de notre
communion. Portez-vous bien dans le Christ» (Cité in F. Dvornik. Ibid. pp. 348-349). l’âne de la fable sur lequel on faisait
reposer tous les troubles qui avaient commencé sous Michel III. Pour les
Occidentaux, il devenait l’auteur intraitable du schisme entre les deux églises
qui devait aboutir moins d’un siècle plus tard à une séparation complète de
Constantinople d’avec Rome. Pour les Orthodoxes, la figure de Photius fut réhabilitée, jusqu’à être couronnée des palmes de la
sainteté. L’excommunication du pape Nicolas avait sans doute frappé le pontife
romain au point qu'il considérait sa primauté ecclésiastique soumise à la
contestation. Ce mauvais exemple ne devait pas être repris par une âme
chrétienne. Le pape seul ne pouvait souffrir la mise au ban de la chrétienté.
l’âne de la fable sur lequel on faisait
reposer tous les troubles qui avaient commencé sous Michel III. Pour les
Occidentaux, il devenait l’auteur intraitable du schisme entre les deux églises
qui devait aboutir moins d’un siècle plus tard à une séparation complète de
Constantinople d’avec Rome. Pour les Orthodoxes, la figure de Photius fut réhabilitée, jusqu’à être couronnée des palmes de la
sainteté. L’excommunication du pape Nicolas avait sans doute frappé le pontife
romain au point qu'il considérait sa primauté ecclésiastique soumise à la
contestation. Ce mauvais exemple ne devait pas être repris par une âme
chrétienne. Le pape seul ne pouvait souffrir la mise au ban de la chrétienté. mains consacrées par la grâce romaine. Quiconque n’a pas reçu
l’investiture par un clerc relié à l’autorité romaine ne peut transmettre la
prêtrise. C’est l'expérience qu'a connu au XIXe siècle Joseph-René Vilatte (1854-1929), jeune Français,
placé en 1867 par son père à l’orphelinat des Frères des Écoles chrétiennes. Il
participa comme soldat à la guerre franco-prussienne de 1870, puis, horrifié
par la tragédie de la Commune, s’expatria outre-Atlantique. Il fut nommé instituteur à
Hull, au Québec, dans une mission patronnée par le Père Louis Reboul. Après la
mort de ce dernier, en 1877, Vilatte s’engagea dans la voie de la prêtrise,
encouragé en cela par Mgr Fabre, évêque du diocèse de Montréal dans lequel se
trouvait la ville de Hull.
mains consacrées par la grâce romaine. Quiconque n’a pas reçu
l’investiture par un clerc relié à l’autorité romaine ne peut transmettre la
prêtrise. C’est l'expérience qu'a connu au XIXe siècle Joseph-René Vilatte (1854-1929), jeune Français,
placé en 1867 par son père à l’orphelinat des Frères des Écoles chrétiennes. Il
participa comme soldat à la guerre franco-prussienne de 1870, puis, horrifié
par la tragédie de la Commune, s’expatria outre-Atlantique. Il fut nommé instituteur à
Hull, au Québec, dans une mission patronnée par le Père Louis Reboul. Après la
mort de ce dernier, en 1877, Vilatte s’engagea dans la voie de la prêtrise,
encouragé en cela par Mgr Fabre, évêque du diocèse de Montréal dans lequel se
trouvait la ville de Hull.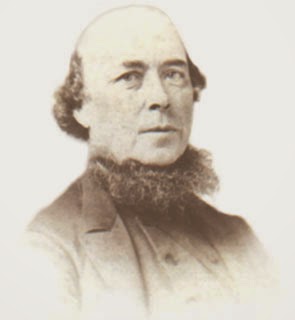 d’un apostat, le
Père Charles Chiniquy (1809-1899), un apôtre de l’œcuménisme moderne peu
compatible avec la stricte catholicité ultramontaine de l’époque. Condamné par
l’Église catholique, Chiniquy s’en ira aux États-Unis et Vilatte passera d’une
secte protestante à l’autre. D’abord l’Église presbytérienne, puis l’institut
Méthodiste français de Saint-Hyacinthe. Pendant ce temps, il fait sa
théologie à l’Université McGill. Il ira par après faire œuvre missionnaire
auprès des francophones immigrés aux États-Unis. En 1885, Vilatte est ordonné
prêtre dans une communauté de Vieux-Catholiques qui se veulent indépendants de
la discipline romaine tout en maintenant le culte et les sacrements de l’Église
catholique. C’est à Berne que Mgr
Herzog ordonnera le nouveau prêtre.
d’un apostat, le
Père Charles Chiniquy (1809-1899), un apôtre de l’œcuménisme moderne peu
compatible avec la stricte catholicité ultramontaine de l’époque. Condamné par
l’Église catholique, Chiniquy s’en ira aux États-Unis et Vilatte passera d’une
secte protestante à l’autre. D’abord l’Église presbytérienne, puis l’institut
Méthodiste français de Saint-Hyacinthe. Pendant ce temps, il fait sa
théologie à l’Université McGill. Il ira par après faire œuvre missionnaire
auprès des francophones immigrés aux États-Unis. En 1885, Vilatte est ordonné
prêtre dans une communauté de Vieux-Catholiques qui se veulent indépendants de
la discipline romaine tout en maintenant le culte et les sacrements de l’Église
catholique. C’est à Berne que Mgr
Herzog ordonnera le nouveau prêtre. 1891, il
obtiendra le soutien de l’évêque orthodoxe russe d’Alaska et de San Francisco,
Mgr Vladimir, qui le prendra sous sa protection canonique. Vilatte ira jusqu’au
Ceylan (Sri Lanka) poursuivre son œuvre sous la coupe de l’orthodoxie syrienne.
Puis il reviendra en Amérique et en Europe. Il demandera sa réadmission au sein
de l’Église catholique mais Rome ne pouvait reconnaître son ordination. Comme
Photius, Vilatte devint l’évêque d’un parti, le Gallicanisme français, et cela
à une époque où le catholicisme français était sous la coupe de l’État laïque.
Ce n’est que vers la fin de sa vie que Vilatte réintégra l’obédience romaine.
En 1925, il signe un acte d’abjuration et doit se retirer dans un pavillon près
d’une abbaye cistercienne à Versailles où il finira ses jours, en 1929, après
avoir entretenu une longue correspondance avec ses disciples. Vaincu par les
besoins d’argent, il semble que l’abjuration de Mgr Vilatte n’ait pas été sans
intérêts.
1891, il
obtiendra le soutien de l’évêque orthodoxe russe d’Alaska et de San Francisco,
Mgr Vladimir, qui le prendra sous sa protection canonique. Vilatte ira jusqu’au
Ceylan (Sri Lanka) poursuivre son œuvre sous la coupe de l’orthodoxie syrienne.
Puis il reviendra en Amérique et en Europe. Il demandera sa réadmission au sein
de l’Église catholique mais Rome ne pouvait reconnaître son ordination. Comme
Photius, Vilatte devint l’évêque d’un parti, le Gallicanisme français, et cela
à une époque où le catholicisme français était sous la coupe de l’État laïque.
Ce n’est que vers la fin de sa vie que Vilatte réintégra l’obédience romaine.
En 1925, il signe un acte d’abjuration et doit se retirer dans un pavillon près
d’une abbaye cistercienne à Versailles où il finira ses jours, en 1929, après
avoir entretenu une longue correspondance avec ses disciples. Vaincu par les
besoins d’argent, il semble que l’abjuration de Mgr Vilatte n’ait pas été sans
intérêts. pontifical, tel Jean sans Terre d’Angle-
pontifical, tel Jean sans Terre d’Angle-terre tout comme son ad-
versaire, le roi Philippe-Auguste de France, ou Henri IV Hohens-
taufen qui alla, jusqu’à Canossa, recevoir l’absolution du pape Grégoire VII en vue de régler la querelle des Investitures. Mais un an plus tard, c’est Grégoire VII qui était chassé de Rome par les armées d’Henri IV descendues de la froide Allemagne. C’est donc dire que cette stratégie n’obtenait pas toujours les résultats escomptés. L’excommunication joua beaucoup sur la parenté des princes afin d’interdire des mariages ou des divorces. Tel prince, répudiant son épouse, pouvait se voir taxer d’excommunication. Ce fut le cas de Philippe Ier de France qui, après son second mariage avec Berthe de Hollande, tombe amoureux de Bertrade de Montfort (1092), déjà l’épouse de Foulque IV le Réchin. Il répudie alors Berthe et se marie avec Bertrade. Le 16 octobre 1094, le concile d’Autun, où sont présents 32 évêques, prononce l’excommunication du roi. Le
 couple royal vécut ainsi pendant dix ans, jusqu’en 1104, sous le coup
de l’anathème de l’Église catholique. Finalement, Philippe et Bertrade se
soumettront lors du Concile de Paris en 1104 tout en poursuivant leur vie
commune. Mais toutes ces histoires d’adultère ne mèneront pas tous au résultat
de la réconciliation. Le cas le plus célèbre, celui d’Henry VIII d’Angleterre
qui trouva tous les prétextes du monde possible pour se séparer de Catherine
d’Aragon afin d’épouser Ann Boleyn s’achèvera dans la répudiation et le schisme
d’avec Rome. Bien que la vraie raison résidait dans la politique religieuse du
roi qui visait les biens de l’Église pour garnir son Trésor, l’action
unilatérale des Tudor entraîna la rupture dans l’Église chrétienne d’Occident.
couple royal vécut ainsi pendant dix ans, jusqu’en 1104, sous le coup
de l’anathème de l’Église catholique. Finalement, Philippe et Bertrade se
soumettront lors du Concile de Paris en 1104 tout en poursuivant leur vie
commune. Mais toutes ces histoires d’adultère ne mèneront pas tous au résultat
de la réconciliation. Le cas le plus célèbre, celui d’Henry VIII d’Angleterre
qui trouva tous les prétextes du monde possible pour se séparer de Catherine
d’Aragon afin d’épouser Ann Boleyn s’achèvera dans la répudiation et le schisme
d’avec Rome. Bien que la vraie raison résidait dans la politique religieuse du
roi qui visait les biens de l’Église pour garnir son Trésor, l’action
unilatérale des Tudor entraîna la rupture dans l’Église chrétienne d’Occident..jpg) l’évêque de Montréal, Ignace Bourget
(1799-1885), second évêque de Montréal (1840-1876). Après l’échec des
rébellions du Bas-Canada en 1837-1838, Mgr Bourget mène la lutte à une
bourgeoisie de professionnels libéraux qui fait étalage de ses frondes idéologiques, dont
la liberté de penser est considérée comme la plus dangereuse pour un catholique. Ces libéraux adhèrent à un club très sélect, l’Institut Canadien de
Montréal, fondé en 1844 par 200 jeunes esprits qui s'appuient essentiellement sur la raison et la liberté de conscience. L’Institut ouvre une
bibliothèque publique, devient un lieu de débat et de conférence littéraire et
scientifique, recrute de jeunes clercs, tout cela sans l’approbation de
l’évêque. Mgr Bourget, après le schisme d’une faction de l’Institut qui devient
l’Institut canadien-français de Montréal et se soumet à l’évêque, condamne l’Institut Canadien de Montréal en 1859, excommuniant ses membres, et
le 7 juillet 1869, l’Annuaire de 1868
de l’Institut sera mis à l’index par Rome. La confrontation va être menée à son
comble avec la célèbre tragédie burlesque de l’affaire Guibord.
l’évêque de Montréal, Ignace Bourget
(1799-1885), second évêque de Montréal (1840-1876). Après l’échec des
rébellions du Bas-Canada en 1837-1838, Mgr Bourget mène la lutte à une
bourgeoisie de professionnels libéraux qui fait étalage de ses frondes idéologiques, dont
la liberté de penser est considérée comme la plus dangereuse pour un catholique. Ces libéraux adhèrent à un club très sélect, l’Institut Canadien de
Montréal, fondé en 1844 par 200 jeunes esprits qui s'appuient essentiellement sur la raison et la liberté de conscience. L’Institut ouvre une
bibliothèque publique, devient un lieu de débat et de conférence littéraire et
scientifique, recrute de jeunes clercs, tout cela sans l’approbation de
l’évêque. Mgr Bourget, après le schisme d’une faction de l’Institut qui devient
l’Institut canadien-français de Montréal et se soumet à l’évêque, condamne l’Institut Canadien de Montréal en 1859, excommuniant ses membres, et
le 7 juillet 1869, l’Annuaire de 1868
de l’Institut sera mis à l’index par Rome. La confrontation va être menée à son
comble avec la célèbre tragédie burlesque de l’affaire Guibord. Joseph Guibord était typographe au journal libéral Le Pays. Il était également membre de
l’Institut Canadien dont il avait été vice-président. Guibord meurt le
18 novembre 1869 et sa famille se fait refuser le droit d’inhumer sa dépouille
dans le cimetière catholique de Côte-des-Neiges. Henrietta Brown, la veuve,
refuse cette exclusion et porte l’affaire devant les tribunaux. Commence alors
l’affaire Guibord. L’avocat de la veuve est un libéral forcené, Me Joseph
Doutre qui portera la cause jusque devant le Conseil Privé de Londres, le 28
novembre 1874.
Joseph Guibord était typographe au journal libéral Le Pays. Il était également membre de
l’Institut Canadien dont il avait été vice-président. Guibord meurt le
18 novembre 1869 et sa famille se fait refuser le droit d’inhumer sa dépouille
dans le cimetière catholique de Côte-des-Neiges. Henrietta Brown, la veuve,
refuse cette exclusion et porte l’affaire devant les tribunaux. Commence alors
l’affaire Guibord. L’avocat de la veuve est un libéral forcené, Me Joseph
Doutre qui portera la cause jusque devant le Conseil Privé de Londres, le 28
novembre 1874. fonctionnaire civil.
fonctionnaire civil. Commence alors le procès devant le juge Mondelet, déjà
favorable à l’Institut Canadien. Chaque partie – celui de la veuve défendue par
Rodolphe Laflamme et la fabrique défendue par Louis-Amable Jetté. Jetté
commence par dénoncer la partie adverse : «Le 9 décembre (1869), Jetté allègue que la poursuite porte à
faux : les inhumations ont lieu dans la matinée, jamais dans l’après-midi,
surtout un dimanche et pendant un office religieux de la paroisse. On ne
pouvait en de telles circonstances obliger un prêtre à sortir de la ville afin
de constater la mise en terre d’un défunt, et cela, sans avis préalable. L’on
tenta de faire l’inhumation à l’insu du curé; celui-ci étant considéré
conjointement avec la fabrique comme propriétaire de l’église et du cimetière,
il lui appartenait de désigner l’endroit de la sépulture» (T. Hudon. Ibid. p. 86). En
Commence alors le procès devant le juge Mondelet, déjà
favorable à l’Institut Canadien. Chaque partie – celui de la veuve défendue par
Rodolphe Laflamme et la fabrique défendue par Louis-Amable Jetté. Jetté
commence par dénoncer la partie adverse : «Le 9 décembre (1869), Jetté allègue que la poursuite porte à
faux : les inhumations ont lieu dans la matinée, jamais dans l’après-midi,
surtout un dimanche et pendant un office religieux de la paroisse. On ne
pouvait en de telles circonstances obliger un prêtre à sortir de la ville afin
de constater la mise en terre d’un défunt, et cela, sans avis préalable. L’on
tenta de faire l’inhumation à l’insu du curé; celui-ci étant considéré
conjointement avec la fabrique comme propriétaire de l’église et du cimetière,
il lui appartenait de désigner l’endroit de la sépulture» (T. Hudon. Ibid. p. 86). En  face, l’avocat Laflamme
entend élever le débat plus haut et l’annexer à la défense de l’Institut
Canadien en attente d’une décision du Saint-Office à Rome où Mgr Bourget est
présent pour répondre des accusations portées par l’Institut auprès de
Saint-Siège : «Laflamme affirme que
le droit civil permet de limiter l’exercice injuste de l’autorité religieuse;
il nie que l’Institut canadien, corporation civile, puisse être restreint par
l’évêque dans ses libertés. Il nie encore que des peines canoniques fassent perdre
les droits civils, que Guibord ait encouru ces peines, il soutient qu’aucune
excommunication majeure n’avait été portée contre Guibord, que celui-ci n’avait
pas encouru l’excommunication mineure…» (T. Hudon. Ibid. p. 87). Comme nous pouvons le constater, deux procès sont
simultanément plaidés : la propriété ecclésiastique du cimetière et la
soumission aux décisions de l’autorité; le droit de la libre pensée affirmée
par le code civil. Dialogue de sourds.
face, l’avocat Laflamme
entend élever le débat plus haut et l’annexer à la défense de l’Institut
Canadien en attente d’une décision du Saint-Office à Rome où Mgr Bourget est
présent pour répondre des accusations portées par l’Institut auprès de
Saint-Siège : «Laflamme affirme que
le droit civil permet de limiter l’exercice injuste de l’autorité religieuse;
il nie que l’Institut canadien, corporation civile, puisse être restreint par
l’évêque dans ses libertés. Il nie encore que des peines canoniques fassent perdre
les droits civils, que Guibord ait encouru ces peines, il soutient qu’aucune
excommunication majeure n’avait été portée contre Guibord, que celui-ci n’avait
pas encouru l’excommunication mineure…» (T. Hudon. Ibid. p. 87). Comme nous pouvons le constater, deux procès sont
simultanément plaidés : la propriété ecclésiastique du cimetière et la
soumission aux décisions de l’autorité; le droit de la libre pensée affirmée
par le code civil. Dialogue de sourds. «Abordant
la question en litige, la première proposition du juge fut que dans une
question de ce genre la coutume de Paris faisait loi et il établit sa thèse en
citant des précédents sous les régimes français et anglais. Les décisions
judiciaires n’ont pas varié donnant dans ces conflits religieux gain de cause à
la partie civile. Il soutient que telle fut l’opinion de Louis-Hippolyte
Lafontaine, de Georges-Étienne Cartier, ce dernier admettant que les tribunaux
civils avaient le pouvoir et le droit de “contraindre le clergé d’administrer
même les sacrements de baptême et de mariage et de donner la sépulture”. (15
octobre 1866.)
«Abordant
la question en litige, la première proposition du juge fut que dans une
question de ce genre la coutume de Paris faisait loi et il établit sa thèse en
citant des précédents sous les régimes français et anglais. Les décisions
judiciaires n’ont pas varié donnant dans ces conflits religieux gain de cause à
la partie civile. Il soutient que telle fut l’opinion de Louis-Hippolyte
Lafontaine, de Georges-Étienne Cartier, ce dernier admettant que les tribunaux
civils avaient le pouvoir et le droit de “contraindre le clergé d’administrer
même les sacrements de baptême et de mariage et de donner la sépulture”. (15
octobre 1866.) cimetière catholique et à payer tous les frais encourus dans la cause. Le
droit civil l’emporte sur le droit canon. La fabrique porte la cause à la Cour
d’Appel qui renverse le jugement Mondelet le 10 septembre suivant. C’est
finalement devant le Conseil Privé à Londres que la cause sera définitivement
tranchée. Les Lords anglais se penchent sur l’histoire du Canada et les
précédents dans les disputes entre des partis civiles et ecclésiastiques. Les
avocats Doutre et Jetté vont plaider leurs causes devant le Conseil
Privé. Le rapport du tribunal sera rendu public le 21 novembre 1874, et son
jugement, huit jours plus tard, le 28 novembre. Il apparaît évident que le
Conseil Privé n’est pas équipé pour rendre un jugement parfaitement mesuré dans
cette affaire. Ainsi, le Conseil Privé décide que la législation ecclésiastique
ne s’applique pas dans ce cas-là. Il prétend étayer ses décisions sur une
interprétation du droit canon. «La
conclusion renverse tout. Au moment de la mort, Guibord n’était sous le coup
d’aucune sentence ou censure ecclésiastique valide qui pût justifier le refus
de sépulture ecclésiastique de ses restes mortels. Les nobles lords se sont
mépris. Dans l’église anglicane, les décisions en matière religieuse
appartiennent au parlement, tandis que pour l’église catholique, elles sont
tranchées par
cimetière catholique et à payer tous les frais encourus dans la cause. Le
droit civil l’emporte sur le droit canon. La fabrique porte la cause à la Cour
d’Appel qui renverse le jugement Mondelet le 10 septembre suivant. C’est
finalement devant le Conseil Privé à Londres que la cause sera définitivement
tranchée. Les Lords anglais se penchent sur l’histoire du Canada et les
précédents dans les disputes entre des partis civiles et ecclésiastiques. Les
avocats Doutre et Jetté vont plaider leurs causes devant le Conseil
Privé. Le rapport du tribunal sera rendu public le 21 novembre 1874, et son
jugement, huit jours plus tard, le 28 novembre. Il apparaît évident que le
Conseil Privé n’est pas équipé pour rendre un jugement parfaitement mesuré dans
cette affaire. Ainsi, le Conseil Privé décide que la législation ecclésiastique
ne s’applique pas dans ce cas-là. Il prétend étayer ses décisions sur une
interprétation du droit canon. «La
conclusion renverse tout. Au moment de la mort, Guibord n’était sous le coup
d’aucune sentence ou censure ecclésiastique valide qui pût justifier le refus
de sépulture ecclésiastique de ses restes mortels. Les nobles lords se sont
mépris. Dans l’église anglicane, les décisions en matière religieuse
appartiennent au parlement, tandis que pour l’église catholique, elles sont
tranchées par  l’Église et par l’Église seule. Son incursion dans le droit canon
n’est pas heu-
l’Église et par l’Église seule. Son incursion dans le droit canon
n’est pas heu-reuse» (T. Hudon. Ibid. p. 129). Enfin, «la fabrique est condam-
née à enterrer Guibord dans la partie catholique du cimetière et à payer les frais encourus devant toutes les cours – sauf les frais de la contestation des juges qui doivent être payés par la poursuite. […] Suit la sentence inique : la fabrique devait payer les frais qui s’élevaient à la somme de cinq mille dollars» (T. Hudon. Ibid. p. 130). Théophile Hudon, qui est Jésuite et développe un parti pris pour la position de Mgr Bourget, a raison toutefois de soulever l’absurdité du jugement : «Tout en condamnant la paroisse à donner la sépulture à Guibord, le Conseil Privé admet que l’Église a le droit de refuser la sépulture aux pécheurs publics et aux excommuniés!» (T. Hudon. Ibid. p. 130).
 L’affaire n’en finit pas là. Se prévalant du jugement du
Conseil Privé, Joseph Doutre avait choisi le 2 septembre 1875 pour procéder à
l’enterrement de Guibord. Il y avait déjà un lot où reposait la sépulture de la
femme de Guibord, morte quelques années plus tôt, mais «un millier de catholiques (et quelques Irlandais) ont bloqué
l’entrée du cimetière Côte-des-Neiges et lapidé le cortège, c’est le suspense»
(R. Hébert. Le procès Guibord ou
l’interprétation des restes, Montréal, Triptyque, 1992, p. 141) :
L’affaire n’en finit pas là. Se prévalant du jugement du
Conseil Privé, Joseph Doutre avait choisi le 2 septembre 1875 pour procéder à
l’enterrement de Guibord. Il y avait déjà un lot où reposait la sépulture de la
femme de Guibord, morte quelques années plus tôt, mais «un millier de catholiques (et quelques Irlandais) ont bloqué
l’entrée du cimetière Côte-des-Neiges et lapidé le cortège, c’est le suspense»
(R. Hébert. Le procès Guibord ou
l’interprétation des restes, Montréal, Triptyque, 1992, p. 141) : À quatre heurs, le maire Hingston avec une escouade de cinquante
hommes de police survient et fait ouvrir les portes.
À quatre heurs, le maire Hingston avec une escouade de cinquante
hommes de police survient et fait ouvrir les portes. la nouvelle arrive que l’en-
la nouvelle arrive que l’en-terrement de Guibord dans le cimetière catho-
lique aurait lieu, le 16 novembre (1875). Le diman-
che, 14 novem-
bre, on recommande dans les églises aux fidèles de s’abstenir. Le lundi 15, un bref est assigné à l’abbé Rousselot, ordonnant la sépulture de Guibord et demandant de faire sur la tombe les prières ordinaires. Le curé accuse réception du bref et rappelle qu’il avait accepté dès la première sommation de présider à une sépulture civile, mais qu’il avait refusé alors et qu’il refuse encore d’accomplir, et ce, sur les ordres de l’évêque les cérémonies liturgiques» (T. Hudon. Ibid. p. 144). Bref, l’abbé Rousselot persiste et signe, déclarant qu’il serait présent, mais seulement comme officier civil.
Le cortège s’ébranle, accompagné de la charge de ciment.
 Ce même jour du seize, une lettre de
Mgr Bourget rappelle le souci pour les autorités religieuses d’éviter le
tumulte et l’effusion du sang et en même temps de sauvegarder les droits de
l’Église.
Ce même jour du seize, une lettre de
Mgr Bourget rappelle le souci pour les autorités religieuses d’éviter le
tumulte et l’effusion du sang et en même temps de sauvegarder les droits de
l’Église. l’épée. Robert Hébert, mieux que Théophile Hudon,
décrit l’importance de l’action militaire comme issue à l’affaire
Guibord : «…très tôt le matin, à
partir du Drill Shed et de la Gare centrale, volontaires et quelque 70
policiers de la ville de Montréal armés de carabines Sniders vont chercher le
cercueil au cimetière Mont-Royal; ils sont rejoints par un imposant convoi
militaire qui, pendant ce temps, paradait à partir du Champ-de-Mars : deux
pièces de canons, une batterie de campagne, un escadron de cavalerie, plusieurs
bataillons (Hochelaga, Victoria, Prince of Wales…), une compagnie d’ingénieurs.
En tout, 950 hommes. […] Bravades,
insultes, rires. Tout se fait assez calmement, sans obstacle autour du lot
N-873 : les fossoyeurs ne sont pas des francophones. On coule le cercueil
dans du ciment de Portland qui a la propriété de durcir rapidement – on craint
une exhumation nocturne. Aucune sépulture ecclésiastique, aucun discours n’est
prononcé “while one of the most cheerless of miserable drizzles steadily fell”»
(R. Hébert. Op. cit, p. 142). D'autre part, il est difficile de considérer Guibord comme une simple «victime expiatoire de l'évêque Bourget» comme le présente Adrien Thério (A. Thério. Joseph Guibord, Montréal, XYZ, Col. Documents, 2000), la mort de Guibord intervenant au milieu d'un conflit qui opposait l'Église catholique au modernisme partout dans le monde, il ne s'agissait pas de faire expier ni Guibord ni l'Institut Canadien, mais tout simplement de déraciner les semences de la controverse. Comme toujours en de telles situations, l'effet fut le contraire et si le curé Rousselot ne s'était pas entêté, Guibord aurait été enterré dans sa portion de terrain catholique comme tant d'autres membres de l'Institut l'avait été auparavant.
l’épée. Robert Hébert, mieux que Théophile Hudon,
décrit l’importance de l’action militaire comme issue à l’affaire
Guibord : «…très tôt le matin, à
partir du Drill Shed et de la Gare centrale, volontaires et quelque 70
policiers de la ville de Montréal armés de carabines Sniders vont chercher le
cercueil au cimetière Mont-Royal; ils sont rejoints par un imposant convoi
militaire qui, pendant ce temps, paradait à partir du Champ-de-Mars : deux
pièces de canons, une batterie de campagne, un escadron de cavalerie, plusieurs
bataillons (Hochelaga, Victoria, Prince of Wales…), une compagnie d’ingénieurs.
En tout, 950 hommes. […] Bravades,
insultes, rires. Tout se fait assez calmement, sans obstacle autour du lot
N-873 : les fossoyeurs ne sont pas des francophones. On coule le cercueil
dans du ciment de Portland qui a la propriété de durcir rapidement – on craint
une exhumation nocturne. Aucune sépulture ecclésiastique, aucun discours n’est
prononcé “while one of the most cheerless of miserable drizzles steadily fell”»
(R. Hébert. Op. cit, p. 142). D'autre part, il est difficile de considérer Guibord comme une simple «victime expiatoire de l'évêque Bourget» comme le présente Adrien Thério (A. Thério. Joseph Guibord, Montréal, XYZ, Col. Documents, 2000), la mort de Guibord intervenant au milieu d'un conflit qui opposait l'Église catholique au modernisme partout dans le monde, il ne s'agissait pas de faire expier ni Guibord ni l'Institut Canadien, mais tout simplement de déraciner les semences de la controverse. Comme toujours en de telles situations, l'effet fut le contraire et si le curé Rousselot ne s'était pas entêté, Guibord aurait été enterré dans sa portion de terrain catholique comme tant d'autres membres de l'Institut l'avait été auparavant. Adolf von Harnack. Or, Harnack est un exégète redoutable et un
positiviste qui ramène à l'historicisme toute l’interprétation de la vie de Jésus. Professeur à
l’École Pratique des Hautes Études, Loisy «prétend
réfuter le protestant allemand Harnack, et son écriture, d’une extrême finesse,
contribue à donner le change sur sa pensée véritable par l’emploi dans un sens
nouveau des termes usuels de l’enseignement dogmatique qu’il s’agit pour lui de
ruiner. L’Évangile se réduirait à une invitation à la pénitence en vue d’une
catastrophe prochaine qui ne s’est pas produite; la foi de ses apôtres et de
ses disciples a fait du Christ un Dieu; l’Église a recueilli ses paroles; les
dogmes qu’elle en a tirés étaient “en rapport avec l’état général des
connaissances humaines dans le temps et le milieu où ils ont été constitués”;
il s’ensuit “qu’un changement considérable dans l’état de la science peut
rendre nécessaire une interprétation nouvelle des anciennes formules”. L’année
suivante, il répond à ses critiques dans une série de lettres réunies
Adolf von Harnack. Or, Harnack est un exégète redoutable et un
positiviste qui ramène à l'historicisme toute l’interprétation de la vie de Jésus. Professeur à
l’École Pratique des Hautes Études, Loisy «prétend
réfuter le protestant allemand Harnack, et son écriture, d’une extrême finesse,
contribue à donner le change sur sa pensée véritable par l’emploi dans un sens
nouveau des termes usuels de l’enseignement dogmatique qu’il s’agit pour lui de
ruiner. L’Évangile se réduirait à une invitation à la pénitence en vue d’une
catastrophe prochaine qui ne s’est pas produite; la foi de ses apôtres et de
ses disciples a fait du Christ un Dieu; l’Église a recueilli ses paroles; les
dogmes qu’elle en a tirés étaient “en rapport avec l’état général des
connaissances humaines dans le temps et le milieu où ils ont été constitués”;
il s’ensuit “qu’un changement considérable dans l’état de la science peut
rendre nécessaire une interprétation nouvelle des anciennes formules”. L’année
suivante, il répond à ses critiques dans une série de lettres réunies  sous le
titre Autour d’un petit livre : le principe
catholique est capable en raison de sa fécondité de s’adapter à toutes les
formes du progrès humain; les dogmes n’apparaissent plus que comme des symboles
dont l’expression varie avec les résultats de la science et les aspirations du
temps présent. En fait, Loisy nie l’idée d’un Dieu personnel et l’immortalité
de l’âme; cependant, il aime toujours l’Église, continue à dire la messe et
vient de faire des démarches pour obtenir l’évêché de Monaco» (A. Dansette.
Histoire religieuse de la France contemporaine,
Paris, Flammarion, Col. L’Histoire, 1965, pp. 679-680). Ce que nous disent
ces théologiens de la modernité, chacun dans sa chapelle, c’est que l’Église
n’est pas en dehors du temps et de l’Histoire, mais que c’est bien elle qui est
soumise aux contingences temporelles et aux contraintes de l’Histoire.
sous le
titre Autour d’un petit livre : le principe
catholique est capable en raison de sa fécondité de s’adapter à toutes les
formes du progrès humain; les dogmes n’apparaissent plus que comme des symboles
dont l’expression varie avec les résultats de la science et les aspirations du
temps présent. En fait, Loisy nie l’idée d’un Dieu personnel et l’immortalité
de l’âme; cependant, il aime toujours l’Église, continue à dire la messe et
vient de faire des démarches pour obtenir l’évêché de Monaco» (A. Dansette.
Histoire religieuse de la France contemporaine,
Paris, Flammarion, Col. L’Histoire, 1965, pp. 679-680). Ce que nous disent
ces théologiens de la modernité, chacun dans sa chapelle, c’est que l’Église
n’est pas en dehors du temps et de l’Histoire, mais que c’est bien elle qui est
soumise aux contingences temporelles et aux contraintes de l’Histoire.Comme nous sommes en pleine crise de la modernité et que la République chasse ses congrégations des œuvres publiques, le livre de Loisy est vite considéré comme un offensive du modernisme dans la théologie. Des diocèses jettent l’interdit sur le livre. Pour le moment, Rome laisse faire, mais l’arrivée de Pie X au pontificat accélère la contre-offensive contre le mouvement moderniste qui accélère ses avancées dans le monde de la philosophie religieuse. Le 4 juillet 1907, le Saint-Office
 promulgue le décret Lamentabili sane exitu qui condamne «des erreurs dangereuses sur les sciences
sacrées, l’interpré-
promulgue le décret Lamentabili sane exitu qui condamne «des erreurs dangereuses sur les sciences
sacrées, l’interpré-tation de la Sainte-Écriture et les principaux mystères de la foi», donc la plupart des thèses avancées par Loisy. Suit l’encyclique Pascendi qui est «un exposé complet de tout ce que les thèses modernistes ont de condamnable : l’agnosticisme en présence des démonstrations à base rationnelle; l’immanence vitale qui fait jaillir la vérité religieuse des besoins de la foi, vérité dont la valeur n’est que symbolique; l’attribution de l’origine des dogmes au travail de l’intelligence sur la perception de Dieu au plus intime de l’homme, de celle des sacrements au besoin de “donner à la religion un corps sensible” et de le faire connaître; la négation de tout surnaturel dans l’Histoire, etc.» (A. Dansette. Ibid. p. 684). Certes, Loisy n’est pas la seule cible de l’Église romaine, mais comme celui-ci refuse de se soumettre à l’encyclique et qu’il récidive en «protestant contre l’encyclique, publie de nouveaux livres dans lesquels il s’attache à l’historicité des Évangiles et qualifie plusieurs dogmes de légendes. Après de vaines négociations, il est frappé» (A. Dansette. Ibid. p. 686) d’un décret d’excommunication vitandus par la Congrégation du Saint-Office, le 7 mars 1908, ce qui interdisait à tout catholique de lui adresser la parole. En retour, l’année suivante, Loisy était nommé à la chaire d’histoire des religions du Collège de France où il enseignera jusqu’à son départ pour la retraite en 1932.
 modernisme, un des adversaires les plus sérieux que la foi ait
rencontrés, était un prêtre, infiniment respectable dans sa vie privée, dont
les amis évoquaient volontiers les trésors de sensibilité pieuse et d’élan
mystique, que révélaient d’ailleurs son aspect, tout empreint de gravité
sacerdotale, et ses ferventes actions de grâces. […] Mais, en lui, le drame de l’homo duplex se jouait; cette religion à laquelle il demeurait extérieurement
fidèle, au fond de lui-même, Alfred Loisy, la trentaine venue, lui
appartenait-il encore?» (H. Daniel-Rops. Un combat pour Dieu, Paris,
Fayard, Col. Les Grandes Études historiques, 1963, pp. 340-341). Il était
possible jadis d’associer l’hérésie à des réinterprétations du dogme par un
Luther ou un Calvin, mais avec Loisy, l’attaque était plus intelligente, elle relevait
de l’ordre de la méthode critique : «Loisy,
dont les convictions… étaient alors déjà fort éloignées de la foi du
charbonnier, saisit l’occasion pour glisser, de façon assez machiavélique, dans
son livre, les thèses auxquelles il était attaché. Appliquant à l’Évangile les
méthodes de sa critique, il rejetait la croyance traditionnelle de l’institution
par le Christ de l’Église et des sacrements, ajoutant que Jésus s’était trompé
lui-même pour les événements qui devaient se dérouler après sa mort, l’idée
principale de son message étant l’annonce d’un Royaume de Dieu terrestre qui s’instaurerait
après la fin du monde, prochaine. Cette théorie “eschatologique” aboutissait à
ruiner radicalement le christianisme, puisque, si Jésus s’était trompé, il ne
pouvait pas être Dieu, et qu’il fallait donc admettre que c’étaient les
premières générations chrétiennes qui l’avaient “déifié”. Les théologiens
perspicaces ne se laissèrent pas duper par l’apologétique antiprotestante de
Loisy…» (H. Daniel-Rops. Ibid. p.
354). Évidemment, pour ce catholique orthodoxe, Loisy ne pouvait être qu’un
fourbe mû par sa duplicité et son machiavélisme en vue de torpiller la Vérité
ecclésiastique confondue avec la Vérité divine puisque l’Église est l’Évangile
en continuité dans le temps. En le
faisant élire au Collège de France, le Gouvernement anti-catholique portait
une autre gifle au Saint-Père.
modernisme, un des adversaires les plus sérieux que la foi ait
rencontrés, était un prêtre, infiniment respectable dans sa vie privée, dont
les amis évoquaient volontiers les trésors de sensibilité pieuse et d’élan
mystique, que révélaient d’ailleurs son aspect, tout empreint de gravité
sacerdotale, et ses ferventes actions de grâces. […] Mais, en lui, le drame de l’homo duplex se jouait; cette religion à laquelle il demeurait extérieurement
fidèle, au fond de lui-même, Alfred Loisy, la trentaine venue, lui
appartenait-il encore?» (H. Daniel-Rops. Un combat pour Dieu, Paris,
Fayard, Col. Les Grandes Études historiques, 1963, pp. 340-341). Il était
possible jadis d’associer l’hérésie à des réinterprétations du dogme par un
Luther ou un Calvin, mais avec Loisy, l’attaque était plus intelligente, elle relevait
de l’ordre de la méthode critique : «Loisy,
dont les convictions… étaient alors déjà fort éloignées de la foi du
charbonnier, saisit l’occasion pour glisser, de façon assez machiavélique, dans
son livre, les thèses auxquelles il était attaché. Appliquant à l’Évangile les
méthodes de sa critique, il rejetait la croyance traditionnelle de l’institution
par le Christ de l’Église et des sacrements, ajoutant que Jésus s’était trompé
lui-même pour les événements qui devaient se dérouler après sa mort, l’idée
principale de son message étant l’annonce d’un Royaume de Dieu terrestre qui s’instaurerait
après la fin du monde, prochaine. Cette théorie “eschatologique” aboutissait à
ruiner radicalement le christianisme, puisque, si Jésus s’était trompé, il ne
pouvait pas être Dieu, et qu’il fallait donc admettre que c’étaient les
premières générations chrétiennes qui l’avaient “déifié”. Les théologiens
perspicaces ne se laissèrent pas duper par l’apologétique antiprotestante de
Loisy…» (H. Daniel-Rops. Ibid. p.
354). Évidemment, pour ce catholique orthodoxe, Loisy ne pouvait être qu’un
fourbe mû par sa duplicité et son machiavélisme en vue de torpiller la Vérité
ecclésiastique confondue avec la Vérité divine puisque l’Église est l’Évangile
en continuité dans le temps. En le
faisant élire au Collège de France, le Gouvernement anti-catholique portait
une autre gifle au Saint-Père. semble à première vue renforcer ses déclarations. Mais un
certain nombre d’ob-
semble à première vue renforcer ses déclarations. Mais un
certain nombre d’ob-servations perspicaces d’É. Poulat invitent au contraire à penser que c’est l’existence même de ce texte, rédigé dans une perspective malveillante à l’égard de Loisy, qui explique pour une part la reconstruction que celui-ci, une fois détaché de toute foi positive, a voulu donner à postériori de son évolution religieuse, ce qui réduit dès lors la crédibilité que certains ont accordé trop vite à ses déclarations sur la date réelle où il cessa de croire. Les fragments de lettres et les souvenirs publiés par R. de Boyer de Sainte-Suzanne sous le titre À Loisy entre la foi et l’incroyance confirment toute la distance qu’il y avait entre ce dernier et un Renan, dont il exécrait le rationalisme scientiste, ou un Houtin, qui fut à certains points de vue son mauvais génie. Certes Loisy, dès 1900, distinguait entre la foi et les croyances, mais les progrès de la sociologie de la connaissance religieuse, comme ceux de la théologie de la foi et de l’herméneutique permettent aujourd’hui de comprendre de façon moins simpliste qu’au début du siècle la psychologie complexe des modernistes.
 l’action de l’Église catholique irréconciliable avec l’Histoire
que von Harnack et Bultmann qui devinrent des sommités dans le monde protestant.
La liberté de conscience défrichée par les réformistes du XVIe siècle rendait
possible ce cheminement intellectuel et moral d’une Église qui acceptait d’affronter
le doute contre le totalitarisme du dogme. D’autres théologiens, dans la même
veine, subiront l’excommunication, tel Prosper Alfaric (1876-1955), prêtre,
théologien, historien des religions qui sera frappé, à son tour, d’excommunication
vitandus et puni de la peine de
dégradation par décret du Saint-Office, le 29 juillet 1933, après la publication
d’un ouvrage collectif : Le Problème
de Jésus et les origines du christianisme, où il élaborait ses thèses sur l’inexistence
historique de Jésus de Nazareth et de Marie. Dès lors, il devenait possible de
considérer les Évangiles comme un ensemble de récits purement mythiques et qui
font, aujourd’hui, le régal d’un philosophe peu profond et amoureux du
scandale, Michel Onfray.
l’action de l’Église catholique irréconciliable avec l’Histoire
que von Harnack et Bultmann qui devinrent des sommités dans le monde protestant.
La liberté de conscience défrichée par les réformistes du XVIe siècle rendait
possible ce cheminement intellectuel et moral d’une Église qui acceptait d’affronter
le doute contre le totalitarisme du dogme. D’autres théologiens, dans la même
veine, subiront l’excommunication, tel Prosper Alfaric (1876-1955), prêtre,
théologien, historien des religions qui sera frappé, à son tour, d’excommunication
vitandus et puni de la peine de
dégradation par décret du Saint-Office, le 29 juillet 1933, après la publication
d’un ouvrage collectif : Le Problème
de Jésus et les origines du christianisme, où il élaborait ses thèses sur l’inexistence
historique de Jésus de Nazareth et de Marie. Dès lors, il devenait possible de
considérer les Évangiles comme un ensemble de récits purement mythiques et qui
font, aujourd’hui, le régal d’un philosophe peu profond et amoureux du
scandale, Michel Onfray. River. Feeney est un exalté pour qui les non
baptisés vont en enfer. Excommunié par Pie XII pour refus de soumission à l’autorité
ecclésiale, Feeney se réconciliera avec le Saint-Siège en 1972 sans qu’on exige
de lui de rétractation sur sa position à propos du baptême. Il est vrai que
dans ses délires, Feeney affirmait l’existence de liens entre Napoléon et la
Franc-Maçonnerie en vue d’abattre la civilisation chrétienne. Comme on le voit,
l’excommunication est de moins en moins utilisée pour des choses sérieuses. Mgr Marcel Lefebvre (1905-1991), adversaire exalté du concile Vatican II, fonde en
1970 la Fraternité Saint-Pie X et le séminaire international d’Écône, créés
pour «former des séminaristes en vue de la prêtrise», une prêtrise
réactionnaire qui en restera aux décrets du Concile de Trente et à la messe de
Saint-Pie V dite en latin. Il est
River. Feeney est un exalté pour qui les non
baptisés vont en enfer. Excommunié par Pie XII pour refus de soumission à l’autorité
ecclésiale, Feeney se réconciliera avec le Saint-Siège en 1972 sans qu’on exige
de lui de rétractation sur sa position à propos du baptême. Il est vrai que
dans ses délires, Feeney affirmait l’existence de liens entre Napoléon et la
Franc-Maçonnerie en vue d’abattre la civilisation chrétienne. Comme on le voit,
l’excommunication est de moins en moins utilisée pour des choses sérieuses. Mgr Marcel Lefebvre (1905-1991), adversaire exalté du concile Vatican II, fonde en
1970 la Fraternité Saint-Pie X et le séminaire international d’Écône, créés
pour «former des séminaristes en vue de la prêtrise», une prêtrise
réactionnaire qui en restera aux décrets du Concile de Trente et à la messe de
Saint-Pie V dite en latin. Il est  excommunié latæ sententiæ en 1988 pour avoir sacré quatre évêques traditionalistes
sans la permission de Rome. Malgré de réguliers affrontements, Mgr Lefebvre et
Jean-Paul II refusent la complète scission. Mgr Lefebvre soutient des régimes
dictatoriaux et des politiques conservatrices réactionnaires. Bien que les
tentatives de réinsertion de Mgr Lefebvre au sein de l’Église catholique aient
échoué de son vivant, après sa mort, Benoît XVI lèvera l’excommunication contre
les 4 évêques consacrés par Mgr Lefebvre, manifestation de réconciliation
tacite avec l’Église traditionaliste. Bien confortée à Écône, on ne promènera pas
la dépouille de Mgr Lefebvre comme on promena celle de Guibord, tant la
politique d’excommunication de l’Église catholique a toujours été de deux poids
deux mesures, selon l’endroit où l’excommunié se plaçait dans le spectre des
idéologies politiques. D’où le Purgatoire peut devenir une arène de luttes pour
les partisaneries idéologiques, catholiques comprises, en mal de reconnaissance
et de pouvoirs terrestres⌛
excommunié latæ sententiæ en 1988 pour avoir sacré quatre évêques traditionalistes
sans la permission de Rome. Malgré de réguliers affrontements, Mgr Lefebvre et
Jean-Paul II refusent la complète scission. Mgr Lefebvre soutient des régimes
dictatoriaux et des politiques conservatrices réactionnaires. Bien que les
tentatives de réinsertion de Mgr Lefebvre au sein de l’Église catholique aient
échoué de son vivant, après sa mort, Benoît XVI lèvera l’excommunication contre
les 4 évêques consacrés par Mgr Lefebvre, manifestation de réconciliation
tacite avec l’Église traditionaliste. Bien confortée à Écône, on ne promènera pas
la dépouille de Mgr Lefebvre comme on promena celle de Guibord, tant la
politique d’excommunication de l’Église catholique a toujours été de deux poids
deux mesures, selon l’endroit où l’excommunié se plaçait dans le spectre des
idéologies politiques. D’où le Purgatoire peut devenir une arène de luttes pour
les partisaneries idéologiques, catholiques comprises, en mal de reconnaissance
et de pouvoirs terrestres⌛





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire