 |
| Hiéronymus Bosch. La luxure. |
LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX : LUXURE
Pénétrant
dans le dernier cercle des péchés capitaux, le poète
latin Stace donne au Dante une explication scientifique et poétique
de la conception : «Si
ton esprit, mon fils, reçoit et garde mes paroles, elles te seront
une lumière qui éclairera le comment dont tu t’enquiers. Le sang
parfait, qui jamais n’est bu par les veines altérées, et reste
comme l’aliment qu’on enlève de table, prend dans le cœur une
vertu informative de tous les membres humains qu’il doit produire
en courant dans les veines.  Plus épuré encore, il descend en un
lieu qu’il est mieux de taire que de nommer; et de là ensuite il
dégoutte sur un autre sang, dans un vase naturel. Ensemble ils s’y
mêlent, l’un passif, l’autre actif, à cause de la perfection du
lieu d’où il est exprimé : et uni à celui-là, il commence à
agir, le coagulant d’abord, puis vivifiant ce qui, par sa matière,
a pris de la consistance. La vertu active devient une âme semblable
à celle d’une plante, différente seulement en ce qu’elle est en
voie, et l’autre déjà au rivage. Tant opère-t-elle ensuite, que
déjà elle se meut et sent, comme une anémone marine; puis elle se
prend à organiser les puissances dont elle est la semence. Tantôt
se replie, tantôt se dilate, mon fils, la vertu qui provient du cœur
du générateur, où la nature veille au soin de tous les membres.
Mais comment d’animal on devient enfant, tu ne le vois pas encore :
c’est là le point sur lequel a erré un plus savant que toi;
lequel, par sa doctrine, sépare de l’âme l’intellect possible,
parce qu’il ne voit pas qu’il prenne aucun organe. Ouvre ton cœur
à la vérité que tu vas entendre, et sache qu’aussitôt que du
cerveau la structure est parfaite dans le fœtus, le premier moteur
vers lui se tourne, et joyeux d’un si grand art de nature, y
souffle un esprit nouveau plein de vertu, qui, attirant dans sa
substance ce qu’il y trouve d’actif, devient une seule âme qui
vit, et sent, et se réfléchit sur elle-même»
(Traduction de Lamennais).
Plus épuré encore, il descend en un
lieu qu’il est mieux de taire que de nommer; et de là ensuite il
dégoutte sur un autre sang, dans un vase naturel. Ensemble ils s’y
mêlent, l’un passif, l’autre actif, à cause de la perfection du
lieu d’où il est exprimé : et uni à celui-là, il commence à
agir, le coagulant d’abord, puis vivifiant ce qui, par sa matière,
a pris de la consistance. La vertu active devient une âme semblable
à celle d’une plante, différente seulement en ce qu’elle est en
voie, et l’autre déjà au rivage. Tant opère-t-elle ensuite, que
déjà elle se meut et sent, comme une anémone marine; puis elle se
prend à organiser les puissances dont elle est la semence. Tantôt
se replie, tantôt se dilate, mon fils, la vertu qui provient du cœur
du générateur, où la nature veille au soin de tous les membres.
Mais comment d’animal on devient enfant, tu ne le vois pas encore :
c’est là le point sur lequel a erré un plus savant que toi;
lequel, par sa doctrine, sépare de l’âme l’intellect possible,
parce qu’il ne voit pas qu’il prenne aucun organe. Ouvre ton cœur
à la vérité que tu vas entendre, et sache qu’aussitôt que du
cerveau la structure est parfaite dans le fœtus, le premier moteur
vers lui se tourne, et joyeux d’un si grand art de nature, y
souffle un esprit nouveau plein de vertu, qui, attirant dans sa
substance ce qu’il y trouve d’actif, devient une seule âme qui
vit, et sent, et se réfléchit sur elle-même»
(Traduction de Lamennais).
Stace
poursuit son explication jusqu'au moment où ils abordent un lieu
autrement menaçant : «Déjà
nous étions arrivés là où le mont s’infléchit une dernière
fois; et nous avions tourné à main droite, et un  autre souci nous
préoccupait. Là le bord lance des flammes, et de la corniche
s’élève un vent qui les repousse, et les éloigne d’elle. Par
quoi, il nous fallait aller le long du côté ouvert, un à un; et
d’ici je craignais le feu, de là je craignais de tomber. Mon Guide
disait : — En cet endroit il faut tenir aux yeux le frein serré,
car l’erreur serait facile. «Summae
Deus clementiae»,1
au sein de cette
grande ardeur j’ouïs alors chanter; ce qui me donna un désir non
moindre de me tourner. Et je vis dans la flamme des esprits qui
allaient et je regardais à leurs pas et aux miens, partageant la vue
tour à tour entre l’un et l’autre. Cette hymne finie, à haute
voix ils criaient : «Virum non cognosco».2
Il y a là une certaine ironie où l'on entend les luxurieux chanter
la complainte de la Vierge à l'Ange qui lui annonçait qu'elle
allait concevoir!
autre souci nous
préoccupait. Là le bord lance des flammes, et de la corniche
s’élève un vent qui les repousse, et les éloigne d’elle. Par
quoi, il nous fallait aller le long du côté ouvert, un à un; et
d’ici je craignais le feu, de là je craignais de tomber. Mon Guide
disait : — En cet endroit il faut tenir aux yeux le frein serré,
car l’erreur serait facile. «Summae
Deus clementiae»,1
au sein de cette
grande ardeur j’ouïs alors chanter; ce qui me donna un désir non
moindre de me tourner. Et je vis dans la flamme des esprits qui
allaient et je regardais à leurs pas et aux miens, partageant la vue
tour à tour entre l’un et l’autre. Cette hymne finie, à haute
voix ils criaient : «Virum non cognosco».2
Il y a là une certaine ironie où l'on entend les luxurieux chanter
la complainte de la Vierge à l'Ange qui lui annonçait qu'elle
allait concevoir!
De
fait, les damnés entonnent des accords vantant les exemples de
chasteté d'épouses et d'époux qui s'en étaient tenus aux devoirs
imposés par la vertu et la sainteté des lois du mariage. À cette
première vague de luxurieux s'en ajoute une seconde, encore plus
vouée aux tourments et qui s'écrie Sodome
et Gomorrhe.
Une âme parmi les autres interpelle Dante : «Combien
tu es heureux, reprit l'ombre qui m'avait interrogé la première,
combien tu es heureux que la connaissance de notre supplice te donne
une expérience salutaire pour mieux vivre! Ces ombres qui marchent
dans _(cropped).jpg) une direction contraire à la nôtre commirent le crime que
César s'entendit reprocher, lorsqu'au milieu de son triomphe on le
saluait du nom de Reine.
Elles s'éloignent
de nous en criant Sodome!,
en se faisant
ainsi des reproches à elles-mêmes, et par cette confession elles
augmentent la rigueur de leur brûlure. Notre péché fut
hermaphrodite. Parce que nous ne suivîmes pas les lois humaines,
parce que nous nous livrâmes à nos désirs luxurieux comme de viles
bêtes, pour montrer notre opprobre, nous proférons sans cesse le
nom de la femme qui, sous des ais façonnés dans la forme d'une
génisse, fut souillée comme un animal de la même nature. Tu
connais nos actions, tu sais de quoi nous fûmes coupables; si tu
veux connaître notre nom, le temps ne me permet pas de te le dire,
et je ne le pourrais. Je t'empêcherai cependant de regretter
d'ignorer le mien : je suis Guido Guinicelli et déjà je me purifie,
parce que je me suis repenti avant d'être arrivé à la fin de ma
carrière»
(traduction d'Artau de Montor).
une direction contraire à la nôtre commirent le crime que
César s'entendit reprocher, lorsqu'au milieu de son triomphe on le
saluait du nom de Reine.
Elles s'éloignent
de nous en criant Sodome!,
en se faisant
ainsi des reproches à elles-mêmes, et par cette confession elles
augmentent la rigueur de leur brûlure. Notre péché fut
hermaphrodite. Parce que nous ne suivîmes pas les lois humaines,
parce que nous nous livrâmes à nos désirs luxurieux comme de viles
bêtes, pour montrer notre opprobre, nous proférons sans cesse le
nom de la femme qui, sous des ais façonnés dans la forme d'une
génisse, fut souillée comme un animal de la même nature. Tu
connais nos actions, tu sais de quoi nous fûmes coupables; si tu
veux connaître notre nom, le temps ne me permet pas de te le dire,
et je ne le pourrais. Je t'empêcherai cependant de regretter
d'ignorer le mien : je suis Guido Guinicelli et déjà je me purifie,
parce que je me suis repenti avant d'être arrivé à la fin de ma
carrière»
(traduction d'Artau de Montor).
Nous
comprenons mieux l'exposé de Stace et la mise en garde de Virgile
qui servent de prologue au dernier cercle du Purgatoire. Ici, nous
rencontrons ceux qui ont refusé la transmission de la descendance
pour se perdre dans la luxure, en particulier celle qui repousse  le
vase naturel pour aller «à
reculons», ce que Dante
appelle l'hermaphrodisme et qui correspond à notre bisexualité.
C'est ainsi qu'il faut comprendre l'allusion à César tirée de
Suétone : «À la même
époque, suivant Marcus Brutus, un certain Octavius, que le
dérangement de son esprit autorisait à tout dire, ayant, devant une
assemblée très nombreuse, donné à Pompée le titre de "roi",
salua même César du nom de "reine"».3
Et plus loin, le chroniqueur rapporte le mot devenu célèbre de
Curion, qu'il était «le
mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris».4
L'idée que César, jeune, eût été l'amant du roi Nicomède IV de
Bithynie, réfugié à Rome après l'invasion de son royaume par
Mithridate, est passé dans la légende, mais que savons-nous des
faits, car Suétone a beau être un grand chroniqueur, c'était aussi
une langue fort bien pendue qui rapportait tous les potins de la curie
romaine. Il en allait ainsi de Dion Cassius qui reprenait la rengaine
qui note toutefois que César prenait à cœur ces allusions qui
venaient de l'armée : «Cela
le blessait et le chagrinait visiblement, il essaya de se défendre,
niant cette affaire sous serment, d'où il devenait plus ridicule».5
le
vase naturel pour aller «à
reculons», ce que Dante
appelle l'hermaphrodisme et qui correspond à notre bisexualité.
C'est ainsi qu'il faut comprendre l'allusion à César tirée de
Suétone : «À la même
époque, suivant Marcus Brutus, un certain Octavius, que le
dérangement de son esprit autorisait à tout dire, ayant, devant une
assemblée très nombreuse, donné à Pompée le titre de "roi",
salua même César du nom de "reine"».3
Et plus loin, le chroniqueur rapporte le mot devenu célèbre de
Curion, qu'il était «le
mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris».4
L'idée que César, jeune, eût été l'amant du roi Nicomède IV de
Bithynie, réfugié à Rome après l'invasion de son royaume par
Mithridate, est passé dans la légende, mais que savons-nous des
faits, car Suétone a beau être un grand chroniqueur, c'était aussi
une langue fort bien pendue qui rapportait tous les potins de la curie
romaine. Il en allait ainsi de Dion Cassius qui reprenait la rengaine
qui note toutefois que César prenait à cœur ces allusions qui
venaient de l'armée : «Cela
le blessait et le chagrinait visiblement, il essaya de se défendre,
niant cette affaire sous serment, d'où il devenait plus ridicule».5
 Et
Guido Guinicelli? De quoi en retournait-il? Son nom était Guido Guinizzelli (ou Guinizelli) et, en français, Guy de Guincel, du nom
de son père Guinizello di Bartolomeo. Guido était né vers 1230 à
Bologne et mourut en exil à Monselice en 1276. C'était l'un des
poètes du dolce
stil nuovo - le nouveau
style doux -, comme Dante l'évoque dans le chant XXIV du Purgatoire.
Rappelons qu'il n'était pas le seul poète toscan à contribuer à ce
mouvement. À côté de lui, on mentionnera Guittone d'Arezzo
(1235-1294). Guido et Guittone furent les grands maîtres spirituels
de Dante qui développa son propre style vernaculaire. Comme
pour tant de poètes du Moyen Âge, nous détenons peu de documents
biographiques concernant Guido Guinizzelli. Nous savons qu'il est
issu d'une noble famille de Bologne, celle des Principi. Son père
était juriste et il lui fit étudier le droit. À partir de 1268, il
aurait exercé les fonctions de juge et de consultant juridique
dans sa ville natale. Guido, appartenant au camp des Gibelins
c'est-à-dire des partisans de l'Empereur contre ceux du Pape,
appuyait les Lambertazzi contre la faction guelfe des Geremei.
Lorsque celle-ci finit par triompher en 1274, Guido dut s'exiler à
Monselice, près de Padoue, avec sa femme, Bice della Fratta, et son
fils Guiduccio. C'est là qu'il mourut, à 46 ans. Tel était le
sort de bon nombre de lettrés italiens au cours du Moyen Âge, ce
qui n'avait vraiment rien d'exceptionnel puisque ce fut également le
destin du Dante de se voir exilé loin de sa Florence bien-aimée.
Et
Guido Guinicelli? De quoi en retournait-il? Son nom était Guido Guinizzelli (ou Guinizelli) et, en français, Guy de Guincel, du nom
de son père Guinizello di Bartolomeo. Guido était né vers 1230 à
Bologne et mourut en exil à Monselice en 1276. C'était l'un des
poètes du dolce
stil nuovo - le nouveau
style doux -, comme Dante l'évoque dans le chant XXIV du Purgatoire.
Rappelons qu'il n'était pas le seul poète toscan à contribuer à ce
mouvement. À côté de lui, on mentionnera Guittone d'Arezzo
(1235-1294). Guido et Guittone furent les grands maîtres spirituels
de Dante qui développa son propre style vernaculaire. Comme
pour tant de poètes du Moyen Âge, nous détenons peu de documents
biographiques concernant Guido Guinizzelli. Nous savons qu'il est
issu d'une noble famille de Bologne, celle des Principi. Son père
était juriste et il lui fit étudier le droit. À partir de 1268, il
aurait exercé les fonctions de juge et de consultant juridique
dans sa ville natale. Guido, appartenant au camp des Gibelins
c'est-à-dire des partisans de l'Empereur contre ceux du Pape,
appuyait les Lambertazzi contre la faction guelfe des Geremei.
Lorsque celle-ci finit par triompher en 1274, Guido dut s'exiler à
Monselice, près de Padoue, avec sa femme, Bice della Fratta, et son
fils Guiduccio. C'est là qu'il mourut, à 46 ans. Tel était le
sort de bon nombre de lettrés italiens au cours du Moyen Âge, ce
qui n'avait vraiment rien d'exceptionnel puisque ce fut également le
destin du Dante de se voir exilé loin de sa Florence bien-aimée.
 Reste
l'œuvre poétique. Œuvre sans doute bien incomplète avec son mince
et original canzoniere
composé
de cinq chansons et quinze sonnets! Considéré aujourd'hui comme
archaïque, proche
des poètes siciliens plus que des Toscans, son Al
cor gentil rempaira sempre amore...
(«En noble cœur amour
se loge toujours...»)
le rapproche de la poésie occitane courtoise de la même époque. De
son temps, l'œuvre de Guido fut critiquée par Guittone d'Arezzo
pour ses comparaisons tirées de la nature et par Bonagiunta de
Lucques qui dénonçait chez Guido un excès d'intellectualisme et
l'usage de citations sacrées. Par contre, ces critiques lui
suscitèrent le ralliement des jeunes poètes toscans, et parmi eux,
Guido Cavalcanti et surtout Dante Alighieri. Ce fut de Guido que ce
dernier tira sa poésie amoureuse. Au cours d'un séjour à Bologne,
Dante y rencontra des philosophes venus du Danemark et disciples
d'Averroès qui le séduisirent par l'audace de leur doctrine. Il en
ramènera des textes averroïstes parmi lesquels se trouvaient des
poèmes de Guido Guinizzelli.
Reste
l'œuvre poétique. Œuvre sans doute bien incomplète avec son mince
et original canzoniere
composé
de cinq chansons et quinze sonnets! Considéré aujourd'hui comme
archaïque, proche
des poètes siciliens plus que des Toscans, son Al
cor gentil rempaira sempre amore...
(«En noble cœur amour
se loge toujours...»)
le rapproche de la poésie occitane courtoise de la même époque. De
son temps, l'œuvre de Guido fut critiquée par Guittone d'Arezzo
pour ses comparaisons tirées de la nature et par Bonagiunta de
Lucques qui dénonçait chez Guido un excès d'intellectualisme et
l'usage de citations sacrées. Par contre, ces critiques lui
suscitèrent le ralliement des jeunes poètes toscans, et parmi eux,
Guido Cavalcanti et surtout Dante Alighieri. Ce fut de Guido que ce
dernier tira sa poésie amoureuse. Au cours d'un séjour à Bologne,
Dante y rencontra des philosophes venus du Danemark et disciples
d'Averroès qui le séduisirent par l'audace de leur doctrine. Il en
ramènera des textes averroïstes parmi lesquels se trouvaient des
poèmes de Guido Guinizzelli.
 Guido
et Dante appartenaient à un même courant où l'on retrouvait
également Guido Cavalcanti (1258-1300) et Cino da Pistoia
(1270-1337). Tous ces poètes ont contribué à donner naissance par
le dialecte toscan à la langue italienne, dont La
Divine Comédie est
sans doute l'œuvre la plus achevée. Chez Guido Guinizzelli, on retrouve
l'emprunt des motifs de la vassalisation amoureuse propre à la
Cortezia; mais
aussi de l'amour vécue comme mort; de la Dame cruelle qui ne
répond pas à l'amour de son soupirant. Enfin, on y retrouve toute une
analyse du processus amoureux que reprendra Dante dans son récit de
Paolo et Francesca. Par ces thèmes, Guido substituait à la noblesse
de naissance la noblesse du cœur comme source de l'amour. C'était
sans doute une idéalisation qui convenait peu à la féodalité et
même à la bourgeoisie des villes italiennes qui, au mépris des
sentiments, scellait des alliances purement de classes.
Guido
et Dante appartenaient à un même courant où l'on retrouvait
également Guido Cavalcanti (1258-1300) et Cino da Pistoia
(1270-1337). Tous ces poètes ont contribué à donner naissance par
le dialecte toscan à la langue italienne, dont La
Divine Comédie est
sans doute l'œuvre la plus achevée. Chez Guido Guinizzelli, on retrouve
l'emprunt des motifs de la vassalisation amoureuse propre à la
Cortezia; mais
aussi de l'amour vécue comme mort; de la Dame cruelle qui ne
répond pas à l'amour de son soupirant. Enfin, on y retrouve toute une
analyse du processus amoureux que reprendra Dante dans son récit de
Paolo et Francesca. Par ces thèmes, Guido substituait à la noblesse
de naissance la noblesse du cœur comme source de l'amour. C'était
sans doute une idéalisation qui convenait peu à la féodalité et
même à la bourgeoisie des villes italiennes qui, au mépris des
sentiments, scellait des alliances purement de classes.
Afin de résister à la réaction cléricale qui voyait d'un mauvais œil l'amour courtois, les thèmes du dolce stil nuovo se sont teints de mysticisme, l'amour de la Dame étant présentée comme un reflet de la gloire de Dieu. C'est ainsi que Chrétien de Troyes (1130-±1185) détourna-t-il de son but l'amour pécheresse vers une forme sublimée chrétienne. Il faut dire que l'un des traits marquants de ces thématiques était d'exiger une mélodie formelle de la langue, une syntaxe cristalline qui écartait la prosodie précieuse. L'usage même d'une terminologie scolastique, sans doute élaborée et pas toujours accessible à la première lecture, fut source d'images appropriées à l'expression des sentiments humains.
Autant
dire que la poésie de Guido Guinizzelli correspondait à une
pré-renaissance dans la mesure où elle suivait les transformations
sociales du XIIIe siècle, lorsque le monde rural italien cédait devant
le  monde urbain. Un monde où s'annonçaient les expériences
violentes qui marqueront la conquête des marchés comme du
gouvernement des cités; où la sensualité des princes et des
banquiers s'illustreront par des œuvres sensuelles et grandioses,
Guido encourageait plutôt l'amour comme une preuve de la noblesse de
cœur des amants. À l'exemple de la Cortezia,
il
célébrait la vertu latente de l'amant se réalisant dans l'acte
d'amour. Plutôt que de sombrer dans la luxure, comme les damnés du
Purgatoire, l'acte amoureux devait contribuer à élever moralement les
amants. Des pratiques comme l'assag,
où
l'amant se soumettait aux pires tourments de la chair, couché nu
auprès de sa Dame sans la toucher, équivalaient aux plus grands
actes des combats de chevalerie. Cet idéal combattant de
l'esprit chevaleresque se portait à la défense de la pureté du
sentiment contre les assauts de la sensualité et de la concupiscence. La force de l'Amour est puissante et sème
l'inquiétude, voire l'effroi dans les cœurs. Parce qu'on ne peut
lui résister, l'idéal - mystique ou chevaleresque - parviendra à
la maîtriser. Voilà pourquoi Guido Guinizzelli est-il traité de
sage dans
La Divine Comédie;
la
vertu étant sauve, l'honneur
de
la dame respecté garantit la sincérité profonde du poète. C'est
déjà la gentilézza
de
Béatrice Portinari que le pèlerin de la Divine
Comédie va
bientôt rencontrer.
monde urbain. Un monde où s'annonçaient les expériences
violentes qui marqueront la conquête des marchés comme du
gouvernement des cités; où la sensualité des princes et des
banquiers s'illustreront par des œuvres sensuelles et grandioses,
Guido encourageait plutôt l'amour comme une preuve de la noblesse de
cœur des amants. À l'exemple de la Cortezia,
il
célébrait la vertu latente de l'amant se réalisant dans l'acte
d'amour. Plutôt que de sombrer dans la luxure, comme les damnés du
Purgatoire, l'acte amoureux devait contribuer à élever moralement les
amants. Des pratiques comme l'assag,
où
l'amant se soumettait aux pires tourments de la chair, couché nu
auprès de sa Dame sans la toucher, équivalaient aux plus grands
actes des combats de chevalerie. Cet idéal combattant de
l'esprit chevaleresque se portait à la défense de la pureté du
sentiment contre les assauts de la sensualité et de la concupiscence. La force de l'Amour est puissante et sème
l'inquiétude, voire l'effroi dans les cœurs. Parce qu'on ne peut
lui résister, l'idéal - mystique ou chevaleresque - parviendra à
la maîtriser. Voilà pourquoi Guido Guinizzelli est-il traité de
sage dans
La Divine Comédie;
la
vertu étant sauve, l'honneur
de
la dame respecté garantit la sincérité profonde du poète. C'est
déjà la gentilézza
de
Béatrice Portinari que le pèlerin de la Divine
Comédie va
bientôt rencontrer.
Il
ne faut donc pas s'étonner qu'à côté de Guido, Dante rencontre
Arnaut Daniel. Né à Ribérac vers  1150, Arnaut était un
authentique troubadour du Périgord. Lui aussi était considéré
comme un grand
maître d'amour, contribuant en tant que meilleur
forgeron du parler maternel à
asseoir le langage vernaculaire contre le latin sclérosé. Comme
Guido, il fut aussi auteur de poèmes érotiques qu'il échafaudât
sur une sextine, une forme où les six vers de chaque strophe se terminent par six rimes
disposées alternativement selon la combinaison 6-1-5-2-4-3. Le
septième et dernier couplet, composé de trois vers seulement,
devant comporter les six-mots-clés du poème.
1150, Arnaut était un
authentique troubadour du Périgord. Lui aussi était considéré
comme un grand
maître d'amour, contribuant en tant que meilleur
forgeron du parler maternel à
asseoir le langage vernaculaire contre le latin sclérosé. Comme
Guido, il fut aussi auteur de poèmes érotiques qu'il échafaudât
sur une sextine, une forme où les six vers de chaque strophe se terminent par six rimes
disposées alternativement selon la combinaison 6-1-5-2-4-3. Le
septième et dernier couplet, composé de trois vers seulement,
devant comporter les six-mots-clés du poème.
- Quand me soveni de la cambra
- Ont a mon dam sai que nulhs òm non intra
- Ans me son tots plus que fraire ni oncle,
- Non ai membre non fremisca, neis l'ongla
- Aicí com' fai l'enfant denant la verga
- Tal paur ai no'l siá tròp de l'arma
- Del cors li fos, non de l'arma
- E consentis m'a celat dins sa cambra !
- Que plus me nafra'l còr que còps de verga
- Car lo sieus sers lai ont ilh es non de intra
- Tots temps serai amb lieis com' carns e ongla
- E non creirai chastic d'amic ni d'oncle
- Arnaut trasmet sa chanson d'ongla e d'oncle
- A grat de lieis que de sa verga a l'arma,
- Son Desirat, qui pretz en cambra intra
- Traduction
-
.jpg) Quand je me souviens de la chambre
Quand je me souviens de la chambre
- Où à mon dam je sais que personne n’entre,
- Mais où tous sont pour moi plus sévères que frère ou oncle,
- Je n’ai membre qui ne frémisse, ni ongle,
- Ainsi que fait l’enfant devant la verge :
- Telle est ma peur que tout entière lui revienne mon âme.
- Puisse-t-elle mon corps, sinon mon âme,
- Recevoir en secret dans sa chambre !
- Cela blesse mon cœur plus que coups de verge,
- Car là où elle se trouve, son esclave point n’entre ;
- Je serai toujours avec elle comme sont chair et ongle,
- Et n’entendrai de remontrance ni d’ami, ni d’oncle.
- Arnaut envoie sa chanson d’ongle et d’oncle
- Au gré de celle qui tient sous la verge son âme,
- À sa Désirée, dont le Mérite en toute chambre entre. (Wikipedia)
Malgré tout, une question demeure. Si Guido Guinizzelli et Arnaut Daniel apparaissent aux yeux de Dante comme les chanteurs de la noblesse de cœur, que font-ils dans le cercle des luxurieux? Le poète donne d'ailleurs une image assez sereine de ces poètes. À bien lire, même s'il ne les nomme pas tous, ils étaient tous artisans du Dolce stil nuovo à se trouver dans cet ultime cercle et - pourquoi pas lui-même -, attendant de gravir la marche qui les sépare du Paradis? Alors qu'on s'attendrait à voir tant d'authentiques luxurieux se hisser à la reconnaissance du poète, comme on le voit dans les autres cercles des péchés capitaux, voici que ce sont des troubadours qui se manifestent :
«Tant me plaît votre courtoise demande, que je ne puis ni ne veux vous cacher mon nom.
Je suis Arnaud qui pleure et vais chantant, par ce brûlant chemin, la folie passée, et je vois devant moi le jour que j’espère.
Ores vous prie, par cette vaillance qui vous guide au sommet de l’escalier, de vous souvenir de ma douleur».
De quelle folie passée parlait Arnaut?
Sans
doute, ne le saurons-nous jamais. Qu'il soit avec les
sodomites nous indique quand même que peut-être la Dame dont il
évoquait la noblesse de cœur n'était peut-être pas une Dame?
La chose irait de même pour Guido Guinizzelli. Dante aurait sans
doute préféré les retrouver ailleurs, au Paradis. Mais il  n'ignorait pas que les désirs qui
motivaient cette poésie sublimée jusqu'à la mystique de la Dame ne
provenaient pas de la spiritualité chrétienne, mais de désirs
profondément charnels et que malgré les transformations opérées
par l'acte poétique, le résultat n'en était pas totalement purgé.
C'est toujours le désir physique, celui-là même qui contribuait à
la procréation comme le rappelait le Stace, qui persistait derrière
la sublimation. Et cette source, même si les troubadours avaient su
la tirer de l'Enfer, persistait tout de même au Purgatoire. Parmi toutes les hypothèses qui
pèsent sur les origines de la Cortezia, il en est une qui
s'est formulée qu'assez récemment et qui supposerait que derrière
la Dame résiderait plutôt un homme : un seigneur, un châtelain, un
croisé, un capitaine, voire même un Infidèle, un Sarrazin! S'il y
a moindrement quelque chose de vrai derrière cette hypothèse, on
conçoit la difficulté qu'il y ait eu à exprimer cette passion
dévorante qui animait la poésie courtoise et jusqu'au dolce stil
nuovo!
n'ignorait pas que les désirs qui
motivaient cette poésie sublimée jusqu'à la mystique de la Dame ne
provenaient pas de la spiritualité chrétienne, mais de désirs
profondément charnels et que malgré les transformations opérées
par l'acte poétique, le résultat n'en était pas totalement purgé.
C'est toujours le désir physique, celui-là même qui contribuait à
la procréation comme le rappelait le Stace, qui persistait derrière
la sublimation. Et cette source, même si les troubadours avaient su
la tirer de l'Enfer, persistait tout de même au Purgatoire. Parmi toutes les hypothèses qui
pèsent sur les origines de la Cortezia, il en est une qui
s'est formulée qu'assez récemment et qui supposerait que derrière
la Dame résiderait plutôt un homme : un seigneur, un châtelain, un
croisé, un capitaine, voire même un Infidèle, un Sarrazin! S'il y
a moindrement quelque chose de vrai derrière cette hypothèse, on
conçoit la difficulté qu'il y ait eu à exprimer cette passion
dévorante qui animait la poésie courtoise et jusqu'au dolce stil
nuovo!
La chose ne saurait être rejeté du revers de la main considérant la séparation radicale des sexes durant le Moyen Âge occidental. Troubadours et belles dames avaient peu l'occasion de se fréquenter, même en public. On n'imagine pas les porteuses de fiefs et de dots se balader à leur guise avec des errants, des saltimbanques, voire même des chevaliers! Pour autant, comment inventer des vertus à des Dames sinon que parce que les poètes ne les connaissaient pas et que c'était aux fruits de leur imagination qu'ils dédiaient leurs vers.
Ces troubadours qui accompagnaient
les croisés ou les pèlerins produisaient sans doute des
œuvres qui  contribuaient à faire rêver les cortèges qui
sillonnaient l'Europe et le Proche-Orient. Et lorsque ces poètes ne
chantaient pas la Dame, de quoi, ou de qui pouvaient-ils bien parler? Des
combattants. Des guerriers, des chefs de troupes, des adversaires. À
la noblesse de corps de la féodalité, il y avait aussi une autre
noblesse de cœur : celle de Roland à Roncevaux ou des chevaliers de
la Table Ronde qui affrontaient des forces surnaturellex; des
souvenirs d'Alexandre le Grand ou de Charlemagne qui hantaient les
imaginations guerrières. Tous ces thèmes se rejoignaient,
s'échangeaient, se complétaient dans la marche des cavaliers et des troupiers partis
reconquérir Jérusalem sur les disciples de Mahomet. Que pouvait-il
bien en rester au retour?
contribuaient à faire rêver les cortèges qui
sillonnaient l'Europe et le Proche-Orient. Et lorsque ces poètes ne
chantaient pas la Dame, de quoi, ou de qui pouvaient-ils bien parler? Des
combattants. Des guerriers, des chefs de troupes, des adversaires. À
la noblesse de corps de la féodalité, il y avait aussi une autre
noblesse de cœur : celle de Roland à Roncevaux ou des chevaliers de
la Table Ronde qui affrontaient des forces surnaturellex; des
souvenirs d'Alexandre le Grand ou de Charlemagne qui hantaient les
imaginations guerrières. Tous ces thèmes se rejoignaient,
s'échangeaient, se complétaient dans la marche des cavaliers et des troupiers partis
reconquérir Jérusalem sur les disciples de Mahomet. Que pouvait-il
bien en rester au retour?
La question qui se pose maintenant
est celle-ci : pourquoi Dante place-t-il la sodomie (qui désignait
alors toutes relations homosexuelles) en tête de la luxure au point
de la réduire à cette seule pratique?  Comme le rappelle l'historien
américain John Boswell : «À partir du XIVe siècle, l'Europe
occidentale céda à une haine farouche et obsessionnelle de
l'homosexualité, conçue comme le plus effroyable des péchés. Les
raisons n'en ont jamais été correctement exposées, mais Dante
(1265-1321) nous offre une excellente illustration de cette
évolution. Dressant la carte détaillée des châtiments
eschatologiques de son temps, il rangea les sodomites dans le cercle
le plus élevé du Purgatoire ("Purgatoire", chant
26) - juste devant les portes du Paradis -, en compagnie des
individus coupables d'une passion hétérosexuelle "exagérée"
: c'est-à-dire proches du salut et bien au-dessus de la majorité
des pécheurs peuplant les terrasses du Purgatoire, ainsi que de tous
les êtres humains tourmentés dans l'Enfer. Pourtant, de son vivant
même ou juste après la mort de Dante, de nombreux États italiens
adoptèrent une législation punissant sévèrement les actes
homosexuels. La position du poète était théologiquement correcte,
mais l'hostilité viscérale contre la passion érotique homosexuelle
était déjà très marquée dans l'ensemble de la population».6
Sa vision n'était donc pas originale puisque, «à la fin du
XIIe siècle, un moine eut une vision des malheureuses âmes expiant
leur comportement homosexuel au Purgatoire. Il fut fort étonné d'y
découvrir un grand nombre de femmes».7
Comme le rappelle l'historien
américain John Boswell : «À partir du XIVe siècle, l'Europe
occidentale céda à une haine farouche et obsessionnelle de
l'homosexualité, conçue comme le plus effroyable des péchés. Les
raisons n'en ont jamais été correctement exposées, mais Dante
(1265-1321) nous offre une excellente illustration de cette
évolution. Dressant la carte détaillée des châtiments
eschatologiques de son temps, il rangea les sodomites dans le cercle
le plus élevé du Purgatoire ("Purgatoire", chant
26) - juste devant les portes du Paradis -, en compagnie des
individus coupables d'une passion hétérosexuelle "exagérée"
: c'est-à-dire proches du salut et bien au-dessus de la majorité
des pécheurs peuplant les terrasses du Purgatoire, ainsi que de tous
les êtres humains tourmentés dans l'Enfer. Pourtant, de son vivant
même ou juste après la mort de Dante, de nombreux États italiens
adoptèrent une législation punissant sévèrement les actes
homosexuels. La position du poète était théologiquement correcte,
mais l'hostilité viscérale contre la passion érotique homosexuelle
était déjà très marquée dans l'ensemble de la population».6
Sa vision n'était donc pas originale puisque, «à la fin du
XIIe siècle, un moine eut une vision des malheureuses âmes expiant
leur comportement homosexuel au Purgatoire. Il fut fort étonné d'y
découvrir un grand nombre de femmes».7
Pourtant, Dante avait déjà placé
des sodomites en Enfer (chants 14-16), alors comment et pourquoi les
retrouve-t-on à nouveau au Purgatoire, et dans le cercle placé le plus près
de l'accès au Paradis? La  réponse se trouverait-elle dans ces
unions homosexuelles que Boswell retrace depuis la
Haute-Antiquité jusqu'à leur effacement à partir du XIIIe siècle?
Car le mariage homosexuel n'est pas une invention récente. Il
existait depuis aussi longtemps que les mariages hétérosexuels. La
difficulté provient sans doute que les termes hétéro et
homosexuel ne se concevaient pas avant la toute fin du XIXe siècle,
même si les unions entre un homme et une femme et les unions entre
deux hommes se pratiquaient couramment sur une échelle comparable.
«Le mariage est (pour le meilleur ou pour le pire, en fonction de
leur point de vue) un phénomène hétérosexuel par essence».8
Il s'accomplit dans le but ultime de la procréation. C'est ainsi que
nous le comprenons encore dans l'Occident moderne, mais il en a pas
toujours été le cas.
réponse se trouverait-elle dans ces
unions homosexuelles que Boswell retrace depuis la
Haute-Antiquité jusqu'à leur effacement à partir du XIIIe siècle?
Car le mariage homosexuel n'est pas une invention récente. Il
existait depuis aussi longtemps que les mariages hétérosexuels. La
difficulté provient sans doute que les termes hétéro et
homosexuel ne se concevaient pas avant la toute fin du XIXe siècle,
même si les unions entre un homme et une femme et les unions entre
deux hommes se pratiquaient couramment sur une échelle comparable.
«Le mariage est (pour le meilleur ou pour le pire, en fonction de
leur point de vue) un phénomène hétérosexuel par essence».8
Il s'accomplit dans le but ultime de la procréation. C'est ainsi que
nous le comprenons encore dans l'Occident moderne, mais il en a pas
toujours été le cas.
 |
| John Boswell (1947-1994) |
Les jugements portés par les anthropologues, les spécialistes du droit antique ou les historiens sur ces unions de gens du même sexe se sont toujours révélés négatifs. Bien que la terminologie utilisée par les rédacteurs des codes de lois visait l'attraction sexuelle que contenaient ces unions, ils ont préféré juger tendancieusement ou carrément détourner le sens des contrats, des serments et des célébrations rituelles de ces unions. Boswell rappelle d'ailleurs «que les êtres humains sont rarement certains de la nature exacte de leurs sentiments. Cette ambiguïté a été abondamment traitée par la culture populaire occidentale, en même temps que le thème réaliste de l'inconstance : les sentiments les plus forts et les plus stables en apparence ne sont pas à l'abri de volte-face soudaines et imprévisibles».9 Aussi trouvons-nous dans le cours de ces unions des séparations, des divorces, des mesures d'adoption, les symboles et les signifiances que nous retrouvons habituellement dans les mariages de couples hétérosexuels.
 Le tribun athénien Démosthène
(384-322 av. J.-C.), dans le Contre Nearea, déclarait :
«Voilà ce qu'être marié veut dire : avoir des fils que l'on
puisse présenter à sa famille et aux voisins, et avoir des filles à
soi que l'on puisse donner à des maris. Car nous avons des
courtisanes pour le plaisir, des concubines pour satisfaire nos
besoins physiques quotidiens et des épouses pour porter nos enfants
légitimes et pour être les fidèles gardiennes de nos foyers».10
Foin de questions sexuelles dans le mariage! Dion Cassius (155-235
apr. J.-C.), cinq siècles plus tard, renchérissait : «Car
qu'existe-t-il de mieux qu'une épouse chaste, femme d'intérieur,
bonne ménagère et qui élève les enfants; une épouse pour te
réjouir quand tu es bien portant, te soigner quand tu es malade,
s'associer à ton bonheur, te réconforter dans le malheur; pour
refréner la folle passion de la jeunesse et adoucir les rigueurs
inopportunes de la vieillesse? Et n'est-il pas délicieux de
reconnaître un enfant qui partage les dons de ses deux parents?».11
Autant dire que l'usage de l'épouse chaste visait à apaiser
les tourments de la sexualité qui hantent généralement le jeune
âge!
Le tribun athénien Démosthène
(384-322 av. J.-C.), dans le Contre Nearea, déclarait :
«Voilà ce qu'être marié veut dire : avoir des fils que l'on
puisse présenter à sa famille et aux voisins, et avoir des filles à
soi que l'on puisse donner à des maris. Car nous avons des
courtisanes pour le plaisir, des concubines pour satisfaire nos
besoins physiques quotidiens et des épouses pour porter nos enfants
légitimes et pour être les fidèles gardiennes de nos foyers».10
Foin de questions sexuelles dans le mariage! Dion Cassius (155-235
apr. J.-C.), cinq siècles plus tard, renchérissait : «Car
qu'existe-t-il de mieux qu'une épouse chaste, femme d'intérieur,
bonne ménagère et qui élève les enfants; une épouse pour te
réjouir quand tu es bien portant, te soigner quand tu es malade,
s'associer à ton bonheur, te réconforter dans le malheur; pour
refréner la folle passion de la jeunesse et adoucir les rigueurs
inopportunes de la vieillesse? Et n'est-il pas délicieux de
reconnaître un enfant qui partage les dons de ses deux parents?».11
Autant dire que l'usage de l'épouse chaste visait à apaiser
les tourments de la sexualité qui hantent généralement le jeune
âge!
 Dion Cassius écrivait à une
époque où se développait déjà une première répression sexuelle
depuis les lois restrictives formulées par l'empereur Auguste
(1er siècle de notre ère). C'est alors que triomphait
«le modèle de mariage hétérosexuel le plus courant dans toutes
les sociétés méditerranéennes (et l'unique forme légale à
Athènes et à Rome) était la monogamie : un couple formé d'un homme
et d'une femme. Ces unions n'étaient souvent accessibles
officiellement qu'aux classes possédantes, mais les relations
monogamiques permanentes que nouaient des membres des classes
inférieures étaient, semble-t-il, considérées tout à fait
analogues».12
- «Dans la mesure où les Romains ne lui demandaient pas de
satisfaire leurs besoins érotiques, le dévouement et le bonheur
conjugaux ne dépendaient pas (et ne révélaient pas) de tendances
sexuelles particulières (comme cela pourrait être le cas dans les
sociétés modernes, où le choix d'un conjoint est essentiellement
dicté par des considérations de satisfaction sentimentale et
sexuelle); être amoureux d'une autre personne que son épouse
n'avait évidemment pas la même signification pour un Romain que
cela en aurait pour un Américain».13
On comprend l'inquiétante étrangeté que les unions du même
sexe peuvent susciter chez les
lecteurs actuels.
Dion Cassius écrivait à une
époque où se développait déjà une première répression sexuelle
depuis les lois restrictives formulées par l'empereur Auguste
(1er siècle de notre ère). C'est alors que triomphait
«le modèle de mariage hétérosexuel le plus courant dans toutes
les sociétés méditerranéennes (et l'unique forme légale à
Athènes et à Rome) était la monogamie : un couple formé d'un homme
et d'une femme. Ces unions n'étaient souvent accessibles
officiellement qu'aux classes possédantes, mais les relations
monogamiques permanentes que nouaient des membres des classes
inférieures étaient, semble-t-il, considérées tout à fait
analogues».12
- «Dans la mesure où les Romains ne lui demandaient pas de
satisfaire leurs besoins érotiques, le dévouement et le bonheur
conjugaux ne dépendaient pas (et ne révélaient pas) de tendances
sexuelles particulières (comme cela pourrait être le cas dans les
sociétés modernes, où le choix d'un conjoint est essentiellement
dicté par des considérations de satisfaction sentimentale et
sexuelle); être amoureux d'une autre personne que son épouse
n'avait évidemment pas la même signification pour un Romain que
cela en aurait pour un Américain».13
On comprend l'inquiétante étrangeté que les unions du même
sexe peuvent susciter chez les
lecteurs actuels.
Cette étrangeté résiderait dans le fait qu'alors, «beaucoup espéraient que l'amour naîtrait du mariage (et non pas le provoquerait»,14 ce qui est le cas de nos sociétés modernes. Cette espérance que l'amour naîtrait de la cohabitation des ménages s'est perpétuée, surtout dans les milieux populaires, jusque tard au XXe siècle. «Et si le mariage était censé satisfaire les besoins sexuels, ce n'était pas parce qu'on avait choisi un(e) partenaire qui correspondait exactement à ses goûts en la matière, mais parce que les époux tenaient compte de leurs désisrs respectifs et limitaient volontairement le champ de leur sexualité au mariage. Avant le Bas-Empire, les époux véritablement "amoureux" l'un de l'autre étaient considérés comme exceptionnels et même comme une bizarrerie».15 Ce qui torpille nos représentations romanesques des amours passées.
 Le sexe, le désir et le plaisir ne
définissaient donc pas les unions matrimoniales romaines.
«L'expression classique du droit romain déclare que "c'est
le consentement et non l'union sexuelle qui fait le mariage"
("nuptias non concubitus sed consensus facit") [...]
Ce qui compte d'abord, c'est le consentement de toutes les
parties intéressées dans ce mariage - c'est-à-dire non seulement
celui des futurs époux, mais aussi celui de leurs tuteurs légaux
[...]. Et, chose peut-être plus importante à nos yeux, le
"consentement" de la fiancée est présumé tant
qu'elle ne protesta pas officiellement, ce qui lui aurait été fort
difficile et ne constituait de véritable obstacle que si l'on
pouvait prouver que le fiancé était "indigne" ou "abject"
- autrement dit, le mariage ne dépendait pas simplement de
ses vœux ou de ses préférences».16
Le consentement concernait moins les partenaires que les intérêts
familiaux dans la conclusion du contrat de mariage.
Le sexe, le désir et le plaisir ne
définissaient donc pas les unions matrimoniales romaines.
«L'expression classique du droit romain déclare que "c'est
le consentement et non l'union sexuelle qui fait le mariage"
("nuptias non concubitus sed consensus facit") [...]
Ce qui compte d'abord, c'est le consentement de toutes les
parties intéressées dans ce mariage - c'est-à-dire non seulement
celui des futurs époux, mais aussi celui de leurs tuteurs légaux
[...]. Et, chose peut-être plus importante à nos yeux, le
"consentement" de la fiancée est présumé tant
qu'elle ne protesta pas officiellement, ce qui lui aurait été fort
difficile et ne constituait de véritable obstacle que si l'on
pouvait prouver que le fiancé était "indigne" ou "abject"
- autrement dit, le mariage ne dépendait pas simplement de
ses vœux ou de ses préférences».16
Le consentement concernait moins les partenaires que les intérêts
familiaux dans la conclusion du contrat de mariage.
Il en allait des unions de même
sexe que des unions hétérosexuelles. Depuis l'époque de la Grèce
archaïque (celle d'Homère), Boswell retient trois  types d'unions en
bonne et due forme. La première nous est relatée par le géographe Strabon (60 av. J.-C-20 apr. J.-C.) qui rapporte une cérémonie
d'enlèvement rituel établissant une relation légale entre amants
de sexe masculin, la fameuse cryptie crétoise. Dans le récit
de Strabon, «hormis l'enlèvement lui-même, nous retrouvons ici
tous les éléments de la tradition européenne du mariage : témoins,
cadeaux, sacrifice religieux, banquet public, coupe, changement
rituel de costume pour l'un des partenaires, changement de position
sociale pour les deux, et jusqu'au voyage de noces. La déclaration
publique au cours du banquet préfigure ce qui allait devenir
l'élément essentiel du mariage dans le droit romain et chrétien :
une déclaration de consentement à l'union (Cf. la formule moderne :
"Acceptez-vous de prendre...?")».17
On ne doit toutefois pas écarter le fait que l'enlèvement d'un
éromène - jeune homme à la limite de la puberté - par un
éraste - homme adulte, souvent invité par le père même du
plus jeune à opérer l'enlèvement -, était doublé d'un rite
initiatique de la chasse et de la guerre, occupations essentielles
des nobles grecs.
types d'unions en
bonne et due forme. La première nous est relatée par le géographe Strabon (60 av. J.-C-20 apr. J.-C.) qui rapporte une cérémonie
d'enlèvement rituel établissant une relation légale entre amants
de sexe masculin, la fameuse cryptie crétoise. Dans le récit
de Strabon, «hormis l'enlèvement lui-même, nous retrouvons ici
tous les éléments de la tradition européenne du mariage : témoins,
cadeaux, sacrifice religieux, banquet public, coupe, changement
rituel de costume pour l'un des partenaires, changement de position
sociale pour les deux, et jusqu'au voyage de noces. La déclaration
publique au cours du banquet préfigure ce qui allait devenir
l'élément essentiel du mariage dans le droit romain et chrétien :
une déclaration de consentement à l'union (Cf. la formule moderne :
"Acceptez-vous de prendre...?")».17
On ne doit toutefois pas écarter le fait que l'enlèvement d'un
éromène - jeune homme à la limite de la puberté - par un
éraste - homme adulte, souvent invité par le père même du
plus jeune à opérer l'enlèvement -, était doublé d'un rite
initiatique de la chasse et de la guerre, occupations essentielles
des nobles grecs.
Le second type d'union provient de
la description d'une cérémonie que Lucien de Samosate, célèbre
voyageur du IIe siècle de notre ère, donnait des Scythes
qui occupaient le littoral nord de la mer Noire  (Crimée actuelle).
Dans un dialogue avec un Grec, le Scythe prétend : «Nous
considérons comme bienvenu dans l'amitié la même chose que vous, à
propos du mariage - faire une longue cour et tout ce genre de choses
afin d'être assuré de conquérir l'ami et de ne pas être repoussé.
Et quand un ami a été préféré à tous les autres, on dresse des
contrats à cette fin et on s'engage par serment solennel à vivre
ensemble, et à mourir, s'il le faut, l'un pour l'autre, ce que nous
faisons. À partir du moment où nous nous sommes tous deux entaillé
le doigt et avons laissé le sang couler dans une coupe, où nous y
avons plongé la pointe de nos glaives et y avons bu l'un et l'autre,
rien ne pourrait défaire ce qui nous lie. Il n'est pas permis de
conclure de tels contrats plus de trois fois, car un homme qui aurait
de nombreuses relations de ce genre nous fera le même effet qu'une
femme dissolue et adultère, et nous ne considérerions pas que son
dévouement fût aussi fort s'il était partagé entre plusieurs
affections».18
Le rite, ici, doublé du serment de sang, partageait avec le mariage
hétérosexuel l'usage d'une coupe à boire très répandu dans la
Méditerranée antique, tandis que «l'absorption du sang d'autrui
(au sens propre ou figuré) est au cœur de nombreuses cérémonies
méditerranéennes dotées de significations très diverses, parmi
lesquelles l'Eucharistie chrétienne».19
(Crimée actuelle).
Dans un dialogue avec un Grec, le Scythe prétend : «Nous
considérons comme bienvenu dans l'amitié la même chose que vous, à
propos du mariage - faire une longue cour et tout ce genre de choses
afin d'être assuré de conquérir l'ami et de ne pas être repoussé.
Et quand un ami a été préféré à tous les autres, on dresse des
contrats à cette fin et on s'engage par serment solennel à vivre
ensemble, et à mourir, s'il le faut, l'un pour l'autre, ce que nous
faisons. À partir du moment où nous nous sommes tous deux entaillé
le doigt et avons laissé le sang couler dans une coupe, où nous y
avons plongé la pointe de nos glaives et y avons bu l'un et l'autre,
rien ne pourrait défaire ce qui nous lie. Il n'est pas permis de
conclure de tels contrats plus de trois fois, car un homme qui aurait
de nombreuses relations de ce genre nous fera le même effet qu'une
femme dissolue et adultère, et nous ne considérerions pas que son
dévouement fût aussi fort s'il était partagé entre plusieurs
affections».18
Le rite, ici, doublé du serment de sang, partageait avec le mariage
hétérosexuel l'usage d'une coupe à boire très répandu dans la
Méditerranée antique, tandis que «l'absorption du sang d'autrui
(au sens propre ou figuré) est au cœur de nombreuses cérémonies
méditerranéennes dotées de significations très diverses, parmi
lesquelles l'Eucharistie chrétienne».19
Un troisième type d'union
homosexuelle «mettait en jeu la pratique juridique de l'"adoption
collatérale" : un homme en adoptait un autre comme frère, soit
de facto (comme dans le Satyricon de Pétrone) soit
officiellement, d'une manière ou d'une autre».20
L'adoptio était un rite fréquent dans la  Rome antique : «Au
début de l'Empire, des hommes commencèrent à prendre des frères
adoptifs (et non plus des fils), qui devenaient ainsi leurs
héritiers mais non leurs enfants. Il suffisait pour ce faire d'une
déclaration devant témoins - aucune autre subtilité juridique
n'était requise (Notez la similitude avec le mariage hétérosexuel
romain.) "Nul ne doute, écrivait le juriste Julius Paulus [dans
le contexte spécifique de l'adoption fraternelle], que quelqu'un
puisse être correctement désigné comme héritier de la sorte :
"Que cet homme soit mon héritier", pourvu que la personne
ainsi désignée soit présente". L'adopté jouissait ainsi d'un
droit sur les biens et sur la succession de celui qui l'avait pris
pour frère - d'un droit plus important même que celui d'un frère
biologique, car il y avait généralement, en l'occurrence, plusieurs
héritiers -, et les deux personnes concernées nouaient ainsi une
relation légale; cependant, le frère adoptif ne se plaçait pas
sous l'autorité ni sous la tutelle de celui qui l'adoptait, et ne
changeait probablement ni de nom ni de statut».21 La dimension contractuelle et
légale de l'adoption la faisait la plus ressembler au mariage
hétérosexuel, quoique les deux partenaires conservassent une
autonomie dont ne jouissait pas l'épouse. «Dans la mesure où
l'expression "adopter un frère" désignait spécifiquement
sous l'Empire l'instauration d'une relation avec un amant homosexuel
et où les hommes de ce temps considéraient le mariage hétérosexuel
comme une sorte d'adoption collatérale - l'épouse devenant, par
essence, une sœur -, il paraît évident que ces adoptions étaient
considérées comme un moyen d'ancrer juridiquement des unions
homosexuelles».22
La nature essentiellement sexuelle de l'adoption fraternelle
distinguait également du mariage hétérosexuel où les aspects
affectif et sexuel étaient secondaires.
Rome antique : «Au
début de l'Empire, des hommes commencèrent à prendre des frères
adoptifs (et non plus des fils), qui devenaient ainsi leurs
héritiers mais non leurs enfants. Il suffisait pour ce faire d'une
déclaration devant témoins - aucune autre subtilité juridique
n'était requise (Notez la similitude avec le mariage hétérosexuel
romain.) "Nul ne doute, écrivait le juriste Julius Paulus [dans
le contexte spécifique de l'adoption fraternelle], que quelqu'un
puisse être correctement désigné comme héritier de la sorte :
"Que cet homme soit mon héritier", pourvu que la personne
ainsi désignée soit présente". L'adopté jouissait ainsi d'un
droit sur les biens et sur la succession de celui qui l'avait pris
pour frère - d'un droit plus important même que celui d'un frère
biologique, car il y avait généralement, en l'occurrence, plusieurs
héritiers -, et les deux personnes concernées nouaient ainsi une
relation légale; cependant, le frère adoptif ne se plaçait pas
sous l'autorité ni sous la tutelle de celui qui l'adoptait, et ne
changeait probablement ni de nom ni de statut».21 La dimension contractuelle et
légale de l'adoption la faisait la plus ressembler au mariage
hétérosexuel, quoique les deux partenaires conservassent une
autonomie dont ne jouissait pas l'épouse. «Dans la mesure où
l'expression "adopter un frère" désignait spécifiquement
sous l'Empire l'instauration d'une relation avec un amant homosexuel
et où les hommes de ce temps considéraient le mariage hétérosexuel
comme une sorte d'adoption collatérale - l'épouse devenant, par
essence, une sœur -, il paraît évident que ces adoptions étaient
considérées comme un moyen d'ancrer juridiquement des unions
homosexuelles».22
La nature essentiellement sexuelle de l'adoption fraternelle
distinguait également du mariage hétérosexuel où les aspects
affectif et sexuel étaient secondaires.
Le passage au christianisme
ne changea pas grand chose dans la mesure où le rituel
matrimonial ne s'adapta que progressivement aux exigences de la nouvelle religion, qui ne reconnut la sacralité du mariage que très
tardivement - ce n'est qu'en 1215, au IVe concile du
Latran tenu sous Innocent III, que le mariage devint l'un des sept
sacrements -; entre temps, les rites d'enlèvement et d'échange des
sangs se 
On conçoit assez facilement la
confusion qui se dégage de ces usages ambiguës entre frère et
amant : «Avec le temps, l'association entre "sœur"
et "épouse" déteignit également sur ces accommodements,
et  ces femmes prirent le nom d'"aimées" ou de "sœurs".
Bien que cette dernière appellation ait probablement joué de
l'ambiguïté de ce terme à double sens, un sens chaste, charitable,
auquel songeaient les chrétiens lorsqu'ils s'appelaient frères et
sœurs, et un sens érotique, conjugal - dans la mesure où ces
arrangements étaient parfois considérés comme des "mariages
spirituels" -, l'emploi de "sœur" dans ce contexte
marquait clairement la désapprobation et donnait à entendre que
toute implication conjugale n'était pas absente"».24
Cette confusion allait jusqu'à brouiller la compréhension même des
textes évangéliques, surtout dans les relations entre Jésus et ses
disciples. Ainsi, que penser du couple formé par Jésus et Jean, son
disciple bien-aimé? Sur ce point, Boswell soulève un
doute choquant pour la plupart des chrétiens : «L'art et la
littérature des époques ultérieures [surtout au Haut Moyen
Âge] ont souvent représenté leurs relations comme intimes,
sinon comme érotiques. Jean se désigne lui-même par six fois comme
"le disciple que le Christ aimait", ce qui incite à se
demander si, du point de vue de Jean, Jésus n'"aimait" pas
les autres apôtres. En tout état de cause, il voulait probablement
dire que Jésus lui vouait une affection particulière. Ce
lien privilégié est confirmé par le fait que Jésus mourant
demanda à Jean de veiller sur sa mère, une situation qui n'est pas
sans rappeler ce qui se passait dans le cas où l'une des parties
d'un couple marié mourait avant l'autre. (Elle suggère aussi,
implicitement, que Jésus et Jean étaient "frères" -
puisqu'ils en vinrent à partager la même mère - en un sens qui
allait au-delà de la "fraternité" liant tous les apôtres
et tous les chrétiens)».25
On comprend qu'une telle interprétation soit loin de faire
l'unanimité parmi les exégètes!
ces femmes prirent le nom d'"aimées" ou de "sœurs".
Bien que cette dernière appellation ait probablement joué de
l'ambiguïté de ce terme à double sens, un sens chaste, charitable,
auquel songeaient les chrétiens lorsqu'ils s'appelaient frères et
sœurs, et un sens érotique, conjugal - dans la mesure où ces
arrangements étaient parfois considérés comme des "mariages
spirituels" -, l'emploi de "sœur" dans ce contexte
marquait clairement la désapprobation et donnait à entendre que
toute implication conjugale n'était pas absente"».24
Cette confusion allait jusqu'à brouiller la compréhension même des
textes évangéliques, surtout dans les relations entre Jésus et ses
disciples. Ainsi, que penser du couple formé par Jésus et Jean, son
disciple bien-aimé? Sur ce point, Boswell soulève un
doute choquant pour la plupart des chrétiens : «L'art et la
littérature des époques ultérieures [surtout au Haut Moyen
Âge] ont souvent représenté leurs relations comme intimes,
sinon comme érotiques. Jean se désigne lui-même par six fois comme
"le disciple que le Christ aimait", ce qui incite à se
demander si, du point de vue de Jean, Jésus n'"aimait" pas
les autres apôtres. En tout état de cause, il voulait probablement
dire que Jésus lui vouait une affection particulière. Ce
lien privilégié est confirmé par le fait que Jésus mourant
demanda à Jean de veiller sur sa mère, une situation qui n'est pas
sans rappeler ce qui se passait dans le cas où l'une des parties
d'un couple marié mourait avant l'autre. (Elle suggère aussi,
implicitement, que Jésus et Jean étaient "frères" -
puisqu'ils en vinrent à partager la même mère - en un sens qui
allait au-delà de la "fraternité" liant tous les apôtres
et tous les chrétiens)».25
On comprend qu'une telle interprétation soit loin de faire
l'unanimité parmi les exégètes!
 L'instauration du christianisme ne
détourna pas les rites traditionnels d'union de même sexe. Cette
pratique s'illustrant surtout dans le monde des officiers
militaires, elle perpétuait le souvenir du Bataillon sacré de
Thèbes. Dans le martyrologue, on vit apparaître des couples unis
étroitement et de même sexe. Boswell retient le récit du martyre
des saintes romaines Perpétue et Félicité (martyres à Carthage en
203); ceux de Polyeucte et de Néarque (259), mais surtout de Serge et de Bacchus martyrisés sous l'ordre d'Antiochus en Syrie (300). Bacchus est d'abord condamné au fouet à mort
jusqu'à épuisement de ses bourreaux : «...le bienheureux Serge,
profondément affligé et chagriné par la perte de Bacchus, pleurait
et se lamentait : "Frère, compagnon d'armes, plus jamais nous
ne chanterons ensemble 'Voyez comme il est bon et comme il est
agréable que des frères demeurent, ne faisant qu'un!' Tu as été
détaché de moi et tu es monté aux cieux, me laissant seul sur
terre, désormais solitaire, sans réconfort". Après qu'il eut
prononcé ces mots, la même nuit, le bienheureux Bacchus apparut
soudain devant lui, le visage radieux comme celui d'un ange, vêtu
d'un uniforme d'officier et il lui parla : "Pourquoi te
chagriner, pourquoi pleurer mon frère? si mon corps t'a été
enlevé, je reste auprès de toi dans le lien de l'union, chantant et
récitant : 'Je suivrai la voie de tes commandements, lorsque tu
dilateras mon cœur'. Hâte-toi donc, frère, par une
L'instauration du christianisme ne
détourna pas les rites traditionnels d'union de même sexe. Cette
pratique s'illustrant surtout dans le monde des officiers
militaires, elle perpétuait le souvenir du Bataillon sacré de
Thèbes. Dans le martyrologue, on vit apparaître des couples unis
étroitement et de même sexe. Boswell retient le récit du martyre
des saintes romaines Perpétue et Félicité (martyres à Carthage en
203); ceux de Polyeucte et de Néarque (259), mais surtout de Serge et de Bacchus martyrisés sous l'ordre d'Antiochus en Syrie (300). Bacchus est d'abord condamné au fouet à mort
jusqu'à épuisement de ses bourreaux : «...le bienheureux Serge,
profondément affligé et chagriné par la perte de Bacchus, pleurait
et se lamentait : "Frère, compagnon d'armes, plus jamais nous
ne chanterons ensemble 'Voyez comme il est bon et comme il est
agréable que des frères demeurent, ne faisant qu'un!' Tu as été
détaché de moi et tu es monté aux cieux, me laissant seul sur
terre, désormais solitaire, sans réconfort". Après qu'il eut
prononcé ces mots, la même nuit, le bienheureux Bacchus apparut
soudain devant lui, le visage radieux comme celui d'un ange, vêtu
d'un uniforme d'officier et il lui parla : "Pourquoi te
chagriner, pourquoi pleurer mon frère? si mon corps t'a été
enlevé, je reste auprès de toi dans le lien de l'union, chantant et
récitant : 'Je suivrai la voie de tes commandements, lorsque tu
dilateras mon cœur'. Hâte-toi donc, frère, par une  confession
entière et parfaite de me chercher et de m'obtenir, lorsque tu auras
achevé ta course. Car pour moi, la couronne de la justice est d'être
avec toi"».26
Et Boswell de souligner l'incongruité de
«la promesse de Bacchus, disant à Serge que, s'il suivait son
exemple, le Seigneur lui accorderait en récompense non pas la vision
béatifique, non pas les joies du Paradis ni même la palme du
martyre, mais Bacchus en personne, cette promesse était pour le
moins remarquable selon les critères de l'Église primitive. Elle
accordait en effet à l'affection humaine une priorité sans
parallèle au cours du premier millénaire du christianisme. Ajoutons
que Serge et Bacchus n'étaient pas des frères biologiques - et
personne n'a jamais prétendu qu'ils l'étaient -, si bien que le
terme "frère" doit être entendu comme le reflet de
l'usage antique des subcultures érotiques ou de l'usage biblique
(particulièrement dans les versions grecques). En tout état de
cause, il possédait de fortes connotations érotiques».27
confession
entière et parfaite de me chercher et de m'obtenir, lorsque tu auras
achevé ta course. Car pour moi, la couronne de la justice est d'être
avec toi"».26
Et Boswell de souligner l'incongruité de
«la promesse de Bacchus, disant à Serge que, s'il suivait son
exemple, le Seigneur lui accorderait en récompense non pas la vision
béatifique, non pas les joies du Paradis ni même la palme du
martyre, mais Bacchus en personne, cette promesse était pour le
moins remarquable selon les critères de l'Église primitive. Elle
accordait en effet à l'affection humaine une priorité sans
parallèle au cours du premier millénaire du christianisme. Ajoutons
que Serge et Bacchus n'étaient pas des frères biologiques - et
personne n'a jamais prétendu qu'ils l'étaient -, si bien que le
terme "frère" doit être entendu comme le reflet de
l'usage antique des subcultures érotiques ou de l'usage biblique
(particulièrement dans les versions grecques). En tout état de
cause, il possédait de fortes connotations érotiques».27
Et c'est ainsi que «pour les
générations suivantes, Serge et Bacchus devinrent l'incarnation
même du "couple" de saints militaires : on les mentionnait
d'ordinaire ensemble et on les représentait souvent réunis (parfois
frottant des auréoles ensemble, ou à cheval, les naseaux de leurs
montures se touchant); ils furent le "couple" le plus
fréquemment invoqué dans les cérémonies d'union homosexuelle
[...]  Sévère d'Antioche déclarait au début du VIe
siècle qu'il lui fallait mentionner Bacchus en même temps que Serge
parce que "nous ne devrions pas séparer dans le discours ceux
qui furent unis dans la vie". Dans la version de loin la plus
courante de leurs biographies, Serge est présenté comme "le
doux compagnon et l'amant" de Bacchus».28 Si le culte des saints Serge et
Bacchus marqua surtout l'Église d'Orient, c'est probablement parce
qu'ils apparaissaient comme les héritiers des couples d'amants qui
formaient l'antique Bataillon sacré de Thèbes. En définitive,
comme le rappelle encore Boswell : «Si curieux que cela puisse
paraître à des esprits nourris d'une culture occidentale moderne,
qui fait de l'homosexualité un vice littéralement "innommable",
les peuples qui émergèrent de l'Antiquité païenne pour entrer
dans le Moyen Âge chrétien avaient plutôt tendance à mépriser
les relations hétérosexuelles, considérées comme une simple
commodité, comme un pur intérêt terrestre. Ils avaient en revanche
de bonnes raisons d'admirer la passion et les unions entre personnes
du même sexe - culte résiduel des attachements entre deux hommes
pouvant aller jusqu'aux nombreux exemples de martyrs militaires
réunis dans la mort, par l'amour qu'ils éprouvaient pour Dieu et
l'un pour l'autre. Tout cela permet de mieux comprendre qu'au moment
où l'Église finit par instaurer des cérémonies d'union certaines
aient pu concerner des couples homosexuels».29
Mais en 1215, au moment où le quatrième concile du Latran décidait
de sacraliser le mariage, les unions de même sexe devaient être
impérativement exclues.
Sévère d'Antioche déclarait au début du VIe
siècle qu'il lui fallait mentionner Bacchus en même temps que Serge
parce que "nous ne devrions pas séparer dans le discours ceux
qui furent unis dans la vie". Dans la version de loin la plus
courante de leurs biographies, Serge est présenté comme "le
doux compagnon et l'amant" de Bacchus».28 Si le culte des saints Serge et
Bacchus marqua surtout l'Église d'Orient, c'est probablement parce
qu'ils apparaissaient comme les héritiers des couples d'amants qui
formaient l'antique Bataillon sacré de Thèbes. En définitive,
comme le rappelle encore Boswell : «Si curieux que cela puisse
paraître à des esprits nourris d'une culture occidentale moderne,
qui fait de l'homosexualité un vice littéralement "innommable",
les peuples qui émergèrent de l'Antiquité païenne pour entrer
dans le Moyen Âge chrétien avaient plutôt tendance à mépriser
les relations hétérosexuelles, considérées comme une simple
commodité, comme un pur intérêt terrestre. Ils avaient en revanche
de bonnes raisons d'admirer la passion et les unions entre personnes
du même sexe - culte résiduel des attachements entre deux hommes
pouvant aller jusqu'aux nombreux exemples de martyrs militaires
réunis dans la mort, par l'amour qu'ils éprouvaient pour Dieu et
l'un pour l'autre. Tout cela permet de mieux comprendre qu'au moment
où l'Église finit par instaurer des cérémonies d'union certaines
aient pu concerner des couples homosexuels».29
Mais en 1215, au moment où le quatrième concile du Latran décidait
de sacraliser le mariage, les unions de même sexe devaient être
impérativement exclues.
Il est vrai, comme le note Boswell,
que «bien qu'on ait pu considérer ces relations comme des
engagements sentimentaux irrévocables, impérieux et souverains, à
cette époque le "mariage" n'était pas envisagé au
premier chef comme l'instrument de l'épanouissement affectif ou
sexuel, mais simplement comme une méthode pour relever ou perpétuer
une succession dynastique. Les unions homosexuelles ne représentaient
donc ni une menace contre le mariage hétérosexuel, ni une solution
de remplacement»,30
ce qui le rendait particulièrement fragile pour une morale qui
plaçait le célibat au-dessus même du mariage! Alors que
«l'existence d'une répression opiniâtre et efficace contre les
comportements homosexuels ne remonte, en Europe, qu'au XIIIe
siècle; elle ne fut jamais courante dans l'Orient byzantin».31
En Occident, c'est la campagne meurtrière que le roi de France
Philippe le Bel entreprit contre l'Ordre des
chevaliers du Temple et conduisant à son extinction (1314), qui sonna le glas de ces pratiques jugées de plus en plus négativement.
Il a été d'usage, tout au long du
Moyen Âge occidental, de reproduire le modèle des unions du même
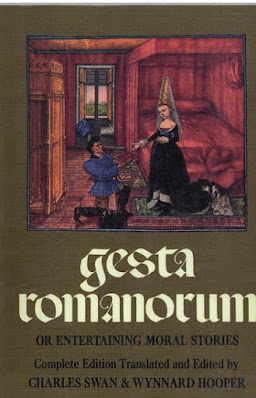 sexe, surtout pour les hommes - Boswell avoue en savoir très peu sur
les unions entre lesbiennes -, qu'on retrouve dans nombre de textes
anciens : «Dans un récit des Gesta romanorum, deux
chevaliers "s'aimaient mutuellement" (mutuo se
dilexerunt) et décidèrent de conclure une alliance en buvant
chacun symboliquement de petites quantités du sang de l'autre.
Dorénavant, en vertu du lien ainsi forgé, aucun ne "divorcerait"
de l'autre "dans la prospérité ni dans l'adversité", et
tout ce que l'un gagnerait serait partagé équitablement avec
l'autre. Puis ils "vécurent pour toujours dans la même
maison". L'un d'eux était sage et l'autre stupide, et le récit
roule sur les reproches qu'ils s'adressent réciproquement pour avoir
respecté si fanatiquement leur promesse de "ne pas divorcer"
qu'ils ont fini par affronter la mort ensemble. Le chevalier sage
déclare que le sot aurait dû lui faire confiance au moment où ils
ont dû faire un choix difficile, tandis que le sot réplique qu'en
vertu de leur serment il aurait suivi le sage partout; celui-ci
aurait donc dû insister. La morale de l'histoire, telle qu'elle nous
est transmise, est que l'union des deux chevaliers est une image de
l'union du corps et de l'âme, l'une étant plus sage que l'autre».32
sexe, surtout pour les hommes - Boswell avoue en savoir très peu sur
les unions entre lesbiennes -, qu'on retrouve dans nombre de textes
anciens : «Dans un récit des Gesta romanorum, deux
chevaliers "s'aimaient mutuellement" (mutuo se
dilexerunt) et décidèrent de conclure une alliance en buvant
chacun symboliquement de petites quantités du sang de l'autre.
Dorénavant, en vertu du lien ainsi forgé, aucun ne "divorcerait"
de l'autre "dans la prospérité ni dans l'adversité", et
tout ce que l'un gagnerait serait partagé équitablement avec
l'autre. Puis ils "vécurent pour toujours dans la même
maison". L'un d'eux était sage et l'autre stupide, et le récit
roule sur les reproches qu'ils s'adressent réciproquement pour avoir
respecté si fanatiquement leur promesse de "ne pas divorcer"
qu'ils ont fini par affronter la mort ensemble. Le chevalier sage
déclare que le sot aurait dû lui faire confiance au moment où ils
ont dû faire un choix difficile, tandis que le sot réplique qu'en
vertu de leur serment il aurait suivi le sage partout; celui-ci
aurait donc dû insister. La morale de l'histoire, telle qu'elle nous
est transmise, est que l'union des deux chevaliers est une image de
l'union du corps et de l'âme, l'une étant plus sage que l'autre».32
Au moment où Dante rédigeait son
récit du dernier cercle du  Purgatoire, l'Europe était sous la
conduite d'une campagne répressive visant à assimiler la sodomie à tout ce qui pouvait la discréditer : les Juifs, les hérétiques,
les sorcières, les Musulmans... Car il faut bien souligner que ce n'était
pas la sodomie qui discréditait les uns et les autres, mais bien les
uns et les autres qui avaient charge de discréditer les sodomites.
La campagne homophobe avait été amorcée en pleine croisade par
Pierre Damien (v. 1007-1072) moine-ermite, puis camaldule (sous-ordre
des bénédictins), enfin évêque puis cardinal avant de recevoir la
canonisation à sa mort. Il prononça une série de sermons virulents
et publia des attaques en règle contre la pratique de
l'homosexualité qui semblait se développer parmi les croisés au
Proche-Orient. C'est cette campagne qui culmina avec les accusations
portées contre l'Ordre du Temple.
Purgatoire, l'Europe était sous la
conduite d'une campagne répressive visant à assimiler la sodomie à tout ce qui pouvait la discréditer : les Juifs, les hérétiques,
les sorcières, les Musulmans... Car il faut bien souligner que ce n'était
pas la sodomie qui discréditait les uns et les autres, mais bien les
uns et les autres qui avaient charge de discréditer les sodomites.
La campagne homophobe avait été amorcée en pleine croisade par
Pierre Damien (v. 1007-1072) moine-ermite, puis camaldule (sous-ordre
des bénédictins), enfin évêque puis cardinal avant de recevoir la
canonisation à sa mort. Il prononça une série de sermons virulents
et publia des attaques en règle contre la pratique de
l'homosexualité qui semblait se développer parmi les croisés au
Proche-Orient. C'est cette campagne qui culmina avec les accusations
portées contre l'Ordre du Temple.
L'Ordre avait été fondé en 1119,
autour de Hugues de Payns par quelques chevaliers qui se donnèrent
«la mission d'assurer en Terre Sainte la sécurité le long des
routes empruntées par les pèlerins. Leur association devient un
ordre régulier, l'ordre du Temple, ainsi nommé parce que son
quartier général est installé, à Jérusalem, dans l'ancienne
mosquée Al-Aqsa, assimilée par les croisés au Temple de Salomon.
Les templiers sont organisés selon une hiérarchie qui reflète
celle de la société du temps, et qui leur permet de s'ouvrir à
toutes les  couches sociales : les chevaliers combattent à cheval,
les sergents à pied, les chapelains prient et distribuent les
sacrements. Une division des tâches est par ailleurs établie entre
les commanderies d'Occident, qui servent de maison de retraite pour
chevaliers âgés, en même temps que de centres de recrutement, et
les établissements d'Orient, au rôle directement militaire,
forterersse de Gaza, de Saphiet, de Tibériade, de
Chastel-Pèlerin...».33
couches sociales : les chevaliers combattent à cheval,
les sergents à pied, les chapelains prient et distribuent les
sacrements. Une division des tâches est par ailleurs établie entre
les commanderies d'Occident, qui servent de maison de retraite pour
chevaliers âgés, en même temps que de centres de recrutement, et
les établissements d'Orient, au rôle directement militaire,
forterersse de Gaza, de Saphiet, de Tibériade, de
Chastel-Pèlerin...».33
 L'Ordre organisait des quêtes afin
d'assurer le transport des croisés vers les lieux de combats. C'est
ainsi qu'il finit par devenir une véritable banque, thésaurisant
des sommes considérables. Il accordait des prêts à intérêts qui
soulevaient la grogne dans les différents pays où il s'était installé.
Son malheur commença le 28 mai 1291, lorsque Saint-Jean-d'Acre fut prise par le sultan mamelouk Khali et qu'au cours du
siège, le grand-maître Guillaume de Beaujeu et nombre des templiers
trouvèrent la mort. «Dans les semaines suivantes, la Terre
Sainte est évacuée définitivement par les chrétiens. D'une
certaine manière, c'est la chute de l'ordre».34
Chaque royaume logeait sa succursale de l'Ordre qui pour être
régulier n'était pas un ordre monastique. Une fois les croisades
terminées, la justification de leurs activités perdait sa
légitimité. On ne retenait d'eux que leurs services financiers.
L'Ordre organisait des quêtes afin
d'assurer le transport des croisés vers les lieux de combats. C'est
ainsi qu'il finit par devenir une véritable banque, thésaurisant
des sommes considérables. Il accordait des prêts à intérêts qui
soulevaient la grogne dans les différents pays où il s'était installé.
Son malheur commença le 28 mai 1291, lorsque Saint-Jean-d'Acre fut prise par le sultan mamelouk Khali et qu'au cours du
siège, le grand-maître Guillaume de Beaujeu et nombre des templiers
trouvèrent la mort. «Dans les semaines suivantes, la Terre
Sainte est évacuée définitivement par les chrétiens. D'une
certaine manière, c'est la chute de l'ordre».34
Chaque royaume logeait sa succursale de l'Ordre qui pour être
régulier n'était pas un ordre monastique. Une fois les croisades
terminées, la justification de leurs activités perdait sa
légitimité. On ne retenait d'eux que leurs services financiers.
 À Paris, le grand-maître Jacques
de Molay refusa le projet réformateur de fusionner les différents
ordres militaires en un ordre unique. D'un autre côté, le roi
Philippe le Bel, toujours en quête d'argent, allant jusqu'à faire
rogner les pièces de métal servant de monnaie, ouvrit une procédure
à l'égard des Templiers, appuyé en cela par le pape Clément V, un
Français. Mais le pape ne se montra pas aussi empressé que Philippe
l'eût voulu et le roi décida de frapper un grand coup. Il envoya
Guillaume de Nogaret - celui-là même qui avait giflé le pape
Boniface VIII à Agnani en septembre 1303 -, préparer l'arrestation
de tous les Templiers présents dans le royaume, soit près de 500
personnes, ce qui se déroula le 13 octobre 1307. Le roman de Maurice
Druon, Les rois maudits, et les deux séries télé qui en
furent l'adaptation, racontent l'épisode final de l'Ordre français :
À Paris, le grand-maître Jacques
de Molay refusa le projet réformateur de fusionner les différents
ordres militaires en un ordre unique. D'un autre côté, le roi
Philippe le Bel, toujours en quête d'argent, allant jusqu'à faire
rogner les pièces de métal servant de monnaie, ouvrit une procédure
à l'égard des Templiers, appuyé en cela par le pape Clément V, un
Français. Mais le pape ne se montra pas aussi empressé que Philippe
l'eût voulu et le roi décida de frapper un grand coup. Il envoya
Guillaume de Nogaret - celui-là même qui avait giflé le pape
Boniface VIII à Agnani en septembre 1303 -, préparer l'arrestation
de tous les Templiers présents dans le royaume, soit près de 500
personnes, ce qui se déroula le 13 octobre 1307. Le roman de Maurice
Druon, Les rois maudits, et les deux séries télé qui en
furent l'adaptation, racontent l'épisode final de l'Ordre français :
«La procédure dura sept années. L'impopularité de l'ordre, la faiblesse du pape, celle de Molay et ses erreurs de jugement, eurent leur part dans l'issue qui fut, au concile de Vienne, en 1312, la suppression de l'ordre par provision, c'est-à-dire par une décision administrative prise formellement par le pape, dictée en fait par le roi de France. Deux ans plus tôt, une soixantaine de templiers, sous les murs de Paris et ailleurs en France, avaient été brûlés vifs pour être revenus sur leurs aveux. Après la suppression de l'ordre, les autres qui s'en étaient tenus à leurs déclarations initiales, furent libérés, à l'exception des dignitaires. Ceux-ci, Molay, Hugues de Payraud, Georffroy de Charnay, comparurent le 19 mars 1314, sur un podium dressé au milieu du parvis Notre-Dame,devant trois cardinaux qui prononcèrent une sentence de prison à vie. Or, depuis sept années, Molay avait tout misé sur une comparution personnelle devant le pape. Se voyant condamné sans l'avoir obtenue, il eut un sursaut imité en cela par Geoffroy de Charnay. Le soir du même jour, Philippe le Bel "les fit brûler tous deux sur le même bûcher dans une petite île de la Seine, entre le Jardin-Royal et l'église des Frères-Ermites-de-Saint-Augustin. Ils parurent soutenir les flammes avec tant de fermeté et de résolution, que la constance de leur mort et leurs dénégations finales frappèrent la multitude d'admiration et de stupeur". La légende courut bientôt que Molay, sur le bûcher, en aurait appelé au "tribunal de Dieu". On sait que le pape et le roi moururent dans l'année; on peut ajouter que la dynastie des Capétiens directs ne survécut guère à l'ordre du Temple, puisque aucun des trois fils de Philippe le Bel ne laissa d'héritier mâle. Ces disparitions ne pouvaient manquer de frapper les imaginations. Elles mettent la touche finale à l'épopée sulfureuse et tragique de l'ordre du Temple».35
Le réquisitoire contre l'Ordre du
Temple était assez imprécis. On accusait ses chevaliers d'être
influencés par l'islam et de pratiquer d'authentiques rites de
satanisme et de sorcellerie. À cela, on ne pouvait éviter 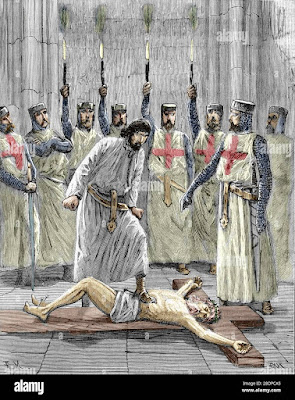 d'ajouter
la sodomie. Toutes ces accusations semblaient découler d'une
interprétation tendancieuse des rites d'initiation. Comme le
rappelle Didier Godard : «Pour ce qui est des pratiques
sexuelles, il faut... partir de la cérémonie
d'initiation, qui se déroulait de nuit, à la lueur des torches. Si
l'on suit les aveux recueillis lors du procès, le postulant,
impressionné, choqué, déstabilisé par les rites sacrilèges qu'on
lui a d'abord imposés, est embrassé ensuite, sur la bouche, par le
chevalier qui le reçoit dans l'ordre. Puis il doit ôter son habit
séculier. Une fois dévêtu, il reçoit de nouveaux baisers, en
divers endroits du corps : "Il me baisa, raconte le templier
Jean l'Anglais, à la poitrine, entre les épaules et sur la chair
nue". Sur la chair nue : la précision nous restitue, par-delà
les siècles, le trouble du novice qui recevait un tel accueil de la
part du groupe d'hommes auquel il allait appartenir. Gageons que,
parfois, ce trouble était partagé par le chevalier qui officiait,
par les témoins qui observaient en silence, dans leur tenue de
chevaliers, revêtus du grand manteau blanc frappé de la croix
rouge, les noces de l'ordre et du néophyte. Encore la localisation
des baisers dont fait état Jean l'Anglais est-elle relativement
innocente. Dans la plupart des témoignages, il est dit que le
"nouveau" était embrassé sur le nombril, sur le sexe, sur
l'anus. "Personne, écrit Jean Favier, ne se demandait le
pourquoi de telles pratiques. Un templier limousin l'avoue avec une
simplicité touchante : 'Tout le monde était stupéfait et
atermoyait jusqu'à ce qu'il nous fût dit que c'était le règlement.
C'est ce que j'ai fait'. Il est possible qu'il y ait eu là une
intention de défi à l'égard de la morale officielle du
christianisme».36
d'ajouter
la sodomie. Toutes ces accusations semblaient découler d'une
interprétation tendancieuse des rites d'initiation. Comme le
rappelle Didier Godard : «Pour ce qui est des pratiques
sexuelles, il faut... partir de la cérémonie
d'initiation, qui se déroulait de nuit, à la lueur des torches. Si
l'on suit les aveux recueillis lors du procès, le postulant,
impressionné, choqué, déstabilisé par les rites sacrilèges qu'on
lui a d'abord imposés, est embrassé ensuite, sur la bouche, par le
chevalier qui le reçoit dans l'ordre. Puis il doit ôter son habit
séculier. Une fois dévêtu, il reçoit de nouveaux baisers, en
divers endroits du corps : "Il me baisa, raconte le templier
Jean l'Anglais, à la poitrine, entre les épaules et sur la chair
nue". Sur la chair nue : la précision nous restitue, par-delà
les siècles, le trouble du novice qui recevait un tel accueil de la
part du groupe d'hommes auquel il allait appartenir. Gageons que,
parfois, ce trouble était partagé par le chevalier qui officiait,
par les témoins qui observaient en silence, dans leur tenue de
chevaliers, revêtus du grand manteau blanc frappé de la croix
rouge, les noces de l'ordre et du néophyte. Encore la localisation
des baisers dont fait état Jean l'Anglais est-elle relativement
innocente. Dans la plupart des témoignages, il est dit que le
"nouveau" était embrassé sur le nombril, sur le sexe, sur
l'anus. "Personne, écrit Jean Favier, ne se demandait le
pourquoi de telles pratiques. Un templier limousin l'avoue avec une
simplicité touchante : 'Tout le monde était stupéfait et
atermoyait jusqu'à ce qu'il nous fût dit que c'était le règlement.
C'est ce que j'ai fait'. Il est possible qu'il y ait eu là une
intention de défi à l'égard de la morale officielle du
christianisme».36
Il restera toujours difficile
d'évaluer la part de fabulation contenue dans ces témoignages
arrachés par la torture, la terreur ou les menaces de mort. Ensuite,
de préciser la signification exacte de ce rite fort apparenté à
celui des unions homosexuelles déjà évoquées. «Les baisers
symbolisent, écrit un universitaire américain, "un itinéraire
érotique complet du corps du néophyte", et "la
progression d'un acte d'amour'. Il n'hésite pas à conclure que
l'initiation pouvait fort bien s'achever par la fellation et la
sodomisation du néophyte. Rien dans les témoignages ne vient étayer
cette supposition; il est vrai que les intéressés ne se seraient
pas vantés de leurs exploits devant les inquisiteurs. Il n'est pas
exclu que cela ait pu se produire, lorsque le postulant était jeune
et appétissant. On nous dit en tout cas que les  candidats âgés
étaient volontiers dispensés de cette partie du rituel. Raoul de
Gisy déclare avoir reçu de la sorte dix ou douze néophytes, mais
que, "pour certains", il refusait les baisers sexuels.
[...] Certaines dépositions suggèrent que l'initiation a pu,
parfois, tourner au viol. Un templier relate en ces termes la
réception d'un de ses proches parents, Hugues Marchant : "Les
frères fermèrent la porte de l'intérieur le plus solidement
possible, ils mirent devant la porte, toujours de l'intérieur, les
courtines du lit, de façon qu'il ne fût pas possible de voir à
travers la porte ce qui pourrait se passer. Ils s'enfermèrent avec
Hugues si longtemps que ceux qui attendaient à l'extérieur en
étaient écœurés; puis ils ouvrirent la porte et me ramenèrent
Hugues, cette fois en habit de templier. Lui, il était pâle,
bouleversé et stupéfait. J'en fus bien étonné, car Hugues avait
bien insisté pour entrer dans cet ordre et être fait chevalier par
moi-même; le même jour, avant d'entrer dans la chambre, il était
tout joyeux, fort et robuste". Le lendemain, le narrateur prend
Hugues à part : "'Pourquoi, lui demandai-je, étais-tu hier si
bouleversé, et le parais-tu encore aujourd'hui?' Il me répondit :
'Je ne pourrai plus jamais être joyeux, ni en paix avec moi-même'.
À ce moment, et bien des fois par la suite, je lui demandai la cause
de son trouble. Jamais il ne voulut me l'avouer. Jamais non plus je
ne le vis joyeux ni avec un bon visage. Et pourtant il était
auparavant fort gai"».37
candidats âgés
étaient volontiers dispensés de cette partie du rituel. Raoul de
Gisy déclare avoir reçu de la sorte dix ou douze néophytes, mais
que, "pour certains", il refusait les baisers sexuels.
[...] Certaines dépositions suggèrent que l'initiation a pu,
parfois, tourner au viol. Un templier relate en ces termes la
réception d'un de ses proches parents, Hugues Marchant : "Les
frères fermèrent la porte de l'intérieur le plus solidement
possible, ils mirent devant la porte, toujours de l'intérieur, les
courtines du lit, de façon qu'il ne fût pas possible de voir à
travers la porte ce qui pourrait se passer. Ils s'enfermèrent avec
Hugues si longtemps que ceux qui attendaient à l'extérieur en
étaient écœurés; puis ils ouvrirent la porte et me ramenèrent
Hugues, cette fois en habit de templier. Lui, il était pâle,
bouleversé et stupéfait. J'en fus bien étonné, car Hugues avait
bien insisté pour entrer dans cet ordre et être fait chevalier par
moi-même; le même jour, avant d'entrer dans la chambre, il était
tout joyeux, fort et robuste". Le lendemain, le narrateur prend
Hugues à part : "'Pourquoi, lui demandai-je, étais-tu hier si
bouleversé, et le parais-tu encore aujourd'hui?' Il me répondit :
'Je ne pourrai plus jamais être joyeux, ni en paix avec moi-même'.
À ce moment, et bien des fois par la suite, je lui demandai la cause
de son trouble. Jamais il ne voulut me l'avouer. Jamais non plus je
ne le vis joyeux ni avec un bon visage. Et pourtant il était
auparavant fort gai"».37
Si l'on fait la part des outrances,
des exagérations et de ce que nous avons précédemment vu, nous
retrouvons bien l'esprit des rites d'union homosexuelle refoulé derrière des manifestations crues  d'érotisme : «Une
fois le néophyte mis en condition, à tout le moins par les baisers,
le chevalier qui le recevait, si l'on suit toujours les dépositions,
énonçait la règle de la disponibilité sexuelle, sur simple
demande, de tous les templiers entre eux. Le "nouveau"
était informé que, s'il était tourmenté par le désir, il pouvait
demander à l'un quelconque des frères de le satisfaire, et qu'a
contrario, il devait accepter, si l'un d'eux lui demandait la
réciproque, de s'y soumettre sans aucune résistance. La cérémonie
s'achevait par le psaume 132 : "Qu'il est bon, qu'il est doux
que des frères demeurent ensemble..." On notera que ce psaume
était "l'extrait biblique le plus couramment lu" dans les
unions homosexuelles étudiées par Boswell».38
d'érotisme : «Une
fois le néophyte mis en condition, à tout le moins par les baisers,
le chevalier qui le recevait, si l'on suit toujours les dépositions,
énonçait la règle de la disponibilité sexuelle, sur simple
demande, de tous les templiers entre eux. Le "nouveau"
était informé que, s'il était tourmenté par le désir, il pouvait
demander à l'un quelconque des frères de le satisfaire, et qu'a
contrario, il devait accepter, si l'un d'eux lui demandait la
réciproque, de s'y soumettre sans aucune résistance. La cérémonie
s'achevait par le psaume 132 : "Qu'il est bon, qu'il est doux
que des frères demeurent ensemble..." On notera que ce psaume
était "l'extrait biblique le plus couramment lu" dans les
unions homosexuelles étudiées par Boswell».38
Dans la mesure où de tous ces
ragots une certaine vérité réussit à percer, «s'agissant de
l'hérésie, écrit Jean Favier, ces moines-soldats étaient des
"hommes rudes", d'une ignorance "effarante", et
qui vivaient en plein "flou théologique"; il n'est donc
pas étonnant, selon lui, qu'ils aient "fini par mêler, sans
bien s'en rendre compte, dans leurs rites d'initiation, la
profanation religieuse et le bizutage", ce  qui ne les empêchait
pas de communier, le vendredi saint, les pieds nus en signe
d'humilité. Contrai-rement aux conclusions que voulut en tirer le
pouvoir royal, ce n'était pas la sincérité de leur foi qui était
sujette à caution, mais leur compréhension des enseignements de
l'Église et des rituels auxquels ils se soumettaient».39
Tout au mieux, peut-on conclure que le schéma templier est conforme
à «l'homosexualité chevaleresque et féodale»,
caractérisée, «d'une part, par le fait que la condamnation
officielle de la sodomie n'est pas remise en cause, et d'autre part
par le fait que cette condamnation reste largement inefficace à
influencer la pratique, à modeler le comportement effectif des
individus, à quelque couche sociale qu'ils appartiennent».40
Ce qu'illustrait le sceau même de l'Ordre, représentant deux cavaliers combattants montés sur un même cheval. À travers les
millénaires s'était transmise l'éthique combattante et homophile
du Bataillon sacré de Thèbes.
qui ne les empêchait
pas de communier, le vendredi saint, les pieds nus en signe
d'humilité. Contrai-rement aux conclusions que voulut en tirer le
pouvoir royal, ce n'était pas la sincérité de leur foi qui était
sujette à caution, mais leur compréhension des enseignements de
l'Église et des rituels auxquels ils se soumettaient».39
Tout au mieux, peut-on conclure que le schéma templier est conforme
à «l'homosexualité chevaleresque et féodale»,
caractérisée, «d'une part, par le fait que la condamnation
officielle de la sodomie n'est pas remise en cause, et d'autre part
par le fait que cette condamnation reste largement inefficace à
influencer la pratique, à modeler le comportement effectif des
individus, à quelque couche sociale qu'ils appartiennent».40
Ce qu'illustrait le sceau même de l'Ordre, représentant deux cavaliers combattants montés sur un même cheval. À travers les
millénaires s'était transmise l'éthique combattante et homophile
du Bataillon sacré de Thèbes.
 Malgré
les répressions sexuelles qui s'abattirent sur le monde occidental à
partir du XIVe siècle, bien des rites survécurent dans la tradition
chrétienne d'union du même sexe. Montaigne en décrivit une qui se
déroula à Rome, en 1578, et dont certains ecclésiastiques savaient
très bien de quoi il en retournait : «[...] à Saint-Jean Porta
Latina, en laquelle église certains Portugais, quelque années y a,
etoint antrés en une étrange confrérie. Ils s'espousoint masle à
masle à la messe, avecq mesmes serimonies que nous faisons nos
mariages, faisoint leurs pasques ensemble, lisoint ce mesme evangile
des nopces, et puis couchoint et habitoint ensemble. Les esperts
romeins dioint que parce qu'en l'autre conjoint de masle et femelle,
cet sule circonstance la rend legitime, que ce soit en mariage, il
avoit samblé à ces fines jans que cet'autre action devindroit
parillemant juste, qui l'auroit authorisée de serimonies et misteres
de l'Eglise».41
Et bien loin de disparaître, malgré la chasse que lui menait
l'autorité romaine, ce rite continua à se dérouler dans diverses
églises de l'Europe :
Malgré
les répressions sexuelles qui s'abattirent sur le monde occidental à
partir du XIVe siècle, bien des rites survécurent dans la tradition
chrétienne d'union du même sexe. Montaigne en décrivit une qui se
déroula à Rome, en 1578, et dont certains ecclésiastiques savaient
très bien de quoi il en retournait : «[...] à Saint-Jean Porta
Latina, en laquelle église certains Portugais, quelque années y a,
etoint antrés en une étrange confrérie. Ils s'espousoint masle à
masle à la messe, avecq mesmes serimonies que nous faisons nos
mariages, faisoint leurs pasques ensemble, lisoint ce mesme evangile
des nopces, et puis couchoint et habitoint ensemble. Les esperts
romeins dioint que parce qu'en l'autre conjoint de masle et femelle,
cet sule circonstance la rend legitime, que ce soit en mariage, il
avoit samblé à ces fines jans que cet'autre action devindroit
parillemant juste, qui l'auroit authorisée de serimonies et misteres
de l'Eglise».41
Et bien loin de disparaître, malgré la chasse que lui menait
l'autorité romaine, ce rite continua à se dérouler dans diverses
églises de l'Europe :
«Dans les régions (essentiellement l'Italie, la Grèce et l'Europe centrale) où l'on continuait de pratiquer cette cérémonie et d'en reconnaître la signification première, elle était cependant imprimée sans commentaire et célébrée comme une cérémonie nuptiale : "Dans les missels des XVIe et XVIIe siècles, on trouve d'ordinaire une ou plusieurs prières lues par le prêtre aux Wahlbrüder* à leur mariage, comme il convient de l'appeler". À partir de la seconde moitié du XIXe siècle - époque où un puissant mouvement de défense des droits des homosexuels se manifesta en Allemagne -, et jusque vers le milieu du XXe siècle - moment où les nazis l'exterminèrent brutalement (en même temps que de nombreux individus homosexuels) -, les anthropologues allemands eurent tendance à aborder cette cérémonie et sa signification avec franchise et réalisme. Bien que son époque l'incitât à employer l'expression de Wahlbrüderschaft, Ciszewski se sentait suffisamment à l'aise pour observer que la cérémonie "est exactement comme celle du mariage, dans laquelle l'union ultime du couple est précédée d'une série de rites introductifs, un ensemble de gestes symboliques censés représenter l'union et introduire son action centrale". Il donnait une description détaillée de l'une de ces cérémonies, appuyant son récit sur un témoignage oculaire. Elle avait lieu le jour de la Saint-Jean, le disciple bien-aimé du Christ. Le prêtre et deux ou trois parents proches étaient invités à la maison, on répandait des cendres du foyer sur les deux côtés d'une planche sur laquelle les deux hommes plaçaient leur pied droit. (Dans certaines régions, les hommes prévenaient tous leurs amis et les invitaient tous à la cérémonie, exactement comme pour un mariage.) Puis le prêtre leur demandait s'ils souhaitaient sincèrement être unis et s'ils croyaient sincèrement en la Trinité, l'Évangile et le feu. Le prêtre faisait une lecture de l'Évangile et leur disait qu'à dater de cet instant ils seraient "plus que des frères" (ja sogar mehr als Brüder) et devaient se traiter en conséquence. (la littérature populaire de la région célèbre un cas où l'un des partenaires prit la place de l'autre dans l'armée.) Puis il demandait aux gens présents d'être témoins de leur nouvelle situation et leur souhaitait bonne chance. Ils s'inclinaient devant lui, baisaient l'Évangile, les mains du prêtre et la main de leur compagnon, puis celle des invités plus âgés qu'eux. Après la cérémonie, ils se donnaient l'un à l'autre des présents et, dans certaines régions, échangeaient leurs croix de baptême, offraient un présent au prêtre et tenaient un grand banquet, parfois dans la demeure de chacun des partenaires. Dans certaines contrées, les partenaires se désignaient légalement comme héritiers à titre réciproque et s'engageaient à ne pas laisser d'autres descendants».42
Ces rites avaient-ils quelque chose à voir avec nos actuels mariages gays? Boswell en est convaincu : «C'était le cas, de toute évidence, bien que..., la nature et les objectifs de toutes les formes de mariage aient considérablement évolué au fil du temps. À chaque époque et en chaque lieu, ou presque, la cérémonie que nous avons étudiée consacrait ce que la plupart des gens considèrent aujourd'hui comme l'essence du mariage : un engagement sentimental permanent entre deux personnes, en présence de la communauté et reconnu par elle».43 Il faut retenir surtout que le trav7ail de la morale chrétienne fut toujours d'inhiber la dimension charnelle, hédoniste de la sexualité pour limiter les unions aux sexes opposés dans les fonctions définies par le droit et surtout en vue de la procréation à la base de la famille. Qu'en étaient-ils des activités sexuelles de ces couples? Y en avaient-ils même? Sodomie, fellation, coït intercrural ou tout simplement amitié, fraternité purement spirituelles? Tous les couples ne pratiquent pas la même sexualité.
 En
dépit des anecdotes salaces et des ragots de tavernes échangés
entre les poètes toscans du dolce stil nuovo
transpa-raissait la persistance
d'une sensibilité raffinée issue des époques les plus crues des
origines euro-asiatiques, Dante plaça les sodomites dans
le cercle le plus rapproché de l'entrée du Paradis; comme pour
justifier la parabole évangélique que les prostitués entreront
parmi les premiers dans le Royaume des Cieux⌛
En
dépit des anecdotes salaces et des ragots de tavernes échangés
entre les poètes toscans du dolce stil nuovo
transpa-raissait la persistance
d'une sensibilité raffinée issue des époques les plus crues des
origines euro-asiatiques, Dante plaça les sodomites dans
le cercle le plus rapproché de l'entrée du Paradis; comme pour
justifier la parabole évangélique que les prostitués entreront
parmi les premiers dans le Royaume des Cieux⌛
NOTES
1 Dieu de suprême clémence. — Commencement de l’hymne des matines du samedi.
2 Je ne connais point d’homme. — Paroles de la Vierge à l’Ange qui lui 7annonce qu’un fils naîtra d’elle.
3 Suétone. Vies des douze Césars, Paris, Belles Lettres, rééd. Livre de poche, Col. Classique, # 718-719, 1961, pp 42-43.
4 Suétone. ibid. p. 45.
5 Cité in R.-F. Martin. Les Douze Césars: du mythe à la réalité, Paris, Belles Lettres, Col. Histoire, 1991, p. 163.
6 J. Boswell. Les unions du même sexe, Paris, Fayard, 1996, pp. 275-276.
7 J. Boswell. ibid. p. 381, n. 31.
8 J. Boswell. ibid. p. 27.
9 J. Boswell. ibid. pp. 34-35.
10 Cité in J. Boswell. ibid. p. 61.7
11 Cité in J. Boswell. ibid. pp. 61-62.
12 J. Boswell. ibid. p. 65.
13 J. Boswell. ibid. p. 71.
14 J. Boswell. ibid. p. 72.
15 J. Boswell. ibid. pp. 72-73.
16 J. Boswell. ibid. p. 83.
17 J. Boswell. ibid. p. 119.
18 Cité in J. Boswell. ibid. p. 122.
19 J. Boswell. ibid. p. 124.7
20 J. Boswell. ibid. p. 125.
21 J. Boswell. ibid. pp. 125-126.
22 J. Boswell. ibid. p. 126.
23 J. Boswell. ibid. pp. 155-156.
24 J. Boswell. ibid. pp. 160-161.
25 J. Boswell. ibid. p. 164.
26 Cité in J. Boswell. ibid. pp. 172-173.
27 J. Boswell. ibid. pp. 173-174.
28 J. Boswell. ibid. p. 175.7
29 J. Boswell. ibid. pp. 181-182.
30 J. Boswell. ibid. p. 209.
31 J. Boswell. ibid. p. 256.
32 Les Gesta romanorum sont un recueil de récits d'anecdotes et de contes rédigés en latin et compilés probablement vers la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècles. J. Boswell. ibid. pp. 271-272.
33 D. Godard. Deux hommes sur un cheval, s.v., H & O, 2003, p. 153
34 D. Godard. ibid. p. 154.
35 D. Godard. ibid. p. 155.
36 D. Godard. ibid. p. 156.
37 D. Godard. ibid. pp. 157-7158.
38 D. Godard. ibid. p. 158.
39 D. Godard, ibid. p. 160.
40 D. Godard. ibid. p. 163.
41 Cité in J. Boswell. op. cit. p. 277.
42 J. Boswell. op. cit. pp. 280-281. * Wahlbrüder, «frères électifs», est l'une des manières dont les anthropologues codèrent et déguisèrent la relation entre les partenaires d'une union homosexuelle; mais ce terme devint sans doute de plus en plus exact, lorsque l'influence de la répugnance occidentale gagna du terrain. Stanislaus Ciszewski employa ce terme, mais utilisa indifféremment Genosse - "compagnon", "associé", "camarade" comme s'ils étaient synonymes». ibid. p. 477, n. 25.
43 J. Boswell. ibid. p. 296.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire