 |
| Le banquet sanglant d'Alberigo dei Manfredi, 1267. |
LE CIRCUIT D'ALBERIGO
Le tableau, tel que décrit par Dante est saisissant. Ugolino, tyran de Pise, a été renversé par une conjuration menée par l’archevêque Ruggeri Ubaldini qui l’a fait emprisonner avec ses fils et laissés mourir de faim. Ne distinguant en eux ni traître ni martyr, Dante les fige tous deux, l'archevêque et le tyran, dans la glace (début du Chant XXXIII de l’Inferno) :
1. De l’horrible pâture ce pécheur souleva la bouche, et l’essuya aux cheveux de la tête que par derrière il avait broyée.
2. Puis il commença : «Tu veux que je renouvelle la douleur désespérée qui, seulement d’y penser, m’oppresse le cœur, avant que je parle.
3. «Mais si mes paroles doivent être une semence d’où recueille l’infamie ce traître que je ronge, tu me verras pleurer et parler tout ensemble.
4. «Je ne sais qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas ; mais à t’entendre, bien me parais-tu Florentin.
5. «Sache que je fus le comte Ugolino, et celui-ci est l’archevêque Ruggeri : tout à l’heure je te dirai pourquoi je lui suis un pareil voisin.
6. «Que, par l’effet de ses méchantes pensées, me fiant à lui, je fus pris, et ensuite mis à mort, pas n’est besoin de le dire;
7. «Mais ce que tu ne peux avoir appris, combien ma mort fut cruelle, tu l’entendras, et tu sauras si par lui je fus offensé.
8. «Un étroit pertuis est dans la mue à cause de moi appelée de la Faim, et où il faut que d’autres encore soient enfermés.
9. «Il m’avait, par son ouverture, déjà montré plusieurs fois la lune, quand je tombai dans le mauvais sommeil, qui le voile de l’avenir pour moi déchira.
10. «Celui-ci me paraissait maître et seigneur, et chassait le loup et les louveteaux vers les monts qui empêchent les Pisans de voir Lucques :
11. «Avec des chiennes maigres, agiles et bien dressées, devant lui il avait posté Gualandi, et Sismondi, et Lanfranchi.
12. «Après une plus longue course, fatigués me paraissaient le père et le fils, et il me semblait voir les dents aiguës leur ouvrir les flancs.
13. «Lorsque avant le matin je fus réveillé, j’entendis mes fils, qui étaient avec moi, se plaindre en dormant et demander du pain.
14. «Bien cruel es-tu, si déjà tu ne t’attristes, pensant à ce qui s’annonçait à mon cœur; et si tu ne pleures pas, de quoi pleureras-tu?
15. «Déjà ils étaient éveillés, et l’heure approchait où, de coutume, la nourriture on nous apportait, et, à cause de son rêve, chacun était en anxiété.
16. «Et j’entendis en bas sceller la porte de l’horrible tour, et de mes fils je regardai le visage, sans rien dire.
17. «Je ne pleurais pas, tant au-dedans je fus pétrifié : ils pleuraient, eux; et mon petit Anselmo dit : — Père, comme tu regardes! Qu’as-tu?...
18 «Cependant je contins mes larmes, et ne répondis point, ni de tout ce jour, ni la nuit d’après, jusqu’à ce que le soleil se fût de nouveau levé sur le monde.
19 «Lorsqu’un faible rayon eut pénétré dans le triste cachot, et que sur quatre visages je vis mon propre aspect,
20. «De douleur les deux mains je me mordis; et ceux-là, pensant que c’était par l’envie de manger, soudain se levèrent,
 |
| Fortuné Dufau (1770-1821), La mort d’Ugolino de Pise, 1835. |
21. «Et dirent : — Père, bien moins de peine nous serait-ce, si de nous tu mangeais; tu nous as revêtus de ces misérables chairs, et toi aussi dépouille-nous-en!...
22. «Lors je me calmai, pour ne pas les affliger plus. Ce jour et le suivant, nous demeurâmes muets. Ah! terre barbare, pourquoi ne t’ouvris-tu point?
23. «Quand nous fûmes au quatrième jour, Guaddo tomba étendu à mes pieds, disant : — Père, pourquoi ne me secours-tu?...
24. «Là il mourut : et, comme tu me vois, je vis les trois autres tomber, un à un, entre le cinquième jour et le sixième; et moi,
25. «Déjà aveugle, de l’un à l’autre à tâtons j’allais ; trois jours je les appelai après qu’ils furent morts... Puis, plus que la douleur, puissante fut la faim.»
26. Cela dit, il tourna les yeux, et renfonça les dents dans le crâne misérable, qu’il broya comme le chien broie les os.
27. Ah ! Pise, honte des peuples du beau pays où sonne le si, puisqu’à te punir tes voisins sont lents,
Voilà
sans conteste l’un des récits les plus émouvants de l’Enfer de Dante, avec le
récit de Paolo Malatesta et de Francesca da Rimini. On en oublie qu’Ugolino
n’était pas un tendre. Sa réputation de cruauté est confirmée. De plus, c’est
un traître, ayant abandonné volontairement la position stratégique des Gibelins
qu’il  devait défendre, faisant perdre à sa ville, sa patrie, une importante
bataille navale (dite bataille de la Meloria, 1284 aux mains des Gênois), ce
qui ne l’empêcha pas de prendre ensuite le pouvoir, soit par ruse, soit par
menaces, exterminant sans pitié tous ceux qui s’opposaient à lui. C’est donc
par la terreur qu’il gouverna Pise, c’est par la terreur que Ruggeri Ubaldini
le renversa, le faisant enfermer avec deux de ses fils et deux de ses petit-fils dans une oubliette située dans une haute tour. leur faisant
d’abord distribuer parcimonieusement les vivres, puis les affamant
progressivement. Au bout de neuf mois (temps de l'enfantement), l'archevêque ordonna aux gardes de jeter les clefs de leur geôle dans l'Arno afin qu'ils ne fussent plus nourris et meurent de faim. L'archevêque était devenu podestat de la cité de Pise, il usa de son pouvoir avec le même degré de cruauté. Il n’est pas sûr qu’Ugolino ait été le dernier à survivre en
mangeant le corps de ses enfants morts près de lui. Aucun témoignage de
l’époque ne l’atteste. Pris dans la glace, Ugolino est condamné à dévorer le
crâne de l’archevêque, mordant à belles dents celui qui l’avait laissé mourir,
lui et ses enfants, de faim.
devait défendre, faisant perdre à sa ville, sa patrie, une importante
bataille navale (dite bataille de la Meloria, 1284 aux mains des Gênois), ce
qui ne l’empêcha pas de prendre ensuite le pouvoir, soit par ruse, soit par
menaces, exterminant sans pitié tous ceux qui s’opposaient à lui. C’est donc
par la terreur qu’il gouverna Pise, c’est par la terreur que Ruggeri Ubaldini
le renversa, le faisant enfermer avec deux de ses fils et deux de ses petit-fils dans une oubliette située dans une haute tour. leur faisant
d’abord distribuer parcimonieusement les vivres, puis les affamant
progressivement. Au bout de neuf mois (temps de l'enfantement), l'archevêque ordonna aux gardes de jeter les clefs de leur geôle dans l'Arno afin qu'ils ne fussent plus nourris et meurent de faim. L'archevêque était devenu podestat de la cité de Pise, il usa de son pouvoir avec le même degré de cruauté. Il n’est pas sûr qu’Ugolino ait été le dernier à survivre en
mangeant le corps de ses enfants morts près de lui. Aucun témoignage de
l’époque ne l’atteste. Pris dans la glace, Ugolino est condamné à dévorer le
crâne de l’archevêque, mordant à belles dents celui qui l’avait laissé mourir,
lui et ses enfants, de faim.
Ce chant du Dante est horrifiant parce qu'il mêle deux, sinon trois tabous dans un seul récit. D'abord
l'assassinat - et non l'exécution d'un tyran - qui demeure toujours un homicide; second tabou, plus horrifiant, le cannibalisme froidement ordonné, calculé, appliqué et qui s'étira durant les mois d'une grossesse; enfin, cela n'est pas dit mais pouvons-nous le supposer dans ce climat obsidionnel dans lequel se trouva les trois générations d'Ugolino, et la chose n'est pas interdite d'être pensée puisque le Sigismond Malatesta fût connu pour avoir violé sa fille et même attenté à la vertu de son fils, l'inceste. Qu'on n'eût pas dite la chose se comprend, l'horreur de la situation étant suffisamment répugnante.
Le
récit d'Ugolino précède celui d'Albéric de Manfredi, membre de
l'Ordre des chevaliers de la Mère de Dieu, ou encore de la frate
gaudente, un
ordre militaire calqué sur celui des Templiers et associé, comme
lui, aux croisades. Ces frères
joyeux qui,
au lieu de défendre la veuve et l'orphelin, semblent s'être
abandonnés à la ripaille et à la gaudriole; étaient aussi appelés frères
jouisseurs. Peut-être ne s'agissait-il que de l'une de ces confusions lexicales si  prolixes au Moyen Âge; d'un jeu de mot sur leur nom initial (chevaliers de la Mère de Dieu) et les sept joies de Marie qui se disent en italien, le sette Gaudi di Maria. Elles constituent la base du rosaire franciscain, lequel se dit aussi Misteri Gaudiosi ("les mystères joyeux)). Dans les allusions de Dante, pourtant, c'était la première idée qui lui venait en tête. Albéric de Manfredi - Alberigo dei Manfredi - était un des chefs du parti guelfe de Faenza. On raconte qu'offensé par des parents, Manfredo et Alberghetto, il contint un temps sa haine, puis les invia à un banquet.
C’était, semble-t-il, en vue d’une réconciliation, mais quand
on arriva au dessert, il se leva en criant qu’on apporte les
figues. C’était le signal convenu. Des hommes d’arme se jetèrent
sur les Manfredi dissidents et les massacrèrent. Cette trahison de
la loi de l'hospitalité est ce qui blesse le plus Dante qui non
seulement précipite Alberigo en Enfer, mais l'y précipite vivant
:
«L'ombre
repartit : "Je suis frère Albéric, je suis celui dont le
jardin a produit des dattes pour des figues : je reçois ici un digne
et juste échange. - Mais, repris-je, est-ce que tu es déjà mort?"
L'esprit ajouta : "Je ne puis te dire ce qu'est devenu mon corps
dans le monde. [...]
pour
que tu brises avec plus de zèle les glaçons épais qui enchaînent
mes larmes, apprends qu'aussitôt qu'une âme est traîtresse comme
la mienne, son corps lui est enlevé par un démon qui le gouverne à
son gré, pendant tout le temps fixé pour le reste de sa vie. Cette
âme tombe alors dans la froide citerne, et peut-être vois-tu encore
là-haut le corps de celui qui est glacé près de moi. Tu dois le
connaître, si, depuis peu, tu as quitté la terre. C'est Branca
d'Oria...
prolixes au Moyen Âge; d'un jeu de mot sur leur nom initial (chevaliers de la Mère de Dieu) et les sept joies de Marie qui se disent en italien, le sette Gaudi di Maria. Elles constituent la base du rosaire franciscain, lequel se dit aussi Misteri Gaudiosi ("les mystères joyeux)). Dans les allusions de Dante, pourtant, c'était la première idée qui lui venait en tête. Albéric de Manfredi - Alberigo dei Manfredi - était un des chefs du parti guelfe de Faenza. On raconte qu'offensé par des parents, Manfredo et Alberghetto, il contint un temps sa haine, puis les invia à un banquet.
C’était, semble-t-il, en vue d’une réconciliation, mais quand
on arriva au dessert, il se leva en criant qu’on apporte les
figues. C’était le signal convenu. Des hommes d’arme se jetèrent
sur les Manfredi dissidents et les massacrèrent. Cette trahison de
la loi de l'hospitalité est ce qui blesse le plus Dante qui non
seulement précipite Alberigo en Enfer, mais l'y précipite vivant
:
«L'ombre
repartit : "Je suis frère Albéric, je suis celui dont le
jardin a produit des dattes pour des figues : je reçois ici un digne
et juste échange. - Mais, repris-je, est-ce que tu es déjà mort?"
L'esprit ajouta : "Je ne puis te dire ce qu'est devenu mon corps
dans le monde. [...]
pour
que tu brises avec plus de zèle les glaçons épais qui enchaînent
mes larmes, apprends qu'aussitôt qu'une âme est traîtresse comme
la mienne, son corps lui est enlevé par un démon qui le gouverne à
son gré, pendant tout le temps fixé pour le reste de sa vie. Cette
âme tombe alors dans la froide citerne, et peut-être vois-tu encore
là-haut le corps de celui qui est glacé près de moi. Tu dois le
connaître, si, depuis peu, tu as quitté la terre. C'est Branca
d'Oria...
Dante
ici, fidèle à la théologie du temps, reconnaît la prédestination
de l'âme d'Alberigo. Vivant, mais pourtant séjournant déjà aux
Enfers. «Cette
hardiesse théologique, écrit
André Pézard, pour
ne rien dire de ce que conseille la simple humanité, a fait couler
des flots  d'encre; Dante lui-même condamne d'ailleurs pareils
jugements»
(Dante. Œuvres
complètes, Paris,
Gallimard, Col. Bibliothèque de la Pléiade, # 182, 1968, pp.
1103-1104, n. 124). Il
en va de même avec Branca Doria (Gênes 1233-1325), qui se montra
plus que discourtois avec Dante. Branca d'Oria, chevalier génois,
gendre de Michel Zanche, seigneur de Logudoro en Sardaigne. Voulant
se substituer à son beau-père, il l'invita dans son château et le
fit tailler en pièces avec ceux qui l'accompagnaient. De tout cela,
on ne peut que retenir des vengeances personnelles du poète. Les
partisans guelfes, les traîtres à la cause des Gibelins qui est son
parti, sont précipités dans cette mer gélatineuse. Ces rancunes
témoignent des vicissitudes que le poète rencontra tout au long de
son exil, une fois chassé de Florence. Mais au-delà des affronts
qui lui étaient personnels, c'était au plus grand péché que les
civilisations ont toujours puni de façons des plus sévères, le
refus de l'hospitalité; la félonie surtout d'attirer un invité à
sa table, ami ou adversaire, afin de profiter de sa confiance pour la
trahir, le détenir, l'emprisonner ou même le tuer.
d'encre; Dante lui-même condamne d'ailleurs pareils
jugements»
(Dante. Œuvres
complètes, Paris,
Gallimard, Col. Bibliothèque de la Pléiade, # 182, 1968, pp.
1103-1104, n. 124). Il
en va de même avec Branca Doria (Gênes 1233-1325), qui se montra
plus que discourtois avec Dante. Branca d'Oria, chevalier génois,
gendre de Michel Zanche, seigneur de Logudoro en Sardaigne. Voulant
se substituer à son beau-père, il l'invita dans son château et le
fit tailler en pièces avec ceux qui l'accompagnaient. De tout cela,
on ne peut que retenir des vengeances personnelles du poète. Les
partisans guelfes, les traîtres à la cause des Gibelins qui est son
parti, sont précipités dans cette mer gélatineuse. Ces rancunes
témoignent des vicissitudes que le poète rencontra tout au long de
son exil, une fois chassé de Florence. Mais au-delà des affronts
qui lui étaient personnels, c'était au plus grand péché que les
civilisations ont toujours puni de façons des plus sévères, le
refus de l'hospitalité; la félonie surtout d'attirer un invité à
sa table, ami ou adversaire, afin de profiter de sa confiance pour la
trahir, le détenir, l'emprisonner ou même le tuer.
Que ce fût dans l'ancien Israël ou dans la Grèce antique, le manque d'hospitalité était perçu comme une faute majeure qui rejaillissait sur toute la cité. Qui accepterait d'accueillir celui qui viendrait d'une ville qui recevait mal ses invités? À plus forte raison celui qui profitait pour les voler ou les assassiner par traîtrise. L'Ancien Testament donne deux passages - Genèse 19 et le Livre des Juges 19 22-24 -, passages qui sont un doublon de la même leçon morale à l'égard de ceux qui ne savent pas recevoir. Le premier, c'est le récit connu de la destruction de Sodome. Yahweh jugeant odieux le comportement des habitants de Sodome a décidé de détruire la ville pécheresse. Seulement, il tient à ce que le neveu d'Abraham, Lot et sa famille, fussent épargnés :
«Quand les deux Anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna, face contre terre. Il dit : "Je vous en prie, Messeigneurs! Veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit et vous laver les pieds, puis au matin vous reprendrez votre route", mais ils répondirent : "Non, nous passerons la nuit sur la place". "Il les pressa tant qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent.
Ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les hommes de la ville, les gens de Sodome, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent : "Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les nous pour que nous en abusions".
Lot sortit vers eux à l'entrée et, ayant fermé la porte derrière lui, il dit : "Je vous en supplie, mes frères, ne commettez pas le mal! écoutez : j'ai deux filles qui sont encore vierges, je vais vous les amener : faites-leur ce qui vous semble bon, mais pour ces hommes, ne leur faites rien, puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de mon toit". Mais ils répondirent : "Ôte-toi de là! En voilà un qui est venu en étranger, et il fait le juge! Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux!" Ils le pressèrent fort, lui Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Mais les hommes sortirent le bras, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les frappèrent de berlue, du plus petit jusqu'au plus grand, et ils n'arrivaient pas à trouver l'ouverture. (Gen. 19, 1-11).
Après vient le récit bien connu de la malédiction de Yahweh qui s'abat sur la ville, la fuite de Lot et de sa famille, sa femme changée en statue de sel pour avoir désobéi et s'être retournée voir la foudre s'abattre sur Sodome.
L'association
du récit de la destruction de Sodome avec l'homosexualité est une
affaire essentiellement occidentale inscrite dans sa longue
répression de la sexualité. «Or,
rappelle
 John Boswell, les
autorités juives classiques n'inter-prétaient généra-lement pas ces
textes comme des com-mentaires sur le compor-tement ou l'attirance
homo-sexuels (ajoutons qu'elles n'envisageaient sans doute même pas
que cette dernière pût exister). Quant aux dizaines de références
bibliques et exégétiques ultérieures au péché de Sodome, lequel
a donné son nom aux pratiques homosexuelles dans l'Europe médiévale,
la plupart estimaient que la cité avait péché en violant les lois
de l'hospitalité, et non en se livrant à des pratiques sexuelles
minoritaires»
(J. Boswell. Les
unions du même sexe dans l'Europe antique et médiévale, Paris,
Fayard, 1996, p. 358). Il n'en reste quand même pas moins, à lire
le texte biblique, que les menaces que les habitants de Sodome
faisaient peser sur Lot et ses invités font bien référence à des
attentats sexuels, d'où l'offre de Lot de leur confier en échange ses deux
filles de préférence aux deux anges. Devant le manque de charité
des habitants de Sodome, la réaction de Yahweh est tout à fait
comparable à celle de Dante devant Alberigo. Ils sont damnés de leur vivant - ils sont aveuglés - avant même la destruction de la ville.
John Boswell, les
autorités juives classiques n'inter-prétaient généra-lement pas ces
textes comme des com-mentaires sur le compor-tement ou l'attirance
homo-sexuels (ajoutons qu'elles n'envisageaient sans doute même pas
que cette dernière pût exister). Quant aux dizaines de références
bibliques et exégétiques ultérieures au péché de Sodome, lequel
a donné son nom aux pratiques homosexuelles dans l'Europe médiévale,
la plupart estimaient que la cité avait péché en violant les lois
de l'hospitalité, et non en se livrant à des pratiques sexuelles
minoritaires»
(J. Boswell. Les
unions du même sexe dans l'Europe antique et médiévale, Paris,
Fayard, 1996, p. 358). Il n'en reste quand même pas moins, à lire
le texte biblique, que les menaces que les habitants de Sodome
faisaient peser sur Lot et ses invités font bien référence à des
attentats sexuels, d'où l'offre de Lot de leur confier en échange ses deux
filles de préférence aux deux anges. Devant le manque de charité
des habitants de Sodome, la réaction de Yahweh est tout à fait
comparable à celle de Dante devant Alberigo. Ils sont damnés de leur vivant - ils sont aveuglés - avant même la destruction de la ville.
L'autre texte qui reprend à peu de choses près celui de la Genèse se trouve dans le Livre des Juges. Ici Sodome s'appelle Gibéa. Un membre de la tribu de Lévi, accompagné de sa concubine et de son serviteur arrivent de nuit à Gibéa...
«Survint un vieillard qui, le soir venu, rentrait de son travail des champs. C'était un homme de la montagne d'Éphraïm, qui résidait à Gibéa, tandis que les gensde l'endroit étaient des Benjaminites. Levant les yeux, il remarqua le voyageur, sur la place de la ville : "D'où viens-tu, lui dit le vieillard, et où vas-tu?" Et l'autre lui répondit : "Nous faisons route de Bethléem de Juda vers le fond de la montagne d'Éphraïm. C'est de là que je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je retourne chez moi, mais personne ne m'a offert l'hospitalité dans sa maison. Nous avons pourtant de la paille et du fourrage pour nos ânes, j'ai aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le jeune homme qui accompagne ton serviteur. Nous ne manquons de rien". - "Sois le bienvenu, repartit le vieillard, laisse-moi pourvoir à tous tes besoins, mais ne passe pas la nuit sur la place". Il le fit donc entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis mangèrent et burent.
Pendant qu'ils se réconfortaient, voici que des gens de la ville, des vauriens, s'attroupèrent autour de la maison et, frappant à la porte à coups redoublés, ilsdirent au vieillard, maître de la maison : "Fais sortir l'homme qui est venu chez toi, que nous le connaissions". Alors le maître de la maison sortit vers eux et leur dit : "Non, mes frères, je vous en prie, ne soyez pas des criminels. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge. Je vous la livrerai. Abuser d'elle et faites ce que bon vous semble, mais ne commettez pas à l'égard de cet homme une pareille infamie". Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent, ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin et, au lever de l'aurore, ils la lâchèrent.
Vers le matin la femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari et elle resta là jusqu'au jour. Au matin son mari se leva et,ayant ouvert la porte de la maison, il sortait pour continuer sa route, quand il vit que la femme, sa concubine, gisait à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. "Lève-toi, lui dit-il, et partons!" Pas de réponse. Alors il la chargea sur son âne et il se mit en route pour rentrer chez lui. Arrivé à la maison, il prit son couteau et, saisissant sa concubine, il la découpa, membre par membre, en douze morceaux, puis l'envoya dans tout le territoire d'Israël. Il donna des ordres à ses émissaires, disant : "Voici ce que vous direz à tous les Israélites : A-t-on jamais vu pareille chose depuis le jour où les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'aujourd'hui? Réfléchissez-y, consultez-vous et prononcez". Et tous ceux qui voyaient, disaient : "Jamais chose pareille n'est arrivée et ne s'est vue depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'aujourd'hui» (Jg. 19. 16-30).
Yahweh
n'abattit pas la foudre sur Gibéa, mais les tribus d'Israël
se portèrent contre la ville, qui refusa de livrer les vauriens. Les Benjamites, qui étaient quand même l'une des douze
tribus d'Israël, tinrent une guerre sans merci aux onze autres
tribus et furent quasiment exterminés. Un viol collectif
s'achevait en massacre. Afin de sauver la fille vierge de son hôte,  le
Lévite sacrifia sa concubine aux habitants de Gibéa qui la
violèrent à mort. C'était déjà en soi un récit peu édifiant!
La réaction du vieillard hôte du Lévite correspond à celle de
Lot, prêt à livrer ses deux filles aux habitants de Sodome. Mais
comme le Lévite n'était pas un ange du ciel, il se déchargea de sa
menace en leur livrant sa concubine et put dormir d'un sommeil
paisible jusqu'au matin. Réalisant que la concubine était morte,
comme une chienne revenant chez son maître après avoir été
battue, poussant son dernier souffle sur le seuil même de
la maison du vieillard qui les avait hébergés. Fidélité de bête. L'avilissement de la
concubine ne pouvait qu'engager Israël dans une guerre civile
meurtrière. Le fait de la dépecer (outrage à un cadavre!) et d'en
expédier les membres par des serviteurs aux douze tribus pour réclamer vengeance, n'ajoute rien de glorieux à l'affaire. Les
deux récits bibliques se rejoignent toutefois sur un constat. Le
mépris des voyageurs par des hôtes non charitables ouvre à de
terribles représailles : destruction par le feu pour Sodome; guerre
civile et massacres pour Gibéa.
le
Lévite sacrifia sa concubine aux habitants de Gibéa qui la
violèrent à mort. C'était déjà en soi un récit peu édifiant!
La réaction du vieillard hôte du Lévite correspond à celle de
Lot, prêt à livrer ses deux filles aux habitants de Sodome. Mais
comme le Lévite n'était pas un ange du ciel, il se déchargea de sa
menace en leur livrant sa concubine et put dormir d'un sommeil
paisible jusqu'au matin. Réalisant que la concubine était morte,
comme une chienne revenant chez son maître après avoir été
battue, poussant son dernier souffle sur le seuil même de
la maison du vieillard qui les avait hébergés. Fidélité de bête. L'avilissement de la
concubine ne pouvait qu'engager Israël dans une guerre civile
meurtrière. Le fait de la dépecer (outrage à un cadavre!) et d'en
expédier les membres par des serviteurs aux douze tribus pour réclamer vengeance, n'ajoute rien de glorieux à l'affaire. Les
deux récits bibliques se rejoignent toutefois sur un constat. Le
mépris des voyageurs par des hôtes non charitables ouvre à de
terribles représailles : destruction par le feu pour Sodome; guerre
civile et massacres pour Gibéa.
 Procuste
est un autre person-nage mythique qui illustre chez les Grecs les
torts qu'un hôte peut faire subir à ses invités. L'expression lit
de Procuste dérive
d'un récit mythologique qui n'a rien à envier aux deux récits
bibliques précédents. Procuste fait partie du cycle des exploits de
Thésée, l'homme qui tua le Minotaure. Retenons le récit qu'en
donne Robert Graves : «En
arrivant à Corydallos, en Attique, Thésée tua le père de Sinis,
Polypémon, surnommé Procuste, qui vivait près de la route et avait
deux lits dans sa maison, l'un petit, l'autre grand. La nuit, il
offrait le gîte aux voyageurs et faisait coucher les
Procuste
est un autre person-nage mythique qui illustre chez les Grecs les
torts qu'un hôte peut faire subir à ses invités. L'expression lit
de Procuste dérive
d'un récit mythologique qui n'a rien à envier aux deux récits
bibliques précédents. Procuste fait partie du cycle des exploits de
Thésée, l'homme qui tua le Minotaure. Retenons le récit qu'en
donne Robert Graves : «En
arrivant à Corydallos, en Attique, Thésée tua le père de Sinis,
Polypémon, surnommé Procuste, qui vivait près de la route et avait
deux lits dans sa maison, l'un petit, l'autre grand. La nuit, il
offrait le gîte aux voyageurs et faisait coucher les  hommes petits
dans le grand lit et il les étirait en leur arrachant les membres
pour les adapter à la longueur du lit; les autres, sur le lit trop
petit, il leur sciait tout ce qui dépassait; certains disent
cependant qu'il n'avait qu'un lit et qu'il allongeait ou
raccourcissait ses clients pour les mettre aux dimensions du lit.
Quoi qu'il en soit, qu'il eût un lit ou bien deux, Thésée le
traita comme il avait traité ses victimes»
(R. Graves. Les
mythes grecs, t. 1, Paris,
Fayard, rééd. Col. Pluriel, # 8399, 1967, p. 351). Évidemment, ce
récit absurde renvoie à la névrose des compulsions de répétition.
Le plaisir sadique d'ajuster des corps qui ne correspondent pas au
meuble traduit une obsession de la norme qui ne se
retrouve pas dans la nature. Il renvoie davantage à des criminels
qui, comme ceux de l'auberge rouge dont nous aurons à reparler, qu'à
des hôtes qui, pour des raisons plus raisonnées, massacrent leurs
invités à la fin d'un banquet.
hommes petits
dans le grand lit et il les étirait en leur arrachant les membres
pour les adapter à la longueur du lit; les autres, sur le lit trop
petit, il leur sciait tout ce qui dépassait; certains disent
cependant qu'il n'avait qu'un lit et qu'il allongeait ou
raccourcissait ses clients pour les mettre aux dimensions du lit.
Quoi qu'il en soit, qu'il eût un lit ou bien deux, Thésée le
traita comme il avait traité ses victimes»
(R. Graves. Les
mythes grecs, t. 1, Paris,
Fayard, rééd. Col. Pluriel, # 8399, 1967, p. 351). Évidemment, ce
récit absurde renvoie à la névrose des compulsions de répétition.
Le plaisir sadique d'ajuster des corps qui ne correspondent pas au
meuble traduit une obsession de la norme qui ne se
retrouve pas dans la nature. Il renvoie davantage à des criminels
qui, comme ceux de l'auberge rouge dont nous aurons à reparler, qu'à
des hôtes qui, pour des raisons plus raisonnées, massacrent leurs
invités à la fin d'un banquet.
Si
nous quittons les mythes et revenons à l'histoire, nous trouvons un
cas plus proche de celui d'Alberigo dans le sort réservé à
Alcibiade. Il n'est pas nécessaire de rappeler la  réputation
d'Alcibiade, l'un des plus beaux fleurons de l'Athènes de
Périclès dont il était le neveu. Né en 450 avant J.-C, Alcibiade
était un esprit doué pour la stratégie militaire bien qu'il fût
connu comme ayant été un élève de Socrate. Doté d'un physique
invitant, Socrate l'avait démasqué en refusant que le jeune
ambitieux partageât sa couche. C'était là un premier dépit qui
devait le conduire plus tard, pendant la
guerre du Péloponnèse (431-404) opposant la ligue péloponésienne
menée par Sparte à Athènes et ses colonies, à trahir sa patrie. À la mort de
Périclès, le contrôle de la ville d'Athènes était passé entre
les mains de Nicias, un adversaire d'Alcibiade. Nicias était
partisan de la paix avec Sparte dont le sort de la cité d'Argos
demeurait la pomme de discorde entre les deux grandes cités grecques.
D'autre part, Corinthe ajoutait à la dissension. C'est alors
qu'Alcibiade décida de dénouer l'impasse en proposant une alliance
avec Argos contre Sparte. Alliance à laquelle se joint Mantinée et
Élis. Ce coup fit d'Alcibiade un stratège dont les Athéniens mesuraient l'habileté. Partisan de la guerre, représentant les intérêts des marchands et
réputation
d'Alcibiade, l'un des plus beaux fleurons de l'Athènes de
Périclès dont il était le neveu. Né en 450 avant J.-C, Alcibiade
était un esprit doué pour la stratégie militaire bien qu'il fût
connu comme ayant été un élève de Socrate. Doté d'un physique
invitant, Socrate l'avait démasqué en refusant que le jeune
ambitieux partageât sa couche. C'était là un premier dépit qui
devait le conduire plus tard, pendant la
guerre du Péloponnèse (431-404) opposant la ligue péloponésienne
menée par Sparte à Athènes et ses colonies, à trahir sa patrie. À la mort de
Périclès, le contrôle de la ville d'Athènes était passé entre
les mains de Nicias, un adversaire d'Alcibiade. Nicias était
partisan de la paix avec Sparte dont le sort de la cité d'Argos
demeurait la pomme de discorde entre les deux grandes cités grecques.
D'autre part, Corinthe ajoutait à la dissension. C'est alors
qu'Alcibiade décida de dénouer l'impasse en proposant une alliance
avec Argos contre Sparte. Alliance à laquelle se joint Mantinée et
Élis. Ce coup fit d'Alcibiade un stratège dont les Athéniens mesuraient l'habileté. Partisan de la guerre, représentant les intérêts des marchands et
 coloniaux athéniens alors que Nicias était la voix de la population
rurale portée à la paix, il engageait le durcis-sement des tensions qui devaient mener à la ruine d'Athènes. Le succès d'Alcibiade fut donc éphémère
et dès 417, il se trouve menacé d'ostracisme par le démagogue
Hyperbolos, son rival auprès des paysans athéniens. Pour éviter la
honte et l'exil, Alcibiade renversa une fois de plus la situation en s'alliant avec Nicias
afin d'ostraciser Hyperbolos.
coloniaux athéniens alors que Nicias était la voix de la population
rurale portée à la paix, il engageait le durcis-sement des tensions qui devaient mener à la ruine d'Athènes. Le succès d'Alcibiade fut donc éphémère
et dès 417, il se trouve menacé d'ostracisme par le démagogue
Hyperbolos, son rival auprès des paysans athéniens. Pour éviter la
honte et l'exil, Alcibiade renversa une fois de plus la situation en s'alliant avec Nicias
afin d'ostraciser Hyperbolos.
Afin de redorer son blason, Alcibiade s'engagea dans une
vaste campagne en Grande Grèce. Une sorte d'Armada se préparait à quitter Athènes pour se rendre en Sicile. Mais les  troubles
politiques vinrent jouer à nouveau contre le vaste projet d'Alcibiade et c'est
une flotte plus réduite qu'on équipât pour se rendre en Méditerranée
occidentale. Entre-temps, sa réputation s'était compromise dans l'affaire des
hermès, ces statues porte-bonheurs du dieu qui marquent les
limites des propriétés publiques et privées qu'on retrouva
mutilées. Véritable sacrilège, le crime était de mauvais augure
juste avant le départ de l'expédition et on appela à dénoncer les
coupables, les hermoscopides. Même
s'il n'était pas mêlé aux hermoscopides, Alcibiade
troubles
politiques vinrent jouer à nouveau contre le vaste projet d'Alcibiade et c'est
une flotte plus réduite qu'on équipât pour se rendre en Méditerranée
occidentale. Entre-temps, sa réputation s'était compromise dans l'affaire des
hermès, ces statues porte-bonheurs du dieu qui marquent les
limites des propriétés publiques et privées qu'on retrouva
mutilées. Véritable sacrilège, le crime était de mauvais augure
juste avant le départ de l'expédition et on appela à dénoncer les
coupables, les hermoscopides. Même
s'il n'était pas mêlé aux hermoscopides, Alcibiade  se trouva
suspecté d'avoir rédigé une parodie des mystères d'Éleusis, ce
qui vint s'entremêler avec l'affaire des hermès. Prompt à se
disculper, Alcibiade demanda d'être traduit en justice afin d'être
innocenté et de bénéficier de la confiance de ses soldats. Par
ruse, ses adversaires obtinrent qu'il quitte Athènes avec la flotte
et qu'on le juge à son retour. Or, peu après son départ, en juin
415, une nouvelle dénonciation le désigna comme ayant joué le
premier rôle, celui de hiérophante (du prêtre) dans
la parodie des mystères d'Éleusis. Condamné à mort
se trouva
suspecté d'avoir rédigé une parodie des mystères d'Éleusis, ce
qui vint s'entremêler avec l'affaire des hermès. Prompt à se
disculper, Alcibiade demanda d'être traduit en justice afin d'être
innocenté et de bénéficier de la confiance de ses soldats. Par
ruse, ses adversaires obtinrent qu'il quitte Athènes avec la flotte
et qu'on le juge à son retour. Or, peu après son départ, en juin
415, une nouvelle dénonciation le désigna comme ayant joué le
premier rôle, celui de hiérophante (du prêtre) dans
la parodie des mystères d'Éleusis. Condamné à mort  par contumace,
ses biens confisqués, son nom inscrit sur une stèle d'infamie, les Athéniens proclamèrent les imprécations officielles. Athènes envoya le navire
officiel, la Salamienne,
avec mission de retrouver et de ramener de Sicile Alcibiade et ses
complices. Alcibiade n'avait plus d'autres choix que de déserter et se
considérer désormais comme en exil. Pour Jacqueline de Romilly,
toute cette affaire n'était au fond qu'une moquerie imprudente et impudente
d'un rite sacré profané par un jeune esprit trop tôt sûr de ses moyens. Que ses ennemis aient voulu faire croire à une
aspiration à la tyrannie de la part d'Alcibiade n'était qu'une
tentative de diversion dans la seule affaire qui comptait réellement : la campagne de
Sicile.
par contumace,
ses biens confisqués, son nom inscrit sur une stèle d'infamie, les Athéniens proclamèrent les imprécations officielles. Athènes envoya le navire
officiel, la Salamienne,
avec mission de retrouver et de ramener de Sicile Alcibiade et ses
complices. Alcibiade n'avait plus d'autres choix que de déserter et se
considérer désormais comme en exil. Pour Jacqueline de Romilly,
toute cette affaire n'était au fond qu'une moquerie imprudente et impudente
d'un rite sacré profané par un jeune esprit trop tôt sûr de ses moyens. Que ses ennemis aient voulu faire croire à une
aspiration à la tyrannie de la part d'Alcibiade n'était qu'une
tentative de diversion dans la seule affaire qui comptait réellement : la campagne de
Sicile.
Celle-ci s'acheva dans la défaite, la défection
d'Alcibiade achevant de ruiner la confiance des troupes. Les Athéniens d'ailleurs, de toute
évidence, avaient sous-estimé les forces en 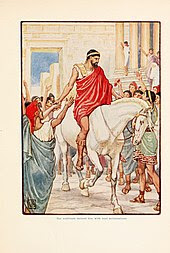 présence en Sicile.
Alcibiade se réfugia à Sparte et devint stratège au service de
l'adversaire d'Athènes. Une fois encore, Alcibiade se tira dans le
pied au moment où Athènes semblait se remettre de ses défaites. Il
aurait été butiner dans le bouquet du roi Agis II en devenant
l'amant de sa femme. Sparte en vint à douter de la loyauté d'un
homme reconnu pour avoir déserté son camp et l'on en arriva à sohaiter sa mort.
Alcibiade fit amende honorable et revint à Athènes en 407, où il
est élu à nouveau stratège dans un accueil triomphal. Ses biens
lui furent restitués et on rétracta les malédictions prononcées
contre lui. Athènes put s'enorgueillir de succès symboliques que
lui fournissait le stratège, mais la situation était mauvaise.
L'écrasement de l'armée athénienne devant la flotte
péloponnésienne au port d'Éphèse, puis la défaite de Notion
entraînèrent la destitution de tous les stratèges athéniens.
Alcibiade décida une fois de plus de s'enfuir dans quelques fortins
qu'il possédait en Thrace. Alors que la flotte athénienne mouille à
Aigos Potamos, Alcibiade rencontre les stratèges nouveaux et suggère
un plan d'attaque; mais on ne l'écoute plus et c'est le coup de
grâce, la défaite d'Aigos Potamos marque la ruine finale d'Athènes,
capitale d'un vaste empire commercial.
présence en Sicile.
Alcibiade se réfugia à Sparte et devint stratège au service de
l'adversaire d'Athènes. Une fois encore, Alcibiade se tira dans le
pied au moment où Athènes semblait se remettre de ses défaites. Il
aurait été butiner dans le bouquet du roi Agis II en devenant
l'amant de sa femme. Sparte en vint à douter de la loyauté d'un
homme reconnu pour avoir déserté son camp et l'on en arriva à sohaiter sa mort.
Alcibiade fit amende honorable et revint à Athènes en 407, où il
est élu à nouveau stratège dans un accueil triomphal. Ses biens
lui furent restitués et on rétracta les malédictions prononcées
contre lui. Athènes put s'enorgueillir de succès symboliques que
lui fournissait le stratège, mais la situation était mauvaise.
L'écrasement de l'armée athénienne devant la flotte
péloponnésienne au port d'Éphèse, puis la défaite de Notion
entraînèrent la destitution de tous les stratèges athéniens.
Alcibiade décida une fois de plus de s'enfuir dans quelques fortins
qu'il possédait en Thrace. Alors que la flotte athénienne mouille à
Aigos Potamos, Alcibiade rencontre les stratèges nouveaux et suggère
un plan d'attaque; mais on ne l'écoute plus et c'est le coup de
grâce, la défaite d'Aigos Potamos marque la ruine finale d'Athènes,
capitale d'un vaste empire commercial.
Le gouvernement d'occupation spartiate d'Athènes, les Trente, décide de frapper une fois de plus Alcibiade d'exil. Le seul endroit où il se sent en sécurité, c'est chez le satrape perse Pharnabaze en Bithynie. Bref séjour. Écoutons Jean Babelon nous raconter, avec une verve toute romanesque, le sort ultime d'Alcibiade :
«Alcibiade vit renouveler sa condamnation à l'exil par le gouvernement des Tyrans. Il chercha à se soustraire à la vengeance des Spartiates et de ceux qu'ils maintenaient au pouvoir. Ses biens d'Athènes avaient été confisqués, son fils âgé de douze ans banni lui aussi. Au printemps, il quitta la Chersonèse et se mit en quête de Pharnabaze.
Or, la situation intérieure de la Perse était changée depuis la mort du roi Darius, en 405. Artaxerxès II Mnémon était monté sur le trône, malgré les menées de son frère Cyrus, dont on connaît les collusions avec les Spartiates. Alcibiade crut pouvoir encore faire son jeu dans cette partie où ses atouts étaient de vieilles rancunes ou de jeunes désirs. La ruse perse eut raison de sa dernière énergie.
Le voici sur les chemins d'Anatolie, toujours à la poursuite de l'aventure, et trompant le souvenir de ses déboires par la vision volontaire d'on ne sait quelle fortune enfin captée. Il est presque seul; ses compagnons sont un ami, un Arcadien fidèle, et cette femme passionnée, Timandra, qui s'attache à ses pas, celle de toutes les ardeurs et de tous les dévouements. À sa suite, quelques esclaves, sans doute, qui portent les bagages et le trésor de l'errant. Les routes sont peu sûres. Des pillards thraces, qui suivent à la piste la petite caravane, s'embusquent et attaquent les porteurs qui s'enfuient. C'est sans ressources et en petit équipage qu'Alcibiade arrive à Dascylion.
Le satrape lui fait bonne mine. Bien plus, il le dédommage de sa perte, le comble de présents et lui octroie les revenus de la ville et du district de Gryneion, en Éolide. Alcibiade, une fois encore, cède à ce goût du luxe et de la mollesse qui fut toujours la contre-partie de sa froide énergie, et que servent si bien l'opulence orientale, l'or abondant, les parfums, les riches étoffes, les femmes nonchalantes et cette facilité asiatique à disposer des êtres et des choses. Pourtant, il prépare son voyage à Suse, et répète les phrases les plus adroites qui lui serviront à investir le cœur du Grand Roi.
Jusque dans l'ombre du palais, dans les salles de fête et dans les corridors, la trahison l'épie. Critias, l'un des Trente d'Athènes, suppôts des Spartiates, envoie un émissaire à Lysandre, alors en Ionie, pour le flatter avec bassesse : la suprématie de Sparte sur la Grèce ne peut se maintenir qu'avec la connivence du gouvernement oligarchique installé à Athènes, et l'oligarchie ne vivra que si l'on écarte, cette fois pour tout de bon, l'éternel gêneur. Déjà de Sparte parvient en Asie une dépêche des éphores. L'ordre est comminatoire; sans ambages, il faut tuer Alcibiade.
Lorsque arrive à Dascylion le message de Lysandre, dans l'hiver de 404, Alcibiade a déjà quitté son hôte. Il est en route pour Suse, et Pharnabaze séduit par la grâce de l'élève de Socrate, se refuse d'abord à obtempérer. Les querelles de ces petits Grecs l'intéressent peu, et c'est précisément de leur concorde qu'il a peu souci. Mais Lysandre insiste et parvient à reconquérir son ascendant : l'alliance est en jeu. Le satrape cède enfin; la vie d'un homme pèse peu à cet Oriental chamarré, qui sait les délices éphémères et la brièveté des jours les plus dorés, les plus fleuris.
Susamithras, l'oncle du prince, et Magaios, son frère, se chargent de l'opération, et se lancent, comme à la chasse d'un fauve, sur la trace de l'homme.
Alcibiade est arrivé à Mélissa, en Phrygie, à mi-chemin des villes de Synnada et de Métropolis. Il est logé dans une petite maison isolée, hors des faubourgs. autour de ce refuge, le désert et la pierraille, un beau terrain pour prendre la bête au gîte.
La nuit, les deux princes et leurs hommes accourent. Contre la maison, sans bruit, on empile des fagots. Tout est prêt. Sur un signe des chefs, les soldats mettent le feu au bûcher, puis se retirent. Les flammes lèchent les parois et s'élancent jusqu'au toit.
Un cri. Est-ce celui de Timandra brusquement éveillée? À la porte ouverte, dans un nuage de fumée, à la lueur du brasier paraît un groupe hagard, la femme, l'Arcadien et Alcibiade nu, une épée à la main. Il a les bras chargés de vêtements et de couvertures qu'il jette sur les flammes pour les étouffer et se frayer un passage. Pour la première fois, il voit clairement sa fin. Il s'échappe, traînant la femme échevelée, et il paraît si vigoureux, si résolu, que les assassins n'osent l'attaquer de près.
La femme est tombée, pleurante et défaite. Alors, vers cette cible unique debout sur un fond d'incendie, pleuvent les traits des invisibles archers perses. Enfin, le noir colosse s'écroule. Un homme bondit avec son poignard courbe. Il tranche la tête, l'emporte, et prend sa course avec toute la bande.
Timandra demeure seule. Elle se lève lentement dans cette désolation. Elle embrasse le corps nu, décapité, ruisselant de sang, et trébuchant dans cette nuit rougeoyante, elle porte le cadavre pesant de son amant jusqu'au bûcher tout préparé, contre le dernier repaire d'Alcibiade.
Plus tard, des gens vinrent, qui enterrèrent les cendres et l'empereur Hadrien, qui savait l'histoire, passant à Mélissa, fit ériger une statue et célébrer des sacrifices, en l'honneur du meilleur et du pire des Athéniens» (J. Babelon. Alcibiade, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1935, pp. 250 à 253).
«La mort d'Alcibiade fut, à l'inverse de sa vie, obscure et misérable, écrit pour sa part Jacqueline de Romilly. Mais elle fut si pathétique qu'aucun mélodrame, jamais, n'eût osé aller jusque-là» (J. de Romilly. Alcibiade, Paris, Éditions de Fallois, rééd. Livre de poche, # 14196, 1995, p. 219). Puis l'historienne développe ensuite ses réflexions :
«D'abord on est frappé, pour tout l'épisode, par cet ensemble de fourberie et de cruauté. Pour une très large mesure, elle est le signe des barbares; et l'on trouvede fréquentes allusions, chez les auteurs grecs, à ces deux défauts des orientaux, qui choquaient tant l'idéal grec. Déjà, on a rencontré, autour d'Alcibiade, la cruauté d'un autre satrape, Tissapherne, dont Plutarque disait qu'il "n'avait lui-même aucune droiture, mais beaucoup de méchanceté et de perversité", et déjà l'on a rencontré la cruauté d'un de ses lieutenants faisant mourir traîtreusement des Grecs de Délos. Les barbares en général passaient aux yeux des Grecs pour être avides de sang et perfides, par contraste avec eux. Et c'est bien ce qui explique la valeur que garde en français le mot "barbare", signifiant "cruel".
En un sens, l'opposition entre ces assassins cachés dans l'ombre et cet homme seul qui sort, sans protection, à travers les flammes et les fait fuir est donc parfaitement symbolique d'une opposition de culture, à laquelle les Grecs étaient fort sensibles. Et la trahison de Pharnabaze, et l'approche nocturne, tout cela porte bien la marque barbare...
[Cette mort] émeut parce que, tout à coup, cet homme, dont on a connu les subterfuges et les intrigues, se révèle dans tout l'éclat de sa force d'âme. Et l'onpense au beau portrait qu'a tracé de lui l'abbé Barthé-lemy dans son Voyage du Jeune Anacharsis : "Il ne fallait pas chercher dans son cœur l'élévation que produit la vertu; mais on y trouvait la hardiesse que donne l'instinct de supériorité. Aucun obstacle, aucun malheur ne pouvait ni le surprendre ni le décourager : il semblait persuadé que, lorsque les âmes d'un certain ordre ne font pas tout ce qu'elles veulent, c'est qu'elles n'osent pas tout ce qu'elles peuvent." Sa conduite devant la mort rend à Alcibiade sa stature de héros». (ibid. pp. 221- 222 et 223).
Platon devait découvrir que les Perses ne détenaient
pas le monopole de la «barbarie».  Le drame de la vie de Platon,
incontestablement, fut le mauvais tour que prit son voyage en Sicile
sur l'invitation de Denys Ier de Syracuse. C'était tenter l'expérience promue dans La République, de joindre le
philosophe au tyran; la sagesse et le Pouvoir. L'idée du pouvoir fort
centré entre les mains d'un roi ou d'un tyran - un dictateur - philosophe avait
de quoi le séduire, surtout qu'il confirmait sa sagesse en
l'invitant, lui, Platon, à venir éduquer sa cour. De son côté,
Platon en était venu à mépriser cette démocratie athénienne qui
avait condamné Socrate. Contre les faiblesses du régime, la vigueur
avec laquelle Denys avait érigé la force de Syracuse était
séduisante : «À Athènes, il le savait, on ne pouvait rien
entreprendre; toute activité politique supposait l'esclavage des
partis, les compromissions, les marchandages. Mais il y avait
l'Occident où une nouvelle Grèce s'était formée, la Sicile
surtout où régnait un homme énergique, Denys, tyran de Syracuse,
qui, peut-être, était accessible aux idées que Platon voulait
propager, à la conception de la vie qui seule, son lui, pouvait
Le drame de la vie de Platon,
incontestablement, fut le mauvais tour que prit son voyage en Sicile
sur l'invitation de Denys Ier de Syracuse. C'était tenter l'expérience promue dans La République, de joindre le
philosophe au tyran; la sagesse et le Pouvoir. L'idée du pouvoir fort
centré entre les mains d'un roi ou d'un tyran - un dictateur - philosophe avait
de quoi le séduire, surtout qu'il confirmait sa sagesse en
l'invitant, lui, Platon, à venir éduquer sa cour. De son côté,
Platon en était venu à mépriser cette démocratie athénienne qui
avait condamné Socrate. Contre les faiblesses du régime, la vigueur
avec laquelle Denys avait érigé la force de Syracuse était
séduisante : «À Athènes, il le savait, on ne pouvait rien
entreprendre; toute activité politique supposait l'esclavage des
partis, les compromissions, les marchandages. Mais il y avait
l'Occident où une nouvelle Grèce s'était formée, la Sicile
surtout où régnait un homme énergique, Denys, tyran de Syracuse,
qui, peut-être, était accessible aux idées que Platon voulait
propager, à la conception de la vie qui seule, son lui, pouvait
 donner le bonheur aux États comme aux individus. C'était une rude
et énergique personnalité que celle de Denys. Il avait plus que
doublé la population de Syracuse en y transportant les habitants
d'autres villes, il avait repoussé les Carthaginois jusqu'à
l'extrémité ouest de l'île. Il s'efforçait d'attirer à sa cour
les poètes et les musiciens. Lui-même se piquait de poésie; il
composait des tragédies dont l'une fut couronnée à Athènes;
flatterie du peuple à un chef puissant plutôt que reconnaissance
d'un véritable talent. Mais Platon se trompait; son entrevue avec
Denys eut des conséquences qu'il ne pouvait pas prévoir; la trop
grande franchise de ses paroles déplut au chef de Syracuse. Platon,
en effet, défendit devant le tyran l'idée essentielle, celle qui
devait lui servir de guide au cours de toute son existence, celle
qu'il avait reçue de Socrate comme un précieux message à
transmettre aux hommes : seule la justice importe en ce monde, seul
l'homme juste est heureux, quelles que soient les conditions
extérieures dans lesquelles il se trouve. Denys, qui avait, au cours
de sa vie, plus d'un acte injuste à se reprocher, ne put supporter
ce courageux enseignement. Avec cet humour féroce qui caractérise
certains hommes d'action, il résolut de mettre à l'épreuve la
constance de Platon, afin de voir si, mis en face des réalités de
la vie, le disciple de Socrate conserverait la même atitude. Or, à
ce moment, Athènes était en guerre avec
donner le bonheur aux États comme aux individus. C'était une rude
et énergique personnalité que celle de Denys. Il avait plus que
doublé la population de Syracuse en y transportant les habitants
d'autres villes, il avait repoussé les Carthaginois jusqu'à
l'extrémité ouest de l'île. Il s'efforçait d'attirer à sa cour
les poètes et les musiciens. Lui-même se piquait de poésie; il
composait des tragédies dont l'une fut couronnée à Athènes;
flatterie du peuple à un chef puissant plutôt que reconnaissance
d'un véritable talent. Mais Platon se trompait; son entrevue avec
Denys eut des conséquences qu'il ne pouvait pas prévoir; la trop
grande franchise de ses paroles déplut au chef de Syracuse. Platon,
en effet, défendit devant le tyran l'idée essentielle, celle qui
devait lui servir de guide au cours de toute son existence, celle
qu'il avait reçue de Socrate comme un précieux message à
transmettre aux hommes : seule la justice importe en ce monde, seul
l'homme juste est heureux, quelles que soient les conditions
extérieures dans lesquelles il se trouve. Denys, qui avait, au cours
de sa vie, plus d'un acte injuste à se reprocher, ne put supporter
ce courageux enseignement. Avec cet humour féroce qui caractérise
certains hommes d'action, il résolut de mettre à l'épreuve la
constance de Platon, afin de voir si, mis en face des réalités de
la vie, le disciple de Socrate conserverait la même atitude. Or, à
ce moment, Athènes était en guerre avec .jpg) Sparte et les deux villes
briguaient l'amitié de Denys. Au moment où Platon se trouvait à
Syracuse, une ambas-sade spartiate séjournait précisément dans
cette ville. Denys fait arrêter Platon, le livre aux Spartiates.
Ceux-ci le considèrent comme prisonnier de guerre, le débarquent
dans l'île d'Égine, à quelque distance d'Athènes, et le font
mettre en vente au marché des esclaves» (G. Méautis. Platon
vivant, Paris, Albin Michel, 1950, pp. 36-37).
Sparte et les deux villes
briguaient l'amitié de Denys. Au moment où Platon se trouvait à
Syracuse, une ambas-sade spartiate séjournait précisément dans
cette ville. Denys fait arrêter Platon, le livre aux Spartiates.
Ceux-ci le considèrent comme prisonnier de guerre, le débarquent
dans l'île d'Égine, à quelque distance d'Athènes, et le font
mettre en vente au marché des esclaves» (G. Méautis. Platon
vivant, Paris, Albin Michel, 1950, pp. 36-37).
On s'imagine la grande humiliation d'un aristocrate
athénien vendu comme un vulgaire prisonnier de guerre. En fait, si
Denys prenait mal les allusions morales du philosophe, il faut
reconnaître que Platon se montrait peu enthousiaste des mœurs de
ses hôtes. Denys  avait construit une cité luxuriante à côté de
laquelle, d'autres cités telle Agrigente, deve-naient des modèles de
farniente. Luxe et raffinement conduisent à la débauche :
«Vivant en goinfrant deux fois par jour et, la nuit, ne jamais
dormir seul, sans compter toutes les pratiques qui sont en harmonie
avec l'existence en question, voilà en effet des habitudes qui,
lorsqu'elles sont pratiquées dès la jeunesse, ne donneront jamais à
aucun des hommes qui sont sous la calotte du ciel la possibilité de
devenir sages [...] et encore moins de devenir tempérants»
(cité in J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris,
Fayard, 2009, p. 40), écrivait Platon dans une de ses lettres.
avait construit une cité luxuriante à côté de
laquelle, d'autres cités telle Agrigente, deve-naient des modèles de
farniente. Luxe et raffinement conduisent à la débauche :
«Vivant en goinfrant deux fois par jour et, la nuit, ne jamais
dormir seul, sans compter toutes les pratiques qui sont en harmonie
avec l'existence en question, voilà en effet des habitudes qui,
lorsqu'elles sont pratiquées dès la jeunesse, ne donneront jamais à
aucun des hommes qui sont sous la calotte du ciel la possibilité de
devenir sages [...] et encore moins de devenir tempérants»
(cité in J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris,
Fayard, 2009, p. 40), écrivait Platon dans une de ses lettres.
Platon avait des attentes démesurées face à Denys. Parce qu'il rêvait, comme il l'écrit, réaliser «l'union de la philosophie avec la puissance», Platon se sentait autoriser de critiquer le tyran envers lequel il «éprouve sans doute les mêmes sentiments que ceux que Lysias et Isocrate ressentent. Denys s'en irrite et voit d'un bon œil le départ du philosophe. Il est en revanche peu probable qu'il ordonne que Platon soit vendu comme esclave» (ibid. p. 63). D'ailleurs, Platon, vite reconnu par l'un de ses disciples, est racheté et peut regagner Athènes en toute sécurité. C'est à son retour (en -387) qu'il fonda son Académie. Cette première mésaventure ne devait pourtant pas le dompter et vingt ans plus tard, Platon entreprit un second voyage à Syracuse, dans le même esprit de devenir le philosophe derrière le prince.
Denys Ier était mort la même année du départ
de Platon, en 367. Son fils, Denys le Jeune lui  succède. Mauvais
fruit d'une bonne graine, Denys le second était dissolu, ivrogne et
montrait peu des qualités de son père. «Il semble n'avoir ni la
culture politique ni les relations néces-saires qui font un homme
d'État», d'autant que la paix n'est toujours pas signée avec
Carthage. Face à lui, son oncle, Dion (409-354) est d'une autre
trempe intellectuelle et politique, supérieure à son neveu : «Il
a de plus pour lui d'être reconnu comme un disciple de Platon. Le
philosophe athénien accepte de revenir à Syracuse pour satisfaire
aux désirs conjoints de Dion et de Denys qui se disent tous les deux
enclins à l'écouter. Sans se faire trop d'illusions [cette
fois] mais soucieux de ne pas apparaître comme un homme se
dérobant à l'action, le philosophe va tenter une nouvelle fois de
transformer un tyran en un roi en lui montrant que le pouvoir ne
repose pas
succède. Mauvais
fruit d'une bonne graine, Denys le second était dissolu, ivrogne et
montrait peu des qualités de son père. «Il semble n'avoir ni la
culture politique ni les relations néces-saires qui font un homme
d'État», d'autant que la paix n'est toujours pas signée avec
Carthage. Face à lui, son oncle, Dion (409-354) est d'une autre
trempe intellectuelle et politique, supérieure à son neveu : «Il
a de plus pour lui d'être reconnu comme un disciple de Platon. Le
philosophe athénien accepte de revenir à Syracuse pour satisfaire
aux désirs conjoints de Dion et de Denys qui se disent tous les deux
enclins à l'écouter. Sans se faire trop d'illusions [cette
fois] mais soucieux de ne pas apparaître comme un homme se
dérobant à l'action, le philosophe va tenter une nouvelle fois de
transformer un tyran en un roi en lui montrant que le pouvoir ne
repose pas  sur la violence mais sur des lois et sur le consentement
des sujets» (ibid. p. 63). Platon pousse même l'audace de
passer une sorte de contrat avec Denys : «Comment faut-il, toi et moi, que nous nous
comportions l'un envers l'autre? Si tu fais fi totalement de la
philosophie, eh bien, dis-lui bonsoir! Mais, si de quelque autre tu
as appris ou que, par toi-même, tu aies trouvé mieux que ce que tu
as trouvé auprès de moi, alors, ces choses-là, honore-les! Si
enfin, d'aventure, ce sont au contraire les enseignements reçus de
moi qui te satisfont, alors c'est moi aussi que tu dois honorer au
plus haut point [...]. Il y a plus : en m'honorant et en prenant,
toi, l'initiative de le faire, c'est la philosophie que tu serais
jugé honorer et cela même (parce que tu as toujours pris en
considération l'opinion des autres) une bonne réputation auprès du
grand public, voilà ce qui te sera conféré comme un vrai
philosophe. De mon côté, si je t'honorais tandis que tu ne
m'honorerais pas, je paraîtrais admirer la richesse et en poursuivre
l'acquisition : or, nous le savons, c'est là une attitude qui, chez
tout le monde, ne porte pas un beau nom! En fin de compte, pour
résumer ma pensée, si tu m'honores, c'est pour l'un et l'autre une
parure; mais, si c'est moi seul qui t'honore, c'est un déshonneur
pour tous les deux. Voilà donc ce que j'avais à te dire là-dessus»
(cité in ibid. pp. 63-64).
sur la violence mais sur des lois et sur le consentement
des sujets» (ibid. p. 63). Platon pousse même l'audace de
passer une sorte de contrat avec Denys : «Comment faut-il, toi et moi, que nous nous
comportions l'un envers l'autre? Si tu fais fi totalement de la
philosophie, eh bien, dis-lui bonsoir! Mais, si de quelque autre tu
as appris ou que, par toi-même, tu aies trouvé mieux que ce que tu
as trouvé auprès de moi, alors, ces choses-là, honore-les! Si
enfin, d'aventure, ce sont au contraire les enseignements reçus de
moi qui te satisfont, alors c'est moi aussi que tu dois honorer au
plus haut point [...]. Il y a plus : en m'honorant et en prenant,
toi, l'initiative de le faire, c'est la philosophie que tu serais
jugé honorer et cela même (parce que tu as toujours pris en
considération l'opinion des autres) une bonne réputation auprès du
grand public, voilà ce qui te sera conféré comme un vrai
philosophe. De mon côté, si je t'honorais tandis que tu ne
m'honorerais pas, je paraîtrais admirer la richesse et en poursuivre
l'acquisition : or, nous le savons, c'est là une attitude qui, chez
tout le monde, ne porte pas un beau nom! En fin de compte, pour
résumer ma pensée, si tu m'honores, c'est pour l'un et l'autre une
parure; mais, si c'est moi seul qui t'honore, c'est un déshonneur
pour tous les deux. Voilà donc ce que j'avais à te dire là-dessus»
(cité in ibid. pp. 63-64).
Platon se montrait prudent, intéressé à ce que ne se
reproduise la mauvaise expérience qui avait mis fin à son premier séjour
à Syracuse. Mais Denys II n'était pas en mesure de  respecter
l'accord de réciprocité proposé par Platon. Lorsqu'on détient un
pouvoir absolu, il est difficile de se soumettre à quel-qu'autre
autorité que se soit. Comme tous les faibles, Denys II devint
paranoïaque. Il bannit son oncle Dion dont les biens furent saisis.
Dion exilé, Platon perdait son principal appui : «Platon vit des
heures difficiles. Il est en résidence surveillée dans la citadelle
d'Ortygie où demeure Denys entouré de ses mercenaires et de ses
partisans qui n'apprécient guère la présence du philosophe»
(ibid. p. 64). Le philosophe voudrait bien
respecter
l'accord de réciprocité proposé par Platon. Lorsqu'on détient un
pouvoir absolu, il est difficile de se soumettre à quel-qu'autre
autorité que se soit. Comme tous les faibles, Denys II devint
paranoïaque. Il bannit son oncle Dion dont les biens furent saisis.
Dion exilé, Platon perdait son principal appui : «Platon vit des
heures difficiles. Il est en résidence surveillée dans la citadelle
d'Ortygie où demeure Denys entouré de ses mercenaires et de ses
partisans qui n'apprécient guère la présence du philosophe»
(ibid. p. 64). Le philosophe voudrait bien  partir et retourner à
Athènes, mais Denys ne veut pas se séparer de lui, et c'est
finalement l'intervention d'Archytas qui fera plier Denys et rendre
sa liberté à Platon. La puissance de Syracuse était en fait sur le
point de s'effondrer dans la guerre civile. Dion revint de son exile
et renversa Denys II... «Mais les circonstances et le tempérament
de Dion ne font pas de lui le philosophe-roi en mesure de transformer
la tyrannie en un régime où la loi prime l'arbitraire. La décennie
qui court de la prise du pouvoir par Dion au retour de Denys est
pleine de bruit et de fureur. L'assassinat de Dion en 354 aggrave
encore les choses» (ibid. p. 65). La riche cité, qui avait
invité par deux fois le philosophe dont la réputation éclipsait
celle des autres sages, s'était montrée une bien piètre
hôtesse, même si l'invité se montrait rigoureux et capricieux.
partir et retourner à
Athènes, mais Denys ne veut pas se séparer de lui, et c'est
finalement l'intervention d'Archytas qui fera plier Denys et rendre
sa liberté à Platon. La puissance de Syracuse était en fait sur le
point de s'effondrer dans la guerre civile. Dion revint de son exile
et renversa Denys II... «Mais les circonstances et le tempérament
de Dion ne font pas de lui le philosophe-roi en mesure de transformer
la tyrannie en un régime où la loi prime l'arbitraire. La décennie
qui court de la prise du pouvoir par Dion au retour de Denys est
pleine de bruit et de fureur. L'assassinat de Dion en 354 aggrave
encore les choses» (ibid. p. 65). La riche cité, qui avait
invité par deux fois le philosophe dont la réputation éclipsait
celle des autres sages, s'était montrée une bien piètre
hôtesse, même si l'invité se montrait rigoureux et capricieux.
Le sort que nous avons vu s'acharner sur Alcibiade
s'acharna de même sur une autre figure militaire de l'Antiquité
classique, celle d'Hannibal Barca (247-±181
av. J.-C.). Hannibal fut  un chef de guerre nettement supérieur à Alcibiade. Durant la deuxième guerre punique opposant Carthage,
sa cité, à Rome (218-202), Hannibal réussit à conduire sa
puissante armée jusqu'aux portes de Rome. L'épisode des éléphants
franchissant les Alpes après avoir remonté les côtes d'Espagne et
de Gaule est resté célèbre. Célèbre également sa tactique
militaire qui lui donna la victoire sur l'armée de Varro le 2 août
216, sur la rive gauche de la rivière Ofanto, dans le sud de
l'Italie, là où les Romains avaient établi leur campement. À la
tête de 50 000 hommes, Hannibal parvint à attirer Varro dans un
piège, finissant par encercler son armée. Aidé de cavaliers
gaulois et numides sur ses flancs, les légions romaines qui
s'étalaient sur un kilomètre et demi finit par s'engouffrer dans la
partie centrale du corps expéditionnaire carthaginois, là les flancs se resserrèrent attaquant la cavalerie de Varro.
L'armée romaine fut tout simplement écrasée.
un chef de guerre nettement supérieur à Alcibiade. Durant la deuxième guerre punique opposant Carthage,
sa cité, à Rome (218-202), Hannibal réussit à conduire sa
puissante armée jusqu'aux portes de Rome. L'épisode des éléphants
franchissant les Alpes après avoir remonté les côtes d'Espagne et
de Gaule est resté célèbre. Célèbre également sa tactique
militaire qui lui donna la victoire sur l'armée de Varro le 2 août
216, sur la rive gauche de la rivière Ofanto, dans le sud de
l'Italie, là où les Romains avaient établi leur campement. À la
tête de 50 000 hommes, Hannibal parvint à attirer Varro dans un
piège, finissant par encercler son armée. Aidé de cavaliers
gaulois et numides sur ses flancs, les légions romaines qui
s'étalaient sur un kilomètre et demi finit par s'engouffrer dans la
partie centrale du corps expéditionnaire carthaginois, là les flancs se resserrèrent attaquant la cavalerie de Varro.
L'armée romaine fut tout simplement écrasée.
Habile
politique autant que fin stratège, Hannibal connaissait bien les
institutions romaines autant que ses acteurs politiques. Rome était
infestée d'espions puniques, souvent de simples  commerçants qui
approvisionnaient d'infor-mations le chef car-thaginois. Mais cette
victoire ne représen-tait rien de décisif. Après la victoire de
Trasimène, l'armée carthaginoise se serait endormie dans les
délices de Capoue. En
fait, c'est Hannibal qui aurait décidé de temporiser, misant sur
l'éventuelle désertion des alliées latins de Rome. En même temps,
il étendait ses forces de plus en plus loin. C'était suffisant pour
que la situation se renverse en faveur des Romains. Hannibal
connaîtra un
commerçants qui
approvisionnaient d'infor-mations le chef car-thaginois. Mais cette
victoire ne représen-tait rien de décisif. Après la victoire de
Trasimène, l'armée carthaginoise se serait endormie dans les
délices de Capoue. En
fait, c'est Hannibal qui aurait décidé de temporiser, misant sur
l'éventuelle désertion des alliées latins de Rome. En même temps,
il étendait ses forces de plus en plus loin. C'était suffisant pour
que la situation se renverse en faveur des Romains. Hannibal
connaîtra un  dernier succès à Herdoniac, mais l'arrivée d'un
nouveau commandant romain, Publius Scipion, surprit les
Carthaginois en prenant Carthagène. Les deux généraux finirent par
se rencontrer le 19 octobre 202 à la bataille de Zama. Les Romains
disposaient d'une meilleure cavalerie alors que la force des Carthaginois
reposait sur l'infanterie. Hannibal essaiera de reproduire
le coup de l'encerclement qui lui avait réussi à Ofanto, mais
prévenus, les Romains ne se laissèrent pas encercler. Ce furent
cette fois les Carthaginois qui furent défaits. Hannibal perdit
près de 40 000 hommes contre 1 500 pour les
Romains. Soumis à une paix pesante par Scipion, les Carthaginois en voulurent à leur ancien général.
dernier succès à Herdoniac, mais l'arrivée d'un
nouveau commandant romain, Publius Scipion, surprit les
Carthaginois en prenant Carthagène. Les deux généraux finirent par
se rencontrer le 19 octobre 202 à la bataille de Zama. Les Romains
disposaient d'une meilleure cavalerie alors que la force des Carthaginois
reposait sur l'infanterie. Hannibal essaiera de reproduire
le coup de l'encerclement qui lui avait réussi à Ofanto, mais
prévenus, les Romains ne se laissèrent pas encercler. Ce furent
cette fois les Carthaginois qui furent défaits. Hannibal perdit
près de 40 000 hommes contre 1 500 pour les
Romains. Soumis à une paix pesante par Scipion, les Carthaginois en voulurent à leur ancien général.
À Carthage, Hannibal
se porta à la tête d'un parti privilégiant un régime démocratique
opposé à un autre prônant l'oligarchie rassemblé autour d'Hannon le Grand riche aristocrate  de Carthage. Élu suffète en 196, Hannibal restaure l'autorité et le
pouvoir de sa faction démocra-tique qui représente une menace pour
les oligarques qui ressortent les critiques du temps de guerre qui
l'accusaient d'avoir trahi Carthage en ne prenant pas d'assaut Rome.
Soupçonnant de détournements de fonds, Hannibal
décide que l'indemnité de guerre annuelle que Carthage devait à
Rome soit directement versée au trésor plutôt que d'être
collectée par les oligarques au travers de taxes extraordinaires.
Ces derniers font alors appel aux Romains qui exigent la reddition
d'Hannibal. Ce dernier choisi volontairement l'exil en 195.
de Carthage. Élu suffète en 196, Hannibal restaure l'autorité et le
pouvoir de sa faction démocra-tique qui représente une menace pour
les oligarques qui ressortent les critiques du temps de guerre qui
l'accusaient d'avoir trahi Carthage en ne prenant pas d'assaut Rome.
Soupçonnant de détournements de fonds, Hannibal
décide que l'indemnité de guerre annuelle que Carthage devait à
Rome soit directement versée au trésor plutôt que d'être
collectée par les oligarques au travers de taxes extraordinaires.
Ces derniers font alors appel aux Romains qui exigent la reddition
d'Hannibal. Ce dernier choisi volontairement l'exil en 195.
Comme
Alcibiade, Hannibal se réfugia en Orient, sous la monarchie des
Séleucide. Commença alors une vie d'errance. Il finit par trouver
refuge en Bithynie auprès du roi  Prusias Ier,
alors en guerre avec un allié de Rome, le roi Eumène II de
Pergamme. De nouveau stratège, il emporte une victoire au dépens
d'Eumène au cours d'une bataille navale durant laquelle il aurait
fait jeter sur les vaisseaux ennemis des jarres de terre cuite
remplies de serpents venimeux. En plus de ses succès militaires,
Hannibal fonde des villes : Prusa d'abord, à la demande du roi
Prusias, qui s'ajoute à Artaxata qui élève Hannibal au rang de
souverain
hellénistique. Comme
toujours, tant de succès soulèvent des inquiétudes. Les Romains,
s'inquiètant de voir leur ancien ennemi consolider ses
rivaux, envoyèrent une ambassade conduite par Titus Quinctius Flaminius
auprès de Prusias afin de
s'assurer de la personne d'Hannibal. Question épineuse. Est-ce
Flaminius qui demanda la tête d'Hannibal où est-ce le Bithynien
qui, pour s'acquérir des bonnes grâces de
Prusias Ier,
alors en guerre avec un allié de Rome, le roi Eumène II de
Pergamme. De nouveau stratège, il emporte une victoire au dépens
d'Eumène au cours d'une bataille navale durant laquelle il aurait
fait jeter sur les vaisseaux ennemis des jarres de terre cuite
remplies de serpents venimeux. En plus de ses succès militaires,
Hannibal fonde des villes : Prusa d'abord, à la demande du roi
Prusias, qui s'ajoute à Artaxata qui élève Hannibal au rang de
souverain
hellénistique. Comme
toujours, tant de succès soulèvent des inquiétudes. Les Romains,
s'inquiètant de voir leur ancien ennemi consolider ses
rivaux, envoyèrent une ambassade conduite par Titus Quinctius Flaminius
auprès de Prusias afin de
s'assurer de la personne d'Hannibal. Question épineuse. Est-ce
Flaminius qui demanda la tête d'Hannibal où est-ce le Bithynien
qui, pour s'acquérir des bonnes grâces de  Rome, décida de trahir
son invité? «Hannibal
était sur ses gardes. Il savait les Romains acharnés à sa
perte..., et ne se faisait aucune illusion sur Prusias, dont il
connaissait la faiblesse. Il avait un refuge à Libyssa, sur la côte
sud de la presqu'île bithynienne, un peu à l'ouest de Nicomédie;
une vraie tanière de renard, à lire Plutarque, avec des entrées et
des sorties multiples : sept souterrains partant de la maison
débouchaient au-dehors. Quand Hannibal fut averti que les soldats de
Prusias étaient déjà dans le vestibule, il envoya des serviteurs
explorer les autres issues. Elles étaient déjà, elles aussi,
gardées par les sbires du roi. Il eut alors recours au poison qu'il
avait toujours sur
Rome, décida de trahir
son invité? «Hannibal
était sur ses gardes. Il savait les Romains acharnés à sa
perte..., et ne se faisait aucune illusion sur Prusias, dont il
connaissait la faiblesse. Il avait un refuge à Libyssa, sur la côte
sud de la presqu'île bithynienne, un peu à l'ouest de Nicomédie;
une vraie tanière de renard, à lire Plutarque, avec des entrées et
des sorties multiples : sept souterrains partant de la maison
débouchaient au-dehors. Quand Hannibal fut averti que les soldats de
Prusias étaient déjà dans le vestibule, il envoya des serviteurs
explorer les autres issues. Elles étaient déjà, elles aussi,
gardées par les sbires du roi. Il eut alors recours au poison qu'il
avait toujours sur  lui, prêt pour une telle éven-tualité. Avant de
lui faire vider la coupe, Tite-Live lui a prêté des ultima
verba évi-demment
fictifs, mais qui nous intéressent pour le reflet qu'ils nous
procurent sans doute de l'émotion que dut causer dans certains
cercles, à Rome et ailleurs, l'élimination peu glorieuse du vieil
homme - Hannibal avait alors soixante-trois ans - : un pauvre oiseau
déplumé par l'âge, dit Plutarque, qu'il eût mieux valu laisser
vivre. En prenant les dieux à témoin de l'inélégance des Romains
et de la traîtrise de Prusias, Hannibal retournait in
fine contre
Rome l'accusation, cent fois lancée contre lui-même, de fides
Punica» (S. Lancel. Hannibal,
Paris,
Fayard, 1995, pp. 336-337).
lui, prêt pour une telle éven-tualité. Avant de
lui faire vider la coupe, Tite-Live lui a prêté des ultima
verba évi-demment
fictifs, mais qui nous intéressent pour le reflet qu'ils nous
procurent sans doute de l'émotion que dut causer dans certains
cercles, à Rome et ailleurs, l'élimination peu glorieuse du vieil
homme - Hannibal avait alors soixante-trois ans - : un pauvre oiseau
déplumé par l'âge, dit Plutarque, qu'il eût mieux valu laisser
vivre. En prenant les dieux à témoin de l'inélégance des Romains
et de la traîtrise de Prusias, Hannibal retournait in
fine contre
Rome l'accusation, cent fois lancée contre lui-même, de fides
Punica» (S. Lancel. Hannibal,
Paris,
Fayard, 1995, pp. 336-337).
Prusias fut-il vraiment ce traître dont parlent les historiens latins? D'autres références rappellent que «Prusias, sans aller jusqu'à braver le Sénat, protesta pourtant contre une demande qui lui aurait fait violer les lois de l'hospitalité. Puisque les Romains désiraient s'emparer d'Annibal, il leur appartenait de venir le capturer!» (G. P. Baker. Annibal, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1952, pp. 295-296). À peu près au même moment mourait Publius Scipion - qui avait pris le surnom d'Africain -, son ombre romaine.
L'ombre
de la Grèce et de Rome pesa sur la Renaissance occidentale, rappelant
ces moments où Grecs et Romains pouvaient tout autant se montrer leurs fidèles élèves en barbarie. La 1.jpeg) façon dont Alberigo dei Manfredi fit massacrer ses invités, ses parents, montre qu'ils pouvaient aller bien plus loin encore dans les outrages faits à leurs invités. La parole des princes italiens du XVe siècle ne valait pas mieux que celles de Pharnabaze ou de Prusias. On s'interroge ainsi de la façon de recevoir un réfugié pour ensuite en faire son otage et le négocier comme une marchandise sur le marché international. Ce fut ce qui arriva au malhleureux prince Zizim (1459-1496), dit aussi Djem :
façon dont Alberigo dei Manfredi fit massacrer ses invités, ses parents, montre qu'ils pouvaient aller bien plus loin encore dans les outrages faits à leurs invités. La parole des princes italiens du XVe siècle ne valait pas mieux que celles de Pharnabaze ou de Prusias. On s'interroge ainsi de la façon de recevoir un réfugié pour ensuite en faire son otage et le négocier comme une marchandise sur le marché international. Ce fut ce qui arriva au malhleureux prince Zizim (1459-1496), dit aussi Djem :
«Fils cadet du sultan ottoman Mehmet II, Djem tente, en 1481, à la mort de son père, de s'emparer du trône de Constantinople. Mais son frère aîné, Bayezid II (Bajazet II) est plus rapide et plus efficace, et Djem, acculé par les  défaites, se trouve contraint de se réfugier à Rhodes en 1482 auprès des Hospitaliers de Saint-Jean. Mais ses hôtes voient en lui un otage possible, aussi le cèdent-ils à la France, ce qui arrange également son frère, le sultan Bayazid II, qui accepte de verser la somme de 45 000 ducats d'or par an pour son entretien et sa détention. En 1489, Djem est "transféré", aux mêmes conditions à Rome où, confié à la garde du pape Innocent VIII, puis Alexandre VI, il est détenu au Vatican puis au château Saint-Ange. Recevant
défaites, se trouve contraint de se réfugier à Rhodes en 1482 auprès des Hospitaliers de Saint-Jean. Mais ses hôtes voient en lui un otage possible, aussi le cèdent-ils à la France, ce qui arrange également son frère, le sultan Bayazid II, qui accepte de verser la somme de 45 000 ducats d'or par an pour son entretien et sa détention. En 1489, Djem est "transféré", aux mêmes conditions à Rome où, confié à la garde du pape Innocent VIII, puis Alexandre VI, il est détenu au Vatican puis au château Saint-Ange. Recevant  régulièrement des envoyés de son frère pour s'assurer qu'il est toujours en vie, Djem rêve de s'enfuir et fait même des projets d'évasion avec les Vénitiens. Toutefois il est devenu un enjeu majeur dans la géopolitique méditerranéenne : pour le sultan ottoman, il reste un prétendant menaçant, quand pour la chrétienté, il est un atout dans la confrontation avec l'Orient. Le pape y voit une source de revenu commode, mais également un moyen de chantage face à l'impérialisme ottoman : c'est dans ce sens que son rôle est envisagé par un traité d'alliance entre Venise, Milan et la papauté de 1493. Cet équilibre fragile est bouleversé par le projet de croisade élaboré par Charles VIII en 1494, dans la foulée de ses
régulièrement des envoyés de son frère pour s'assurer qu'il est toujours en vie, Djem rêve de s'enfuir et fait même des projets d'évasion avec les Vénitiens. Toutefois il est devenu un enjeu majeur dans la géopolitique méditerranéenne : pour le sultan ottoman, il reste un prétendant menaçant, quand pour la chrétienté, il est un atout dans la confrontation avec l'Orient. Le pape y voit une source de revenu commode, mais également un moyen de chantage face à l'impérialisme ottoman : c'est dans ce sens que son rôle est envisagé par un traité d'alliance entre Venise, Milan et la papauté de 1493. Cet équilibre fragile est bouleversé par le projet de croisade élaboré par Charles VIII en 1494, dans la foulée de ses  ambitions italiennes. En effet, Charles VIII entend reprendre Djem Sultan et l'employer dans sa croisade... Arrivé à Rome en décembre 1494, le roi de France use de la menace pour arracher au pape un accord, et la remise de l'otage, le 27 janvier 1495. L'accord en soi est significatif de ce que "vaut" désormais le prince ottoman : Charles VIII s'engage à verser 20 000 ducats au pape Alexandre VI - qui lui cède pour six mois Djem, avec son soutien à la croisade accordée du bout des lèvres - ainsi qu'une caution démesurée de 500 000 ducats... Djem peut bien fantasmer au sujet d'une croisade qui le rétablirait sur le trône ottoman, les enjeux le dépassent. Charles VIII imagine que Djem pourrait être converti, baptisé et installé sur le trône d'un Empire ottoman qui se christianiserait dans la foulée... De son côté, Bayezid II a proposé au roi français la couronne de Jérusalem (depuis 1498) en échange de la détention de son frère et d'une alliance contre les Mamelouks du Caire, lesquels offrent la même couronne au roi en échange d'une alliance épaulée par Djem... La mort de ce dernier, à Naples, en 1495, solde l'affaire, et les guerres d'Italie anéantiront les rêves de croisade de Charles VIII. Mais l'épisode de l'otage ottoman préfigure le devenir des otages, monnayables à la fois financièrement et politiquement, enjeux d'une politique qui ne se fait plus à hauteur d'hommes» (G. Ferragu. Otages, une histoire, Paris, Gallimard, Col. Folio-Histoire, # 294, 2020, pp. 94 à 96).
ambitions italiennes. En effet, Charles VIII entend reprendre Djem Sultan et l'employer dans sa croisade... Arrivé à Rome en décembre 1494, le roi de France use de la menace pour arracher au pape un accord, et la remise de l'otage, le 27 janvier 1495. L'accord en soi est significatif de ce que "vaut" désormais le prince ottoman : Charles VIII s'engage à verser 20 000 ducats au pape Alexandre VI - qui lui cède pour six mois Djem, avec son soutien à la croisade accordée du bout des lèvres - ainsi qu'une caution démesurée de 500 000 ducats... Djem peut bien fantasmer au sujet d'une croisade qui le rétablirait sur le trône ottoman, les enjeux le dépassent. Charles VIII imagine que Djem pourrait être converti, baptisé et installé sur le trône d'un Empire ottoman qui se christianiserait dans la foulée... De son côté, Bayezid II a proposé au roi français la couronne de Jérusalem (depuis 1498) en échange de la détention de son frère et d'une alliance contre les Mamelouks du Caire, lesquels offrent la même couronne au roi en échange d'une alliance épaulée par Djem... La mort de ce dernier, à Naples, en 1495, solde l'affaire, et les guerres d'Italie anéantiront les rêves de croisade de Charles VIII. Mais l'épisode de l'otage ottoman préfigure le devenir des otages, monnayables à la fois financièrement et politiquement, enjeux d'une politique qui ne se fait plus à hauteur d'hommes» (G. Ferragu. Otages, une histoire, Paris, Gallimard, Col. Folio-Histoire, # 294, 2020, pp. 94 à 96).
Or, le prince Djem fut-il, comme on l'a maintes fois rapporté, victime des poisons des Borgia? Le sultan Bayezid avait effectivement suggéré au pape, tenu par une entente forcée  avec le roi de France, d'«enlever Djem aux misères de cette terre» assorti de 300 000 ducats d'or en plus d'une assistance mutuelle et perpé-tuelle. Lettre apocryphe a-t-on dit. Toutefois, cela traduisait assez bien la nature des pourparlers secrets qui devaient en arriver à la même conclusion. Pour Giuseppe Portigliotti, des tractations d'Alexandre avec Ferdinand d'Aragon lui aurait fait confier la garde de Djem à son fils, le cardinal César Borgia. Ce faisant, note l'historien italien, «il est évident que le pape accordait à sa possession une trop jalouse attention pour qu'elle fût légitimée par la simple crainte de perdre la pension annuelle.
avec le roi de France, d'«enlever Djem aux misères de cette terre» assorti de 300 000 ducats d'or en plus d'une assistance mutuelle et perpé-tuelle. Lettre apocryphe a-t-on dit. Toutefois, cela traduisait assez bien la nature des pourparlers secrets qui devaient en arriver à la même conclusion. Pour Giuseppe Portigliotti, des tractations d'Alexandre avec Ferdinand d'Aragon lui aurait fait confier la garde de Djem à son fils, le cardinal César Borgia. Ce faisant, note l'historien italien, «il est évident que le pape accordait à sa possession une trop jalouse attention pour qu'elle fût légitimée par la simple crainte de perdre la pension annuelle.  Djem était un gage précieux entre ses mains et si un accord tacite avec Bajazet II n'était pas encore conclu, il pouvait toujours avoir lieu à la satis-faction de tous deux, au détriment du mal-heureux prisonnier (G. Portigliotti. Les Borgia, Paris, Payot, 1953, p. 87). Charles VIII avait obtenu du pape la «consigne» du prince Djem, mais accompagné par le cardinal Borgia, emmenés tous deux au camp français de Naples avec un statut d'otages. César parvint à s'enfuir déguisé en garçon d'écurie alors que Djem décédait subitement. Considérant la réputation de la famille, on ne tarda pas à accuser les poisons des Borgia d'avoir libéré Djem des misères de cette terre!
Djem était un gage précieux entre ses mains et si un accord tacite avec Bajazet II n'était pas encore conclu, il pouvait toujours avoir lieu à la satis-faction de tous deux, au détriment du mal-heureux prisonnier (G. Portigliotti. Les Borgia, Paris, Payot, 1953, p. 87). Charles VIII avait obtenu du pape la «consigne» du prince Djem, mais accompagné par le cardinal Borgia, emmenés tous deux au camp français de Naples avec un statut d'otages. César parvint à s'enfuir déguisé en garçon d'écurie alors que Djem décédait subitement. Considérant la réputation de la famille, on ne tarda pas à accuser les poisons des Borgia d'avoir libéré Djem des misères de cette terre!
Le Britannique Collison-Morley doute que «le poison lent des Borgia, probablement mythique, devait être en effet merveilleux s'il eut la propriété de devenir fatal à Djem un mois après qu'il lui eut été administré par César». Le commentaire de l'évêque Johann  Burchard, chroniqueur peu amène des Borgia, se montre plutôt perplexe : «Burchard dit que "Gem" mourut d'avoir mangé ou bu quelque chose qui ne lui convenait pas. L'envoyé mantouan crut qu'il était mort de mort naturelle, mais nombre de gens prétendent qu'on lui avait donné quelque chose à boire, expression sibylline qui ne se rencontre que trop fréquemment dans les dépêches ultérieures de Rome. Le Conseil des Dix à Venise, qui n'était pas ami d'Alexandre, écrivit à leur ambassadeur à Constantinople que Djem avait mal à la gorge en quittant Rome et que le rhume lui était ensuite tombé sur la poitrine. Cela parut raisonnable dans le cas d'un homme qui avait fait un long voyage en hiver après une réclusion assez prolongée. Ludovic le More lui-même n'avait aucun doute à ce sujet. Et on ne voit pas très bien ce que le pape avait à gagner si Djem mourait étant au pouvoir de Charles» (L. Collison-Morley. Histoire des Borgia, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1951, pp. 77-78).
Burchard, chroniqueur peu amène des Borgia, se montre plutôt perplexe : «Burchard dit que "Gem" mourut d'avoir mangé ou bu quelque chose qui ne lui convenait pas. L'envoyé mantouan crut qu'il était mort de mort naturelle, mais nombre de gens prétendent qu'on lui avait donné quelque chose à boire, expression sibylline qui ne se rencontre que trop fréquemment dans les dépêches ultérieures de Rome. Le Conseil des Dix à Venise, qui n'était pas ami d'Alexandre, écrivit à leur ambassadeur à Constantinople que Djem avait mal à la gorge en quittant Rome et que le rhume lui était ensuite tombé sur la poitrine. Cela parut raisonnable dans le cas d'un homme qui avait fait un long voyage en hiver après une réclusion assez prolongée. Ludovic le More lui-même n'avait aucun doute à ce sujet. Et on ne voit pas très bien ce que le pape avait à gagner si Djem mourait étant au pouvoir de Charles» (L. Collison-Morley. Histoire des Borgia, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1951, pp. 77-78).
Il est vrai, en apparence du moins, que la disparition du prince Djem ne servait pas les intérêts des Borgia. Alexandre avait été contraint de le laisser «en consigne» au roi de France, avec son fils César : «En gage de la bonne exécution de l'accord, le pape avait  donné deux otages : l'un était le prince Djem, mais il était entendu que le roi le restituerait quatre mois plus tard. L'autre était César Borgia. Charles VIII attachait une grande importance au fait de garder près de lui le frère de Bajazet, qui lui permettait de tenir en échec le Grand Turc, et le fils du pape, qu'Alexandre VI adorait. Le pauvre Djem ne devait pas demeurer longtemps sous la tutelle du Valois; il mourut le 25 février, et Commines prétend qu'il "fut empoisonné". C'est aussi l'opinion de Sanudo, qui parle d'"un poison à retardement" qui ne devait faire son effet qu'un mois environ après le départ de Rome. Il est plus vraisemblable que tombé malade dans ce dur hiver de 1495, traîné à la suite de l'armée à travers toutes les intempéries, le pauvre Djem, mal soigné, négligé, délaissé, n'a pas résisté aux fatigues de ce voyage» (M. Brion. Les Borgia, Paris, Tallendier, Col. Texto, 2011, pp. 122-123). Bien qu'il apparaisse que les Borgia ne fussent point à l'origine de la mort du prince Djem, d'autres questions demeurent toutefois sans réponse :
donné deux otages : l'un était le prince Djem, mais il était entendu que le roi le restituerait quatre mois plus tard. L'autre était César Borgia. Charles VIII attachait une grande importance au fait de garder près de lui le frère de Bajazet, qui lui permettait de tenir en échec le Grand Turc, et le fils du pape, qu'Alexandre VI adorait. Le pauvre Djem ne devait pas demeurer longtemps sous la tutelle du Valois; il mourut le 25 février, et Commines prétend qu'il "fut empoisonné". C'est aussi l'opinion de Sanudo, qui parle d'"un poison à retardement" qui ne devait faire son effet qu'un mois environ après le départ de Rome. Il est plus vraisemblable que tombé malade dans ce dur hiver de 1495, traîné à la suite de l'armée à travers toutes les intempéries, le pauvre Djem, mal soigné, négligé, délaissé, n'a pas résisté aux fatigues de ce voyage» (M. Brion. Les Borgia, Paris, Tallendier, Col. Texto, 2011, pp. 122-123). Bien qu'il apparaisse que les Borgia ne fussent point à l'origine de la mort du prince Djem, d'autres questions demeurent toutefois sans réponse :
«À l'entrée du roi à Capoue, le frère du sultan chevauche au côté du souverain,mais il tient à peine à cheval, car il souffre de violentes douleurs dans la tête et la gorge. Les jours suivants, le mal gagne la poitrine. On doit porter le prince en litière à Aversa puis à Naples où Charles VIII entre le 22 février. Les médecins du roi ne peuvent rien contre cette maladie mystérieuse. Le 25 février, âgé de trente-cinq ans, Djem meurt, certainement d'une pneumonie résultant d'une bronchite.
Comme on le fait souvent lors de la mort subite d'un prince, on parle de poison. D'abord le cérémoniaire Burckard, Djem aurait absorbé "un aliment ou un breuvage qui ne convenait pas à son estomac et dont il n'avait pas l'habitude". L'hypothèse de l'empoisonnement est ainsi discrètement formulée. L'historiographe vénitien Mario Sanudo croit savoir que le cadavre présentait des signes non équivoques de mort par le poison. Il se fait l'écho des rumeurs : "Le pape aurait livré au roi le prince empoisonné", mais il ajoute tout aussitôt qu'il s'agit là d'une "accusation à laquelle on ne doit pas ajouter foi car c'eût été au détriment du pape tout le premier". Certes le décès ne semble pas profiter à Alexandre VI : il perd les 40 000 ducats de rente annuelle versés par Bajazet II pour la pension de son frère. Mais les ennemis d'Alexandre VI se souviennent opportunément que, dans des lettres adressées au pape, saisies à l'automne de 1494, le sultan lui a offert 300 000 ducats contre la suppression de Djem. Si aucune trace n'existe d'un tel transfert d'argent, le fait que plus tard Alexandre essaiera de se faire payer la remise du cadavre à Bajazet est pour le moins troublant. Les Turcs eux-mêmes croyaient à l'empoisonnement : le chroniqueur Seadeddin supposait qu'un barbier avait inoculé le poison du pape à l'aide du rasoir.
Ainsi de toutes parts, débute une véritable campagne de calomnie à l'égard des Borgia. Murmurée par les contemporains, l'accusation se retrouve amplifiée chezleurs successeurs. Au siècle suivant l'historien italien Paul Jove se prononce pour l'empoisonnement : "C'était une opinion générale que le pape par haine du roi de France et pour gagner la récompense promise par le sultan, avait fait mêler une poudre mortelle au sucre que Djem mettait dans toutes ses boissons. C'était une poudre très blanche, d'un goût non désagréable, qui n'opprimait pas subitement les esprits vitaux comme les poisons d'aujourd'hui, mais qui se glissait peu à peu dans les veines en amenant tardivement la mort". Guichardin porte la même accusation et ajoute que la nature criminelle du pontife rend vraisemblable un
tel forfait. Le poison employé aurait été soit de l'arsenic, soit de la poudre de cantharide obtenue par la dessiccation de petits scarabées : la cantharide procure à petite dose un effet aphrodisiaque et à dose moyenne des lésions internes capables de provoquer la mort. La légende du poison lent des Borgia allait connaître une belle fortune littéraire à partir de ces quelques suppositions.
Ne souhaitant pas envenimer ses rapports avec le Saint-Siège, Charles VIII avait préféré opter pour l'hypohtèse d'une mort naturelle. Il avait fait embaumer le cadavre et l'avait déposé dans le château de Gaàte : les restes de l'otage ne devaient être transportés que quatre ans plus tard, en 1499, dans la nécropole de ses ancêtres à Bursa en Anatola.
Il est incontestable que la mort de Djem profitait indirectement au pape et à tous ceux qui, en Italie, se déclaraient maintenant hostiles à la venue du roi de France : en effet elle retirait à Charles VIII l'atout dont il pensait se servir pour la croisade après avoir effectué la conquête de Naples. Le mobile religieux du roi ayant disparu. Alexandre pouvait s'allier à Venise et à Milan pour enfermer Charles dans un piège en interrompant ses liaisons avec la base arrière du duc d'Orléans, resté au Piémont, et avec la France» (I. Cloulas. Les Borgia, Paris, Fayard, 1987, pp. 156 à 158).
 pour fuir ceux que son frère avait
envoyés pour le tuer passa du statut de réfugié à celui d'otage,
enfin en monnaie de négo-ciation diploma-tique.
Qu'il fût vivant ou mort, Djem ne valait rien en lui-même,
seulement en tant que stratégie ou tactique dans des négociations où il n'avait pas son mot à dire entre la France, Rome, Venise et Constantinople. L'ancienne
trahison brutale des barbares s'était enrichie du diktat de la raison d'État. Ce sont ces mêmes rapports de force
qui devaient sceller le sort de Marie, reine d'Écosse.
pour fuir ceux que son frère avait
envoyés pour le tuer passa du statut de réfugié à celui d'otage,
enfin en monnaie de négo-ciation diploma-tique.
Qu'il fût vivant ou mort, Djem ne valait rien en lui-même,
seulement en tant que stratégie ou tactique dans des négociations où il n'avait pas son mot à dire entre la France, Rome, Venise et Constantinople. L'ancienne
trahison brutale des barbares s'était enrichie du diktat de la raison d'État. Ce sont ces mêmes rapports de force
qui devaient sceller le sort de Marie, reine d'Écosse.
Marie Stuart (1542-1587) fut reine d'Écosse mais elle ne fut pas la reine des Écossais. Jouet de forces
considérablement plus puissantes que ses capacités politiques, elle n'avait ni le  sens de l'État que
disposaient des femmes comme Catherine de Médicis ou Élisabeth
d'Angleterre, ni leur intelligence pour savoir quand et comment tirer son épingle de jeu qui
la dominait. Inconnue au départ des Écossais, elle devint vite haïe de la population, victime des campagnes menées contre elle par le prédicateur calviniste John Knox. Ainsi passa-t-elle d'une cour aux mœurs sans doutes
cruelles mais raffinées de la Renaissance française à la brutalité
sauvage d'une Écosse encore toute médiévale. Comme Djem, elle n'était rien qu'un instrument, aussi bien entre les mains des
Valois, lorsqu'elle était reine de France aux côtés du falot François
II, que de son cousin et époux, Henry Stuart - lord Darnley - qu'elle
fît assassiner avec l'aide de son amant Bothwell qu'elle épousa
sous le rite protestant, suscitant l'ire de la confédération des
nobles écossais. Emprisonnée au château de Loch Leven, situé sur
une île au milieu du loch, en juin 1567, elle abdiqua le 24 juillet
en faveur de son fils Jacques, âgé alors d'un an. Si elle avait eu
plus de discernement que d'ambition, aurait-elle utilisée cette
situation comme une occasion de devenir autre chose qu'une reine
malheureuse. Malheureusement, elle s'évada le 2 mai 1568 et leva une
petite armée dans l'espoir de récupérer son trône.
sens de l'État que
disposaient des femmes comme Catherine de Médicis ou Élisabeth
d'Angleterre, ni leur intelligence pour savoir quand et comment tirer son épingle de jeu qui
la dominait. Inconnue au départ des Écossais, elle devint vite haïe de la population, victime des campagnes menées contre elle par le prédicateur calviniste John Knox. Ainsi passa-t-elle d'une cour aux mœurs sans doutes
cruelles mais raffinées de la Renaissance française à la brutalité
sauvage d'une Écosse encore toute médiévale. Comme Djem, elle n'était rien qu'un instrument, aussi bien entre les mains des
Valois, lorsqu'elle était reine de France aux côtés du falot François
II, que de son cousin et époux, Henry Stuart - lord Darnley - qu'elle
fît assassiner avec l'aide de son amant Bothwell qu'elle épousa
sous le rite protestant, suscitant l'ire de la confédération des
nobles écossais. Emprisonnée au château de Loch Leven, situé sur
une île au milieu du loch, en juin 1567, elle abdiqua le 24 juillet
en faveur de son fils Jacques, âgé alors d'un an. Si elle avait eu
plus de discernement que d'ambition, aurait-elle utilisée cette
situation comme une occasion de devenir autre chose qu'une reine
malheureuse. Malheureusement, elle s'évada le 2 mai 1568 et leva une
petite armée dans l'espoir de récupérer son trône.
Plus
d'une semaine après son évasion, à la bataille de Langside, le 13
mai, elle prit le parti  de se réfugier chez sa cousine Élisabeth, en
Angleterre. Pourquoi en Angleterre? Comme se le demande Stefan Zweig,
elle aurait pu «aller
en France, en Espagne, en Angleterre. C'est en France qu'elle a été
élevée, là elle a des parents et des amis; nombreux y sont encore
ceux qui l'aiment, les poètes qui l'ont chantée, les gentilshommes
qui l'ont escortée; jadis ce pays l'a traité avec la plus large
hospitalité, et l'a couronnée avec faste et magnificence. Mais
c'est précisément parce qu'elle y fut reine, parce qu'elle y vécut
au milieu d'un luxe unique au monde, parce qu'elle y a été la
première parmi les premières, qu'elle ne veut pas y retourner en
mendiante, en suppliante, les vêtements déchirés, l'honneur
entaché. Elle ne veut pas affronter le sourire ironique de Catherine
de Médicis, la haineuse Italienne, ni recevoir l'aumône ou se
laisser
de se réfugier chez sa cousine Élisabeth, en
Angleterre. Pourquoi en Angleterre? Comme se le demande Stefan Zweig,
elle aurait pu «aller
en France, en Espagne, en Angleterre. C'est en France qu'elle a été
élevée, là elle a des parents et des amis; nombreux y sont encore
ceux qui l'aiment, les poètes qui l'ont chantée, les gentilshommes
qui l'ont escortée; jadis ce pays l'a traité avec la plus large
hospitalité, et l'a couronnée avec faste et magnificence. Mais
c'est précisément parce qu'elle y fut reine, parce qu'elle y vécut
au milieu d'un luxe unique au monde, parce qu'elle y a été la
première parmi les premières, qu'elle ne veut pas y retourner en
mendiante, en suppliante, les vêtements déchirés, l'honneur
entaché. Elle ne veut pas affronter le sourire ironique de Catherine
de Médicis, la haineuse Italienne, ni recevoir l'aumône ou se
laisser  enfermer dans un couvent. Chercher un asile auprès du
glacial Philippe II serait aussi humiliant : jamais cette cour bigote
ne lui pardonnerait de s'être fait unir à Bothwell par un prêtre
protestant, d'avoir reçu la bénédiction d'un hérétique. Il lui
reste l'Angleterre. Durant les jours sans espoir de sa captivité à
Lochleven, Élisabeth ne lui a-t-elle pas fait savoir pour
l'encourager "qu'elle pouvait en tout temps compter sur la reine
d'Angleterre comme sur une amie dévouée"? Ne lui a-t-elle pas
promis solennellement de la rétablir sur son trône? Ne lui a-t-elle
pas envoyé une bague qui est le gage d'une amitié à laquelle elle
peut faire appel à tout moment?»
(S. Zweig. Marie
Stuart, Paris,
Grasset, rééd. Livre de poche, Col. historique, # 337-338, s.d., p.
350). C'était suffisant pour que Marie accepte ce qui avait tout
l'air d'une invitation à gagner l'Angleterre voisine.
enfermer dans un couvent. Chercher un asile auprès du
glacial Philippe II serait aussi humiliant : jamais cette cour bigote
ne lui pardonnerait de s'être fait unir à Bothwell par un prêtre
protestant, d'avoir reçu la bénédiction d'un hérétique. Il lui
reste l'Angleterre. Durant les jours sans espoir de sa captivité à
Lochleven, Élisabeth ne lui a-t-elle pas fait savoir pour
l'encourager "qu'elle pouvait en tout temps compter sur la reine
d'Angleterre comme sur une amie dévouée"? Ne lui a-t-elle pas
promis solennellement de la rétablir sur son trône? Ne lui a-t-elle
pas envoyé une bague qui est le gage d'une amitié à laquelle elle
peut faire appel à tout moment?»
(S. Zweig. Marie
Stuart, Paris,
Grasset, rééd. Livre de poche, Col. historique, # 337-338, s.d., p.
350). C'était suffisant pour que Marie accepte ce qui avait tout
l'air d'une invitation à gagner l'Angleterre voisine.
 Malheureusement
encore, bien des compagnons qui l'avaient accompagnée dans cette
fuite pensaient déjà à une conquête de l'Angleterre par la reine
catholique d'Écosse : «En
posant le pied sur la grève du petit port de Workington, dans le
comté de Cumberland, Marie Stuart trébucha et tomba. Ses compagnons
affectèrent d'y voir un heureux présage : c'était pour mieux
prendre possession de son futur royaume qu'elle en avait ainsi
embrassé le sol. Telle était la force des illusions»
(M. Duchein. Marie
Stuart, Paris,
Fayard, 1987, p. 359). Si elle avait attendue avant de quitter le sol
écossais, elle aurait pu prendre connaissance de la lettre envoyée
par sa cousine Élisabeth : «Ayant
appris l'heureuse nouvelle de votre évasion, mon affection pour vous
et mon sens de la dignité royale m'engagent à vous écrire aussitôt
[...]. Dans le passé, vous vous êtes peu souciée de votre état et
de votre honneur. Je vous le dirais en face si je vous voyais en
personne. Si vous aviez montré autant d'intérêt pour votre
réputation que pour ce misérable vaurien, le monde entier aurait
compati à vos malheurs, ce qui, pour dire la vérité, n'a pas été
le cas de beaucoup [...]. Je vous dis là ce que je me dirais à
moi-même si j'étais dans la même situation que vous»
(citée in ibid. p. 360). Sur ce, Marie débarquait en Angleterre où
Malheureusement
encore, bien des compagnons qui l'avaient accompagnée dans cette
fuite pensaient déjà à une conquête de l'Angleterre par la reine
catholique d'Écosse : «En
posant le pied sur la grève du petit port de Workington, dans le
comté de Cumberland, Marie Stuart trébucha et tomba. Ses compagnons
affectèrent d'y voir un heureux présage : c'était pour mieux
prendre possession de son futur royaume qu'elle en avait ainsi
embrassé le sol. Telle était la force des illusions»
(M. Duchein. Marie
Stuart, Paris,
Fayard, 1987, p. 359). Si elle avait attendue avant de quitter le sol
écossais, elle aurait pu prendre connaissance de la lettre envoyée
par sa cousine Élisabeth : «Ayant
appris l'heureuse nouvelle de votre évasion, mon affection pour vous
et mon sens de la dignité royale m'engagent à vous écrire aussitôt
[...]. Dans le passé, vous vous êtes peu souciée de votre état et
de votre honneur. Je vous le dirais en face si je vous voyais en
personne. Si vous aviez montré autant d'intérêt pour votre
réputation que pour ce misérable vaurien, le monde entier aurait
compati à vos malheurs, ce qui, pour dire la vérité, n'a pas été
le cas de beaucoup [...]. Je vous dis là ce que je me dirais à
moi-même si j'étais dans la même situation que vous»
(citée in ibid. p. 360). Sur ce, Marie débarquait en Angleterre où
 elle fût reçue par le substitut du gouverneur de Carlisle, Richard
Lowther, «qui
dut assumer ses respon-sabilités, sans ins-tructions du gouver-nement,
et pour cause. Il prit le parti le plus sage : accueillir la fugitive
avec honneur, et envoyer d'urgence un messager à Londres pour
solliciter des ordres. Sa position était d'autant plus inconfortable
qu'il était lui-même catholique et que sa sympathie pour Marie
Stuart était connue»
(ibid. pp. 360-361). Bientôt, elle aménagea au château du seigneur
des environs :
elle fût reçue par le substitut du gouverneur de Carlisle, Richard
Lowther, «qui
dut assumer ses respon-sabilités, sans ins-tructions du gouver-nement,
et pour cause. Il prit le parti le plus sage : accueillir la fugitive
avec honneur, et envoyer d'urgence un messager à Londres pour
solliciter des ordres. Sa position était d'autant plus inconfortable
qu'il était lui-même catholique et que sa sympathie pour Marie
Stuart était connue»
(ibid. pp. 360-361). Bientôt, elle aménagea au château du seigneur
des environs :
«De ce château, sans doute, elle écrivit à Élisabeth - sa lettre est datée du 17 - pour lui raconter les détails de son équipée et lui demander de la rencontrer : "Je vous supplie le plus tôt que vous pourrez m'envoyer quérir, car je suis en piteux état, non pour reine mais pour gentillefemme, car je n'ai chose au monde que ma personne, comme je me suis sauvée". Elle n'en était pas encore à la fiction d'une entrée volontaire et délibérée en Angleterre, comme elle le soutiendra par la suite : il s'agit bien d'une fugitive cherchant refuge, et de rien d'autre.
Bientôt Lowther arriva avec une escorte et conduisit la reine à Carlisle, où elle fut reçue avec respect et logée au château, résidence du gouverneur. Comme elle était démunie de tout, elle se fit faire en hâte une robe de drap noir ("à crédit", précise-t-elle dans ses souvenirs racontés à Claude Nau); mais déjà la nouvelle de son arrivée s'était répandue dans la région, et les nobles catholiques affluaient vers elle» (ibid. p. 361).
C'était suffisant pour faire lever bien des soupçons.
En fait, Élisabeth
ne désirait surtout pas sa présence en sol anglais, anticipant
les troubles civils que cela susciterait. Comme le raconte Stefan
Zweig : «Il n'y a pas de doute qu'Élisabeth fut stupéfaite à la nouvelle de l'arrivée de Marie Stuart en Angleterre. Cette visite non désirée la met dans un cruel embarras. Certes, au cours de l'année précédente, elle a, par solidarité monarchique, cherché à la protéger contre ses sujets rebelles; elle l'a solennellement assurée - le papier ne coûte pas cher et la politesse écrite coule aisément d'une plume diplomatique - de sa sympathie, de son amitié, de son affection; elle lui a promis avec emphase, avec trop d'emphase, hélas! qu'elle pouvait en toute circonstance  compter sur elle et son dévouement. Mais jamais Élisabeth n'avait engagé Marie Stuart à venir dans ses États, au contraire, elle avait, depuis des années, contrarié sans cesse tout projet de rencontre avec elle. Et voilà que soudain l'importune débarque en Angleterre, dans ce pays dont, il n'y a pas bien longtemps encore, elle se vantait d'être la reine véritable. Elle est venue sans y être appelée, sans invitation, et sa première parole est de se réclamer de cette "promesse" d'amitié faite naguère» (S. Zweig. op. cit. pp. 353-354). Malgré
tout, «son
premier mouvement, le plus vrai et le plus instinctif, est-il
d'inviter généreusement chez elle la reine déchue. "J'ai
appris", écrit l'ambassadeur de France, "que la reine, au
conseil de la couronne, prit énergiquement le parti de la souveraine
d'Écosse et fit comprendre à tout le monde qu'elle avait
l'intention de la recevoir et de l'honorer conformément à son
ancienne dignité et son ancienne grandeur, et non à sa situation
actuelle"»
(ibid. p. 354).
compter sur elle et son dévouement. Mais jamais Élisabeth n'avait engagé Marie Stuart à venir dans ses États, au contraire, elle avait, depuis des années, contrarié sans cesse tout projet de rencontre avec elle. Et voilà que soudain l'importune débarque en Angleterre, dans ce pays dont, il n'y a pas bien longtemps encore, elle se vantait d'être la reine véritable. Elle est venue sans y être appelée, sans invitation, et sa première parole est de se réclamer de cette "promesse" d'amitié faite naguère» (S. Zweig. op. cit. pp. 353-354). Malgré
tout, «son
premier mouvement, le plus vrai et le plus instinctif, est-il
d'inviter généreusement chez elle la reine déchue. "J'ai
appris", écrit l'ambassadeur de France, "que la reine, au
conseil de la couronne, prit énergiquement le parti de la souveraine
d'Écosse et fit comprendre à tout le monde qu'elle avait
l'intention de la recevoir et de l'honorer conformément à son
ancienne dignité et son ancienne grandeur, et non à sa situation
actuelle"»
(ibid. p. 354).
C'était
sans compter sur le principal conseiller de la reine, Sir Robert Cecil qui retint «la
main secourable que tend Élisabeth. En politique avisé, il prévoit
immédiatement la portée  des obligations qui naîtraient pour le
gouvernement anglais d'un engagement vis-à-vis de cette femme qui,
depuis des années, sème le trouble partout. Recevoir Marie Stuart à
Londres avec les honneurs royaux serait implicitement reconnaître
ses prétentions sur l'Écosse et obligerait l'Angleterre à
combattre Murray et les lords par l'argent et par les armes. Cecil
n'en a nullement l'intention : n'est-ce pas lui qui a poussé les
lords à la révolte? Marie Stuart reste pour lui l'ennemie
héréditaire du protestantisme, le grand péril qui menace les
Anglais, et il met Élisabeth en garde contre elle-même.
Entre-temps, elle a appris avec déplaisir que ses propres nobles ont
reçu avec honneur la reine d'Écosse sur son
des obligations qui naîtraient pour le
gouvernement anglais d'un engagement vis-à-vis de cette femme qui,
depuis des années, sème le trouble partout. Recevoir Marie Stuart à
Londres avec les honneurs royaux serait implicitement reconnaître
ses prétentions sur l'Écosse et obligerait l'Angleterre à
combattre Murray et les lords par l'argent et par les armes. Cecil
n'en a nullement l'intention : n'est-ce pas lui qui a poussé les
lords à la révolte? Marie Stuart reste pour lui l'ennemie
héréditaire du protestantisme, le grand péril qui menace les
Anglais, et il met Élisabeth en garde contre elle-même.
Entre-temps, elle a appris avec déplaisir que ses propres nobles ont
reçu avec honneur la reine d'Écosse sur son  territoire. Le plus
puissant des lords catholiques, Northumberland, lui a offert
l'hospitalité dans son château; le plus influent des lords
protestants, Norfolk, lui a rendu visite. Tous semblent être sous
son charme; comme Élisabeth est d'un naturel méfiant et, en tant
que femme, vaniteuse jusqu'à la folie, elle abandonne bientôt
l'idée généreuse de faire venir à sa cour une princesse qui
pourrait l'éclipser et que les mécontents de son royaume
accueilleraient peut-être volontiers comme prétendante»
(ibid. pp. 355-356). Le résultat fut que Marie Stuart fut mise en
état d'arrestation avant même de penser quitter Carlisle pour
Londres, le 19 mai 1568. C'est alors qu'elle prononça sa phrase
célèbre : «En
ma fin gît mon commencement»,
phrase qu'elle fit broder sur sa robe.
territoire. Le plus
puissant des lords catholiques, Northumberland, lui a offert
l'hospitalité dans son château; le plus influent des lords
protestants, Norfolk, lui a rendu visite. Tous semblent être sous
son charme; comme Élisabeth est d'un naturel méfiant et, en tant
que femme, vaniteuse jusqu'à la folie, elle abandonne bientôt
l'idée généreuse de faire venir à sa cour une princesse qui
pourrait l'éclipser et que les mécontents de son royaume
accueilleraient peut-être volontiers comme prétendante»
(ibid. pp. 355-356). Le résultat fut que Marie Stuart fut mise en
état d'arrestation avant même de penser quitter Carlisle pour
Londres, le 19 mai 1568. C'est alors qu'elle prononça sa phrase
célèbre : «En
ma fin gît mon commencement»,
phrase qu'elle fit broder sur sa robe.
On
en voudrait pas à Élisabeth de tenir éloigner Marie Stuart. De
l'emprisonner même. Mais de la garder prisonnière sous enquête
(celui du meurtre de Darnley, qui ne concernait pas les affaires
d'Angleterre) apparaît tout simplement aussi odieux que les
trahisons des deux  Denys de Syracuse à l'égard de Platon. Comme le
souligne Stefan Zweig : «Du
point de vue humain comme du point de vue politique l'ambiguïté est
la chose la plus néfaste, car elle inquiète les âmes et jette le
trouble dans le monde. Et c'est là que commence la grande,
l'indéniable faute d'Élisabeth vis-à-vis de Marie Stuart. Le sort
lui a offert la victoire dont elle rêvait depuis des années : sa
rivale, qui passait pour le miroir de toutes les vertus
chevaleresques, est tombée, sans qu'elle y fût pour rien, dans la
honte et l'infamie; la reine qui voulait s'emparer de sa couronne
perd la sienne; la femme qui l'affrontait avec orgueil est devant
elle en suppliante. Élisabeth pourrait lui offrir, comme à une
solliciteuse, l'asile que généreusement l'Angleterre accorde
toujours à tout fugitif et lui infliger ainsi une humiliation
morale; ou, pour des raisons politiques, lui refuser le séjour dans
son pays. L'une comme l'autre de ces attitudes porterait la marque du
droit. On peut accueillir un quémandeur. on peut le repousser. Mais
il est une chose qui jure avec tout droit : c'est
Denys de Syracuse à l'égard de Platon. Comme le
souligne Stefan Zweig : «Du
point de vue humain comme du point de vue politique l'ambiguïté est
la chose la plus néfaste, car elle inquiète les âmes et jette le
trouble dans le monde. Et c'est là que commence la grande,
l'indéniable faute d'Élisabeth vis-à-vis de Marie Stuart. Le sort
lui a offert la victoire dont elle rêvait depuis des années : sa
rivale, qui passait pour le miroir de toutes les vertus
chevaleresques, est tombée, sans qu'elle y fût pour rien, dans la
honte et l'infamie; la reine qui voulait s'emparer de sa couronne
perd la sienne; la femme qui l'affrontait avec orgueil est devant
elle en suppliante. Élisabeth pourrait lui offrir, comme à une
solliciteuse, l'asile que généreusement l'Angleterre accorde
toujours à tout fugitif et lui infliger ainsi une humiliation
morale; ou, pour des raisons politiques, lui refuser le séjour dans
son pays. L'une comme l'autre de ces attitudes porterait la marque du
droit. On peut accueillir un quémandeur. on peut le repousser. Mais
il est une chose qui jure avec tout droit : c'est  d'attirer à soi un
être en détresse et de le retenir ensuite contre son gré. Aucune
raison, aucun prétexte ne peuvent justifier l'inexcusable perfidie
d'Élisabeth refusant à Marie Stuart, malgré son désir formel,
l'autorisation de quitter l'Angleterre et la retenant au contraire
par la ruse et le mensonge, par des fallacieuses promesses et une
violence masquée, poussant ainsi une femme déjà vaincue et
humiliée à aller plus loin qu'elle ne l'eût voulu dans la sombre
voie du désespoir et du crime»
(ibid. pp. 356-357).
d'attirer à soi un
être en détresse et de le retenir ensuite contre son gré. Aucune
raison, aucun prétexte ne peuvent justifier l'inexcusable perfidie
d'Élisabeth refusant à Marie Stuart, malgré son désir formel,
l'autorisation de quitter l'Angleterre et la retenant au contraire
par la ruse et le mensonge, par des fallacieuses promesses et une
violence masquée, poussant ainsi une femme déjà vaincue et
humiliée à aller plus loin qu'elle ne l'eût voulu dans la sombre
voie du désespoir et du crime»
(ibid. pp. 356-357).
La suite était déjà
toute tracée. Marie Stuart resterait «assignée à résidence»
pendant dix-huit ans et jamais elle ne rencontrerait sa cousine
Élisabeth pour se justifier. Sous la garde de George Talbot, comte
de Shrewsbury, Marie s'engagea dans des activités occultes avec des
 partisans catholiques anglais, activités souvent télécom-mandées
par Cecil. Les complots l'impli-quant ne cessaient de se multiplier et
certains visaient à l'assassinat même d'Élisabeth. Des lettres
cryptées qu'elle échangeait avec ses partisans étaient
interceptées puis déchiffrées. Elles devaient servir à sa
condamnation. Elle fut finalement exécutée à la hache au château
de Fotheringhay le 8 février 1587.
partisans catholiques anglais, activités souvent télécom-mandées
par Cecil. Les complots l'impli-quant ne cessaient de se multiplier et
certains visaient à l'assassinat même d'Élisabeth. Des lettres
cryptées qu'elle échangeait avec ses partisans étaient
interceptées puis déchiffrées. Elles devaient servir à sa
condamnation. Elle fut finalement exécutée à la hache au château
de Fotheringhay le 8 février 1587.
Entre l'arrestation et l'exécution de Marie Stuart s'était produit à Paris, le 24 août 1572, une réplique amplifiée de la fourberie d'Alberigo dei Manfredi. Je parle du massacre des protestants français rassemblés à Paris pour célébrer les épousailles de leur chef, Henri de Navarre - futur Henri IV - avec la sœur du roi de France, Marguerite de Valois - la Reine Margot -, cérémonial qui devait prendre le titre de noces vermeilles.
Depuis
des années, la France est déchirée par une guerre civile. D'un
côté, le parti catholique mené par le duc Henri de Guise; le
parti protestant, lui, est mené par l'amiral de Coligny.  Entre les
deux, le roi se veut défenseur du catholicisme, mais ne
peut se permettre de se mettre à dos les Huguenots, ces protestants
calvinistes dont est formée une partie importante de sa noblesse,
parmi les plus riches et les plus fidèles soutiens au trône des
Valois. Coligny exerce un ascendant sur le roi qui le gratifie d'un
respectueux «mon père» lorsqu'il s'adresse à lui. Le parti du roi
est mené par la reine-mère Catherine de Médicis, plusieurs fois
régente, qui exerce une emprise morale et politique pesante sur le
faible Charles IX. Le 18 août ont lieues les noces sur le parvis de Notre-Dame plutôt qu'à l'intérieur de la cathédrale. De leur côté,
Catherine et de Guise ont décidé d'en finir avec l'amiral. Un tueur à gages est engagé dont le coup d'arquebuse ne fait que blesser Coligny. Ramené
blessé à son hôtel parisien, l'amiral reçoit la visite de Charles IX, paniqué : «Si la blessure est pour vous, la douleur est pour moi […] mais par la
mort de Dieu, je vengerai si roidement cet outrage, qu’il en sera
mémoire à jamais» (H. Noguères. La
saint-barthélemy, Paris,
Robert Laffont, Col. Ce jour là, 1959, p. 79.
Entre les
deux, le roi se veut défenseur du catholicisme, mais ne
peut se permettre de se mettre à dos les Huguenots, ces protestants
calvinistes dont est formée une partie importante de sa noblesse,
parmi les plus riches et les plus fidèles soutiens au trône des
Valois. Coligny exerce un ascendant sur le roi qui le gratifie d'un
respectueux «mon père» lorsqu'il s'adresse à lui. Le parti du roi
est mené par la reine-mère Catherine de Médicis, plusieurs fois
régente, qui exerce une emprise morale et politique pesante sur le
faible Charles IX. Le 18 août ont lieues les noces sur le parvis de Notre-Dame plutôt qu'à l'intérieur de la cathédrale. De leur côté,
Catherine et de Guise ont décidé d'en finir avec l'amiral. Un tueur à gages est engagé dont le coup d'arquebuse ne fait que blesser Coligny. Ramené
blessé à son hôtel parisien, l'amiral reçoit la visite de Charles IX, paniqué : «Si la blessure est pour vous, la douleur est pour moi […] mais par la
mort de Dieu, je vengerai si roidement cet outrage, qu’il en sera
mémoire à jamais» (H. Noguères. La
saint-barthélemy, Paris,
Robert Laffont, Col. Ce jour là, 1959, p. 79.
La
noblesse des deux partis avait été invitée à résider au Louvre,
palais où logent le roi et sa cour. Malgré l'atmosphère orageuse
surchargée, les festivités continuent. Catherine assiège  l'esprit
faible du roi pour obtenir qu'on liquide les principaux meneurs
protestants, à l'exception d'Henri de Navarre et du prince de Condé.
Charles hésite. Finalement, il cède, mais a ce mot malheureux :
«Tuez-les,
par la mort-Dieu, mais tuez-les tous, qu'il n'en survive aucun pour
me le reprocher! Allez, donnez-y ordre promptement...».
C'est sans doute plus que n'en attendait de Guise. Des bandes sont
formées dirigées, entre autres, par le comte de Tavannes un habitué
aux guerres de religion et véritable boucher : «Saignez,
saignez! La saignée est aussi bonne en août qu'en mai»
(cité in P. Erlanger. Le
Massacre de la Saint-Barthélemy, Paris,
Gallimard, Col. Trente journées qui ont fait la France, 1960, p.
166). Les bandes se dispersent autour du Louvre, dans les quartiers
où la noblesse protestante se loge. L'amiral de Coligny, bien sûr,
est leur première victime. Il est massacré et son corps mutilé
jeté du balcon, au pied du duc de Guise qui frappe le cadavre de son
pied. C'est le signe de la ruade. Bientôt, les eaux de la Seine
deviendront rouge de sang.
l'esprit
faible du roi pour obtenir qu'on liquide les principaux meneurs
protestants, à l'exception d'Henri de Navarre et du prince de Condé.
Charles hésite. Finalement, il cède, mais a ce mot malheureux :
«Tuez-les,
par la mort-Dieu, mais tuez-les tous, qu'il n'en survive aucun pour
me le reprocher! Allez, donnez-y ordre promptement...».
C'est sans doute plus que n'en attendait de Guise. Des bandes sont
formées dirigées, entre autres, par le comte de Tavannes un habitué
aux guerres de religion et véritable boucher : «Saignez,
saignez! La saignée est aussi bonne en août qu'en mai»
(cité in P. Erlanger. Le
Massacre de la Saint-Barthélemy, Paris,
Gallimard, Col. Trente journées qui ont fait la France, 1960, p.
166). Les bandes se dispersent autour du Louvre, dans les quartiers
où la noblesse protestante se loge. L'amiral de Coligny, bien sûr,
est leur première victime. Il est massacré et son corps mutilé
jeté du balcon, au pied du duc de Guise qui frappe le cadavre de son
pied. C'est le signe de la ruade. Bientôt, les eaux de la Seine
deviendront rouge de sang.
 Le
tocsin sonne. Les matines
vermeilles peuvent com-mencer.
On com-mencera par les «Hugue-nots de guerre» avant d'étendre à
l'ensemble de la population protestante de Paris la logique du
massacre : «Les
huguenots logés au Louvre sont à leur tour tirés de leur lit,
rabattus dans les couloirs par les archers et les gardes suisses pour
être poussés dans ce cul-de-sac mortel. Tragique chasse à l'homme
au long des galeries, des salles, des cabinets de l'immense château
car pas un ne doit en réchapper! Tous, gentilshommes, valets,
précepteurs, domestiques, pages, pressés par les soldats sont
dirigés vers le lieu de leur exécution.
Le
tocsin sonne. Les matines
vermeilles peuvent com-mencer.
On com-mencera par les «Hugue-nots de guerre» avant d'étendre à
l'ensemble de la population protestante de Paris la logique du
massacre : «Les
huguenots logés au Louvre sont à leur tour tirés de leur lit,
rabattus dans les couloirs par les archers et les gardes suisses pour
être poussés dans ce cul-de-sac mortel. Tragique chasse à l'homme
au long des galeries, des salles, des cabinets de l'immense château
car pas un ne doit en réchapper! Tous, gentilshommes, valets,
précepteurs, domestiques, pages, pressés par les soldats sont
dirigés vers le lieu de leur exécution.  Quelques-uns ont compris
l'enjeu de cette traque et tentent d'échapper au piège [...] Au fur
et à mesure que les huguenots sont rabattus, ils sont... poussés
vers la cour du Louvre. Dans cet espace clos, théâtre immobile
d'une exécution presqu'incomparable, attendent piques baissées les
Suisses de la garde; à peine un malheureux est-il jeté par la porte
qu'il est cloué et taraudé de fers. Ici sont exterminés
quelques-uns appartenant à la grande noblesse, celle immémoriale
qui a voulu fêter les noces d'Henry de Navarre et peut-être aussi
jouir de ce qu'elles signifiaient de réconciliation avec le roi de
France. Joachim de Ségur dit du Puch de Pardaillan, le baron de
Pardaillan, page d'Henry de Navarre, Lois Goulard sire de Beauvais,
ancien précepteur du même Navarre, Charles de Beaumanoir vicomte de
Lavardin, François de Moneins, Saint-Martin dit Brichanteau, Barbier
de Francourt, ancien chancelier de Navarre, meurent ainsi, dans cette
arène improvisée, perforés par les piques.
Quelques-uns ont compris
l'enjeu de cette traque et tentent d'échapper au piège [...] Au fur
et à mesure que les huguenots sont rabattus, ils sont... poussés
vers la cour du Louvre. Dans cet espace clos, théâtre immobile
d'une exécution presqu'incomparable, attendent piques baissées les
Suisses de la garde; à peine un malheureux est-il jeté par la porte
qu'il est cloué et taraudé de fers. Ici sont exterminés
quelques-uns appartenant à la grande noblesse, celle immémoriale
qui a voulu fêter les noces d'Henry de Navarre et peut-être aussi
jouir de ce qu'elles signifiaient de réconciliation avec le roi de
France. Joachim de Ségur dit du Puch de Pardaillan, le baron de
Pardaillan, page d'Henry de Navarre, Lois Goulard sire de Beauvais,
ancien précepteur du même Navarre, Charles de Beaumanoir vicomte de
Lavardin, François de Moneins, Saint-Martin dit Brichanteau, Barbier
de Francourt, ancien chancelier de Navarre, meurent ainsi, dans cette
arène improvisée, perforés par les piques.  D'autres encore, une
trentaine peut-être. La chronique qui aime les morts héroïques
évoque la fin du capitaine Piles. Celui-ci, projeté dans la cour,
voit son malheur : ses amis gisant à terre ensanglantés, les
Suisses travaillant les corps et... Charles IX contemplant ce
spectacle d'une fenêtre; levant son visage le vigoureux gascon
invective : "Roi
déloyal", hurle-t-il.
Devant le silence, il tend son manteau à l'un des tueurs : "Tenez,
Monsieur, Piles vous donne cela, souvenez-vous toujours de la mort
d'un homme tué si indignement..." Le
chroniqueur Agrippa d'Aubigné a beaucoup lu Plutarque et les auteurs
antiques dont il se souvient. Il ajoute que Charles IX refuse à l'un
de ses amis catholiques, Fervacques, la grâce d'un des condamnés,
François de Moneins achevé comme les autres au petit matin du 24
août 1572»
(J. Garrisson. La
Saint-Barthélemy, Bruxelles,
Complexe, Col. La mémoire des siècles, # 205, 1987, pp. 103 à
105).
D'autres encore, une
trentaine peut-être. La chronique qui aime les morts héroïques
évoque la fin du capitaine Piles. Celui-ci, projeté dans la cour,
voit son malheur : ses amis gisant à terre ensanglantés, les
Suisses travaillant les corps et... Charles IX contemplant ce
spectacle d'une fenêtre; levant son visage le vigoureux gascon
invective : "Roi
déloyal", hurle-t-il.
Devant le silence, il tend son manteau à l'un des tueurs : "Tenez,
Monsieur, Piles vous donne cela, souvenez-vous toujours de la mort
d'un homme tué si indignement..." Le
chroniqueur Agrippa d'Aubigné a beaucoup lu Plutarque et les auteurs
antiques dont il se souvient. Il ajoute que Charles IX refuse à l'un
de ses amis catholiques, Fervacques, la grâce d'un des condamnés,
François de Moneins achevé comme les autres au petit matin du 24
août 1572»
(J. Garrisson. La
Saint-Barthélemy, Bruxelles,
Complexe, Col. La mémoire des siècles, # 205, 1987, pp. 103 à
105).
De tels récits dramatiques sont innombrables : «De
tous les hommes visés par la tuerie, les Caumont connurent un destin
singulier. Le père, François, ne voulut pas quitter le faubourg
parce que son aîné était malade. Arrêté avec ses deux fils par
un capitaine nommé Martin, il fut ramené à Paris et momentanément
sauvé grâce à la promesse d'une rançon. Puis, à deux  reprises,
il refusa de saisir des occasions de s'enfuir offertes par les deux
Suisses affectés à sa garde : il leur dit s'en remettre à la
volonté de Dieu. La mort le rattrapa le mardi suivant : une troupe
de soldats conduits par le comte de Coconat étant venue le chercher,
il tomba sous leurs coups avec son aîné, au bout de la rue des
Petits-Champs, sous les remparts; Jacques-Nompar, le plus jeune des
fils, terrorisé mais indemne, s'effondra entre les corps de son père
et de son frère; couvert de leur sang, il passa pour mort et se tint
coi pour assister, impuissant, à leur agonie. Il fut finalement
sauvé par un marqueur de jeu de paume qui, le prenant en pitié,
l'amena chez lui puis le conduisit chez sa tante, Jeanne de Gontaut,
sœur du maréchal de Biron et protestante; le maréchal catholique
mais d'esprit tolérant, le cacha à l'Arsenal»
(A. Jouanna. La
Saint-Barthélemy, Paris,
Gallimard, Col. Les journées qui ont fait la France, 2007, p. 153).
reprises,
il refusa de saisir des occasions de s'enfuir offertes par les deux
Suisses affectés à sa garde : il leur dit s'en remettre à la
volonté de Dieu. La mort le rattrapa le mardi suivant : une troupe
de soldats conduits par le comte de Coconat étant venue le chercher,
il tomba sous leurs coups avec son aîné, au bout de la rue des
Petits-Champs, sous les remparts; Jacques-Nompar, le plus jeune des
fils, terrorisé mais indemne, s'effondra entre les corps de son père
et de son frère; couvert de leur sang, il passa pour mort et se tint
coi pour assister, impuissant, à leur agonie. Il fut finalement
sauvé par un marqueur de jeu de paume qui, le prenant en pitié,
l'amena chez lui puis le conduisit chez sa tante, Jeanne de Gontaut,
sœur du maréchal de Biron et protestante; le maréchal catholique
mais d'esprit tolérant, le cacha à l'Arsenal»
(A. Jouanna. La
Saint-Barthélemy, Paris,
Gallimard, Col. Les journées qui ont fait la France, 2007, p. 153).
Les
massacreurs s'en prirent avec une férocité toute particulière aux
femmes, mais le massacre ne s'arrêta pas aux adultes : «On
compte désormais presque autant d'enfants que d'adultes, parmi les
morts : Rue Saint-Marceau, après avoir tué un cordonnier et sa
femme, les massacreurs s'acharnent sur leurs trois enfants; un
doreur, Guillaume Maillart est tué avec sa femme et son jeune fils;
une chaperonnière demeurant rue Saint-Martin, la veuve Marquette,
voit assassiner ses deux enfants avant d'être, elle-même,
poignardée; rue Saint-Denis, à la corne du Cerf, ce sont les trois
enfants d'un marchand de soie qui sont égorgés sur les corps de
leurs parents. Parfois, ces scènes effroyables se prolongent et
atteignent le  comble de l'horreur : tandis qu'un marchand de chevaux,
criblé de coups de couteau, est traîné vers la rivière, ses deux
enfants s'accro-chent à lui, criant et pleurant... Le triste cortège
arrive ainsi jusqu'à la Seine, et là, après avoir jeté à l'eau
le corps du malheureux père, les meurtriers, pour se débarrasser
des deux enfants, les poignardent et les noient également»
(H. Noguères. op. cit. pp. 190-191). Frappant les
quartiers où s'était établie la bourgeoisie protestante, les
tueurs n'hésitent pas à faire des rapines et à se remplir les
poches, comme le montre la rançon extorquée à Caumont.
comble de l'horreur : tandis qu'un marchand de chevaux,
criblé de coups de couteau, est traîné vers la rivière, ses deux
enfants s'accro-chent à lui, criant et pleurant... Le triste cortège
arrive ainsi jusqu'à la Seine, et là, après avoir jeté à l'eau
le corps du malheureux père, les meurtriers, pour se débarrasser
des deux enfants, les poignardent et les noient également»
(H. Noguères. op. cit. pp. 190-191). Frappant les
quartiers où s'était établie la bourgeoisie protestante, les
tueurs n'hésitent pas à faire des rapines et à se remplir les
poches, comme le montre la rançon extorquée à Caumont.
À la cupidité des massacreurs s'ajoute le sadisme : «...brûlés enfin, non seulement les livres sur lesquels travaillait Spire Niquet, un pauvre relieur, père de sept enfants, mais aussi Niquet lui-même, que ses tortionnaires ont fait rôtir devant la porte de son échoppe, rue Judas, sur un brasier qu'alimentaient ses in-folio» (ibid. p. 193) :
«René, le parfumeur de la reine mère, mérite aussi une mention spéciale. L'Estoile le dépeint ainsi : "Homme confit en toutes sortes de cruautés, de méchancetés, qui allait aux prisons pour poignarder les huguenots et ne vivait que de meurtres, de brigandages et d'empoisonnements". Il avait été accusé par la rumeur publique - à tort semble-t-il - d'avoir quelques jours avant le mariage du roi de Navarre, empoisonné Jeanne d'Albret [la mère d'Henri de Navarre]
Simon Goulart, sur l'attitude de ce même René, le 24 août, cite un autre trait : "Il attira chez lui un joaillier, sous prétexte de le sauver; il se fit donner toutes ses marchandises, et puis lui coupa la gorge et le jeta dans la Seine".
Enfin un gentilhomme, au moins, a bien gagné de figurer aux côtés de ce tireur d'or, de ce boucher et de ce parfumeur : il s'agit du beau comte Marc Hannibal de Coconas. Celui-ci,à l'en croire - ou plutôt à en croire l'Estoile qui rapporte, d'après Henri III, les vantardises de ce gentilhomme piémontais - se faisait gloire d'avoir racheté de ses deniers à des tueurs besogneux, plus de trente protestants. Et ceci pour s'offrir un plaisir de choix : il les torturait, puis leur promettait la vie sauve contre leur abjuration et enfin, qu'ils eussent ou non renié leur foi, il les poignardait. Mais non point d'un seul coup de dague, comme l'ont fait, toute la journée, des manants sans raffinement ni éducation... il les tuait à petits coups, lentement, pour les faire languir, pour prolonger leurs souffrances, et aussi, bien sûr, sa propre jouissance» (ibid. pp. 199-200). C'était aller au-delà du machiavélisme au pur sadisme.
 «Leur
bande se rend d'abord chez La Rochefoucauld. Le capitaine Raymond
Anglarez, chargé d'expédier l'ami du Roi a la promesse formelle
d'hériter de sa charge. Selon des bruits recueillis par Brantôme,
il est accompagné de son fils Chicot qui sera le célèbre bouffon
de Henri III. Voyant des hommes masqués envahir sa chambre, le comte
croit que Charles IX, coutumier de ce genre de farces, est du nombre
et vient lui donner les étrivières. - Au moins, dit-il, ne frappez
pas trop fort! "Il riait encore quand on l'égorgea"
(Michelet).
On était toujours dans l'esprit des fêtes
galantes!
De Paris, les massacres s'étendent en province. C'est la France
entière qui est bientôt en sang, les démonstrations de cruautés
sadiques ne cessant de se multiplier les jours qui suivent le grand
massacre parisien.
«Leur
bande se rend d'abord chez La Rochefoucauld. Le capitaine Raymond
Anglarez, chargé d'expédier l'ami du Roi a la promesse formelle
d'hériter de sa charge. Selon des bruits recueillis par Brantôme,
il est accompagné de son fils Chicot qui sera le célèbre bouffon
de Henri III. Voyant des hommes masqués envahir sa chambre, le comte
croit que Charles IX, coutumier de ce genre de farces, est du nombre
et vient lui donner les étrivières. - Au moins, dit-il, ne frappez
pas trop fort! "Il riait encore quand on l'égorgea"
(Michelet).
On était toujours dans l'esprit des fêtes
galantes!
De Paris, les massacres s'étendent en province. C'est la France
entière qui est bientôt en sang, les démonstrations de cruautés
sadiques ne cessant de se multiplier les jours qui suivent le grand
massacre parisien.
 De
tels hôtes ne méritaient que le triste sort qui les attendait.
Charles IX mourut le 30 mai 1574, troublé par des cauchemars sans
fin. Henri III, alors duc d'Anjou, complice de la décision prise par
son frère, sera assassiné par le moine Jacques Clément. Catherine de Médicis agonise alors qu'à l'étage au-dessous sa garde fidèle
massacre Henri de Guise. Coconas, le gentilhomme piémontais qui
dépouillait avant de tuer, sera décapité sur la place de Grève
pour avoir conspiré contre le roi, sa maîtresse, la duchesse de
Nevers, rachetant au bourreau la tête de son amant pour la faire
embaumer, dit-on. Au siège de La Rochelle, le capitaine Raymond,
l'un des
De
tels hôtes ne méritaient que le triste sort qui les attendait.
Charles IX mourut le 30 mai 1574, troublé par des cauchemars sans
fin. Henri III, alors duc d'Anjou, complice de la décision prise par
son frère, sera assassiné par le moine Jacques Clément. Catherine de Médicis agonise alors qu'à l'étage au-dessous sa garde fidèle
massacre Henri de Guise. Coconas, le gentilhomme piémontais qui
dépouillait avant de tuer, sera décapité sur la place de Grève
pour avoir conspiré contre le roi, sa maîtresse, la duchesse de
Nevers, rachetant au bourreau la tête de son amant pour la faire
embaumer, dit-on. Au siège de La Rochelle, le capitaine Raymond,
l'un des  assassins de La Rochefoucauld sera tué. «Maurevert
- le "tueur du roi" [c'est
lui qui avait tiré le coup d'arquebuse manqué sur l'amiral de
Coligny] -
était également devant La Rochelle. Et lui aussi était si
ostensiblement tenu à l'écart que les autres officiers que ceux-ci
"ne voulaient même souffrir qu'il entrât en garde avec eux".
Sorti indemne de cette campagne, Maurevert devait, néanmoins,
quelques années plus tard, mourir de mort violente. Et par l'effet,
cette fois, non de la justice immanente mais bien de la vengeance
sacrée, exercée par le fils d'une de ses victimes, le jeune
seigneur de Mouy, qui, cherchant depuis bien longtemps, se rua sur
lui, un jour d'avril 1583, en pleine rue, devant l'église
Saint-Honoré, et le perça d'un coup d'épée "par le bas du
ventre jusqu'à la mamelle gauche"»
(ibid. pp. 284-285). D'autres encore subirent un cruel retour du
destin qui veut que ceux qui trahissent l'hospitalité doivent en
payer le prix.
assassins de La Rochefoucauld sera tué. «Maurevert
- le "tueur du roi" [c'est
lui qui avait tiré le coup d'arquebuse manqué sur l'amiral de
Coligny] -
était également devant La Rochelle. Et lui aussi était si
ostensiblement tenu à l'écart que les autres officiers que ceux-ci
"ne voulaient même souffrir qu'il entrât en garde avec eux".
Sorti indemne de cette campagne, Maurevert devait, néanmoins,
quelques années plus tard, mourir de mort violente. Et par l'effet,
cette fois, non de la justice immanente mais bien de la vengeance
sacrée, exercée par le fils d'une de ses victimes, le jeune
seigneur de Mouy, qui, cherchant depuis bien longtemps, se rua sur
lui, un jour d'avril 1583, en pleine rue, devant l'église
Saint-Honoré, et le perça d'un coup d'épée "par le bas du
ventre jusqu'à la mamelle gauche"»
(ibid. pp. 284-285). D'autres encore subirent un cruel retour du
destin qui veut que ceux qui trahissent l'hospitalité doivent en
payer le prix.
L'ampleur
du massacre de la Saint-Barthélemy dépasse les règlements de
comptes de type évoqué par l'anecdote d'Alberigo dei Manfredi.
D'autre part, le mythe du lit de Procuste  ouvre à une autre forme,
tout aussi sordide, de manque-ment à l'étiquette. En 1808, trois
person-nages sont venus ouvrir une auberge à Peyre-beille, plateau
désertique des monts de l'Ardèche, près d'Aubenas, à 1 200 mètres
d'altitude. Pierre Martin, dit Leblanc, né en 1773 était un ancien
montreur d'ours et son complice, Pierre Rochette, un mulâtre
d'origine argentine, né en 1785, était également saltimbanque,
hercule puis dompteur de serpents. Le troisième personnage était
une femme, Marie Breysse, épouse de Martin et maîtresse de
Rochette. Pendant vingt-trois ans, ce ménage à trois va tenir l'auberge
qui, sans rouler sur l'or, ne manque pas de clients. On y vient pour
célébrer des noces, bien que d'étranges rumeurs circulent dans les
environs.
ouvre à une autre forme,
tout aussi sordide, de manque-ment à l'étiquette. En 1808, trois
person-nages sont venus ouvrir une auberge à Peyre-beille, plateau
désertique des monts de l'Ardèche, près d'Aubenas, à 1 200 mètres
d'altitude. Pierre Martin, dit Leblanc, né en 1773 était un ancien
montreur d'ours et son complice, Pierre Rochette, un mulâtre
d'origine argentine, né en 1785, était également saltimbanque,
hercule puis dompteur de serpents. Le troisième personnage était
une femme, Marie Breysse, épouse de Martin et maîtresse de
Rochette. Pendant vingt-trois ans, ce ménage à trois va tenir l'auberge
qui, sans rouler sur l'or, ne manque pas de clients. On y vient pour
célébrer des noces, bien que d'étranges rumeurs circulent dans les
environs.
En
effet, car «ce
ne sont... pas les cadavres qui manquent. On en trouve beaucoup, au
cours de ces années, le crâne fracassé, au fond des ravins ou au
détour des sentiers. Les uns ont  peut-être été victimes de
quelque accident, les autres manifes-tement assassinés. Beaucoup de
dispa-ritions aussi, parmi les nombreux visiteurs qui traversent cette
région du Vivarais»
(B. Oudin. Le
crime et l'argent, s.v.
Laffont-Tchou, 1975, pp. 117-118). Tous ces crimes relèvent du
mystère. Du moins jusqu'en octobre 1831, avec la découverte, sur
les rives de l'Allier, du cadavre de Jean-Antoine Enjolras, un riche
marchand de bestiaux de la région de Langogne. Un témoin dit
l'avoir vu pour la dernière fois entrer à l'auberge des Martin. Le
témoin est un certain «Laurent
Chaze, un mendiant que les aubergistes ont laissé dormir, cette
nuit-là, dans leur grenier à foin. De là, Chaze, que l'on croyait
endormi, a assisté à toute la scène du meurtre :
peut-être été victimes de
quelque accident, les autres manifes-tement assassinés. Beaucoup de
dispa-ritions aussi, parmi les nombreux visiteurs qui traversent cette
région du Vivarais»
(B. Oudin. Le
crime et l'argent, s.v.
Laffont-Tchou, 1975, pp. 117-118). Tous ces crimes relèvent du
mystère. Du moins jusqu'en octobre 1831, avec la découverte, sur
les rives de l'Allier, du cadavre de Jean-Antoine Enjolras, un riche
marchand de bestiaux de la région de Langogne. Un témoin dit
l'avoir vu pour la dernière fois entrer à l'auberge des Martin. Le
témoin est un certain «Laurent
Chaze, un mendiant que les aubergistes ont laissé dormir, cette
nuit-là, dans leur grenier à foin. De là, Chaze, que l'on croyait
endormi, a assisté à toute la scène du meurtre :  l'arrivée
d'Enjolras, le dîner au cours duquel Marie Breysse, tout en parlant
de choses et d'autres, interroge habilement le voyageur sur le but de
son déplacement, son origine, sa famille, sa fortune. Chaze décrit
surtout la scène finale : la victime montant pour se coucher, Martin
l'éclairant à l'aide d'une bougie et, en haut de l'escalier,
Rochette, caché dans l'ombre, tenant à la main un lourd merlin...»
(ibid. p. 118). Martin et Rochette sont arrêtés et, aussitôt, les
langues se délient. La police perquisitionne l'auberge. On retrouve
la masse dont s'était servi Rochette tachée de sang; des os
calcinés reconnus par les experts comme humains sont découverts
dans le four à pain. Enfin, un véritable bric-à-brac d'objets et
de vêtements ayant appartenu aux victimes, ce qui permettra
d'identifier les différentes victimes de l'auberge de Peyrebeille.
l'arrivée
d'Enjolras, le dîner au cours duquel Marie Breysse, tout en parlant
de choses et d'autres, interroge habilement le voyageur sur le but de
son déplacement, son origine, sa famille, sa fortune. Chaze décrit
surtout la scène finale : la victime montant pour se coucher, Martin
l'éclairant à l'aide d'une bougie et, en haut de l'escalier,
Rochette, caché dans l'ombre, tenant à la main un lourd merlin...»
(ibid. p. 118). Martin et Rochette sont arrêtés et, aussitôt, les
langues se délient. La police perquisitionne l'auberge. On retrouve
la masse dont s'était servi Rochette tachée de sang; des os
calcinés reconnus par les experts comme humains sont découverts
dans le four à pain. Enfin, un véritable bric-à-brac d'objets et
de vêtements ayant appartenu aux victimes, ce qui permettra
d'identifier les différentes victimes de l'auberge de Peyrebeille.
L'horreur
s'amplifia lorsqu'on réalisa que le trio n'épargnait ni les femmes
ni les enfants. Des  témoins appelés au procès affirmeront
reconnaître les habits de leur mari disparu. Le procès se déroula
en juin 1833. Reconnus coupables, les assassins furent conduits en
charrette devant la façade de l'auberge où ils furent guillotinés.
«Martin
et Rochette moururent en donnant les signes extérieurs du repentir
et de la piété, mais Marie Breysse, qui avait espéré la grâce du
roi Louis-Philippe, cracha sur le crucifix que l'aumônier lui
tendait»
(ibid. p. 119). On estima la foule présente à 30 000 personnes, ce
qui était assez exceptionnel pour un endroit aussi difficile
d'accès! «Une
joie indécente s'empara des assistants»
(A. Monestier. Les
grandes affaires criminelles, Paris,
Bordas, Col. Les compacts, # 5, 1998, p. 61).
témoins appelés au procès affirmeront
reconnaître les habits de leur mari disparu. Le procès se déroula
en juin 1833. Reconnus coupables, les assassins furent conduits en
charrette devant la façade de l'auberge où ils furent guillotinés.
«Martin
et Rochette moururent en donnant les signes extérieurs du repentir
et de la piété, mais Marie Breysse, qui avait espéré la grâce du
roi Louis-Philippe, cracha sur le crucifix que l'aumônier lui
tendait»
(ibid. p. 119). On estima la foule présente à 30 000 personnes, ce
qui était assez exceptionnel pour un endroit aussi difficile
d'accès! «Une
joie indécente s'empara des assistants»
(A. Monestier. Les
grandes affaires criminelles, Paris,
Bordas, Col. Les compacts, # 5, 1998, p. 61).
Il
faut dire que ce qui avait été révélé au procès était déjà
assez fantastique que bien des questions se posaient à l'esprit :
«Depuis
quand les époux Martin tuaient-ils leur clientèle?  Combien de
meurtres ont-ils commis? Est-il vrai qu'ils aient utilisé la chair
de leurs victimes pour enrichir en protéines la nourriture de leurs
cochons? Est-il vrai-semblable, comme on l'a prétendu, que leur
clientèle ait pratiqué, à son insu, l'anthropophagie?»
(ibid. p. 61). Bien des incertitudes couvaient, au point qu'un siècle
plus tard, un avocat voulut les innocenter totalement. Tout prêtait
à assombrir le milieu où les crimes s'étaient produits :
«L'auberge
de Peyrebeille est perdue sur un plateau désertique de l'Ardèche.
Battues par des vents glacés et couvertes de neige une bonne partie
de l'année, deux grandes routes s'y croisent; celle qui va du Puy
vers la vallée du Rhône et celle qui joint le Gévaudan et le
Velay. Elle était autrefois la halte presque obligée des rouliers
et des charretiers qui, par temps de neige, n'avaient d'autre lieu où
trouver refuge»
(ibid. pp. 61-62).
Combien de
meurtres ont-ils commis? Est-il vrai qu'ils aient utilisé la chair
de leurs victimes pour enrichir en protéines la nourriture de leurs
cochons? Est-il vrai-semblable, comme on l'a prétendu, que leur
clientèle ait pratiqué, à son insu, l'anthropophagie?»
(ibid. p. 61). Bien des incertitudes couvaient, au point qu'un siècle
plus tard, un avocat voulut les innocenter totalement. Tout prêtait
à assombrir le milieu où les crimes s'étaient produits :
«L'auberge
de Peyrebeille est perdue sur un plateau désertique de l'Ardèche.
Battues par des vents glacés et couvertes de neige une bonne partie
de l'année, deux grandes routes s'y croisent; celle qui va du Puy
vers la vallée du Rhône et celle qui joint le Gévaudan et le
Velay. Elle était autrefois la halte presque obligée des rouliers
et des charretiers qui, par temps de neige, n'avaient d'autre lieu où
trouver refuge»
(ibid. pp. 61-62).
On
ignore ce qui incita les époux Martin à tuer leur clientèle. Alain
Monestier suppose une  première mort accidentelle d'un voyageur de
passage dont les époux auraient empoché la bourse bien garnie. Ils
n'avaient qu'à balancer le corps dans un ravin pour qu'on l'oublie avant longtemps! Puis, d'un premier cadavre détroussé - la chose était si facile -, ils
multiplièrent les occasions de tuer d'autres voyageurs venus
chercher refuge à l'auberge : «Aidés
de leur unique domestique, Jean Rochette, un
première mort accidentelle d'un voyageur de
passage dont les époux auraient empoché la bourse bien garnie. Ils
n'avaient qu'à balancer le corps dans un ravin pour qu'on l'oublie avant longtemps! Puis, d'un premier cadavre détroussé - la chose était si facile -, ils
multiplièrent les occasions de tuer d'autres voyageurs venus
chercher refuge à l'auberge : «Aidés
de leur unique domestique, Jean Rochette, un  garçon du pays surnommé
le "Mulâtre" en raison de la couleur de sa peau, les époux
organisèrent leur coupe-gorge avec un soin diabolique. Un trou
discret, pratiqué dans une cloison de bois, leur permettait d'épier
les conversations des clients installés à la table d'hôte. Si les
imprudents faisaient allusion à l'argent qu'ils avaient dans leur
poche, ou laissaient échapper un mot qui pût faire penser que leurs
bourses étaient bien garnies, leur compte était bon. Jean Rochette
courait se cacher dans un recoin de l'escalier, attendait le moment
où ils monteraient se coucher et les assommait d'un grand coup de
gourdin. On les tirait ensuite dans une grange, où Martin leur
donnait le coup de grâce avant de les détrousser».
(ibid. p. 62). Les assassins n'avaient plus ensuite qu'à faire
disparaître les cadavres en les disséminant dans la région perdue
ou en les brûlant dans le four à pain.
garçon du pays surnommé
le "Mulâtre" en raison de la couleur de sa peau, les époux
organisèrent leur coupe-gorge avec un soin diabolique. Un trou
discret, pratiqué dans une cloison de bois, leur permettait d'épier
les conversations des clients installés à la table d'hôte. Si les
imprudents faisaient allusion à l'argent qu'ils avaient dans leur
poche, ou laissaient échapper un mot qui pût faire penser que leurs
bourses étaient bien garnies, leur compte était bon. Jean Rochette
courait se cacher dans un recoin de l'escalier, attendait le moment
où ils monteraient se coucher et les assommait d'un grand coup de
gourdin. On les tirait ensuite dans une grange, où Martin leur
donnait le coup de grâce avant de les détrousser».
(ibid. p. 62). Les assassins n'avaient plus ensuite qu'à faire
disparaître les cadavres en les disséminant dans la région perdue
ou en les brûlant dans le four à pain.
Si
tout éclata en 1833, c'était depuis longtemps que
«les
rumeurs les plus fâcheuses circulaient sur le compte de l'auberge.
On racontait bien dans le pays que les Martin, sous forme de pâté
ou de ragoût, faisaient manger certains de leurs hôtes au reste de
leur clientèle. Un paysan se répandait un peu partout en affirmant
avoir vu dans leur cuisine une marmite bouillante contenant des mains
humaines. Bref, les racontars allaient bon train, et cela d'autant
plus qu'on voyait les aubergistes s'enrichir rapidement»
(ibid. p. 62). Malgré cette réputation dommageable, personne ne
s'en prit ouvertement aux Martin avant cette année 1833. On ne
 pouvait, effectivement, se fier à des fables
colportées
par des ivrognes. C'était trop énorme pour qu'on puisse y accorder
crédit. Il y avait, bien sûr, des disparus dont on ne retrouvait
jamais les cadavres. Des victimes, des loups ou d'autres brigands.
Peyrebeille n'était pas très loin du Gévaudan, à l'époque où,
jeune encore, Pierre Martin avait sans doute entendu parler des
massacres commis par la monstrueuse bête, un loup particulièrement
gros et meurtrier. D'ailleurs les époux Martin étaient gens
accueillant, aimable et tranquille, dotés d'une extrême
bienveillance. Le
meurtre d'Enjolras, aperçu par un témoin avant son entrée à
l'auberge et le récit de Chaze devait suffire à mettre fin au
manège du trio.
pouvait, effectivement, se fier à des fables
colportées
par des ivrognes. C'était trop énorme pour qu'on puisse y accorder
crédit. Il y avait, bien sûr, des disparus dont on ne retrouvait
jamais les cadavres. Des victimes, des loups ou d'autres brigands.
Peyrebeille n'était pas très loin du Gévaudan, à l'époque où,
jeune encore, Pierre Martin avait sans doute entendu parler des
massacres commis par la monstrueuse bête, un loup particulièrement
gros et meurtrier. D'ailleurs les époux Martin étaient gens
accueillant, aimable et tranquille, dotés d'une extrême
bienveillance. Le
meurtre d'Enjolras, aperçu par un témoin avant son entrée à
l'auberge et le récit de Chaze devait suffire à mettre fin au
manège du trio.
L'affaire
passa vite dans la petite littérature judiciaire. Les têtes des assassins furent confiées à un médecin qui en prit des moulages,
toujours conservé au musée du Puy-en-Velay bien  qu'on ne les
présente pas au publique. Ce qui se dit au procès rappelait un
mélodrame à succès depuis 1823, l'Auberge
des Adrets, en
trois actes, de Antier, Saint-Amant et Paulyanthe et présenté la
première fois au théâtre de l'Ambigüe-Comique. La pièce fit la
carrière de Frédérick Lemaître qui y tenait le rôle principal de
Robert Macaire, l'un des deux voyous qui assassinaient pour le voler
un riche invité d'une noce. Le drame avait toutefois peu à voir avec l'anecdote
de l'auberge de Peyrebeille. Enfin, comment oublier l'adaptation
cinématographique qu'en fît en 1951 Claude Autant-Lara, L'Auberge
rouge, mettant
en vedette une prestation inoubliable de Fernandel. Cette affaire
sinistre accoucha ici «d'un
petit chef-d'œuvre d'humour noir. Carette et Françoise Rosay, ce
couple d'inquiétants aubergistes, s'en prenaient à un groupe de
voyageurs ainsi qu'au moine
qu'on ne les
présente pas au publique. Ce qui se dit au procès rappelait un
mélodrame à succès depuis 1823, l'Auberge
des Adrets, en
trois actes, de Antier, Saint-Amant et Paulyanthe et présenté la
première fois au théâtre de l'Ambigüe-Comique. La pièce fit la
carrière de Frédérick Lemaître qui y tenait le rôle principal de
Robert Macaire, l'un des deux voyous qui assassinaient pour le voler
un riche invité d'une noce. Le drame avait toutefois peu à voir avec l'anecdote
de l'auberge de Peyrebeille. Enfin, comment oublier l'adaptation
cinématographique qu'en fît en 1951 Claude Autant-Lara, L'Auberge
rouge, mettant
en vedette une prestation inoubliable de Fernandel. Cette affaire
sinistre accoucha ici «d'un
petit chef-d'œuvre d'humour noir. Carette et Françoise Rosay, ce
couple d'inquiétants aubergistes, s'en prenaient à un groupe de
voyageurs ainsi qu'au moine  surprenant qu'interprétait Fernan-del»
(B. Oudin. op. cit. p. 117). C'est que la trame du film en était
tout simple-ment absurde. Cette pochade, où la farce apparaît au
creux d'une tragédie comme un œuf au milieu du nid, relate, nous dit
Jean Tulard, des «voyageurs
d'une diligence [qui]
descendent
à l'auberge, bientôt suivis par un moine bon vivant. Or, la femme
Martin éprouve le besoin de se confesser au saint homme. À sa
grande horreur, elle lui avoue la bagatelle de cent trois crimes. Le
moine, lié par le secret de la confession, va cependant s'employer
par tous les moyens à sauver les voyageurs. Un bonhomme de neige lui
en donnera l'occasion. Confondus, les aubergistes sont arrêtés par
la police tandis que leur fille file le parfait amour avec le novice
du moine. Les voyageurs, soulagés, reprennent la route. Pas pour
longtemps, car la diligence s'écrase dans le ravin...!»
(J. Tulard. Guide
des films, t.
1, Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1990, p. 150. - Il est
possible de visionner ce film à cette adresse :
https://ok.ru/video/10462180425).
surprenant qu'interprétait Fernan-del»
(B. Oudin. op. cit. p. 117). C'est que la trame du film en était
tout simple-ment absurde. Cette pochade, où la farce apparaît au
creux d'une tragédie comme un œuf au milieu du nid, relate, nous dit
Jean Tulard, des «voyageurs
d'une diligence [qui]
descendent
à l'auberge, bientôt suivis par un moine bon vivant. Or, la femme
Martin éprouve le besoin de se confesser au saint homme. À sa
grande horreur, elle lui avoue la bagatelle de cent trois crimes. Le
moine, lié par le secret de la confession, va cependant s'employer
par tous les moyens à sauver les voyageurs. Un bonhomme de neige lui
en donnera l'occasion. Confondus, les aubergistes sont arrêtés par
la police tandis que leur fille file le parfait amour avec le novice
du moine. Les voyageurs, soulagés, reprennent la route. Pas pour
longtemps, car la diligence s'écrase dans le ravin...!»
(J. Tulard. Guide
des films, t.
1, Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1990, p. 150. - Il est
possible de visionner ce film à cette adresse :
https://ok.ru/video/10462180425).
 Un
dernier rappel du circuit d'Alberigo dei Manfredi se trouve dans
l'histoire russe, à quelques mois à peine du déclenchement de la
révolution de février 1917, dans la nuit du 17 décembre 1916. Un
complot avait été ourdi afin de se débarrasser du staretz
Grigori Efimovitch Raspoutine. La Russie était en pleine guerre
mondiale et les choses allaient mal pour elle sur le front. On
cherchait un bouc émissaire et Raspoutine, en faveur dans les bonnes
grâces de la famille du Tsar où il jouait le rôle de guérisseur
auprès de l'hémophile tsarévitch,
Un
dernier rappel du circuit d'Alberigo dei Manfredi se trouve dans
l'histoire russe, à quelques mois à peine du déclenchement de la
révolution de février 1917, dans la nuit du 17 décembre 1916. Un
complot avait été ourdi afin de se débarrasser du staretz
Grigori Efimovitch Raspoutine. La Russie était en pleine guerre
mondiale et les choses allaient mal pour elle sur le front. On
cherchait un bouc émissaire et Raspoutine, en faveur dans les bonnes
grâces de la famille du Tsar où il jouait le rôle de guérisseur
auprès de l'hémophile tsarévitch,  prenait trop d'influence dans
les affaires politiques. C'est du moins ce qu'en jugeait les députés
de droite à la Douma menés par un gros propriétaire,
Pourichkévitch. C'est à lui que le prince Félix Youssoupov
présenta un projet d'assassinat. Un troisième larron s'associa au
projet, le grand-duc Dimitri Pavlovitch. En tant que princes,
Youssoupov et Pavlovitch étaient immunisés des lois courantes et ne
relevaient que de la justice du Tsar. Le complot accueilli aussi un
médecin d'origine polonaise, le docteur Lazovert, chargé de
procurer le poison qui serait l'arme du crime, de l'officier de
cavalerie Soukhotine, et du valet de chambre de Youssoupov, Néfédov.
prenait trop d'influence dans
les affaires politiques. C'est du moins ce qu'en jugeait les députés
de droite à la Douma menés par un gros propriétaire,
Pourichkévitch. C'est à lui que le prince Félix Youssoupov
présenta un projet d'assassinat. Un troisième larron s'associa au
projet, le grand-duc Dimitri Pavlovitch. En tant que princes,
Youssoupov et Pavlovitch étaient immunisés des lois courantes et ne
relevaient que de la justice du Tsar. Le complot accueilli aussi un
médecin d'origine polonaise, le docteur Lazovert, chargé de
procurer le poison qui serait l'arme du crime, de l'officier de
cavalerie Soukhotine, et du valet de chambre de Youssoupov, Néfédov.
 Youssoupov
réussit à se faire l'ami de Raspoutine qui raffolait l'entendre
chanter et jouer de la guitare. Il suffisait de l'inviter chez lui, et
«le
16 décembre fut choisi pour l'assassinat de Raspoutine. Le meurtre
devait être accompli dans une des caves du palais de Youssoupov à
la Moïka; celle-ci était précisément vide par suite de
réparations. Sous ces voûtes, on serait tranquille et aucun bruit
suspect ne parviendrait à l'extérieur. On avait aussi trouvé un
prétexte pour attirer le staretz : Grigori Efimovitch avait exprimé
depuis longtemps le désir de faire la connaissance de la femme du
prince Félix, la jeune et jolie Irina Alexandrovna et on avait ainsi
constitué le dernier maillon de la chaîne»
(R. Fülop-Miller. Raspoutine
et les femmes, Paris,
Payot, Col. Bibliothèque historique, 1952, pp. 359-360). «La
cave où le crime devait être commis avait été autrefois affectée
aux vins, et il s'agissait de l'aménager en salle à manger. Cette
pièce était dallée, avait un plafond assez bas et voûté, enfin
deux fenêtres étroites donnaient au niveau de la rue sur
Youssoupov
réussit à se faire l'ami de Raspoutine qui raffolait l'entendre
chanter et jouer de la guitare. Il suffisait de l'inviter chez lui, et
«le
16 décembre fut choisi pour l'assassinat de Raspoutine. Le meurtre
devait être accompli dans une des caves du palais de Youssoupov à
la Moïka; celle-ci était précisément vide par suite de
réparations. Sous ces voûtes, on serait tranquille et aucun bruit
suspect ne parviendrait à l'extérieur. On avait aussi trouvé un
prétexte pour attirer le staretz : Grigori Efimovitch avait exprimé
depuis longtemps le désir de faire la connaissance de la femme du
prince Félix, la jeune et jolie Irina Alexandrovna et on avait ainsi
constitué le dernier maillon de la chaîne»
(R. Fülop-Miller. Raspoutine
et les femmes, Paris,
Payot, Col. Bibliothèque historique, 1952, pp. 359-360). «La
cave où le crime devait être commis avait été autrefois affectée
aux vins, et il s'agissait de l'aménager en salle à manger. Cette
pièce était dallée, avait un plafond assez bas et voûté, enfin
deux fenêtres étroites donnaient au niveau de la rue sur 
 Les
autres conspirateurs les rejoignirent. Le docteur Lazovert amena le
poison qu'il saupoudra à l'intérieur de gâteaux au chocolat. Il en
mit aussi dans le vin, et jugea que la quantité était suffisante
pour tuer le staretz.
«Enfin
ils se partagèrent une dernière fois les rôles que chacun devait
tenir pendant l'assassinat de Raspoutine : le grand-duc Dimitri, qui
était resté jusque-là inactif, exprima le désir de tuer un peu
lui aussi. Mais Pourichkévitch, le farouche impérialiste, fit
preuve de la
Les
autres conspirateurs les rejoignirent. Le docteur Lazovert amena le
poison qu'il saupoudra à l'intérieur de gâteaux au chocolat. Il en
mit aussi dans le vin, et jugea que la quantité était suffisante
pour tuer le staretz.
«Enfin
ils se partagèrent une dernière fois les rôles que chacun devait
tenir pendant l'assassinat de Raspoutine : le grand-duc Dimitri, qui
était resté jusque-là inactif, exprima le désir de tuer un peu
lui aussi. Mais Pourichkévitch, le farouche impérialiste, fit
preuve de la  subtilité de ses sentiments : il démontra qu'il y
avait une certaine limite qu'un membre de la famille du tsar ne
devait pas dépasser au cours d'un attentat; à son avis, un prince
du sang ne devait pas se salir les mains en tuant un paysan
malpropre; il lui serait seulement permis d'assister au meurtre comme
témoin. Cette opinion ayant été admise, il fut arrêté que seul
Youssoupov verserait le poison au staretz, et que les autres
conspirateurs attendraient dans son cabinet, situé exactement
au-dessus de la cave, jusqu'à ce que Raspoutine soit mort. Enfin ils
feraient marcher le phonographe pour faire croire au staretz qu'une
joyeuse société était rassemblée à l'étage supérieur»
(ibid. pp. 361-362). Puis on se mit en marche.
subtilité de ses sentiments : il démontra qu'il y
avait une certaine limite qu'un membre de la famille du tsar ne
devait pas dépasser au cours d'un attentat; à son avis, un prince
du sang ne devait pas se salir les mains en tuant un paysan
malpropre; il lui serait seulement permis d'assister au meurtre comme
témoin. Cette opinion ayant été admise, il fut arrêté que seul
Youssoupov verserait le poison au staretz, et que les autres
conspirateurs attendraient dans son cabinet, situé exactement
au-dessus de la cave, jusqu'à ce que Raspoutine soit mort. Enfin ils
feraient marcher le phonographe pour faire croire au staretz qu'une
joyeuse société était rassemblée à l'étage supérieur»
(ibid. pp. 361-362). Puis on se mit en marche.
Youssoupov
alla chercher Raspoutine en automobile. Tout au long du trajet, le
prince manifesta une certaine nervosité. Arrivé à la demeure,
Raspoutine s'enquérit du  phonographe. Youssoupov répondit que
c'était sa femme (qui était absente) qui recevait quelques amis.
Puis, ils descen-dirent au sous-sol aménagé au cours de la journée.
Elle séduisit particulièrement Raspoutine. Le prince servit du thé
et quelques gâteaux - ceux qui n'étaient pas empoisonnés - et la
conversation alla bon train. Enfin se présenta le moment de
présenter les gâteaux empoisonnés et le vin. On s'attendait à un
résultat immédiat du cyanure qu'ils contenaient :
phonographe. Youssoupov répondit que
c'était sa femme (qui était absente) qui recevait quelques amis.
Puis, ils descen-dirent au sous-sol aménagé au cours de la journée.
Elle séduisit particulièrement Raspoutine. Le prince servit du thé
et quelques gâteaux - ceux qui n'étaient pas empoisonnés - et la
conversation alla bon train. Enfin se présenta le moment de
présenter les gâteaux empoisonnés et le vin. On s'attendait à un
résultat immédiat du cyanure qu'ils contenaient :
«Raspoutine vida plusieurs verres sans la moindre méfiance et avec un contentement visible : Félix restait debout devant lui, observant chacun de ses mouvements et s'attendant à voir le staretz tomber foudroyé d'un moment à l'autre. Mais, au bout de quelques instants, Grigori Efimovitch se leva, fit quelques pas dans la pièce et réclama encore du vin. Félix lui en offrit un verre. Raspoutine le vida cette fois encore sans aucun effet.
Ils étaient tous deux face à face, le prince se désespérait, cherchant à comprendre pourquoi le poison n'avait pas opéré. Le docteur Lazovert s'était-il trompé? Et avait-il apporté une poudre inoffensive au lieu de poison? Ou bien Raspoutine était-il vraiment un être surnaturel? Mais non, cela n'était vraiment pas croyable!
Il regarda Raspoutine fixement et crut lire dans ses yeux une expression de méfiance et de soupçon; alors Youssoupov s'approcha du mur et prit sa guitare. Grigori Efimovitch sourit avec bonheur et lui dit d'un ton suppliant :
- Ah oui! Joue-moi quelque chose de gai! J'aime tellement t'entendre!
Le prince Félix joua donc et chanta, il interpréta quelques mélodies tziganes d'une voix exagérément douce et prenante, et le staretz l'écouta en souriant. Chaque fois que le prince s'arrêtait, il le priait de continuer, et son visage exprimait alors autant de pureté que celui d'un vieillard.
Les autres conspirateurs, réunis dans le cabinet de Youssoupov, commençaient à s'impatienter et ils firent un peu de bruit, comme pour faire comprendre au prince qu'il était temps d'en finir. Raspoutine leva la tête et demanda ce qui se passait en haut.
- Ce sont probablement les amis de ma femme qui s'en vont, répondit Félix gêné.
Mais heureux de trouver un prétexte pour quitter la pièce, il ajouta :
- Je vais monter un instant pour me rendre compte de ce qu'ils font!
Et, se levant vivement, il sortit, avec l'intention d'aller chercher une arme pour tuer le staretz d'un coup de feu, puisque le poison n'avait aucune action.
Raspoutine le regarda partir avec un regard paisible et plein d'affection : il était certain qu'à son retour, Félix reprendrait sa guitare et recommencerait à chanter. Oh! comme cela lui faisait du bien, et qu'il avait donc de plaisir à écouter la voix de ce jeune homme aimable et gracieux» (ibid. pp. 369-370).
Les choses ne se produisirent évidemment pas ainsi :
«Toute la monde fut stupéfait à l'annonce de ce qu'on crut être le résultat d'une résistance surnaturelle du thaumaturge. D'abord, les conjurés décidèrent de descendre tous ensemble pour se jeter sur lui et l'étrangler. Finalement, ils laissèrent Youssoupoff agir seul. Armé du révolver du grand-duc Dimitri, et le cachant derrière son dos, le prince descendit au sous-sol. Le "staretz" paraissait las, mais gardait tous ses esprits. Saisissant le moment où il s'intéressait à une ancienne armoire en ébène, contenant un labyrinthe de petites glaces, qui ornait la pièce, le prince lui conseilla de regarder plutôt un ancien crucifix italien, posé sur ce meuble, "et de dire une prière".
[...] Grigori se tenait debout devant son meurtrier, "immobile et la tête penchée, les yeux fixés sur le crucifix". Youssoupoff visa au cœur et pressa la détente. En poussant "un rugissement sauvage", le "staretz" "s'effondra sur la peau d'ours", étendue devant l'armoire du labyrinthe.
En apparence, le but des conjurés avait été atteint. Tout n'était cependant pas encore fini.
"Au bruit du coup de feu mes amis étaient accourus", poursuit Youssoupoff. "Raspoutine était étendu sur le dos. Au bout de quelques minutes, il cessa de bouger. Le docteur constata que la balle avait traversé la région du cœur. Il n'y avait plus à en douter : Raspoutine était bien mort".
...
Youssoupoff et Pourichkévitch restèrent seuls. À un certain moment, le prince, saisi d'une vague inquiétude, descendit au sous-sol. Grigori gisait toujours à la même place. Sans, comme il le dit lui-même, s'expliquer les raisons de son acte, il secoua violemment le cadavre, qui retomba inanimé. Soudain il vit s'entrouvrir son œil gauche. Quelques instants après, les deux yeux de Raspoutine se fixèrent sur lui "avec une expression de haine satanique". "D'un mouvement brusque et violent", il "bondit sur ses pieds" et se jeta sur son assassin en cherchant à le saisir à la gorge. "Ses yeux sortaient de leurs orbites, le sang coulait de ses lèvres. D'une voix basse et rauque, Raspoutine m'appelait tout le temps par mon nom... Une lutte terrible s'engagea entre nous... Par un effort surhumain, je parvins à me dégager de son étreinte. Il retomba sur le dos râlant affreusement et serrant dans sa main mon épaulette qu'il avait arrachée... Je bondis dans l'escalier en appelant Pourichkévitch qui était demeuré dans mon cabinet de travail".
Et voici comment ce dernier raconte la scène qui s'ensuivit : "Tout à coup j'entendis un cri sauvage, presque inhumain dans lequel je crus reconnaître la voix de Youssoupoff : "Pourichkévitch, tirez, tirez, il est vivant, il s'enfuit!"
"Celui qui poussait ces cris, et qui était effectivement Youssoupoff, grimpa à toutes jambes l'escalier... Dans un état semi-conscient, presque sans me voir, avec un regard d'aliéné, il se précipita vers la porte donnant sur le couloir principal et disparut dans les appartements de ses parents".
Descendu au sous-sol, celui à qui échut la tâche de l'achever vit, par la porte d'entrée restée ouverte, le "staretz" traverser en courant la cour d'honneur du palais. Dans le silence de la nuit, on l'entendait répéter : "Félix, Félix, je dirai tout à la tsarine!" Pourichkévitch tira quatre fois sur lui. Les deux premières balles manquèrent le but. La troisième toucha Grigori au dos; la quatrième à la tête. Il s'effondra près de la grille. Tout indiquait que maintenant il était vraiment mort..."» (M. de Enden. Raspoutine ou la fascination, Paris, Fayard, 1976, pp. 294-296.
Youssoupov
était dans un état de transe. Se refusant à croire que Raspoutine
était définitivement mort, il s'approcha de lui et commença à le
frapper de toute sa force à la  tempe avec une matraque de deux
livres. À grand peine, ses amis réussirent à le ramener, «tout
éclaboussé de sang»
dans le cabinet de travail. Puis, «enve-loppé
dans un épais tissu et solidement ficelé, le corps de Raspoutine
fut transporté dans la voiture personnelle du grand-duc Dimitri,
conduite par le grand-duc lui-même - le docteur Lazovert ayant eu
une défaillance momentanée - jusqu'à l'île de Pétrovski, à
l'extrémité de la capitale. Ayant procédé à la reconnaissance
préalable du terrain, les conjurés avaient, en effet, décidé de
le précipiter, du haut d'un pont, dans une
tempe avec une matraque de deux
livres. À grand peine, ses amis réussirent à le ramener, «tout
éclaboussé de sang»
dans le cabinet de travail. Puis, «enve-loppé
dans un épais tissu et solidement ficelé, le corps de Raspoutine
fut transporté dans la voiture personnelle du grand-duc Dimitri,
conduite par le grand-duc lui-même - le docteur Lazovert ayant eu
une défaillance momentanée - jusqu'à l'île de Pétrovski, à
l'extrémité de la capitale. Ayant procédé à la reconnaissance
préalable du terrain, les conjurés avaient, en effet, décidé de
le précipiter, du haut d'un pont, dans une  trouée qu'ils avaient
repérée dans la glace recouvrant l'un des bras de la Néva.
Prenaient part à l'expédi-tion, en dehors du grand-duc, Soukho-tine,
le docteur Lazovert, Pourichkévitch et l'un des domestiques de
Youssoupoff. On doit attribuer à l'énervement des conjurés les
erreurs qu'ils commirent à ce moment. Ils oublièrent, par exemple,
d'attacher au cadavre les poids qu'ils avaient emmenés avec eux. La
pelisse et les galoches du "staretz" ne furent pas brûlées
comme cela avait été prévu. On les jeta, après le corps, dans la
rivière. Tout cela facilita les recherches et permit de découvrir
le cadavre»
(ibid. pp. 297-298).
trouée qu'ils avaient
repérée dans la glace recouvrant l'un des bras de la Néva.
Prenaient part à l'expédi-tion, en dehors du grand-duc, Soukho-tine,
le docteur Lazovert, Pourichkévitch et l'un des domestiques de
Youssoupoff. On doit attribuer à l'énervement des conjurés les
erreurs qu'ils commirent à ce moment. Ils oublièrent, par exemple,
d'attacher au cadavre les poids qu'ils avaient emmenés avec eux. La
pelisse et les galoches du "staretz" ne furent pas brûlées
comme cela avait été prévu. On les jeta, après le corps, dans la
rivière. Tout cela facilita les recherches et permit de découvrir
le cadavre»
(ibid. pp. 297-298).
En effet, plus tard dans la matinée, les proches de Raspoutine signalèrent sa disparition. L'entourage impérial comprit très vite qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. On retrouva le cadavre le lendemain, 18 décembre :
«Après la découverte du caoutchouc, la police avait fait briser la glace de la Néva au pont Pétrovski, et des plongeurs retrouvèrent le corps. Les bras et les jambes étaient serrés par de grosses cordes, et le cadavre portait de nombreuses traces de blessures. Raspoutine n'était certainement pas mort quand on l'avait jeté à l'eau, car il avait réussi à dégager à moitié une de ses mains, et les poumons étaient pleins d'eau.
Le cadavre fut transporté en grand mystère à l'hospice de Tchéma, où le professeur Kossorotov l'examina. Quand l'impératrice apprit que le corps avait été retrouvé, elle donna l'ordre à la sœur Akouline, cette même nonne que Raspoutine avait guérie au couvent d'Okhtoï, de rendre les derniers devoirs au staretz. Celle-ci passa la nuit près de lui, le lava, l'habilla de linge propre, et lui mit un crucifix dans la main, ainsi qu'une lettre d'adieu de la tsarine :
"Donne-moi la bénédiction, cher martyr, afin qu'elle m'accompagne dans le chemin douloureux que j'ai encore à parcourir ici-bas. Pense aussi à nous dans tes saintes prières! Alexandra".
Tels furent les derniers mots de l'impératrice à l'"Ami"» (R. Fülop-Miller. op. cit. pp. 378-379).
Raspoutine. L'homme qu'on avait empoisonné, révolvérisé, matraqué, étranglé, était mort noyé⏳







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire